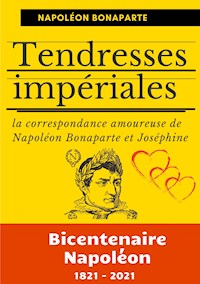Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Mémoires de Napoléon Bonaparte est un ouvrage incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire de France et à la vie de l'empereur Napoléon Ier. Ce livre, écrit par l'empereur lui-même, offre un aperçu fascinant de sa vie, de ses pensées et de ses actions. À travers ses mémoires, Napoléon nous plonge dans les coulisses de son règne, nous dévoilant ses stratégies militaires, ses réflexions politiques et ses relations avec les grandes figures de son époque.
Ce récit autobiographique nous permet de mieux comprendre la personnalité complexe de Napoléon, ainsi que les événements qui ont marqué son règne. De ses premières campagnes militaires à ses conquêtes en Europe, en passant par sa chute et son exil à Sainte-Hélène, l'empereur nous livre ses souvenirs avec une grande lucidité et une plume incisive.
Mémoires de Napoléon Bonaparte est un témoignage historique précieux qui nous offre un éclairage unique sur l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Ce livre captivant nous plonge au cœur de l'épopée napoléonienne et nous permet de revivre les moments forts de cette période mouvementée. Une lecture incontournable pour tous les passionnés d'histoire et les amateurs de biographies historiques.
Extrait : "Je n'écris pas de commentaires : car les événements de mon règne sont assez connus, et je ne suis pas obligé d'alimenter la curiosité publique. Je donne les précis de ces événements, parce que mon caractère et mes intentions peuvent être étrangement défigurés, et je tiens à paraître tel que j'ai été, aux yeux de mon fils comme à ceux de la postérité."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335040418
©Ligaran 2015
Je n’écris pas des commentaires : car les évènements de mon règne sont assez connus, et je ne suis pas obligé d’alimenter la curiosité publique. Je donne le précis de ces évènements, parce que mon caractère et mes intentions peuvent être étrangement défigurés, et je tiens à paraître tel que j’ai été, aux yeux de mon fils comme à ceux de la postérité.
C’est le but de cet écrit. Je suis forcé d’employer une voie détournée pour le faire paraître ; car s’il tombait dans les mains des ministres anglais, je sais, par expérience, qu’il resterait dans leurs bureaux.
Ma vie a été si étonnante, que les admirateurs de mon pouvoir ont pensé que mon enfance même avait été extraordinaire. Ils se sont trompés. Mes premières années n’ont rien eu de singulier. Je notais qu’un enfant obstiné et curieux. Ma première éducation a été pitoyable, comme tout ce qu’on faisait en Corse. J’ai appris assez facilement le français par les militaires de la garnison, avec lesquels je passais mon temps.
Je réussissais dans ce que j’entreprenais parce que je le voulais : mes volontés étaient fortes, et mon caractère décidé. Je n’hésitais jamais ; ce qui m’a donné de l’avantage sur tout le monde. La volonté dépend, au reste, de la trempe de l’individu ; il n’appartient pas à chacun d’être maître chez lui.
Mon esprit me portait à détester les illusions ; j’ai toujours discerné la vérité de plein saut ; c’est pourquoi j’ai toujours vu mieux que d’autres le fond des choses. Le monde a toujours été pour moi dans le fait, et non dans le droit. Aussi n’ai-je ressemblé à peu près à personne. J’ai été par ma nature, toujours isolé.
Je n’ai jamais compris quel serait le parti que je pourrais tirer des études, et dans le fait elles ne m’ont servi qu’à m’apprendre des méthodes. Je n’ai retiré quelque fruit que des mathématiques. Le reste ne m’a été utile à rien : mais j’étudiais par amour propre.
Mes facultés intellectuelles prenaient cependant leur essor, sans que je m’en mêlasse. Elles ne consistaient que dans une grande mobilité des fibres de mon cerveau. Je pensais plus vite que les autres ; en sorte qu’il m’est toujours resté du temps pour réfléchir. C’est en cela qu’a consisté ma profondeur.
Ma tête était trop active pour m’amuser avec les divertissements ordinaires de la jeunesse. Je n’y étais pas totalement étranger ; mais je cherchais ailleurs de quoi m’intéresser. Cette disposition plaçait : dans une espèce de solitude où je ne trouvais que mes propres pensées. Cette manière d’être m’a été habituelle dans toutes les situations de ma vie.
Je me plaisais à résoudre des problèmes : je les cherchais dans les mathématiques ; mais j’en eus bientôt assez, parce que l’ordre matériel est extrêmement borné. Je les cherchai alors dans l’ordre moral : c’est le travail qui m’a le mieux réussi. Cette recherche est devenue chez moi une disposition habituelle. Je lui ai dû les grands pas que j’ai fait faire à la politique et à la guerre.
Ma naissance me destinait au service : c’est pourquoi j’ai été placé dans les écoles militaires. J’obtins une lieutenance au commencement de la révolution. Je n’ai jamais reçu de titre avec autant de plaisir que celui-là. Le comble de mon ambition se bornait alors à porter un jour une épaulette à bouillons sur chacune de mes épaules : un colonel d’artillerie me paraissait le nec plus ultra de la grandeur humaine.
J’étais trop jeune dans ce temps pour mettre de l’intérêt à la politique. Je ne jugeais pas encore de l’homme en masse. Aussi je n’étais ni surpris ni effrayé du désordre qui régnait à cette époque, parce que je n’avais pu la comparer avec aucune autre. Je m’accommodai de ce que je trouvai. Je n’étais pas encore difficile.
On m’employa dans l’armée des Alpes. Cette armée ne faisait rien de ce que doit faire une armée. Elle ne connaissait ni la discipline ni la guerre, j’étais à mauvaise école. Il est vrai que nous n’avions pas d’ennemis à combattre ; nous n’étions chargés que d’empêcher les Piémontais de passer les Alpes, et rien n’était si facile.
L’anarchie régnait dans nos cantonnements : le soldat n’avait aucun respect pour l’officier ; l’officier n’en avait guère pour le général : ceux-ci étaient tous les matins destitués par les représentants du peuple : l’armée n’accordait qu’à ces derniers l’idée du pouvoir, la plus forte sur l’esprit humain. J’ai senti dès lors le danger de l’influence civile sur le militaire, et j’ai su m’en garantir.
Ce n’était pas le talent, mais la loquacité, qui donnait du crédit dans l’armée : tout y dépendait de cette faveur populaire, qu’on obtient par des vociférations.
Je n’ai jamais eu avec la multitude, cette communauté de sentiments qui produit l’éloquence des rues. Je n’ai jamais eu le talent d’émouvoir le peuple. Aussi je ne jouais aucun rôle dans cette armée. J’en avais mieux le temps de réfléchir.
J’étudiais la guerre, non sur le papier, mais sur le terrain. Je me trouvai pour la première fois au feu dans une petite affaire de tirailleurs, du côté du Mont Genêvre. Les balles étaient clairsemées ; elles ne firent que blesser quelques-uns de nos gens. Je n’éprouvai pas d’émotion ; cela n’en valait pas la peine ; j’examinai l’action. Il me parut évident qu’on n’avait des deux côtés aucune intention de donner un résultat à cette fusillade. On se tiraillait seulement pour l’acquit de sa conscience, et parce que c’est l’usage à la guerre. Cette nullité d’objet me déplut ; la résistance me donna de l’humeur : je reconnus notre terrain ; je pris le fusil d’un blessé, et j’engageai un bonhomme de capitaine qui nous commandait de nourrir son feu, pendant que j’irais avec une douzaine d’hommes couper la retraite des Piémontais.
Il m’avait paru facile d’atteindre une hauteur qui dominait leur position, en passant par un bouquet de sapins sur lequel notre gauche s’appuyait. Notre capitaine s’échauffa ; sa troupe gagna du terrain ; elle nous renvoya l’ennemi, et lorsqu’il fut ébranlé, je démasquai mes gens. Notre feu gêna sa retraite ; nous lui fîmes quelques morts, et vingt prisonniers. Le reste se sauva.
J’ai raconté mon premier fait d’armes, non parce qu’il me valut le grade de capitaine, mais parce qu’il m’initia au secret de la guerre. Je m’aperçus qu’il était plus facile qu’on ne croit de battre l’ennemi, et que ce grand art consiste à ne pas tâtonner dans l’action, et surtout à ne tenter que des mouvements décisifs, parce que c’est ainsi qu’on enlève le soldat.
J’avais gagné mes éperons ; je me croyais de l’expérience. D’après cela je me sentis beaucoup d’attrait pour un métier qui me réussissait si bien. Je ne pensai qu’à cela, et je me donnai à résoudre tous les problèmes qu’un champ de bataille peut offrir. J’aurais voulu étudier, aussi la guerre dans les livres, mais je n’en avais point. Je cherchai à me rappeler le peu que j’avais lu dans l’histoire, et je comparais ces récits avec le tableau que j’avais sous les yeux. Je me suis fait ainsi une théorie de la guerre, que le temps a développée, mais n’a jamais démentie.
Je menai cette vie insignifiante jusqu’au siège de Toulon. J’étais alors chef de bataillon, et comme tel je pus avoir quelque influence sur le succès de ce siège.
Jamais armée ne fut plus mal menée que la nôtre. On ne savait qui la commandait. Les généraux ne l’osaient pas, de peur des représentants du peuple : ceux-ci avaient encore plus de peur du comité de salut public. Les commissaires pillaient, les officiers buvaient, les soldats mouraient de faim ; mais ils avaient de l’insouciance et du courage. Ce désordre même leur inspirait plus de bravoure que la discipline. Aussi suis-je resté convaincu que les armées mécaniques ne valent rien : elles nous l’ont prouvé.
Tout se faisait au camp par motions et par acclamations. Cette manière de faire m’était insupportable, mais je ne pouvais pas l’empêcher, et j’allai à mon but sans m’en embarrasser.
J’étais peut-être le seul dans l’armée qui eût un but ; mais mon goût était d’en mettre au bout de tout. Je ne m’occupai que d’examiner la position de l’ennemi et la nôtre. Je comparai ses moyens moraux et les nôtres. Je vis que nous les avions tous, et qu’il n’en avait point. Son expédition était un misérable coup de tête, dont il devait prévoir d’avance la catastrophe, et l’on est bien faible quand on prévoit d’avance sa déroute.
Je cherchai les meilleurs points d’attaque : je jugeai la portée de nos batteries, et j’indiquai les positions où il fallait les placer. Les officiers expérimentés les trouvèrent trop dangereuses, mais on ne gagne pas des batailles avec de l’expérience. Je m’obstinai ; j’exposai mon plan à Barras : il avait été marin : ces braves gens n’entendent rien à la guerre, mais ils ont de l’intrépidité. Barras l’approuva, parce qu’il voulait en finir. D’ailleurs la Convention ne lui demandait pas compte des bras et des jambes, mais du succès.
Mes artilleurs étaient braves, et sans expériences. C’est la meilleure de toutes les dispositions pour las soldats. Nos attaques réussirent : l’ennemi s’intimidait ; il n’osait plus rien tenter contre nous. Il nous envoyait bêtement des boulets, qui tombaient où ils pouvaient, et ne servaient à rien. Les feux que je dirigeais allaient mieux au but. J’y mettais beaucoup de zèle, parce que j’en attendais mon avancement : j’aimais d’ailleurs le succès pour lui-même. Je passais mon temps aux batteries ; je dormais dans nos épaulements. On ne fait bien que ce qu’on fait soi-même. Les prisonniers nous apprenaient que tout allait au diable dans la place. On l’évacua enfin d’une manière effroyable.
Nous avions bien mérité de la patrie. On me fit général de brigade. Je fus employé, dénoncé, destitué, ballotté, par les intrigues et les factions. Je pris en horreur, l’anarchie qui était alors à son comble, et je ne me suis jamais raccommodé avec elle. Ce gouvernement massacreur m’était d’autant plus antipathique qu’il était absurde, et se dévorait lui-même. C’était une révolution perpétuelle, dont les meneurs ne cherchaient pas seulement à s’établir d’une manière permanente.
Général, mais sans emploi, je fus à Paris, parce qu’on ne pouvait en obtenir que là. Je m’attachai à Barras, parce que je n’y connaissais que lui. Robespierre était mort ; Barras jouait un rôle ; il fallait bien m’attacher à quelqu’un et à quelque chose.
L’affaire des sections se préparait : je n’y mettais pas un grand intérêt, parce que je m’occupais moins de politique que de guerre. Je ne pensais pas à jouer un rôle dans cette affaire ; mais Barras me proposa de commander sous lui la force armée contre les insurgés. Je préférais, en qualité de général, d’être à la tête des troupes, plutôt qu’à me jeter rien dans les rangs des sections, où je n’avais rien à faire.
Nous n’avions, pour garder la salle du manège, qu’une poignée d’hommes, et deux pièces de quatre. Une colonne de sectionnaires vint nous attaquer pour son malheur. Je fis mettre le feu à mes pièces, les sectionnaires se sauvèrent ; je les fis suivre ; ils se jetèrent sur les gradins de Saint-Roch. On n’avait pu passer qu’une pièce, tant la rue était étroite. Elle fit feu sur cette cohue, qui se dispersa en laissant quelques morts : le tout fut terminé en dix minutes.
Cet évènement, si petit en lui-même, eut de grandes conséquences : il empêcha la révolution de rétrograder. Je m’attachai naturellement au parti pour lequel je venais de me battre, et je me trouvai lié à la cause de la révolution.
Je commençai à mesurer, et je restai convaincu qu’elle serait victorieuse, parce qu’elle avait pour elle l’opinion, le nombre, et l’audace.
L’affaire des sections m’éleva au grade de général de division, et me valut une sorte de célébrité. Comme le parti vainqueur était inquiet de sa victoire, il me garda à Paris malgré moi ; car, je n’avais d’autre ambition que celle de faire la guerre dans mon nouveau grade.
Je restai donc désœuvré sur le pavé du Paris. Je n’y avais pas de relations ; je n’avais aucune habitude de la société, et je n’allais que dans celle de Barras, où j’étais bien reçu. C’est là que j’ai vu, pour la première fois, ma femme, qui a eu une grande influence sur ma vie, et dont mémoire me sera toujours chère.
Je n’étais pas insensible aux charmes des femmes, mais jusqu’alors elles ne m’avaient pas gâté ; et mon caractère me rendait timide auprès d’elles. Madame de Beauharnais est la première qui m’ait rassuré. Elle m’adressa des choses flatteuses sur mes talents militaires, un jour où je me trouvai placé, auprès d’elle. Cet éloge m’enivra ; je m’adressai continuellement à elle ; je la suivais partout ; j’en étais passionnément amoureux et notre société le savait déjà, que j’étais encore loin d’oser le lui dire.
Mon sentiment s’ébruita ; Barras m’en parla. Je n’avais pas de raisons pour le nier. « En ce cas, » me dit-il, « il faut que vous épousiez madame de Beauharnais. Vous avez un grade et des talents à faire valoir ; mais vous êtes isolé, sans fortune, sans relations ; il faut vous marier ; cela donne de l’aplomb. Madame de Beauharnais est agréable et spirituelle, mais elle est veuve. Cet état ne vaut plus rien aujourd’hui ; les femmes ne jouent plus de rôle ; il faut qu’elles se marient pour avoir de la consistante. Vous avez du caractère ; vous ferez votre chemin ; vous lui convenez ; voulez-vous me charger de cette négociation ? »
J’attendis la réponse avec anxiété. Elle fut favorable : madame de Beauharnais m’accordait sa main, et s’il y a eu des moments de bonheur dans ma vie, c’est à elle que je les ai dus.
Mon attitude dans le monde changea après mon mariage. Il s’était refait, sous le Directoire, une manière d’ordre social dans lequel j’avais pris une place assez élevée. L’ambition devenait raisonnable chez moi : je pouvais aspirer à tout.
En fait d’ambition, je n’en avais pas d’autre que celle d’obtenir un commandement en chef ; car un homme n’est rien, s’il n’est précédé d’une réputation militaire. Je croyais être sûr de faire la mienne, car je me sentais l’instinct la guerre ; mais je n’avais pas de droits fondés pour faire une pareille demande. Il fallait me les donner. Dans ce temps-là ce n’était pas difficile.
L’armée d’Italie était ait rebut, parce qu’on ne l’avait destinée à rien. Je pensai à la mettre en mouvement pour attaquer l’Autriche sur le point où elle avait plus de sécurité, c’est-à-dire en Italie.
Le Directoire était en paix, avec la Prusse et l’Espagne ; mais l’Autriche, soldée par l’Angleterre fortifiait son état militaire, et nous tenait tête sur le Rhin. Il était évident que nous devions faire une diversion en Italie, pour ébranler l’Autriche, pour donner une leçon aux petits princes d’Italie qui s’étaient ligués contre nous ; pour donner, enfin, une couleur décidée à la guerre, qui n’en avait point jusqu’alors.
Ce plan était si simple, il convenait si bien au Directoire, parce qu’il avait besoin de succès pour faire son crédit, que je me hâtai de le présenter, de peur d’être prévenu. Il n’éprouva pas de contradiction, et je fus nommé général en chef de l’armée d’Italie.
Je partis pour la joindre. Elle avait reçu quelques renforts, de l’armée d’Espagne, et je la trouvai forte de cinquante mille hommes, dépourvus de tout, si ce n’est de bonne volonté. J’allais la mettre à l’épreuve. Peu de jours après mon arrivée, j’ordonnai un mouvement général sur toute la ligne. Elle s’étendait de Nice jusqu’à Savone. C’était au commencement d’avril 1796.