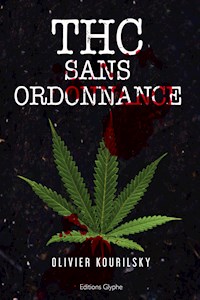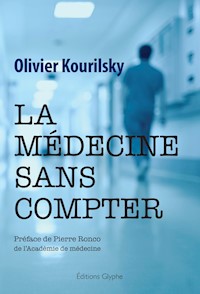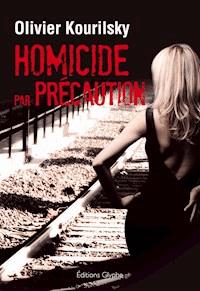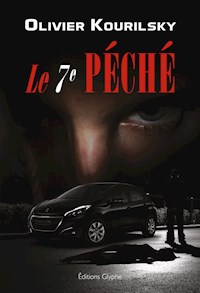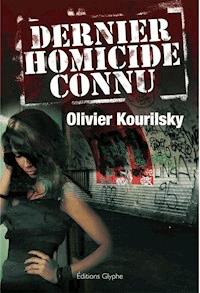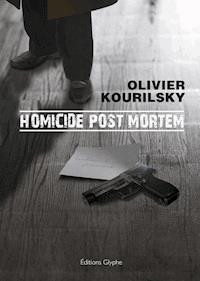Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Glyphe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Polars du DR K
- Sprache: Französisch
Deux intrigues en une pour un polar impossible à lâcher...
Agnès Bourdin cache une blessure profonde. Elle n'a jamais connu son père, mort pendant la guerre d'Algérie.
Dans le service de chirurgie très réputé où elle vient de décrocher un poste, une série d’évènements bizarres trouble le quotidien de l’hôpital. Tandis que chacun suspecte tous les autres, Agnès se penche sur le passé de son père. Quel homme était-il en réalité ? Que s’est-il passé en Algérie ?
D’autres événements secouent le quartier. Un tueur en série, plusieurs peut-être, rôde près de Barbès. Le commissaire Maupas mène les deux enquêtes de front, avec l’aide discrète de son collègue Machefer.
Dans cette intrigue palpitante et humaniste, on retrouve avec plaisir plusieurs protagonistes des deux premiers romans d’Olivier Kourilsky, Meurtre à la morgue et Meurtre avec prémédication, également disponibles en numérique.
EXTRAIT
- Debout là-dedans ! On y va !
Les types se lèvent mécaniquement. Ils avalent leur café en silence et montent dans les camions. Bientôt, ils roulent dans la nuit. L’air est encore frais. Ils tiennent leur fusil entre les genoux.
L’opération a été annoncée la veille. Il faut rechercher des armes dans un village voisin. Et, si possible, retrouver la trace des fellouzes qui ont attaqué une jeep de reconnaissance hier matin. L’assaut a dû être très brutal. Les trois occupants n’ont manifestement pas eu le temps de réagir. Ils ont été criblés de balles, leur armement volé, le véhicule incendié. Nous les connaissions tous bien. L’un d’entre eux était à un mois de la quille… Et le jour précédent, c’est un de nos informateurs, un garçon de dix-neuf ans, qui a été retrouvé égorgé non loin d’ici, le sexe sectionné enfoncé dans la bouche. Le fameux sourire kabyle et l’humiliante castration. Un avertissement. Cette vision d’horreur ne me quitte plus.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Séduite par ce livre et par l'élégance de la plume du Dr K, je n'en ai fait qu'une bouchée … voilà de « bonnes raisons » de le lire ! -
Carine Boulay,
Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Olivier Kourilsky, alias le Docteur K, écrit des romans policiers depuis un peu plus de dix ans. Il s’est rapidement imposé comme une star dans le genre du thriller et fait de fréquentes apparitions dans les médias, soit en tant que maître du polar, soit en sa qualité de médecin néphrologue.
Il est également membre de la Société des gens de lettres et de la Société des auteurs de Normandie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éditions Glyphe
Liste des ouvrages
Du même auteur chez le même éditeur
Le septième péché. (Sortie : Septembre 2014)
Homicide post mortem. 2013
Dernier homicide connu.2011
Homicide par précaution. 2010
Meurtre avec prémédication. 2007
Meurtre à la morgue. 2005
Chez le même éditeur (extrait)
Caroline de Costa. Cloné. 2014
Eric de L’Estoile. L’Effleure du mal. 2013
Philippe Le Douarec. Glaciales glissades. 2013
Jean-Paul Copetti. Pour le repos des morts. 2013
Chris Costantini. Lames de fond. 2013
Louis Raffin. Proteus. 2013
Roger Caporal. Psychose au laboratoire. 2012
Michel Roset. Rue de la crique. 2011
© Éditions Glyphe. Paris, 2014
85, avenue Ledru-Rollin. 75012 Paris
www.editions-glyphe.com
Illustration de couverture : Aurélie Dève
ISBN 978-2-36934-005-8
Pour « Caudie », qui a tant donné pour sauver des vies.
Pour Pierre, celui qui était toujours là.
Pour Jean-Daniel, en souvenir de tout.
Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier.Honoré de Balzac
Quelques scènes de ce roman qui se déroulent à l’époque de la guerre d’Algérie sont (malheureusement) tirées de faits réels. Les exactions atroces du FLN, les représailles massives de l’armée française, l’engrenage terrible de la violence et de la vengeance qui a conduit certains militaires, de jeunes appelés, voire d’anciens résistants (eux-mêmes soumis à la torture à peine quinze ans plus tôt), à commettre des actes qui paraissent inconcevables en temps de paix, ont été rapportés dans des témoignages bouleversants. Ceux-ci ont été notamment publiés dans les livres de Pierre Vidal-Naquet et le remarquable ouvrage de Patrick Rotman (L’ennemi intime, éditions du Seuil). Je me suis librement inspiré de certains d’entre eux.
Note à l’intention du lecteur
Si les personnages et l’intrigue de ce roman sont fictifs, certains souvenirs personnels y sont mêlés.
Ainsi, j’ai été confronté à des actes de sabotage de divers matériels alors que j’étais assistant dans un service de réanimation. Le ou la coupable, qui appartenait forcément à l’équipe, n’a jamais pu être démasqué… Nous avons fait appel à la police pour qu’elle nous interroge tous, et les incidents ont cessé du jour au lendemain. C’est heureusement la seule fois de ma vie où j’ai eu affaire à un comportement pathologique aussi inquiétant de la part d’un soignant !
De même, un de mes patients, transplanté rénal, a développé un abcès à serratia autour de son greffon et a dû être opéré d’urgence un dimanche après-midi en raison d’une hémorragie massive, liée à une brèche vasculaire.
Une partie de ma famille est originaire de Seine-et-Marne, plus précisément de ce joli village de Blandy-les-Tours, que j’encourage chacun à visiter (mais l’action se déroule dans une maison différente de la nôtre !). Et ma cousine par alliance a créé et dirigé le Samu 77 pendant de nombreuses années avec un engagement et un dévouement exceptionnels.
J’étais trop jeune pour faire mon « service militaire » en Algérie, mais des aînés plus ou moins proches y furent appelés (pas dans les conditions décrites dans ce livre !) ; une de mes sœurs y a perdu un ami dans un stupide accident de jeep.
Prologue
1959, en Algérie
– Debout là-dedans ! On y va !
Les types se lèvent mécaniquement. Ils avalent leur café en silence et montent dans les camions. Bientôt, ils roulent dans la nuit. L’air est encore frais. Ils tiennent leur fusil entre les genoux.
L’opération a été annoncée la veille. Il faut rechercher des armes dans un village voisin. Et, si possible, retrouver la trace des fellouzes qui ont attaqué une jeep de reconnaissance hier matin. L’assaut a dû être très brutal. Les trois occupants n’ont manifestement pas eu le temps de réagir. Ils ont été criblés de balles, leur armement volé, le véhicule incendié. Nous les connaissions tous bien. L’un d’entre eux était à un mois de la quille… Et le jour précédent, c’est un de nos informateurs, un garçon de dix-neuf ans, qui a été retrouvé égorgé non loin d’ici, le sexe sectionné enfoncé dans la bouche. Le fameux sourire kabyle et l’humiliante castration. Un avertissement. Cette vision d’horreur ne me quitte plus.
Dans l’aube naissante, je scrute mes voisins. Les visages sont durs, les mâchoires serrées, le regard vide. Le désir de vengeance monte. La haine, brute, nous a envahis, balayant tout autre sentiment. De toute façon, ce village est suspect ; cette fois, les officiers n’auront pas besoin de nous exhorter à trouver où les rebelles cachent leur arsenal.
On nous a déposés à quelques centaines de mètres de l’objectif. Le ciel, très pâle, commence à se colorer. Le jour est proche.
La compagnie se déploie en silence. Grenades à la ceinture, pistolet-mitrailleur sous le bras, fusil à la main. Sensation de puissance mêlée d’angoisse. Des cailloux roulent sous nos rangers. Les chiens aboient.
Le village est maintenant encerclé. Amené devant notre capitaine, le chef assure qu’il n’y a ni fellaghas, ni armes sur place. Comme d’habitude. Les rares Arabes sortis nous regardent avec inquiétude et se dépêchent de rentrer dans leurs gourbis.
Nous pénétrons bruyamment dans les ruelles désertes, ouvrons les portes d’un coup de pied, faisons sortir sans ménagements les femmes et les enfants apeurés, renversons les coffres, les jarres, tout ce qui peut servir de cache.
Soudain, un coup de feu éclate. Un des nôtres s’écroule, son treillis se couvre de sang.
– Ça vient de là, sur la droite !
Les pistolets mitrailleurs crépitent, le tir se concentre sur la mechta où se cachent le ou les rebelles. Les balles éraflent les murs dans tous les sens, déchirent le bois de la porte. Nous balançons des grenades à l’intérieur. Des flammes s’élèvent très haut dans le ciel.
Mon camarade a été tué sur le coup. Je ramasse son MAT 49. Au moment où je me relève, j’entends derrière moi une cavalcade de pieds nus. Je me retourne, lâche une longue rafale. Deux Arabes tombent. J’en descends un autre qui tente de s’enfuir.
C’est le déchaînement. Nous tirons sur tout ce qui bouge, au milieu des cris et des pleurs. Ces salauds nous ont encore menti. Pas de pitié.
Bientôt, le village flambe.
Les femmes s’enfuient, portant leurs petits en bas âge, des enfants courent à leurs côtés. Nous abattons certains de ces fuyards. Un vieillard reste assis par terre, hébété, devant sa maison incendiée.
Dans une des dernières cahutes, je trouve une jeune fille prostrée, accroupie dans un coin. Elle me regarde de ses beaux yeux affolés. Je me rappelle ce que l’adjudant m’a raconté en ricanant. Un officier qui criait à sa section : « Vous pouvez violer, mais faites ça discrètement ! ».
Une brusque pulsion me saisit. Sous la menace de mon couteau, la pointe appuyée contre sa gorge, je l’allonge par terre.
Elle gémit, elle va crier.
– Ferme-la ou je te crève !
Je relève sa gandoura, je me défais prestement.
Je jouis presque tout de suite.
– Fous le camp !
J’ai hésité un instant à la tuer. Je ne sais pas ce qui m’a retenu.
Les véhicules repartent. Tournés vers les ruines du village surmontées par une épaisse fumée, nos treillis collés aux omoplates par la sueur, le visage noirci, nous ne prononçons pas un mot.
Je suis en proie à d’étranges sensations.
La fièvre de l’expédition punitive est retombée, mais je ne ressens aucun remords.
J’ai découvert le plaisir de tuer. De dominer.
Chapitre 1
Paris, novembre 1996
– Bistouri électrique.
Agnès prend l’instrument que lui tend la panseuse, effleure l’extrémité de la pince à coaguler dont les branches enserrent le petit vaisseau, enfonce la pédale « cautérisation ». Un grésillement, une minuscule volute de fumée, une discrète odeur de cochon brûlé. L’artériole cesse de saigner.
– Il ne dort pas du tout !
Le ton est calme, légèrement chantant, mais sans appel. L’imperceptible tressaillement du patient n’a pas échappé à Agnès. Même s’il ne s’agit que d’un réflexe, elle ne tient pas à ce que son opéré se réveille trop tôt. L’intervention n’est pas encore terminée.
Derrière le champ déployé comme une toile de tente au-dessus des épaules et de la tête, Myriam lève les yeux au ciel, histoire de souligner l’exagération du propos, mais injecte aussitôt le contenu de la seringue dans la perfusion. Elle connaît Agnès et aime bien travailler avec elle. De plus, elle n’est pas mécontente de voir une femme faire ses preuves dans ce milieu très masculin qu’est la chirurgie. Et Agnès est impressionnante de calme et d’efficacité.
Bientôt le champ opératoire ne saigne pratiquement plus. Sutures au fil résorbable, drains aspiratifs, agrafes sur la peau.
– Eh bien, merci tout le monde.
L’anesthésiste retire doucement l’appareillage de ventilation, tapote les joues flasques.
– Monsieur Toutrot, réveillez-vous. C’est terminé…
*
La porte du bureau s’ouvrit au moment précis où elle passait devant. On aurait pu croire qu’il la guettait.
– Tout s’est bien passé, Agnès ?
– Pas de problème, Monsieur. C’était bien une occlusion intestinale sur bride. Pas d’autres dégâts, et comme on a pu intervenir très tôt, le colon était encore sain.
– Parfait.
Le professeur Bernard Lambertin portait bien sa soixantaine. Grand, belle carrure, ventre plat entretenu par des heures de musculation au club de sport. Chevelure abondante, noire de jais à l’origine, maintenant poivre et sel, ramenée en arrière pour masquer une tonsure naissante. Quelques rides d’expression, mais une peau encore étonnamment lisse. Des yeux verts fascinants, surtout lorsqu’ils étaient plissés par un sourire que son propriétaire savait irrésistible.
Bien entendu, une réputation de séducteur invétéré le précédait et les rumeurs les plus folles couraient sur ses supposées aventures. Il était cependant difficile de se faire une opinion précise, tant le personnage était discret. Il appréciait manifestement la vue et la compagnie des jolies femmes. Mais il demeurait d’une courtoisie extrême. Jamais on ne pouvait surprendre un geste déplacé ou ambigu. Seul ce regard d’hypnotiseur le trahissait. Beaucoup auraient aimé percer le mystère. Agnès n’était pas insensible à son charme, même s’il avait à peu de choses près l’âge qu’aurait son père.
Son père qu’elle n’avait pas connu. Robert Viral était mort en Algérie début 1960, plusieurs mois avant sa naissance. Stupidement, comme bon nombre d’appelés1. Accident de jeep. Le véhicule s’était renversé sur une piste au cours d’une mission de reconnaissance. Robert, coincé sous son siège, avait eu la nuque brisée.
Une mort sans combat, peu glorieuse. Sa mère avait eu du mal à en faire le deuil. Le seul souvenir qu’Agnès conservait de son père était un album de photos où on le voyait étudiant à Sciences Po, puis engoncé dans son costume de marié aux côtés de sa jeune épouse, enfin en tenue militaire dans le djebel. Souriant, de trois-quarts, le bras appuyé sur la jeep qui allait le tuer quelques jours plus tard.
Sa mère s’était remariée avec Christian Bourdin, un ami d’enfance, alors qu’Agnès n’était pas encore née. Ils avaient eu par la suite deux garçons, Patrick et Michel. Christian avait beau l’avoir toujours considérée comme sa fille (il l’avait officiellement adoptée dès sa naissance), Agnès ressentait cruellement l’absence de ce père dont elle ne connaissait que ces photos en noir et blanc. Après une scolarité difficile et plusieurs redoublements (elle ne fichait rien), elle avait fini par décrocher son bac. Elle s’était alors jetée à corps perdu dans des études de médecine, avait brillamment réussi le concours de l’Internat, et choisi une voie particulièrement difficile pour une femme, la chirurgie viscérale. Pourquoi la médecine ? Pourquoi cette spécialité ? Un défi ? Au nom de quoi ? Elle ne savait pas répondre précisément à ces questions, qu’on lui posait souvent avec plus ou moins de délicatesse.
– Vous partez bientôt ?
La voix chaude de Lambertin la fit sursauter. Elle se retourna.
– Un peu plus tard, je vais faire la contre-visite. Vous aviez besoin de moi ?
– Non, non. Soyez prudente, c’est tout ; le quartier n’est pas très sûr le soir.
– Mais je suis en voiture, répondit-elle, un rien agacée. Et j’ai autre chose à faire que de traîner dans les rues, la nuit tombée.
– Alors, tout va bien. Pas de souci. À demain.
– À demain, Monsieur.
Agnès reprit sa marche dans le couloir tandis que la porte du bureau se refermait sans bruit.
Toujours contrariée. Lambertin ne s’était jamais permis une réflexion empreinte de la moindre misogynie. C’était même un des seuls Patrons qui ne lui avait pas infligé, lorsqu’elle était venue se présenter, un interrogatoire insidieux sur ses motivations. « Curieux pour une femme, quand même. Vous êtes bien sûre de votre choix ? C’est une spécialité physiquement difficile, vous savez. Pas d’horaire, pas de vie de famille. Vous n’avez pas d’enfants ? Vous voudrez en avoir bientôt, sans doute ? » Une des raisons pour lesquelles elle l’appréciait beaucoup. Et voilà qu’il lui sortait ce discours protecteur sur l’insécurité à Barbès. Insécurité qu’elle n’avait, au demeurant, jamais ressentie les rares fois où elle s’y était aventurée. Certes, la foule était dense, multicolore, mais bon enfant et pas menaçante, lui semblait-il.
Aurait-il tenu les mêmes propos aux autres chirurgiens du service, tous de sexe masculin ? Évidemment non. Et il ne le savait peut-être pas, mais Agnès était capable de se défendre. Même si elle n’avait plus beaucoup le temps de fréquenter la salle de sport, elle avait longuement pratiqué l’aïkido et même un peu le karaté. Grande, jolie avec ses cheveux blonds coupés court et ses yeux bleu clair, elle était très féminine. Mais ceux qui avaient voulu l’approcher de trop près, ceux qui l’avaient traitée avec vulgarité, que ce soit dans la rue ou en salle de garde, elle les avait remis à leur place sans ménagement. Quant aux morts dans le quartier… Il y avait toujours eu des bagarres et parfois des règlements de compte entre dealers. Notamment du côté de la rue Doudeauville. On récupérait les blessés aux urgences de Lariboisière. Mais les protagonistes s’en prenaient rarement aux passants.
*
La 205 GTI démarra au quart de tour et Agnès vira sur le boulevard Magenta dans un crissement de pneus. Elle adorait sa petite voiture et le rugissement nerveux de son moteur. Elle remonta vers la place de la République. Il était plus de vingt heures et la circulation était encore chargée.
Agnès réussit à trouver une place tout près de chez elle, rue Jean-Pierre Timbaud. Pas vraiment autorisée, mais comme elle partait le lendemain aux aurores, le risque était minime. Elle entra dans un immeuble ancien qui ne payait pas de mine, monta quatre à quatre les deux étages et se retrouva enfin dans son petit appartement.
Une fois la porte blindée refermée sur un escalier imprégné d’odeurs de cuisine, elle pouvait s’isoler dans son deux-pièces douillet, décoré avec goût. Salle de séjour avec murs blancs, parquet blond, canapé de velours rouge. Télévision et minichaîne en face, cuisine américaine sur le côté. Dans la chambre, un grand lit avec une couette fleurie et une armoire ancienne. Éclairage indirect partout. Salle de bain laquée vert d’eau. Agnès passait peu de temps dans son appartement, mais voulait s’y sentir parfaitement bien.
Elle se servit un verre de Perrier, se laissa tomber dans le canapé et pianota sur sa télécommande. Comme d’habitude, pas grand-chose d’intéressant. Aucun programme ne la tentait. Elle alluma sa chaîne et glissa un disque de Schubert. La jeune fille et la mort. Son quatuor préféré. Pendant que la musique poignante emplissait la pièce, elle passa derrière le bar pour se préparer à manger. Il était près de vingt et une heures et sa journée commençait tôt le lendemain. Avec une intervention lourde : un cancer de l’estomac. Elle en aurait pour toute la matinée.
Agnès ne sortait pas lorsqu’elle devait opérer, quitte à se rattraper les autres soirs. Elle devait être en pleine possession de ses moyens, d’autant que certains ne rateraient aucune occasion de lui faire comprendre que le métier de chirurgien viscéral était trop dur pour une femme… Elle avait bien conscience que sa vie était un peu trop ascétique, mais les folies ne lui manquaient pas trop. Elle aimait la vie hospitalière, ce travail d’équipe, cette chaleur humaine, et même l’ambiance si particulière de l’hôpital les nuits de garde. Bien sûr, il lui était arrivé de céder à la tentation, mais elle évitait de sortir avec des gens du milieu médical. Ses collègues chirurgiens lui paraissaient souvent un peu gamins, et de toute façon, que l’heureux élu soit chirurgien, médecin ou autre, cela faisait trop d’histoires dans le microcosme de la salle de garde.
Alors, sans doute la trouvait-on un peu pimbêche, mais tant pis.
Son dîner avalé, Agnès fila sous la couette et éteignit la lumière. Le sommeil s’empara d’elle très vite.
1. Un pourcentage non négligeable des décès chez les appelés en Algérie est survenu en dehors des combats (accidents de véhicule ou de tir).
Chapitre 2
L’intervention fut longue et difficile, mais Agnès s’en tira bien. La tumeur était encore localisée. Il n’y avait pas d’envahissement. Mohand Bentahar, l’anesthésiste qui était dans sa salle ce matin, était manifestement aux anges. Elle l’aimait bien, même si elle le soupçonnait de nourrir des sentiments troubles à son égard.
Il était presque treize heures lorsqu’elle se rendit aux soins intensifs pour voir son opéré de la veille. Les suites semblaient simples : température inférieure à 37°5, reprise du transit intestinal annoncée par des gaz. On pourrait bientôt retirer l’aspiration.
– Agnès, pourrais-je te dire un mot ?
C’était Pascale, une des infirmières de réa.
– Oui, bien sûr. Qu’y a-t-il ?
– Je préférerais qu’on parle dans un coin tranquille.
Allons bon, encore un conflit, ou des reproches sur un interne ou un anesthésiste. Pourtant, Pascale n’était pas du genre à faire des histoires. Elle travaillait là depuis plusieurs années, et avait un caractère plutôt agréable.
Elles s’isolèrent dans le poste infirmier, momentanément désert.
– Regarde.
Elle lui tendit un tuyau en plastique. L’extrémité était sectionnée net, en biseau.
– C’était la tubulure d’aspiration de monsieur Toutrot. Je l’ai trouvée comme ça en faisant mon tour ce matin.
Agnès eut l’impression que le ciel lui tombait sur la tête. Elle imagina en un instant les conséquences. Cela signifiait que le patient aurait été en danger si l’infirmière, heureusement chevronnée, n’avait pas tout vérifié. Il ne pouvait s’agir d’un accident ou d’un défaut de fabrication. La tubulure avait été sectionnée volontairement, dans le but de nuire. Mais par qui ? L’auteur de cet acte ne pouvait qu’appartenir au personnel du service. À moins d’imaginer un visiteur fou ? Impossible, il n’y avait pas de visites le matin.
Elle croisa le regard de Pascale qui, à l’évidence, s’était fait les mêmes réflexions.
– Merde ! Tu en as parlé à quelqu’un ?
– Non, à personne. Tu imagines l’ambiance…
Agnès imaginait sans difficulté. Suspicion généralisée et obligatoirement injuste pour la plupart, regards en coin…
– Il faut quand même qu’on informe Marie-Christine.
Marie-Christine, la surveillante du service, était une femme solide, affichant toujours un calme impérial au milieu des pires coups de torchon. Approchant la cinquantaine, brune aux yeux bleus, elle était très belle avec son faux air de Françoise Fabian.
Elles attendirent patiemment qu’elle ait terminé un entretien avec une nouvelle infirmière. Agnès espérait qu’elles n’attireraient pas trop l’attention du reste de l’équipe avec leurs airs de conspiratrices.
– Ça, c’est très ennuyeux, dit la surveillante de son ton parfaitement égal. Ne soufflez mot de cette histoire à personne. Je ne sais même pas encore si je vais en parler au Patron. Il est capable de perdre son sang-froid, d’accuser tout le monde et de se mettre l’équipe à dos. Je vais ouvrir l’œil et faire une enquête discrète. Il sera toujours temps d’aviser au cas où il y aurait un nouvel acte similaire.
Agnès s’éclipsa, intriguée. Elle n’était dans le service que depuis deux mois, mais n’avait jamais vu Lambertin, le Patron, dire un mot plus haut que l’autre lorsque quelque chose le contrariait. Il était plutôt du genre colère froide. Son regard vert devenait dur, la voix glaciale. Comme tous les gens apparemment très calmes, il devait exploser en de rares occasions et cela surprenait d’autant plus.
L’après-midi passa très vite. À cause de cet incident, Agnès commença sa consultation avec retard. Elle n’aimait pas faire attendre les patients. Certains manifestaient déjà une réticence non dissimulée lorsqu’ils réalisaient que le chirurgien était une femme. Autrefois, lorsqu’elle était interne, il n’était pas rare qu’on la prenne pour une infirmière… Bien sûr, pour certains, il était inconcevable qu’une jeune femme soit médecin, encore moins chirurgien ! Mais le mélange de douceur et de force qui émanait d’elle inspirait rapidement confiance aux plus endurcis, et la plupart des malades qu’elle prenait en charge ne voulaient plus voir quelqu’un d’autre.
*
Elle quitta l’hôpital à dix-huit heures. Ce soir, elle assisterait à un concert salle Gaveau, avec son amant du moment, un architecte de dix ans son aîné, rencontré lors d’un dîner chez des amis. Une liaison plutôt tranquille, qui lui procurait un peu d’oxygène dans une vie confinée à l’hôpital. Musique, théâtre, cinéma. Parfois ils passaient la nuit ensemble, sans débordements sexuels mémorables. Elle n’en demandait pas plus. Cette relation avec un homme plus mûr lui plaisait. Manque du père ? Elle ne voulait pas se livrer à cette introspection simpliste. Quant à Jacques, récemment divorcé, on sentait bien qu’il n’avait pas envie de se remettre la corde au cou tout de suite. Il avait déjà bien des soucis avec ses deux enfants de douze et quatorze ans, qu’il tenait à accueillir un week-end sur deux.
Agnès sortit du concert enthousiasmée. Ce jeune pianiste italien, Giovanni Bellucci, s’était montré époustouflant, dans un programme mêlant des œuvres de Beethoven et de Liszt. Envahie par un besoin de tendresse, elle prit le bras de Jacques.
– On va dîner à l’Hippo des Champs ? J’ai envie d’une bonne grillade.
– Si tu veux, mais rapidement. J’ai une dure journée demain et je ne voudrais pas me coucher trop tard.
Une dure journée ? Les siennes ne l’étaient pas sans doute ? Il ne s’était manifestement pas posé la question. De toute façon, elle comprit que ce soir, elle rentrerait dormir chez elle. Dommage… Elle aurait bien aimé un petit câlin, mais elle avait horreur de devoir insister. Ce serait pour une autre fois.
*
Toufik se dissimula dans l’encoignure de la porte du 33 bis et prit un air absorbé. Les deux types qui avançaient dans la rue, en jean et blouson de cuir, étaient des flics en civil. Il les avait déjà repérés la semaine précédente. Ils passèrent devant lui sans le regarder et entrèrent d’un pas de propriétaire dans le poste de police situé en face, au 50. Il poussa un soupir de soulagement. Ce n’était pas le moment de se faire prendre avec la marchandise alors que cette petite unité de quartier allait fermer pour la nuit : il était près de vingt heures.
La rue Doudeauville était encore pleine de monde. Il traversa et s’engagea dans la rue Léon, descendant vers les ruelles mal éclairées. Toufik rasait les murs, croisant des groupes bruyants, des noirs et des Maghrébins, des ombres furtives à la tête recouverte d’une capuche. De temps à autre, il se retournait pour s’assurer qu’il n’était pas suivi.
Il bifurqua rue Pierre Budin, passa devant l’école et entra dans un des immeubles lépreux qui se trouvaient un peu plus loin sur la gauche. À peine eut-il refermé la porte qu’une main puissante se plaqua sur sa bouche, l’empêchant d’appeler au secours.
– Prends ça, ordure.
Ce furent les derniers mots qu’il entendit. L’acier pénétra entre ses côtes, déclenchant une douleur aiguë, puis la lame déchira son ventricule gauche et il perdit conscience.
*
– Tiens, il y a eu encore un dealer tué dans le quartier hier soir.
– Tu sais déjà ça, toi ? T’es branchée sur la fréquence radio de la police ou quoi ?
– Tu sais bien que j’habite rue des Poissonniers ; j’ai entendu les sirènes.
– Et évidemment, tu es descendue voir ?
– Ben oui… Il n’était même pas vingt-deux heures. Tu te rends compte ? Ils règlent leurs comptes de plus en plus tôt maintenant !
Pascale riait sous cape malgré la nouvelle plutôt tragique. Sa collègue et néanmoins amie Valérie était toujours à l’affût de tous les faits divers et potins imaginables. Il n’était pas rare de la trouver plongée dans un numéro de France Dimanche ou de Détective emprunté à un malade.
– Bon, il faut que j’aille faire mon tour.
Elle quitta la salle de détente où elles venaient de boire le troisième café de la matinée, passa dans le poste de soins prendre son matériel et se dirigea vers la première chambre.
Dans l’ensemble, les malades allaient bien. Monsieur Toutrot, opéré par Agnès pour une occlusion intestinale sur bride, avait repris son transit. Température presque normale. Il pourrait repasser en salle. Les autres se maintenaient, sauf un patient qui était en chambre isolée, sous respirateur. Celui-là devait être dialysé tout à l’heure. Mohand, l’anesthésiste, viendrait pour le branchement, mais Pascale devait auparavant préparer le matériel et purger le circuit.
Pascale entra dans la chambre et mit en route le générateur. Puis elle commença à monter les lignes du circuit extracorporel.
Elle s’interrompit brusquement. Elle avait les pieds dans l’eau. Il y avait une fuite quelque part.
Le tuyau d’arrivée du liquide de dialyse avait été sectionné.
*
Aujourd’hui, on a amené dans notre local trois rebelles arrêtés dans leur mechta la nuit dernière. Ce sont eux qui ont égorgé les ouvriers musulmans qui travaillaient pour nous. Quatre corps avaient été retrouvés, allongés près du chantier, dans une mare de sang. Manque de pot pour eux, les assassins ont été reconnus par des habitants du village qui les ont dénoncés. P.C. m’a laissé assister à l’interrogatoire. Ils se sont vite mis à table. La gégène a fait merveille…
Ce soir, on les a emmenés en dehors du camp. Je pensais qu’on allait les abattre au pistolet-mitrailleur, mais P.C. m’a retenu.
– Tu veux que le bruit ameute tout le monde ?
On les a égorgés et on a abandonné leurs cadavres dans un champ.
Chapitre 3
– Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Pourquoi m’en parle-t-on seulement aujourd’hui ? C’est très grave ! On me prend pour un con ou quoi ? Quelqu’un cherche à me nuire et on ne me tient même pas au courant !
Le professeur Lambertin, d’ordinaire si courtois, était hors de lui. Agnès ne l’avait jamais vu dans cet état et n’en menait pas large. Pascale ne semblait guère rassurée non plus. Heureusement que le bureau du Patron était bien insonorisé !
– Ne vous mettez pas en colère, Monsieur. C’est moi qui leur ai demandé de ne rien dire à personne. Je ne voulais pas vous inquiéter. De toute façon, vous savez bien que vous avez une équipe remarquable, à qui rien n’échappe : la preuve. S’il y a un cinglé parmi nous, il faut jouer serré pour le démasquer.
Le flegme communicatif de Marie-Christine finit par exercer son effet. Lambertin ne sembla pas s’offusquer du ton discrètement autoritaire de sa surveillante et reprit d’un ton plus calme :
– Vous n’avez aucune piste ?
– Malheureusement, Monsieur, ça ne peut être que quelqu’un du personnel. Les visites sont restreintes dans cette salle, et les actes de sabotage n’ont pas été faits au hasard. Il s’agit probablement d’une personne un peu déséquilibrée. Je ne suis pas certaine qu’on cherche à vous nuire, comme vous le disiez. Cela dit, il va être très difficile de découvrir le coupable, à moins de le prendre en flagrant délit. Nous sommes nombreux à aller et venir dans le secteur. Quand on sait comment s’y prendre, il ne faut que quelques secondes pour sectionner discrètement un tuyau.
Une fois de plus, Agnès était impressionnée par l’assurance de Marie-Christine, qui contredisait son Patron sans insolence aucune, mais avec une parfaite tranquillité. Secrètement désireuse de retrouver les bonnes grâces de Lambertin, elle prit la parole.
– J’ai peut-être une idée.
– Je vous écoute.
– Ne pourrait-on pas avertir la police et lui suggérer d’interroger tous les membres du personnel, un à un ? Y compris nous bien sûr. Elle peut trouver des indices et démasquer le ou la coupable, surtout s’il panique. Et même si elle ne trouve pas, l’enquête peut lui faire peur et l’inciter à s’arrêter.
Lambertin réfléchit un instant.
– Après tout, pourquoi pas ? Cela ne coûte rien d’essayer. Je vais appeler la PJ au Quai des Orfèvres et…
– Monsieur, intervint Marie-Christine, je pense qu’il serait préférable de saisir le commissariat central, rue de Clignancourt. C’est la procédure normale. De plus, le commissaire Maupas connaît bien le service. Vous l’avez opéré d’un ulcère perforé l’an dernier. Il est astucieux, il appréhendera rapidement le contexte.
– Le fait qu’il ait séjourné ici en tant que malade ne risque-t-il pas d’affaiblir son autorité ?
– Je ne crois pas. Il s’était rétabli rapidement et il ne s’est pas montré familier avec le personnel. Mais il avait l’œil vif ; on voyait bien qu’il était attentif à tout ce qui se passait. Déformation professionnelle sans doute…