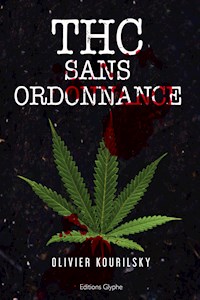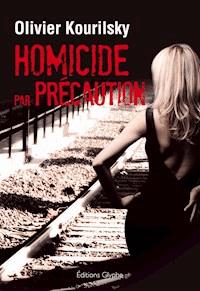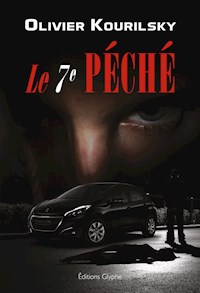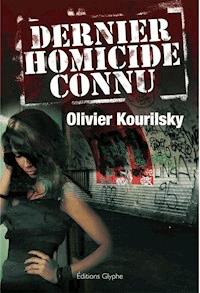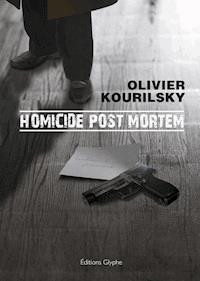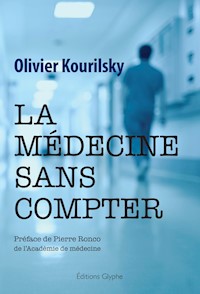
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Glyphe
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Un retour sur la vie du docteur K mêlé de réflexions sur le monde hospitalier.
Dernier né d’une famille de six enfants comportant déjà quatre médecins, Olivier Kourilsky a ressenti très tôt la vocation médicale. Élève du professeur Jean Hamburger, puis assistant du professeur Gabriel Richet pendant une dizaine d’années, il a été nommé à 37 ans chef de service de néphrologie dans un hôpital qui sortait de terre à Évry et l’a dirigé avec enthousiasme pendant près de trente ans. Déjà auteur de plusieurs livres de médecine, mais aussi de romans policiers, le Dr K nous livre ici, avec une bonne dose d’autodérision et d’humour, un florilège d’anecdotes, drôles ou bouleversantes mais toujours pleines d’empathie, glanées tout au long d’une riche carrière. Olivier Kourilsky établit un constat alarmant sur l’évolution de la médecine hospitalière. Un vibrant plaidoyer pour une médecine humaine plus à l’écoute du patient et moins obnubilée par la maîtrise des dépenses.
Sous forme de mémoire, Olivier Kourilsky, alias le Docteur K, livre un témoignage passionnant sur sa vie et sa vision de la médecine et du monde particulier des hôpitaux.
EXTRAIT
J’AI NEUF ANS DEPUIS DEUX MOIS ; je termine ma 7e au lycée Janson de Sailly avec le prix d’excellence et suis couvert de premiers prix (ce sera la seule fois de ma vie !). Lors de la cérémonie, je croule sous une pyramide de livres. Une magnifique journée. Mais, non loin de moi, un garçon sanglote dans les bras de sa maman. Je vais demander ce qui se passe ; la mère m’explique qu’il n’a eu aucun prix. Ému aux larmes, je sors un livre de ma pile et je cours lui donner. Je ne supporte déjà pas de voir les autres souffrir. Entendre un enfant pleurer me bouleverse. Il me faudra plus tard lutter contre cette sensibilité sans perdre la compassion indispensable à mon métier.
À dix ans, mon plus grand bonheur est de suivre mes parents à l’hôpital Saint-Antoine quand je n’ai pas classe. Tout le service me connaît bien sûr, et le garçon de laboratoire, Monsieur Serrurier, m’a installé au sous-sol un espace avec quelques éprouvettes et tubes à essai, dénommé pompeusement laboratoire, pour que je joue au savant ! Je rencontre régulièrement les collaborateurs de mon père, j’allais dire les membres de la grande famille du service : Guy Decroix, René Pierron, Guy-André Voisin, Alain Barré et tant d’autres…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Olivier Kourilsky, alias le Docteur K, est médecin néphrologue, professeur honoraire au Collège de médecine des Hôpitaux de Paris ; il a dirigé le service de néphrologie du Centre Hospitalier Sud-Francilien
Il écrit des romans policiers depuis un peu plus de dix ans et a publié six ouvrages depuis 2005, dont
Meurtre pour de bonnes raisons, prix Littré 2010. Ses personnages évoluent souvent dans le monde hospitalier, entre les années soixante et aujourd’hui. Au fil du temps, on suit le professeur Banari, le commissaire Maupas, le commandant Chaudron, jeune policière chef de groupe à la Crim’…
Olivier Kourilsky est membre de la Société des gens de lettres et de la Société des auteurs de Normandie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes parents, dont le regard et le sourire m’accompagnent tous les jours
À ma famille, et en particulier à Françoise, François ainsi qu’à Anne-Marie, Pierre et Catherine qui nous ont déjà quittés
Pour Grégory et Douanglattana
Et pour Séraphin, afin qu’il connaisse un jour une des vies de son grand-père !
Pour Sophie, qui me supporte depuis si longtemps ! et pour Valéry-Rose, Gustave et Blue
Pour mes cinq filleuls, et mes filleuls de cœur !
À Mademoiselle
À celles et ceux qui ont partagé mes aventures hospitalières au quotidien
Aux malades que nous avons tenté d’aider dans leur combat
Et à la mémoire de Gabriel Richet
Préface
CE LIVRE RACONTE UNE ÉPOPÉE, celle d’un médecin nourri de culture académique, chef d’un service de néphrologie réputé proche de Paris, récemment « retraité ». C’est effectivement une véritable épopée médicale racontée avec un grand talent, qui commence peu après la naissance de la néphrologie et se poursuit dans les milieux médicaux et universitaires parisiens, anglais et franciliens. C’est surtout une véritable épopée du cœur et de l’amitié dans laquelle le patient malade devient le patient ami. Ce livre est émaillé des prénoms de ceux qu’Olivier Kourilsky a soignés dans leur corps mais aussi dans leur âme, avec lesquels le médecin est devenu l’ami, c’est un livre de chair et de sang.
« Je n’ai jamais supporté la souffrance des autres », écrit Olivier dans le premier chapitre du livre. Et il ajoute : « J’ai toujours éprouvé beaucoup de bonheur lorsque je parvenais à la soulager, quelles qu’en soient les difficultés, et si je devais refaire ma vie, malgré mon goût pour le cinéma, je ne changerais d’orientation pour rien au monde ». Tout est dit, ou presque. Laissez-vous porter par cette aventure au quotidien, décrite avec simplicité, émotion et empathie.
Le livre pose des questions essentielles sur l’avenir de la médecine et sur les relations à l’autre, profondément façonnées par l’enseignement médical. Il conduit tout naturellement à s’interroger sur la place des Facultés de médecine et de l’Université dans la médecine de demain. La mission d’une Université est à l’évidence la transmission du savoir et la progression des connaissances grâce à la recherche. Il est incontestable que les moyens de transmission ont été profondément transformés par la révolution informatique. Néanmoins, l’enseignement par compagnonnage auprès du malade y garde toute sa place, comme le souligne Olivier Kourilsky dont l’enthousiasme pour l’enseignement des stagiaires a suscité bien des vocations de néphrologues. Aucun moyen d’enseignement ne remplacera la palpation d’un foie, l’auscultation d’un cœur, le contact direct avec le patient qui peut révéler une histoire médicale plus ou moins riche en fonction de la confiance que ce contact inspire. La révélation d’une maladie familiale nécessite souvent beaucoup de diplomatie et d’empathie au-delà des possibilités de la médecine à distance et de celles d’un robot. Il n’y a pas de plus belles illustrations que les anecdotes dont ce livre fourmille.
Il n’y a pas de progrès médical sans innovation. Nous vivons une véritable révolution technologique et il est bien difficile de savoir ce que nous apportera l’avenir. Cette révolution a deux noms : -Omique (génomique, protéomique…) et Bioinformatique. Notre époque est celle de l’explosion des connaissances, qu’elles résultent de l’analyse du génome, de sa transcription, de sa traduction en protéines, et plus récemment de son interaction avec l’environnement, auxquelles s’ajoutent les connaissances du génome des bactéries intestinales qui semblent jouer un rôle important dans certaines maladies. Il en résulte un très grand nombre de données qu’il importe de traiter par des méthodes bioinformatiques puissantes incluant l’intelligence artificielle. C’est ainsi que pourront être découverts et caractérisés de nouveaux biomarqueurs des maladies permettant de préciser le diagnostic, d’affiner le pronostic et de choisir le meilleur traitement dans le cadre d’une médecine de plus en plus personnalisée où les oncologues nous ont montré la voie. Il n’est pas question de dénigrer ici l’apport de l’intelligence artificielle dans le diagnostic des maladies complexes, et en particulier des maladies rares, mais au contraire de la replacer au sein d’un ensemble dont le malade est le centre.
L’exercice médical est-il pour autant devenu purement scientifique ? Sans l’empathie, cette capacité à ressentir les émotions de l’autre et à se mettre à sa place, peut-on faire une bonne médecine, ou tout simplement de la médecine ? Rien ne sert de développer des algorithmes sophistiqués si le recueil de l’information médicale est incomplet ou erroné. A l’évidence des adaptations dans l’enseignement et l’exercice de la médecine sont nécessaires, mais comme le disait le grand maître Lyonnais Jules Traeger à un externe en médecine au cours d’une très belle interview, en parlant du malade : « Lui avez-vous pris la main ? » La fille d’un patient atteint d’un cancer très grave auquel Olivier Kourilsky avait prodigué un message d’espoir, lui avait dit combien son père avait été transformé par ces paroles apaisantes. « Ce n’était pourtant pas grand-chose : s’asseoir tout près, toucher, parler, être là. Bref, être humain », répliqua Olivier.
Olivier Kourilsky souligne la chance qui lui a été offerte d’exercer une spécialité passionnante aux avant-postes de la médecine par les progrès des connaissances, les innovations scientifiques et technologiques, mais aussi par les questions d’éthique qui sont posées quotidiennement avec la dialyse et la greffe. Et pourtant ou peut-être à cause de cela, la néphrologie est de loin la plus jeune des disciplines médicales, née en septembre 1960 sur les rives du lac Léman où elle est portée sur les fonts baptismaux par le premier président de la Société de Néphrologie, Jean Hamburger. Par quelle aberration ou jeu politique, le Prix Nobel de Médecine n’a-t-il pas été attribué à Wilhelm Kolff et Belding Scribner pour leur invention du rein artificiel qui a sauvé des millions de vies de patients insuffisants rénaux ? Olivier Kourilsky a connu la fin de cette période avec le « comité de la hache » où il fallait sélectionner les patients qui pouvaient bénéficier de la dialyse et ceux qui étaient exclus (« trois sur quatre », écrit-il), et un nouveau défi nous est lancé avec le vieillissement de la population malheureusement parfois associé à une perte des capacités cognitives : faut-il dialyser à tout prix ? Olivier nous conte également l’épopée de la transplantation rénale qui a été un progrès majeur dans la prise en charge des patients et dans les développements de l’immunologie. Les problèmes d’éthique sont aujourd’hui au cœur de la transplantation, soulignés par la Déclaration d’Istanbul contre le trafic d’organes et le tourisme de transplantation. Ainsi la néphrologie est-elle un véritable laboratoire de la bioéthique.
Reste-t-il une place pour l’aventure médicale dans le tourbillon de ces progrès fulgurants dont seule la partie visible nous apparaît aujourd’hui ? La carrière d’Olivier Kourilsky nous en donne un vibrant exemple. Du laboratoire de recherche sur le complément (un système de protéines sériques qui joue un rôle très important en immunologie) au Hammersmith Hospital en Angleterre à la création d’un grand service de néphrologie à Evry, que l’aventure a été belle et fructueuse, certes non exempte de frustrations et de déceptions. Ce livre offre l’opportunité de mettre en avant les innombrables difficultés engendrées ces dernières années par des lois tatillonnes et des personnels administratifs parfois condescendants, ou pire méprisants, portés au premier rang par la loi HPST et par la création des pôles dont le principal objectif est la gestion financière sans grande considération pour les malades et leurs besoins. Si l’objectif de contrôle des dépenses est évidemment louable, les injonctions paradoxales dont les médecins et le personnel non médical sont la cible vont souvent à l’encontre de l’objectif recherché.
Il n’y a pas de belle et grande médecine sans désir et sans plaisir. Olivier Kourilsky y fait plusieurs fois allusion à propos de la ruche que constituait le service du professeur Richet à l’hôpital Tenon dans lequel il a passé de nombreuses années. Gabriel, comme on l’appelait (j’ai été son dernier élève), disait au cours d’une interview : « A Tenon, nous travaillions dans la joie ». Et Charles van Ypersele de Strihou, un grand maître de la néphrologie belge, de dire au cours de la même série « Je retrouve aujourd’hui l’enchantement de mes premières années : la vue de globules rouges circulant dans les membranes palmaires de la grenouille quand j’avais 12 ans, le désir d’élucider de nouvelles maladies. Je compatis avec tous ceux qui arrivent le matin à leur travail sans curiosité, sans attentes ». C’était un temps où les heures n’étaient pas comptées, où la dynamique de service hospitalier était grande avec un fort sentiment d’appartenance, où les réglementations draconiennes et parfois castratrices d’aujourd’hui n’existaient pas : elles auraient à coup sûr empêché le développement du rein artificiel et le sauvetage de millions de vies.
La vie d’Olivier Kourilsky illustre magnifiquement cette parole de Louis Pasteur souvent citée par Gabriel Richet : « Qu’elle serait belle et utile l’histoire de la part du cœur dans les progrès de la science » et j’ajouterais : « de la médecine ». Souhaitons aux nombreux jeunes médecins habités par l’espoir de faire des rencontres comme celle d’Olivier Kourilsky et aux lecteurs d’apprécier cette belle aventure humaine.
Professeur Pierre Ronco, de l’Académie nationale de médecine
Extrait de la leçon inaugurale de Raoul Kourilsky,Chaire de clinique médicale, 1958
L’homme que vous avez devant vous s’est voué à la médecine. Son être le plus profond s’exprime à travers elle.
Cette vocation fut précoce et irrésistible […].
Mon père était médecin de campagne dans la plaine de Brie ; ma mère, orpheline, que rien n’avait préparée à ce rôle, l’aidait de toutes ses forces. C’était encore la médecine de Balzac ; le médecin seul avec le drame ; les opérations faites à la ferme. La vie ou la mort se jugeaient sur un retard ou sur une erreur. La responsabilité morale et matérielle était totale.
Les changements prodigieux de ce demi-siècle rendent ce tableau irréel ; telle est pourtant la médecine que j’ai connue, à l’aube de ma vie, dans mon pays natal, maintenant à une heure de Paris.
Sa dureté et son incertitude eussent dû me rebuter. Je fus pris au contraire à la tête et au cœur. Émerveillé de voir éclaircir en quelques instants les problèmes embrouillés de la maladie, j’imaginai que la médecine était un merveilleux accès à la connaissance scientifique et, lorsque je lisais dans les yeux la reconnaissance qui transfigurait les plus antipathiques, je sentais que la médecine était aussi un des plus puissants moyens d’échanger la bonté entre les hommes et de susciter ce mouvement de l’âme vers le bien de l’autre, qu’il est difficile d’acquérir dans la condition humaine.
L’expérience de toute ma vie m’a confirmé dans ces vertus.
Introduction
LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE ? Je pourrais dire, sans prétention, que je suis tombé dedans quand j’étais petit.
Mon père était chef de service à l’hôpital Saint-Antoine. Une salle et un bâtiment de l’hôpital portent aujourd’hui son nom. Il aurait été juste d’y associer le nom de ma mère, médecin elle-même et qui a travaillé toute sa vie à ses côtés. Ils formaient un couple extraordinaire et lumineux. La réussite de mon père n’aurait pas été possible sans elle.
Cet homme discret était un des pionniers du temps plein hospitalier instauré en 1958, à une époque où ce statut suscitait au mieux une ironie grinçante, au pire une franche hostilité : une ambiance difficile à imaginer pour ceux qui n’ont pas vécu cette période ! Toute l’activité des hôpitaux était concentrée le matin. L’après-midi, les médecins partaient exercer dans leur cabinet privé ; les internes assuraient la permanence et la visite des patients en fin de journée.
Mon père fut aussi un des fondateurs de l’association Claude Bernard, dissoute il y a quelques années par la mairie de Paris, qui a permis le développement de la recherche dans les hôpitaux avant la création de l’Inserm (dont une des trois premières unités fut implantée à Saint-Antoine), et un des premiers à insister sur l’importance de la psychologie en médecine (il présida le premier congrès de psychologie médicale en 1964). Il fut membre de l’Académie de médecine (« l’agagadémie » comme il disait parfois, avec cet humour qui lui était familier).
Ma mère, originaire de la Nièvre1, était assistant des hôpitaux dans les années trente, fait assez rare pour une femme à cette époque. Mais, plutôt que de poursuivre une carrière qui s’annonçait brillante, elle préféra travailler aux côtés de son mari, qu’elle avait rencontré lorsqu’elle était externe des hôpitaux, et l’aider à réaliser ses projets. Ceci ne signifie nullement qu’elle était effacée : tous ceux qui l’ont côtoyée pendant ces années peuvent en témoigner ! Elle ne cherchait pas non plus à jouer le rôle d’éminence grise du Patron. Elle était là, tout simplement. Discrète et efficace, elle protégeait l’emploi du temps compliqué de mon père, et on savait qu’on pouvait lui parler à l’oreille de certains problèmes pour qu’elle aide à les résoudre. D’ailleurs, mon père plaisantait souvent en parlant de ma mère : « Il faudra voir ça avec le gouvernement ! » Simone avait une forte personnalité et ne se laissait guère impressionner par qui que ce soit. Son bon sens hérité de ses racines nivernaises lui a inspiré de savoureuses répliques. Ainsi, à quelqu’un qui se plaignait de ressentir les inconvénients de la vieillesse : « Vous savez, la vieillesse, c’est le seul moyen qu’on ait trouvé pour vivre longtemps ! ». Ou, lorsque des amis qui venaient de perdre un proche reconnaissaient que les paroles d’un prêtre leur avaient apporté du réconfort : « Ah ! mais c’est qu’on n’a encore rien trouvé de mieux. »
*
Mes parents étaient donc ensemble toute la journée, à l’hôpital comme à la maison, sans jamais se disputer. Nous étions six enfants, et la cellule familiale a toujours été un lieu de chaleur, d’affection, d’amour, d’épanouissement, malgré des personnalités forcément différentes ! Et les liens entre nous demeurent toujours aussi forts : une réussite de plus à porter à leur crédit. Je reste impressionné par la présence qu’ils ont su assurer dans leur foyer malgré un travail si prenant et leurs six rejetons plutôt remuants.
L’appartement, d’une taille permettant de loger toute la tribu, était ouvert à tous, amis, cousins et cousines. Un de mes cousins habitant en Amérique est resté plusieurs années pour passer son bac en France. Il en a gardé un souvenir indélébile et il est devenu le petit frère que je n’ai pas eu !
Les six enfants ont fait des études supérieures dont les parents étaient très fiers2… Il faut dire que tout était fait pour nous faciliter le travail, y compris un suivi serré ! Il était impossible de ne pas tenter de réussir dans cette ambiance, studieuse mais joyeuse. Quant au petit dernier (votre serviteur), il bénéficiait des « avantages sociaux » acquis par les aînés et souvent de leur aide (sans compter la protection de « Mademoiselle », à la fois nounou et majordome restée plus de vingt ans chez mes parents)…
Nous avions aussi des réunions familiales bruyantes avec nos cousins et cousines. Il faut dire que, malgré notre nom exotique, nous sommes très liés à la Seine-et-Marne. Mon grand-père, Mottel Kourilsky, est arrivé d’Odessa en 1889 avec quelques camarades et a fait ses études de médecine en France. Une affiche dans la salle des pas perdus de la Faculté a alors attiré son attention : « Le Châtelet-en-Brie cherche médecin ». On mettait à la disposition de l’heureux volontaire une calèche et des chevaux (cette incitation revient à la mode !). Il s’est donc installé comme médecin de campagne dans la Brie et a rencontré au cours de ses tournées une jeune orpheline élevée par son oncle et sa tante à Blandy-les-Tours, quelques kilomètres plus loin. Il l’épousa à l’église. Un document atteste que Mottel, devenu Michel, abjura la religion orthodoxe (qu’il n’avait sûrement jamais embrassée), et mon père naquit en 1899 à Bombon, un village voisin, où le docteur Michel Kourilsky habitait une maison qui existe toujours. Deux autres enfants sont nés ensuite, Raymond et Andrée. Mobilisé pendant la Grande Guerre, Mottel est mort en 1917 de maladie. En 1941, mon père a acheté une maison toute proche de celle de sa mère à Blandy ; les deux bâtiments communiquaient par un clos à l’arrière, ce qui permettait aux nombreux cousins et cousines un accès permanent et libre d’une maison à l’autre.
Les attaches briardes se sont trouvées renforcées par le mariage de ma tante Andrée avec Alfred Porta, qui appartenait à une famille très connue à Melun. Enfin, je serais incomplet si je n’ajoutais pas qu’il existe une rue Raoul Kourilsky à Blandy. Un drame a été évité de justesse le 18 août 1944 grâce à l’intervention de mon père, collé au mur avec une cinquantaine d’autres otages.3
*
J’ai conscience d’avoir eu une enfance privilégiée sur le plan matériel. Et je ne tire aucune gloire d’avoir gravi certains échelons très tôt ; je sais à qui je dois cette précocité apparente. Mes parents avaient quarante-six et quarante-trois ans lorsque je suis né. Ils étaient obsédés à l’idée qu’il puisse leur arriver quelque chose avant que j’aie « le pied à l’étrier ». Après avoir sauté deux classes au début de ma scolarité, je suis donc entré en Math Élem à quinze ans, et j’ai dû obtenir une dispense du rectorat pour passer mon bac à seize ans (avec des notes très moyennes d’ailleurs !). À cet âge, les années comptent beaucoup, le hiatus avec mes camarades de dix-huit à dix-neuf ans était important. Et comme j’ai eu la chance (je dis bien la chance) d’être reçu à mon premier concours d’internat, ce qui était rare à l’époque, je me suis retrouvé interne des hôpitaux à vingt-deux ans – et très immature !
Mais je suis fier de ce que j’ai réalisé plus tard au nouvel hôpital d’Évry qui sortait de terre : développer ex nihilo un service hospitalier avec toutes les facettes de la néphrologie moderne, et construire une équipe unie et énergique, attentive aux patients, dans une ambiance quasi familiale et plutôt gaie ! La bonne humeur est favorable au moral et à la guérison. Plusieurs années après ma retraite hospitalière, médecins et infirmières du service gardent des contacts et se retrouvent avec joie pour des moments riches d’affection. J’ai la sensation d’une véritable famille. Nous nous affublons de surnoms. J’appelle une infirmière très attentive au respect des procédures « Mon recommandé AR préféré », une autre « Belle des îles »… Quant à moi, c’est « Le tank Sherman », « Goldfinger », « Maître » (carrément ironique), ou plus simplement « Chef », voire « Chefounet » ou « Papy Kourilsky » ! Au cours de ces trente ans, j’ai aussi noué de solides amitiés avec des collègues et des élèves dont j’ai pu suivre la carrière.
Trois des six enfants Kourilsky sont devenus médecins. Je fus le troisième. Le virus m’avait contaminé très tôt. Dès l’âge de dix ans, j’accompagnais mes parents à l’hôpital : je m’y sentais chez moi ! C’est dire à quel point j’étais atteint… Il peut paraître suranné aujourd’hui, voire ridicule, de parler de vocation. Pourtant, c’est ce que j’ai toujours ressenti au fond de moi. Je n’ai jamais supporté la souffrance des autres, j’ai toujours éprouvé beaucoup de bonheur lorsque je parvenais à la soulager, quelles que soient les difficultés, et si je devais refaire ma vie, malgré mon goût pour le cinéma, je ne changerais d’orientation pour rien au monde ! Je n’ai pas une virgule à retirer au magnifique texte que j’ai cité au début de ce livre. Mon père a réussi à associer une médecine profondément humaine à une exigence scientifique rigoureuse. Chaque fois que j’ai l’impression de bien faire mon métier, j’ai une pensée pour mes parents, qui m’ont montré l’exemple de la médecine avec un grand M.
En cinquante ans de médecine hospitalière, on engrange quantité de souvenirs, parfois bouleversants, parfois drôles. Je me suis toujours refusé à me livrer à cet exercice. Voilà que j’y cède. Le besoin de partager mon expérience ? La pratique de la médecine change très vite au XXIe siècle. L’envie m’a pris de témoigner d’histoires que j’ai vécues à une époque maintenant révolue (les avortements clandestins, la naissance de la dialyse et des premières greffes, les journées sans fin et les nuits à l’hôpital, etc.).4
Comme tout un chacun, j’ai fait des erreurs, j’ai commis des maladresses. Je m’en veux encore. J’ai aussi lié des relations très fortes avec certains patients que je connais depuis plus de trente ans. Ils m’ont énormément appris. Beaucoup d’entre eux m’ont donné des exemples de courage inouï, et m’ont fait de véritables leçons de vie.
Ce métier est le plus beau du monde si on l’exerce avec son cœur. Sinon, mieux vaut choisir une autre voie ! Ceux qui font ce métier sans amour ne savent pas à côté de quelles joies ils passent et n’en ressentent que plus durement ses contraintes.5 Je dis volontiers en plaisantant à mon ami d’enfance prêtre que la médecine est le moyen le plus facile pour mettre en pratique le commandement du Christ. L’humour permet souvent d’exprimer ce que l’on pense avec une légèreté apparente.
Un fil conducteur important pour exercer humainement la médecine humaine est d’essayer de se mettre à la place des autres. J’invite ici les lecteurs à la même démarche : un petit voyage aux côtés d’un médecin qui a consacré sa vie à l’hôpital, comme d’autres l’ont fait à leur cabinet médical. Que mes lecteurs sachent, malgré les nombreuses critiques qu’il est de bon ton d’adresser en ce moment au milieu médical, que beaucoup d’entre nous, médecins et soignants, sont pleinement dévoués à leur métier.
1. Son père, ancien ouvrier, avait gravi peu à peu l’échelle sociale pour devenir directeur technique d’Hispano Suiza !
2. De ce point de vue, l’hérédité familiale est assez lourde : Ma sœur Françoise, maître assistant à la Sorbonne, a fondé et dirigé la compagnie théâtrale Ubu à new York pendant trente ans, mon frère François, médecin et chercheur, a dirigé le centre de Marseille Luminy avant d’être vice-président du Conseil supérieur de la technologie et de la recherche, puis directeur général du CNRS pendant six ans, ma sœur Marie-Thérèse, après Sciences Po, a été inspectrice générale de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales), ma sœur Elisabeth professeur d’endocrinologie, mon frère Philippe, polytechnicien, professeur au Collège de France, a dirigé l’institut Pasteur pendant six ans. Et chez les cousins et cousines, les études poussées étaient aussi la règle.
3. J’ai raconté cette histoire dans une nouvelle intitulée La Fracture, qui a été publiée avec la réédition de mon premier roman policier, Meurtre à la morgue.
4. Je n’ai cité aucun nom de patient afin de préserver le secret médical et j’ai demandé, dans toute la mesure du possible, leur autorisation aux personnes concernées.
5. Et l’exercice de la médecine devient de plus en plus encadré, pesant et difficile (voir Épilogue).
1 Au lycée
J’AI NEUF ANS DEPUIS DEUX MOIS ; je termine ma 7e au lycée Janson de Sailly avec le prix d’excellence et suis couvert de premiers prix (ce sera la seule fois de ma vie !). Lors de la cérémonie, je croule sous une pyramide de livres. Une magnifique journée. Mais, non loin de moi, un garçon sanglote dans les bras de sa maman. Je vais demander ce qui se passe ; la mère m’explique qu’il n’a eu aucun prix. Ému aux larmes, je sors un livre de ma pile et je cours lui donner. Je ne supporte déjà pas de voir les autres souffrir. Entendre un enfant pleurer me bouleverse. Il me faudra plus tard lutter contre cette sensibilité sans perdre la compassion indispensable à mon métier.
*
À dix ans, mon plus grand bonheur est de suivre mes parents à l’hôpital Saint-Antoine quand je n’ai pas classe. Tout le service me connaît bien sûr, et le garçon de laboratoire, Monsieur Serrurier, m’a installé au sous-sol un espace avec quelques éprouvettes et tubes à essai, dénommé pompeusement laboratoire, pour que je joue au savant ! Je rencontre régulièrement les collaborateurs de mon père, j’allais dire les membres de la grande famille du service1 : Guy Decroix, René Pierron, Guy-André Voisin, Alain Barré et tant d’autres…
Ce jour-là, je trottine derrière ma mère dans les couloirs du pavillon Grancher.2 Elle s’arrête pour saluer les uns et les autres, un petit mot pour chacun, avec ce mélange de douceur et de fermeté rassurante qui la caractérise. Mon attention est attirée par un malade qui la regarde comme si elle était le Bon Dieu.
Dès que nous sommes un peu éloignés, je lui dis avec admiration :
– Maman, tu as vu comment il te regardait le monsieur ? Il t’aime !
– Mon petit, tu verras (car elle ne doutait déjà pas que j’embrasse la carrière médicale), dans ce métier, il y a des moments très difficiles, mais tous les jours tu as une joie comme celle-là.
J’ai pu vérifier la justesse de cette remarque tout au long de ma vie de médecin.
Qu’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas dans mon esprit ni dans le sien du plaisir ambigu de se sentir admiré, mais bien de l’échange d’amour entre les êtres humains, parfois si difficile à entretenir.
*
Cet autre jour, j’accompagne encore ma mère à l’hôpital. Lorsqu’elle arrive, la surveillante l’interpelle :
– Madame Kourilsky, il y a un problème. Monsieur M. (un agent hospitalier) n’est pas venu prendre son service. Il est chez lui, en pleine dépression. Sa femme l’a quitté, il ne veut pas se soigner.
– Comment ça ? rugit ma mère. On y va !
Et nous voilà partis dans la 2 CV maternelle, conduite de façon fort dangereuse par sa propriétaire, dans les petites rues qui bordent l’hôpital Saint-Antoine, maman et la surveillante devant, moi sur le siège arrière, ravi de l’aventure. Arrivés devant un immeuble vétuste, nous descendons. Ma mère monte l’escalier avec énergie et frappe à la porte d’un appartement. Après un long moment, M. ouvre. Il est en pyjama, les cheveux en friche.
– Laissez-moi tranquille, je ne veux pas bouger d’ici.
– Allez, mon petit (maman avait tendance à appeler toute personne de sept à soixante-dix-sept ans « mon petit »), il faut vous soigner. Venez avec nous, il faut aller à l’hôpital. Vous ne pouvez pas rester comme ça.
– Non, non, je ne veux pas.
La surveillante intervient.
– Voyons, M, écoutez donc Madame Kourilsky, elle s’est déplacée exprès pour venir vous chercher. Venez avec nous.
Monsieur M finit par se laisser faire. Nous repartons à l’hôpital où Simone le fait hospitaliser séance tenante en psychiatrie. Il guérira de son état dépressif sévère et n’oubliera jamais ce coup de pied aux fesses salutaire. Sa reconnaissance s’étendra au gamin qui accompagnait sa mère ce jour-là : des années plus tard, préposé à la barrière d’entrée de l’hôpital, il me laisse à chaque fois entrer sans badge avec un petit salut…
Ce souvenir me rappelle un autre du même registre, plus récent. Un externe de mon patron Gabriel Richet, immobilisé chez lui par une violente crise de colique néphrétique, voit avec stupéfaction son patron débouler dans sa chambre de bonne. Pendant un instant, il pense qu’on vient s’assurer qu’il est bien malade. Mais non : Richet lui demande comment il va et s’il a besoin de quelque chose ! Autres temps, autres mœurs…
*
À cette époque, l’avortement était interdit ; une aide-soignante du service est arrêtée par la police pour avoir aidé une femme à avorter. Mon père se déplace au commissariat pour plaider sa cause et obtient sa libération. J’étais trop jeune pour connaître les détails, mais l’histoire m’avait frappé. Le service de Raoul et Simone (comme les appelaient entre eux certains de leurs élèves) ressemblait à une grande famille, sans paternalisme aucun. La fidélité de leurs collaborateurs, quel que soit leur « grade », m’a toujours frappé.
*
Très vite après la fin de la guerre, mon père tissa des liens avec le Canada (il fut d’ailleurs nommé plus tard professeur honoris causa de l’université de Montréal). Cette collaboration donna lieu à de nombreux échanges et son service accueillit des médecins canadiens à l’accent délicieux.
Un des professeurs canadiens vient passer quelques jours à Paris avec son épouse. À l’époque, l’unité de mesure canadienne était la verge… Présentée au professeur Milliez lors d’un dîner, la dame s’exclame :
– Mas qu’est-ce que vous êtes grand ! Vous faites bien une verge de plus que mon mari !
Une autre fois, la même femme, en visite au Bon Marché, s’adresse au chef de rayon, très digne dans son costume queue-de-pie :
– J’vous d’mande pardon, vous auriez’t’y du poil de singe à la verge ?
Les manteaux en poil de singe étaient très à la mode au Canada… mais le chef de rayon, offusqué, n’a pas compris !
*
Au lycée Janson de Sailly, en Math-Élem à quinze ans, je suis assez gamin à côté de mes camarades dont certains conduisent déjà la voiture de papa… Mon frère Philippe, futur polytechnicien, m’aide avec patience à faire mes devoirs de maths (nous partageons la même chambre). Avec mon ami Alain Decroix, fils d’un fidèle collaborateur de mon père, nous révisons le bac. Nos familles sont très liées et nous nous connaissons depuis la dixième. Parfois, dans la chambre du 6e étage récemment occupée par un cousin Porta, les révisions s’éternisent lorsque nous découvrons, caché dans la cheminée, un paquet de revues osées…
Au cours de cette année, on m’invite à une soirée un peu guindée du XVIe arrondissement. Lorsque je me présente, la maîtresse de maison (dont je tairai le célèbre nom) garde d’autorité ma main dans la sienne et me demande d’un ton soupçonneux :
– Kourilsky, ce n’est pas un peu… israélite, comme nom ?
Interloqué, je balbutie :
– Euh… non, Madame…
De retour à la maison, je me précipite pour demander à mon père :
– Papa, Papa, on m’a demandé si Kourilsky, c’était juif !
Stupeur ! Il entre dans une colère noire :
– Comment ? Qu’est-ce que ça veut dire ? J’ai travaillé pendant la guerre, c’est pas une preuve, ça ? Tu n’as qu’à leur dire !
Je n’ai compris que des années plus tard, lorsque nous avons su que Raoul et Raymond avaient été convoqués par la police allemande pendant l’occupation et sommés de produire leur certificat de baptême. Et comme cela ne suffisait pas, on leur avait réclamé un certificat de non-inscription au rabbinat d’Odessa pour Mottel. Les lois de Pétain étaient passées par là : un seul parent suffisait… Soit les rabbins, connaissant les risques, ont produit un faux certificat, soit le grand-père n’était pas pratiquant, ce qui est l’hypothèse la plus probable. Mon père, mon oncle et ma tante s’étaient empressés d’enterrer ce mauvais souvenir. Toutefois, mon père, catholique pratiquant, fut très tôt au courant de l’existence des camps d’extermination et, après la guerre, nombre de ses collaborateurs étaient juifs. Ce qui faisait dire à certains dans l’hôpital avec un humour que je laisse chacun apprécier à sa juste valeur : « Kourilsky, c’est un service très spécialisé… »
*
À dix ans, ma décision est déjà prise. Je veux être médecin. Je suis le troisième des enfants à choisir cette voie. En vacances, je me promène avec une ridicule petite trousse de secours accrochée à ma ceinture.
Lorsque je suis reçu à mon bac, mon père, toujours honnête jusqu’au bout des ongles, m’emmène marcher dans la campagne près de notre maison. Il veut s’assurer que ma décision est bien mûrie. Les aînés ricanent déjà : « Encore un ? Il y en a déjà deux, ça suffit ! »
– Tu sais, tu pourrais faire Math sup, ou une école d’ingénieur…
Il me décrit d’autres carrières qui me paraissent ennuyeuses !
– Je veux être médecin.
Il s’incline, secrètement ravi de voir un autre de ses enfants se lancer dans ce métier qui est toute sa vie.
1. D’ailleurs, deux cousins de maman, Georges et Monique Develay, travaillent dans le service.
2. Pavillon aujourd’hui disparu, remplacé par le bâtiment axial.
2 À la Fac
JE SUIS ENTRÉ en Faculté au tout début du vent de réformes qui a transformé en profondeur les études médicales : instauration du numerus clausus, concours d’entrée en médecine, modification puis suppression du concours de l’externat, suppression de l’oral de l’internat… J’ai donc souvent connu les dernières versions de certains examens ou concours ou expérimenté les nouvelles.
Ainsi, je commence mes études par un des derniers PCB, le certificat « Physique Chimie Biologie », à La Fac des sciences, remplacé par le barrage du PCEM1 puis du PACES et ses dix à quatorze pour cent de reçus, sélectionnés sur des matières théoriques qui ne leur serviront pas toujours par la suite.
Les cours ont lieu rue Cuvier, en face du jardin des Plantes. Après la difficile année de Math Elem (dans les années soixante, il n’y avait que cinquante pour cent de réussite au Bac…), et les quatre mois de vacances qui m’ont permis de faire des progrès fulgurants (et transitoires) au piano, cette année est pour le moins reposante. Les cinémas du Quartier latin n’ont plus aucun secret pour moi et je me demande encore comment j’ai pu être reçu aux examens. La sélection s’opérait plus tard, lors des concours d’externat et d’internat.
Après le PCB, nous intégrons la nouvelle Fac de médecine rue des Saints-Pères avec ses larges amphithéâtres (où Christian Cabrol nous donne de mémorables cours d’anatomie !) et ses salles de dissection impressionnantes qui, plus tard, serviront de décor à mon premier roman policier.
*
Dès la deuxième année de médecine commencent les stages à l’hôpital. Je choisis d’aller en stage à l’hôpital Saint-Antoine, dans le service de mon père. J’ai envie de voir comment fonctionne le service de plus près, mais en me faisant discret au sein du troupeau de stagiaires !
Le bonheur de cette immersion est à la hauteur de mon attente. L’ambiance dans le service est gaie, familiale. Les malades sont traités avec prévenance bien avant qu’on parle d’humanisation des hôpitaux (qu’on attend encore dans bien des endroits !).
C’est encore l’époque des fameux mandarins, tant décriés, mais la parole reste plutôt libre dans le service. Un jour, mon père reproche en réunion à ses collaborateurs de « ne pas assez travailler ». Guy Decroix lui répond avec son humour habituel :
– Mais Monsieur, vous n’avez aucun mérite, vous aimez travailler. Madame Kourilsky et moi, on n’aime pas ça !
Désarçonné, Raoul choisit d’en rire.
À cette époque, il est encore fréquent de présenter des malades et de lire leur dossier devant le service, stagiaires compris, parfois dans un amphi. Difficile d’imaginer une telle situation aujourd’hui ! À l’hôpital Saint-Antoine, la présentation a lieu dans un mini-amphithéâtre avec seulement quelques gradins, plus intime. J’admire le véritable travail d’hypnotiseur de mon père, qui se lève pour accueillir le patient et cherche à capter son attention pour établir un dialogue singulier afin de lui faire oublier la présence d’une quarantaine de personnes dans la pièce. La présentation en public n’excluait pas le respect. Malheureusement, ce n’était pas toujours le cas dans d’autres services que j’ai fréquentés.
Des psychologues sont intégrés à l’équipe et participent aux présentations. Simone les observe d’un œil soupçonneux, car ils ont tendance à rendre les mères responsables de nombreux désordres psychologiques… !
Un des assistants de mon père, Rodolphe Bydlowski, nous fait répéter le soir avec quelques amis1 des sujets d’externat. Responsable de l’unité de réanimation (il deviendra plus tard psychiatre !), c’est un enseignant passionné et un remarquable pédagogue. Je n’ai jamais oublié certains détails de ses cours.
*
Mon premier contact avec la néphrologie date de cette année 1963. Au fond d’une salle commune (c’était la règle, bien qu’au pavillon Grancher il y eût quelques chambres individuelles), je remarque une jeune fille d’une vingtaine d’années qui se tient dans son lit, demi-assise, le teint pâle, le regard triste. J’interroge l’assistant :
– Monsieur, qu’est-ce qu’elle a, cette jeune fille, près de la fenêtre ?
– Ah oui, elle a une néphrite chronique avec une insuffisance rénale terminale, on ne peut malheureusement rien faire. Elle va mourir.