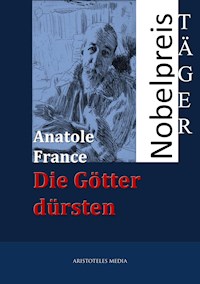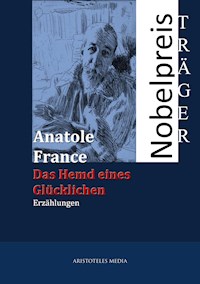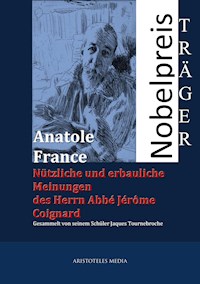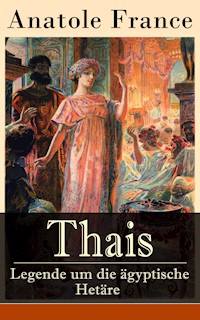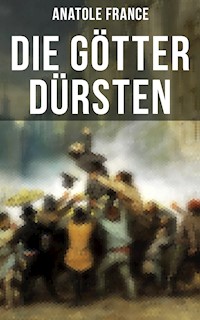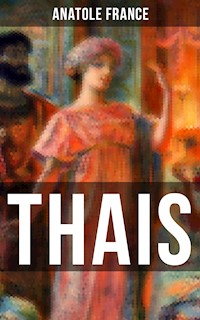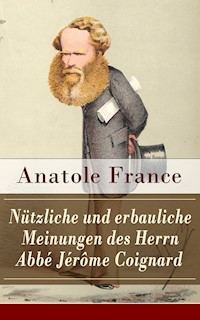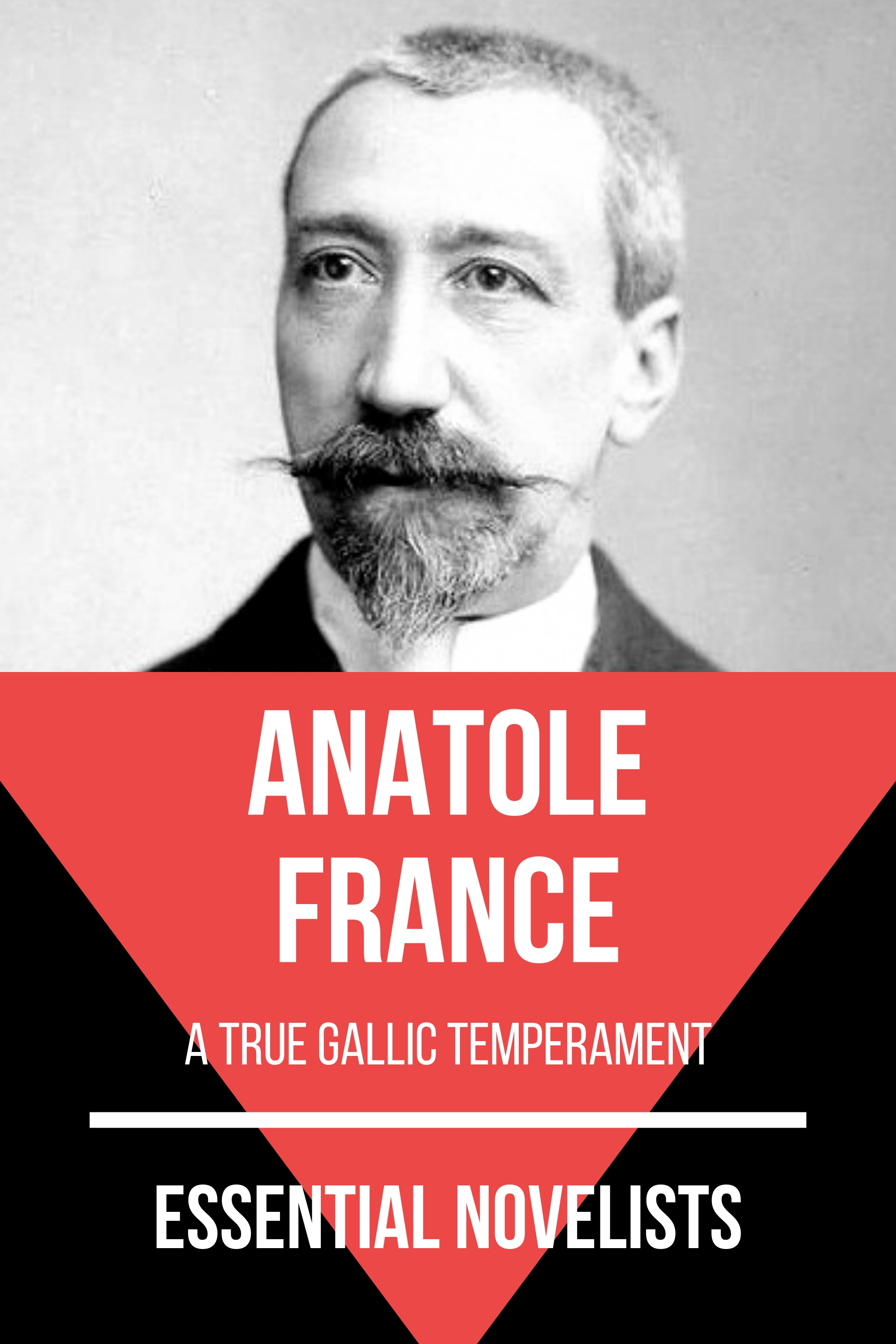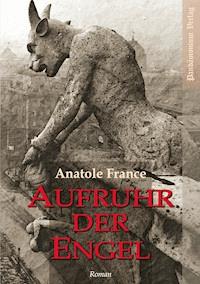Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le hasard ou quelque dieu bienfaisant. à moins que ce ne soit simplement le jeu des hiérarchies universitaires, donne au professeur Bergeret une chaire à Paris. Les rêves de M.Beqrgeret se sont réalisés. Il a gagné la considération de ses pairs et obtenu sa nomination à la Sorbonne. Il s'installe à Paris. La République est encore divisée par l'affaire Dreyfus, affaiblie par le scandale de Panama et agitée par les complots royalistes. Avec sa sérénité coutumière, le sage universitaire traverse cette période fiévreuse en rêvant d'une Cité idéale où l'extinction du paupérisme et l'abolition de la propriété ramèneraient l'âge d'or. En attendant ces temps hypothétiques, il faut se contenter du spectacle éblouissant et dérisoire de cette " Belle Epoque " qu s'achève dans des flonflons de kermesse. L'Exposition universelle a commencé. Les foules se rendent à Longchamp pour acclamer l'armée française. Es français n'ont jamais eu de goût durable pour la tragédie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monsieur Bergeret à Paris
Pages de titreChapitre IChapitre IIChapitre IIIChapitre IVChapitre VChapitre VIChapitre VIIChapitre VIIIChapitre IXChapitre XChapitre XIChapitre XIIChapitre XIIIChapitre XIVChapitre XVChapitre XVIChapitre XVIIChapitre XVIIIChapitre XIXChapitre XXChapitre XXIChapitre XXIIChapitre XXIIIChapitre XXIVChapitre XXVChapitre XXVIChapitre XXVIIPage de copyright1
Monsieur Bergeret à Paris
Anatole France
2
Chapitre I
1
M. Bergeret était à table et prenait son repas modique du soir ;
Riquet était couché à ses pieds sur un coussin de tapisserie. Riquet
avait l’âme religieuse et rendait à l’homme des honneurs divins. Il
tenait son maître pour très bon et très grand. Mais c’est
principalement quand il le voyait à table qu’il concevait la grandeur
et la bonté souveraines de M. Bergeret. Si toutes les choses de la
nourriture lui étaient sensibles et précieuses, les choses de la
nourriture humaine lui étaient augustes. Il vénérait la salle à manger
comme un temple, la table comme un autel. Durant le repas, il
gardait sa place aux pieds du maître, dans le silence et l’immobilité.
— C’est un petit poulet de grain, dit la vieille Angélique en posant
le plat sur la table.
— Eh bien ! veuillez le découper, dit M. Bergeret, inhabile aux
armes, et tout à fait incapable de faire œuvre d’écuyer tranchant.
— Je veux bien, dit Angélique ; mais ce n’est pas aux femmes,
c’est aux messieurs à découper la volaille.
— Je ne sais pas découper.
— Monsieur devrait savoir.
Ces propos n’étaient point nouveaux ; Angélique et son maître les
échangeaient chaque fois qu’une volaille rôtie venait sur la table. Et
ce n’était pas légèrement, ni certes pour épargner sa peine, que la
servante s’obstinait à offrir au maître le couteau à découper, comme
1 Les volumes de l’Histoire contemporaine qui précèdent celuici ont pour titre :
L’Orme du mail. Le Mannequin d’Osier. L’Anneau d’Améthyste.
3
un signe de l’honneur qui lui était dû. Parmi les paysans dont elle
était sortie et chez les petits bourgeois où elle avait servi, il est de
tradition que le soin de découper les pièces appartient au maître. Le
respect des traditions était profond dans son âme fidèle. Elle
n’approuvait pas que M. Bergeret y manquât, qu’il se déchargeât sur
elle d’une fonction magistrale et qu’il n’accomplît pas luimême son
office de table, puisqu’il n’était pas assez grand seigneur pour le
confier à un maître d’hôtel, comme font les Brécé, les Bonmont et
d’autres à la ville ou à la campagne. Elle savait à quoi l’honneur
oblige un bourgeois qui dîne dans sa maison et elle s’efforçait, à
chaque occasion, d’y ramener M. Bergeret.
— Le couteau est fraîchement affûté. Monsieur peut bien lever
une aile. Ce n’est pas difficile de trouver le joint, quand le poulet est
tendre.
— Angélique, veuillez découper cette volaille.
Elle obéit à regret, et alla, un peu confuse, découper le poulet sur
un coin du buffet. À l’endroit de la nourriture humaine, elle avait des
idées plus exactes mais non moins respectueuses que celles de
Riquet.
Cependant M. Bergeret examinait, au dedans de luimême, les
raisons du préjugé qui avait induit cette bonne femme à croire que le
droit de manier le couteau à découper appartient au maître seul. Ces
raisons, il ne les cherchait pas dans un sentiment gracieux et
bienveillant de l’homme se réservant une tâche fatigante et sans
attrait. On observe, en effet, que les travaux les plus pénibles et les
plus dégoûtants du ménage demeurent attribués aux femmes, dans le
cours des âges, par le consentement unanime des peuples. Au
contraire, il rapporta la tradition conservée par la vieille Angélique à
cette antique idée que la chair des animaux, préparée pour la
nourriture de l’homme, est chose si précieuse, que le maître seul peut
et doit la partager et la dispenser. Et il rappela dans son esprit le divin
porcher Eumée recevant dans son étable Ulysse qu’il ne reconnaissait
pas, mais qu’il traitait avec honneur comme un hôte envoyé par Zeus.
« Eumée se leva pour faire les parts, car il avait l’esprit équitable. Il
fit sept parts. Il en consacra une aux Nymphes et à Hermès, fils de
4
Maia, et il donna une des autres à chaque convive. Et il offrit, à son
hôte, pour l’honorer, tout le dos du porc. Et le subtil Ulysse s’en
réjouit et dit à Eumée : — Eumée, puissestu toujours rester cher à
Zeus paternel, pour m’avoir honoré, tel que je suis, de la meilleure
part ! »
Et M. Bergeret, près de cette vieille servante, fille de la terre
nourricière, se sentait ramené aux jours antiques.
— Si monsieur veut se servir ?…
Mais il n’avait pas, ainsi que le divin Ulysse et les rois d’Homère,
une faim héroïque. Et, en dînant, il lisait son journal ouvert sur la
table. C’était là encore une pratique que la servante n’approuvait pas.
— Riquet, veuxtu du poulet ? demanda M. Bergeret. C’est une
chose excellente.
Riquet ne fit point de réponse. Quand il se tenait sous la table,
jamais il ne demandait de nourriture. Les plats, si bonne qu’en fût
l’odeur, il n’en réclamait point sa part. Et même il n’osait toucher à
ce qui lui était offert. Il refusait de manger dans une salle à manger
humaine. M. Bergeret, qui était affectueux et compatissant, aurait eu
plaisir à partager son repas avec son compagnon. Il avait tenté,
d’abord, de lui couler quelques menus morceaux. Il lui avait parlé
obligeamment, mais non sans cette superbe qui trop souvent
accompagne la bienfaisance. Il lui avait dit :
— Lazare, reçois les miettes du bon riche, car pour toi, du moins,
je suis le bon riche.
Mais Riquet avait toujours refusé. La majesté du lieu
l’épouvantait. Et peutêtre aussi avaitil reçu, dans sa condition
passée, des leçons qui l’avaient instruit à respecter les viandes du
maître.
Un jour, M. Bergeret s’était fait plus pressant que de coutume. Il
avait tenu longtemps sous le nez de son ami un morceau de chair
délicieuse. Riquet avait détourné la tête et, sortant de dessous la
nappe, il avait regardé le maître de ses beaux yeux humbles, pleins de
douceur et de reproche, qui disaient :
— Maître, pourquoi me tentestu ?
Et, la queue basse, les pattes fléchies, se traînant sur le ventre en
5
signe d’humilité, il était allé s’asseoir tristement sur son derrière,
contre la porte. Il y était resté tout le temps du repas. Et M. Bergeret
avait admiré la sainte patience de son petit compagnon noir.
Il connaissait donc les sentiments de Riquet. C’est pourquoi il
n’insista pas, cette fois. Il n’ignorait pas d’ailleurs que Riquet, après
le dîner auquel il assistait avec respect, irait manger avidement sa
pâtée, dans la cuisine, sous l’évier, en soufflant et en reniflant tout à
son aise. Rassuré à cet endroit, il reprit le cours de ses pensées.
C’était pour les héros, songeaitil, une grande affaire que de
manger. Homère n’oublie pas de dire que, dans le palais du blond
Ménélas, Étéonteus, fils de Boéthos, coupait les viandes et faisait les
parts. Un roi était digne de louanges quand chacun, à sa table,
recevait sa juste part du bœuf rôti. Ménélas connaissait les usages.
Hélène aux bras blancs faisait la cuisine avec ses servantes. Et
l’illustre Étéonteus coupait les viandes. L’orgueil d’une si noble
fonction reluit encore sur la face glabre de nos maîtres d’hôtel. Nous
tenons au passé par des racines profondes. Mais je n’ai pas faim, je
suis petit mangeur. Et de cela encore Angélique Borniche, cette
femme primitive, me fait un grief. Elle m’estimerait davantage si
j’avais l’appétit d’un Atride ou d’un Bourbon.
M. Bergeret en était à cet endroit de ses réflexions, quand Riquet,
se levant de dessus son coussin, alla aboyer devant la porte.
Cette action était remarquable parce qu’elle était singulière. Cet
animal ne quittait jamais son coussin avant que son maître se fût levé
de sa chaise.
Riquet aboyait depuis quelques instants lorsque la vieille
Angélique, montrant par la porte entr’ouverte un visage bouleversé,
annonça que « ces demoiselles » étaient arrivées. M. Bergeret
comprit qu’elle parlait de Zoé, sa sœur, et de sa fille Pauline qu’il
n’attendait pas si tôt. Mais il savait que sa sœur Zoé avait des façons
brusques et soudaines. Il se leva de table. Cependant Riquet, au bruit
des pas, qui maintenant s’entendaient dans le corridor, poussait de
terribles cris d’alarme. Sa prudence de sauvage, qui avait résisté à
une éducation libérale, l’induisait à croire que tout étranger est un
ennemi. Il flairait pour lors un grand péril, l’épouvantable invasion
6
de la salle à manger, des menaces de ruine et de désolation.
Pauline sauta au cou de son père, qui l’embrassa, sa serviette à la
main, et qui se recula ensuite pour contempler cette jeune fille,
mystérieuse comme toutes les jeunes filles, qu’il ne reconnaissait
plus après un an d’absence, qui lui était à la fois très proche et
presque étrangère, qui lui appartenait par d’obscures origines et qui
lui échappait par la force éclatante de la jeunesse.
— Bonjour, mon papa !
La voix même était changée, devenue moins haute et plus égale.
— Comme tu es grande, ma fille !
Il la trouva gentille avec son nez fin, ses yeux intelligents et sa
bouche moqueuse. Il en éprouva du plaisir. Mais ce plaisir lui fut tout
de suite gâté par cette réflexion qu’on n’est guère tranquille sur la
terre et que les êtres jeunes, en cherchant le bonheur, tentent une
entreprise incertaine et difficile.
Il donna à Zoé un rapide baiser sur chaque joue.
— Tu n’as pas changé, toi, ma bonne Zoé… Je ne vous attendais
pas aujourd’hui. Mais je suis bien content de vous revoir toutes les
deux.
Riquet ne concevait pas que son maître fît à des étrangères un
accueil si familier. Il aurait mieux compris qu’il les chassât avec
violence, mais il était accoutumé à ne pas comprendre toutes les
actions des hommes. Laissant faire à M. Bergeret, il faisait son
devoir. Il aboyait à grands coups pour épouvanter les méchants. Puis
il tirait du fond de sa gueule des grognements de haine et de colère ;
un pli hideux des lèvres découvrait ses dents blanches. Et il menaçait
les ennemis en reculant.
— Tu as un chien, papa ? fit Pauline.
— Vous ne deviez venir que samedi, dit M. Bergeret.
— Tu as reçu ma lettre ? dit Zoé.
— Oui, dit M. Bergeret.
— Non, l’autre.
— Je n’en ai reçu qu’une.
— On ne s’entend pas ici.
Et il est vrai que Riquet lançait ses aboiements de toute la force de
7
son gosier.
— Il y a de la poussière sur le buffet, dit Zoé en y posant son
manchon. Ta bonne n’essuie donc pas ?
Riquet ne put souffrir qu’on s’emparât ainsi du buffet. Soit qu’il
eût une aversion particulière pour mademoiselle Zoé, soit qu’il la
jugeât plus considérable, c’est contre elle qu’il avait poussé le plus
fort de ses aboiements et de ses grognements. Quand il vit qu’elle
mettait la main sur le meuble où l’on renfermait la nourriture
humaine, il haussa à ce point la voix que les verres en résonnèrent sur
la table. Mademoiselle Zoé, se retournant brusquement vers lui, lui
demanda avec ironie :
— Estce que tu veux me manger, toi ?
Et Riquet s’enfuit, épouvanté.
— Estce qu’il est méchant, ton chien, papa ?
— Non. Il est intelligent et il n’est pas méchant.
— Je ne le crois pas intelligent, dit Zoé.
— Il l’est, dit M. Bergeret. Il ne comprend pas toutes nos idées ;
mais nous ne comprenons pas toutes les siennes. Les âmes sont
impénétrables les unes aux autres.
— Toi, Lucien, dit Zoé, tu ne sais pas juger les personnes.
M. Bergeret dit a Pauline :
— Viens, que je te voie un peu. Je ne te reconnais plus.
Et Riquet eut une pensée. Il résolut d’aller trouver, à la cuisine, la
bonne Angélique, de l’avertir, s’il était possible, des troubles qui
désolaient la salle à manger. Il n’espérait plus qu’en elle pour rétablir
l’ordre et chasser les intrus.
— Où astu mis le portrait de notre père ? demanda mademoiselle
Zoé.
— Asseyezvous et mangez, dit M. Bergeret. Il y a du poulet et
diverses autres choses.
— Papa, c’est vrai que nous allons habiter Paris ?
— Le mois prochain, ma fille. Tu en es contente ?
— Oui, papa. Mais je serais contente aussi d’habiter la campagne,
si j’avais un jardin.
Elle s’arrêta de manger du poulet et dit :
8
— Papa, je t’admire. Je suis fière de toi. Tu es un grand homme.
— C’est aussi l’avis de Riquet, le petit chien, dit M. Bergeret.
9
Chapitre II
Le mobilier du professeur fut emballé sous la surveillance de
mademoiselle Zoé, et porté au chemin de fer.
Pendant les jours de déménagement, Riquet errait tristement dans
l’appartement dévasté. Il regardait avec défiance Pauline et Zoé dont
la venue avait précédé de peu de jours le bouleversement de la
demeure naguère si paisible. Les larmes de la vieille Angélique, qui
pleurait toute la journée dans la cuisine, augmentaient sa tristesse.
Ses plus chères habitudes étaient contrariées. Des hommes inconnus,
mal vêtus, injurieux et farouches, troublaient son repos et venaient
jusque dans la cuisine fouler au pied son assiette à pâtée et son bol
d’eau fraîche. Les chaises lui étaient enlevées à mesure qu’il s’y
couchait et les tapis tirés brusquement de dessous son pauvre
derrière, que, dans sa propre maison, il ne savait plus où mettre.
Disons, à son honneur, qu’il avait d’abord tenté de résister. Lors
de l’enlèvement de la fontaine, il avait aboyé furieusement à
l’ennemi. Mais à son appel personne n’était venu. Il ne se sentait
point encouragé, et même, à n’en point douter, il était combattu.
Mademoiselle Zoé lui avait dit sèchement : « Taistoi donc ! » Et
mademoiselle Pauline avait ajouté : « Riquet, tu es ridicule ! »
Renonçant désormais à donner des avertissements inutiles et à
lutter seul pour le bien commun, il déplorait en silence les ruines de
la maison et cherchait vainement de chambre en chambre un peu de
tranquillité. Quand les déménageurs pénétraient dans la pièce où il
s’était réfugié, il se cachait par prudence sous une table ou sous une
commode, qui demeuraient encore. Mais cette précaution lui était
10
plus nuisible qu’utile, car bientôt le meuble s’ébranlait sur lui, se
soulevait, retombait en grondant et menaçait de l’écraser. Il fuyait,
hagard et le poil rebroussé, et gagnait un autre abri, qui n’était pas
plus sûr que le premier.
Et ces incommodités, ces périls même, étaient peu de chose
auprès des peines qu’endurait son cœur. En lui, c’est le moral,
comme on dit, qui était le plus affecté.
Les meubles de l’appartement lui représentaient non des choses
inertes, mais des êtres animés et bienveillants, des génies favorables,
dont le départ présageait de cruels malheurs. Plats, sucriers, poêlons
et casseroles, toutes les divinités de la cuisine ; fauteuils, tapis,
coussins, tous les fétiches du foyer, ses lares et ses dieux
domestiques, s’en étaient allés. Il ne croyait pas qu’un si grand
désastre pût jamais être réparé. Et il en recevait autant de chagrin
qu’en pouvait contenir sa petite âme. Heureusement que, semblable à
l’âme humaine, elle était facile à distraire et prompte à l’oubli des
maux. Durant les longues absences des déménageurs altérés, quand
le balai de la vieille Angélique soulevait l’antique poussière du
parquet, Riquet respirait une odeur de souris, épiait la fuite d’une
araignée, et sa pensée légère en était divertie. Mais il retombait
bientôt dans la tristesse.
Le jour du départ, voyant les choses empirer d’heure en heure, il
se désola. Il lui parut spécialement funeste qu’on empilât le linge
dans de sombres caisses. Pauline, avec un empressement joyeux,
faisait sa malle. Il se détourna d’elle comme si elle accomplissait une
œuvre mauvaise. Et, rencogné au mur, il pensait : « Voilà le pire !
C’est la fin de tout ! » Et, soit qu’il crût que les choses n’étaient plus
quand il ne les voyait plus, soit qu’il évitât seulement un pénible
spectacle, il prit soin de ne pas regarder du côté de Pauline. Le hasard
voulut qu’en allant et venant, elle remarquât l’attitude de Riquet.
Cette attitude, qui était triste, elle la trouva comique et elle se mit à
rire. Et, en riant, elle l’appela : « Viens ! Riquet, viens ! » Mais il ne
bougea pas de son coin et ne tourna pas la tête. Il n’avait pas en ce
moment le cœur à caresser sa jeune maîtresse et, par un secret
instinct, par une sorte de pressentiment, il craignait d’approcher de la
11
malle béante. Pauline l’appela plusieurs fois. Et, comme il ne
répondait pas, elle l’alla prendre et le souleva dans ses bras. « Qu’on
est donc malheureux ! lui ditelle ; qu’on est donc à plaindre ! » Son
ton était ironique. Riquet ne comprenait pas l’ironie. Il restait inerte
et morne dans les bras de Pauline, et il affectait de ne rien voir et de
ne rien entendre. « Riquet, regardemoi ! » Elle fit trois fois cette
objurgation et la fit trois fois en vain. Après quoi, simulant une
violente colère : « Stupide animal, disparais », et elle le jeta dans la
malle, dont elle renversa le couvercle sur lui. À ce moment sa tante
l’ayant appelée, elle sortit de la chambre, laissant Riquet dans la
malle.
Il y éprouvait de vives inquiétudes. Il était à mille lieues de
supposer qu’il avait été mis dans ce coffre par simple jeu et par
badinage. Estimant que sa situation était déjà assez fâcheuse, il
s’efforça de ne point l’aggraver par des démarches inconsidérées.
Aussi demeuratil quelques instants immobile, sans souffler. Puis,
ne se sentant plus menacé d’une nouvelle disgrâce, il jugea
nécessaire d’explorer sa prison ténébreuse. Il tâta avec ses pattes les
jupons et les chemises sur lesquels il avait été si misérablement
précipité, et il chercha quelque issue pour s’échapper. Il s’y
appliquait depuis deux ou trois minutes quand M. Bergeret, qui
s’apprêtait à sortir, l’appela :
— Viens, Riquet, viens ! Nous allons faire nos adieux à Paillot, le
libraire… Viens ! Où estu ? …
La voix de M. Bergeret apporta à Riquet un grand réconfort. Il y
répondait par le bruit de ses pattes qui, dans la malle, grattaient
éperdument la paroi d’osier.
— Où est donc le chien ? demanda M. Bergeret à Pauline, qui
revenait portant une pile de linge.
— Papa, il est dans la malle.
— Pourquoi estil dans la malle ?
— Parce que je l’y ai mis, papa.
M. Bergeret s’approcha de la malle et dit :
— Ainsi l’enfant Comatas, qui soufflait dans sa flûte en gardant
les chèvres de son maître, fût enfermé dans un coffre. Il y fut nourri
12
de miel par les abeilles des Muses. Mais toi, Riquet, tu serais mort de
faim dans cette malle, car tu n’es pas cher aux Muses immortelles.
Ayant ainsi parlé, M. Bergeret délivra son ami. Riquet le suivit
jusqu’à l’antichambre en agitant la queue. Puis une pensée traversa
son esprit. Il rentra dans l’appartement, courut vers Pauline, se dressa
contre les jupes de la jeune fille. Et ce n’est qu’après les avoir
embrassées tumultueusement en signe d’adoration qu’il rejoignit son
maître dans l’escalier. Il aurait cru manquer de sagesse et de religion
en ne donnant pas ces marques d’amour à une personne dont la
puissance l’avait plongé dans une malle profonde.
M. Bergeret trouva la boutique de Paillot triste et laide. Paillot y
était occupé à « appeler », avec son commis, les fournitures de
l’École communale. Ces soins l’empêchèrent de faire au professeur
d’amples adieux. Il n’avait jamais été très expressif ; et il perdait peu
à peu, en vieillissant, l’usage de la parole. Il était las de vendre des
livres, il voyait le métier perdu, et il lui tardait de céder son fonds et
de se retirer dans sa maison de campagne, où il passait tous ses
dimanches.
Bergeret s’enfonça, à sa coutume, dans le coin des bouquins, il
tira du rayon le tome XXXVIII de l’Histoire générale des voyages.
Le livre cette fois encore s’ouvrit entre les pages 212 et 213, et cette
fois encore il lut ces lignes insipides :
« C’est à cet échec, ditil, que nous devons d’avoir pu visiter de
nouveau les îles Sandwich et enrichir notre voyage d’une découverte
qui, bien que la dernière, semble, sous beaucoup de rapports, être la
plus importante que les Européens aient encore faite dans toute
l’étendue de l’Océan Pacifique ». Les heureuses prévisions que
semblaient annoncer ces paroles ne se réalisèrent malheureusement
pas. »
Ces lignes, qu’il lisait pour la centième fois et qui lui rappelaient
tant d’heures de sa vie médiocre et difficile, embellie cependant par
les riches travaux de la pensée, ces lignes dont il n’avait jamais
cherché le sens, le pénétrèrent cette fois de tristesse et de
découragement, comme si elles contenaient un symbole de l’inanité
de toutes nos espérances et l’expression du néant universel. Il ferma
13
le livre, qu’il avait tant de fois ouvert et qu’il ne devait jamais plus
ouvrir, et sortit désolé de la boutique du libraire Paillot.
Sur la place SaintExupère, il donna un dernier regard à la maison
de la reine Marguerite. Les rayons du soleil couchant en frisaient les
poutres historiées, et, dans le jeu violent des lumières et des ombres,
l’écu de Philippe Tricouillard accusait avec orgueil les formes de son
superbe blason, armes parlantes dressées là, comme un exemple et un
reproche, sur cette cité stérile.
Rentré dans la maison démeublée, Riquet frotta de ses pattes les
jambes de son maître, leva sur lui ses beaux yeux affligés ; et son
regard disait :
— Toi, naguère si riche et si puissant, estce que tu serais devenu
pauvre ? estce que tu serais devenu faible, ô mon maître ? Tu laisses
des hommes couverts de haillons vils envahir ton salon, ta chambre à
coucher, ta salle à manger, se ruer sur tes meubles et les traîner
dehors, traîner dans l’escalier ton fauteuil profond, ton fauteuil et le
mien, le fauteuil où nous reposions tous les soirs, et bien souvent le
matin, à côté l’un de l’autre. Je l’ai entendu gémir dans les bras des
hommes mal vêtus, ce fauteuil qui est un grand fétiche et un esprit
bienveillant. Tu ne t’es pas opposé à ces envahisseurs. Si tu n’as plus
aucun des génies qui remplissaient ta demeure, si tu as perdu jusqu’à
ces petites divinités que tu chaussais, le matin, au sortir du lit, ces
pantoufles que je mordillais en jouant, si tu es indigent et misérable,
ô mon maître, que deviendraije ?
— Lucien, nous n’avons pas de temps à perdre, dit Zoé. Le train
part à huit heures et nous n’avons pas encore dîné. Allons dîner à la
gare.
— Demain, tu seras à Paris, dit M. Bergeret à Riquet. C’est une
ville illustre et généreuse. Cette générosité, à vrai dire, n’est point
répartie entre tous ses habitants. Elle se renferme, au contraire, dans
un très petit nombre de citoyens. Mais toute une ville, toute une
nation résident en quelques personnes qui pensent avec plus de force
et de justesse que les autres. Le reste ne compte pas. Ce qu’on
appelle le génie d’une race ne parvient à sa conscience que dans
d’imperceptibles minorités. Ils sont rares en tout lieu les esprits assez
14
libres pour s’affranchir des terreurs vulgaires et découvrir eux
mêmes la vérité voilée.
15
Chapitre III
M. Bergeret, lors de sa venue à Paris, s’était logé, avec sa sœur
Zoé et sa fille Pauline, dans une maison qui allait être démolie et où
il commençait à se plaire depuis qu’il savait qu’il n’y resterait pas.
Ce qu’il ignorait, c’est que, de toute façon, il en serait sorti au même
terme. Mademoiselle Bergeret l’avait résolu dans son cœur. Elle
n’avait pris ce logis que pour se donner le temps d’en trouver un plus
commode et s’était opposée à ce qu’on y fît des frais
d’aménagement.
C’était une maison de la rue de Seine, qui avait bien cent ans, qui
n’avait jamais été jolie et qui était devenue laide en vieillissant. La
porte cochère s’ouvrait humblement sur une cour humide entre la
boutique d’un cordonnier et celle d’un emballeur. M. Bergeret y
logeait au second étage et il avait pour voisin de palier un réparateur
de tableaux, dont la porte laissait voir, en s’entr’ouvrant, de petites
toiles sans cadre autour d’un poêle de faïence, paysages, portraits
anciens et une dormeuse à la chair ambrée, couchée dans un bosquet
sombre, sous un ciel vert. L’escalier, assez clair et tendu aux angles
de toiles d’araignées, avait des degrés de bois garnis de carreaux aux
tournants. On y trouvait, le matin, des feuilles de salade tombées du
filet des ménagères. Rien de cela n’avait un charme pour M.
Bergeret. Pourtant il s’attristait à la pensée de mourir encore à ces
choses, après être mort à tant d’autres, qui n’étaient point précieuses,
mais dont la succession avait formé la trame de sa vie.
Chaque jour, son travail accompli, il s’en allait chercher un logis.
Il pensait demeurer de préférence sur cette rive gauche de la Seine,
16
où son père avait vécu et où il lui semblait qu’on respirât la vie
paisible et les bonnes études. Ce qui rendait ses recherches difficiles,
c’était l’état des voies défoncées, creusées de tranchées profondes et
couvertes de monticules, c’était les quais impraticables et à jamais
défigurés. On sait en effet, qu’en cette année 1899 la face de Paris fut
toute bouleversée, soit que les conditions nouvelles de la vie eussent
rendu nécessaire l’exécution d’un grand nombre de travaux, soit que
l’approche d’une grande foire universelle eût excité, de toutes parts,
des activités démesurées et une soudaine ardeur d’entreprendre. M.
Bergeret s’affligeait de voir que la ville était culbutée, sans qu’il en
comprît suffisamment la nécessité. Mais, comme il était sage, il
essayait de se consoler et de se rassurer par la méditation, et quand il
passait sur son beau quai Malaquais, si cruellement ravagé par des
ingénieurs impitoyables, il plaignait les arbres arrachés et les
bouquinistes chassés, et il songeait, non sans quelque force d’âme :
— J’ai perdu mes amis et voici que tout ce qui me plaisait dans
cette ville, sa paix, sa grâce et sa beauté, ses antiques élégances, son
noble paysage historique, est emporté violemment. Toutefois, il
convient que la raison entreprenne sur le sentiment. Il ne faut pas
s’attarder aux vains regrets du passé ni se plaindre des changements
qui nous importunent, puisque le changement est la condition même
de la vie. Peutêtre ces bouleversements sontils nécessaires, et peut
être fautil que cette ville perde de sa beauté traditionnelle pour que
l’existence du plus grand nombre de ses habitants y devienne moins
pénible et moins dure.
Et M. Bergeret en compagnie des mitrons oisifs et des sergots
indolents, regardait les terrassiers creuser le sol de la rive illustre, et
il se disait encore :
— Je vois ici l’image de la cité future où les plus hauts édifices ne
sont marqués encore que par des creux profonds, ce qui fait croire
aux hommes légers que les ouvriers qui travaillent à l’édification de
cette cité, que nous ne verrons pas, creusent des abîmes, quand en
réalité peutêtre ils élèvent la maison prospère, la demeure de joie et
de paix.
Ainsi M. Bergeret, qui était un homme de bonne volonté,
17
considérait favorablement les travaux de la cité idéale. Il
s’accommodait moins bien des travaux de la cité réelle, se voyant
exposé, à chaque pas, à tomber, par distraction, dans un trou.
Cependant, il cherchait un logis, mais avec fantaisie. Les vieilles
maisons lui plaisaient, parce que leurs pierres avaient pour lui un
langage. La rue GîtleCœur l’attirait particulièrement, et quand il
voyait l’écriteau d’un appartement à louer, à côté d’un mascaron en
clef de voûte, sur une porte d’où l’on découvrait le départ d’une
rampe en fer forgé, il gravissait les montées, accompagné d’une
concierge sordide, dans une odeur infecte, amassée par des siècles de
rats et que réchauffaient, d’étage en étage, les émanations des
cuisines indigentes. Les ateliers de reliure et de cartonnage y
mettaient d’aventure une horrible senteur de colle pourrie. Et M.
Bergeret s’en allait, pris de tristesse et de découragement.
Et rentré chez lui, il exposait, à table, pendant le dîner, à sa sœur
Zoé et à sa fille Pauline, le résultat malheureux de ses recherches.
Mademoiselle Zoé l’écoutait sans trouble. Elle était bien résolue à
chercher et à trouver ellemême. Elle tenait son frère pour un homme
supérieur, mais incapable d’une idée raisonnable dans la pratique de
la vie.
— J’ai visité un logement sur le quai Conti. Je ne sais ce que vous
en penserez toutes deux. On y a vue sur une cour, avec un puits, du
lierre et une statue de Flore, moussue et mutilée, qui n’a plus de tête
et qui continue à tresser une guirlande de roses. J’ai visité aussi un
petit appartement rue de la Chaise ; il donne sur un jardin, où il y a
un grand tilleul, dont une branche, quand les feuilles auront poussé,
entrera dans mon cabinet. Pauline aura une grande chambre, qu’il ne
tiendra qu’à elle de rendre charmante avec quelques mètres de
cretonne à fleurs.
— Et ma chambre ? demanda mademoiselle Zoé. Tu ne t’occupes
jamais de ma chambre. D’ailleurs…
Elle n’acheva pas, tenant peu de compte du rapport que lui faisait
son frère.
— Peutêtre seronsnous obligés de nous loger dans une maison
neuve, dit M. Bergeret, qui était sage et accoutumé à soumettre ses
18
désirs à la raison.
— Je le crains, papa, dit Pauline. Mais sois tranquille, nous te
trouverons un petit arbre qui montera à ta fenêtre ; je te promets.
Elle suivait ces recherches avec bonne humeur, sans s’y intéresser
beaucoup pour ellemême, comme une jeune fille que le changement
n’effraye point, qui sent confusément que sa destinée n’est pas fixée
encore et qui vit dans une sorte d’attente.
— Les maisons neuves, reprit M. Bergeret, sont mieux aménagées
que les vieilles. Mais je ne les aime pas, peutêtre parce que j’y sens
mieux, dans un luxe qu’on peut mesurer, la vulgarité d’une vie
étroite. Non pas que je souffre, même pour vous, de la médiocrité de
mon état. C’est le banal et le commun qui me déplaît… Vous allez
me trouver absurde.
— Oh ! non, papa.
— Dans la maison neuve, ce qui m’est odieux, c’est l’exactitude
des dispositions correspondantes, cette structure trop apparente des
logements qui se voit du dehors. Il y a longtemps que les citadins
vivent les uns sur les autres. Et puisque ta tante ne veut pas entendre
parler d’une maisonnette dans la banlieue, je veux bien
m’accommoder d’un troisième ou d’un quatrième étage, et c’est
pourquoi je ne renonce qu’à regret aux vieilles maisons.
L’irrégularité de celleslà rend plus supportable l’empilement. En
passant dans une rue nouvelle, je me surprends à considérer que cette
superposition de ménages est, dans les bâtisses récentes, d’une
régularité qui la rend ridicule. Ces petites salles à manger, posées
l’une sur l’autre avec le même petit vitrage, et dont les suspensions
de cuivre s’allument à la même heure ; ces cuisines, très petites, avec
le gardemanger sur la cour et des bonnes très sales, et les salons
avec leur piano chacun l’un sur l’autre, la maison neuve enfin me
découvre, par la précision de sa structure, les fonctions quotidiennes
des êtres qu’elle renferme, aussi clairement que si les planchers
étaient de verre ; et ces gens qui dînent l’un sous l’autre, jouent du
piano l’un sous l’autre, se couchent l’un sous l’autre, avec symétrie,
composent, quand on y pense, un spectacle d’un comique humiliant.
— Les locataires n’y songent guère, dit mademoiselle Zoé, qui
19
était bien décidée à s’établir dans une maison neuve.
— C’est vrai, dit Pauline pensive, c’est vrai que c’est comique.
— Je trouve bien, çà et là, des appartements qui me plaisent, reprit
M. Bergeret. Mais le loyer en est d’un prix trop élevé. Cette
expérience me fait douter de la vérité d’un principe établi par un
homme admirable, Fourier, qui assurait que la diversité des goûts est
telle, que les taudis seraient recherchés autant que les palais, si nous
étions en harmonie. Il est vrai que nous ne sommes pas en harmonie.
Car alors nous aurions tous une queue prenante pour nous suspendre
aux arbres. Fourier l’a expressément annoncé. Un homme d’une
bonté égale, le doux prince Kropotkine, nous a assuré plus
récemment que nous aurions un jour pour rien les hôtels des grandes
avenues, que leurs propriétaires abandonneront quand ils ne
trouveront plus de serviteurs pour les entretenir. Ils se feront alors
une joie, dit ce bienveillant prince, de les donner aux bonnes femmes
du peuple qui ne craindront pas d’avoir une cuisine en soussol. En
attendant, la question du logement est ardue et difficile. Zoé, faismoi
le plaisir d’aller voir cet appartement du quai Conti, dont je t’ai parlé.
Il est assez délabré, ayant servi trente ans de dépôt à un fabricant de
produits chimiques. Le propriétaire n’y veut pas faire de réparations,
pensant le louer comme magasin. Les fenêtres sont à tabatière. Mais
on voit de ces fenêtres un mur de lierre, un puits moussu, et une
statue de Flore, sans tête et qui sourit encore. C’est ce qu’on ne
trouve pas facilement à Paris.
20
Chapitre IV
— Il est à louer, dit mademoiselle Zoé Bergeret, arrêtée devant la
porte cochère. Il est à louer, mais nous ne le louerons pas. Il est trop
grand. Et puis…
— Non, nous ne le louerons pas. Mais veuxtu le visiter ? Je suis
curieux de le revoir, dit timidement M. Bergeret à sa sœur.
Ils hésitaient. Il leur semblait qu’en pénétrant sous la voûte
profonde et sombre, ils entraient dans la région des ombres.
Parcourant les rues à la recherche d’un logis, ils avaient traversé
d’aventure cette rue étroite des GrandsAugustins qui a gardé sa
figure de l’ancien régime et dont les pavés gras ne sèchent jamais.
C’est dans une maison de cette rue, il leur en souvenait, qu’ils
avaient passé six années de leur enfance. Leur père, professeur de
l’Université, s’y était établi en 1856, après avoir mené, quatre ans,
une existence errante et précaire, sous un ministre ennemi, qui le
chassait de ville en ville. Et cet appartement où Zoé et Lucien avaient
commencé de respirer le jour et de sentir le goût de la vie était
présentement à louer, au témoignage de l’écriteau battu du vent.
Lorsqu’ils traversèrent l’allée qui passait sous un massif avant
corps, ils éprouvèrent un sentiment inexplicable de tristesse et de
piété. Dans la cour humide se dressaient des murs que les brumes de
la Seine et les pluies moisissaient lentement depuis la minorité de
Louis XIV. Un appentis, qu’on trouvait à droite en entrant, servait de
loge au concierge. Là, à l’embrasure de la portefenêtre, une pie
dansait dans sa cage, et dans la loge, derrière un pot de fleurs, une
femme cousait.
21
— C’est bien le second sur la cour qui est à louer ?
— Oui. Vous voulez le voir ?
— Nous désirons le voir.
La concierge les conduisit, une clef à la main. Ils la suivirent en
silence. La morne antiquité de cette maison reculait dans un
insondable passé les souvenirs que le frère et la sœur retrouvaient sur
ces pierres noircies. Ils montèrent l’escalier de pierre avec une
anxiété douloureuse, et, quand la concierge eut ouvert la porte de