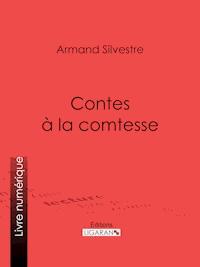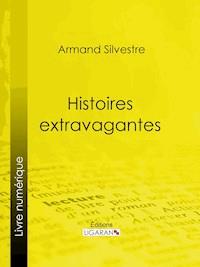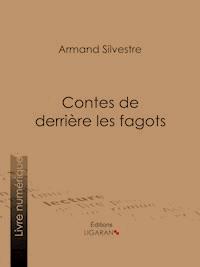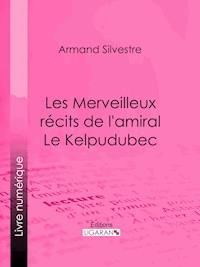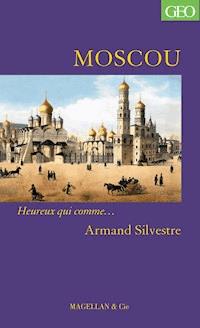
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme...
- Sprache: Französisch
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel.
Des églises du Kremlin aux bistrots borgnes imbibés de vodka, le poète symboliste et libertin Armand Silvestre s’avère un guide passionnant pour découvrir les secrets de la ville aux « sept fois soixante-dix clochers d’or ». Curieux de tout, ébranlé par le spectacle de la piété orthodoxe des moujiks, il passe volontiers des anecdotes les plus cocasses à de belles envolées lyriques.
Récit extrait de La Russie, impressions, portraits, paysages, 1892.
Plongez dans ce portrait poétique de la capitale russe au 19ème siècle
EXTRAIT
Il est quatre heures du matin et il fait aussi jour qu’à midi, sans que la nuit ait duré plus de trois heures. Les derniers tramways circulent et les premiers vont les croiser bientôt, sur leur double voie. Les rues n’ont pas cessé un seul instant d’être pleines de monde. On ne reconnaît pas ceux qui vont se coucher de ceux qui se lèvent. Tous sont également frais et souriants. Quelques buveurs zigzaguent aux bras les uns des autres, affectueusement enlacés et, quand l’un d’eux se heurte au détestable pavé de Moscou, c’est avec une sollicitude infinie que ses compagnons le relèvent, toute la grappe l’ayant quelquefois suivi dans sa chute.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Armand Silvestre (1837-1901) est un écrivain français. Dandy libertin et farceur, auteur reconnu de son vivant, il est surpris – et séduit – par le fanatisme religieux et les marques de piété qu’il constate dans la capitale russe en 1892.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heureux qui comme…
Collection conçue et produite par Marc Wiltzen partenariat avec le magazine GÉO
UN PAÏEN EN SAINTE RUSSIE
Présenté par Charles Stépanoff
« Je garde à Moscou une tendresse filiale, une tendresse qui ne peut avoir son secret que dans de mystérieux atavismes, dans d’étranges métempsycoses. »
Étrange rencontre que celle d’Armand Silvestre, dandy libertin et farceur, fleur toute parisienne, avec les misérables moujiks de Moscou, rampant à genoux, suant la vieille foi orthodoxe dans le labyrinthe des obscures cathédrales du Kremlin. En comparaison, Voltaire serait presque dans son élément au milieu des pèlerins de Sainte-Anne-d’Auray. Que peut faire Silvestre devant ce spectacle de piété sans retenue, ces dévotions puériles, qui ont toujours fait frémir de dédain les voyageurs français depuis le XVIIIe siècle ? Même un abbé comme Chappe d’Auteroche s’était gaussé du « fanatisme » russe. Le plus naturel n’est-il pas de réprouver paternellement, s’esclaffer et tourner les talons ? Silvestre ne se satisfait pas de ces postures faciles. Un peu écœuré d’abord par les « popes crasseux aux chevelures inquiétantes et vaguement zoologiques », il ne se détourne pourtant pas avec un rire narquois, il s’arrête, il se tait, oublie ses dégoûts et admire. Cet instant de surprise est déjà de trop : il croit encore contempler de loin, en esthète ou en ethnologue curieux, mais, bientôt, il l’avoue, le voilà pris par la ferveur de la foule ; ses bras, comme tous les bras qui l’entourent, esquissent le signe de croix « à rebours ». Le voilà pleinement désorienté, même le signe de croix catholique de son enfance toulousaine, de gauche à droite, n’est plus valable ici. Pourtant, fugace illusion de touriste ou non, il se sent réellement frère de cette foule, et la seule explication qu’il trouve à fournir, c’est celle d’une fantaisiste métempsycose, comme si en lui se réveillait, au fond de sa mémoire, quelque babouchka ancestrale pour guider ses gestes et ses émotions.
Couronné de succès en son temps, Armand Silvestre est aujourd’hui bien peu illustre ; il a disparu, au fil des décennies, de tous les dictionnaires. Et c’est d’ailleurs le moindre contraste de la destinée de cet homme, polytechnicien devenu poète et auteur d’opéras, écrivain contrasté dans tous les sens, paradoxal, antithétique, burlesquo-sérieux, farceur tragique aux « mélancolies joyeuses ». Hautain artiste du Parnasse autant qu’amuseur public, antinomique au point d’être soupçonné par certains critiques de schizophrénie, Armand Silvestre livre dans ce Moscou une contradiction supplémentaire, un repli intérieur de sa personnalité foisonnante : une fibre mystique. Lorsqu’il est poète élégant, Silvestre cisèle des vers compliqués et teintés d’une suavité fugace ; bientôt il va plus loin, il pousse le recherché jusqu’au bizarre, passe de l’hermétique au louche, et le voici soudain conteur grivois, développant avec verdeur des historiettes volontiers grosses, voire grossières. Il y a un Armand Silvestre ami de Leconte de Lisle et de Théophile Gautier, sectateur du Parnasse contemporain, qui ne rêve que de « frondaisons blanches qu’avril fait neiger au front des pommiers ». Celui-ci est l’auteur de recueils comme La Vie de l’âme, Les Renaissances, Le Pays des roses, Les Ailes d’or ; il est le poète de :
Le long des flots
La Vierge lente et pâle
Sans trêve exhale
Ses éternels sanglots.
Comme elle, Ô mer
Vierge aux douleurs immense,
Tu recommences ton chant toujours amer.
De ses vers, George Sand écrit : « Ils ont l’accent ému des impressions fortes, et le chantre qui les dit est un artiste éminent, on le voit et on le sent de reste. »
Et il y a l’autre Armand Silvestre, fréquentant Alfred Jarry et Alphonse Allais (qui le qualifie de « conteur à gaz »), épris de « croupes bondissantes », et autres voluptés moins éthérées que les précédentes. Celui-là signe des ouvrages aux titres sans fards : L’Effroi des bégueules, Histoires scandaleuses, Qui lira rira et de nombreux contes : Contes de derrière les fagots, Contes grassouillets, mais aussi salés, audacieux, pantagruéliques et galants, désopilants, irrévérencieux, ou encore gaillards. Les héros en sont « le général Pétenlair de Vertilleul » et « l’amiral Le Kelpudubec ». 1892 est l’année qui résume le mieux les ambiguïtés du personnage : en même temps paraissent La Russie, impressions, portraits, paysages, teinté de mysticisme, Au pays des souvenirs, mémoires empreints de nostalgie où « la fantaisie ne tient aucune place », et Aventures grassouillettes pour prouver que la veine drolatique ne s’est pas tarie. George Sand, préfacier inattendu des Sonnets païens, a bien deviné que les métamorphoses paradoxales de Silvestre n’ont rien d’atermoiements capricieux, mais laissent transparaître la contradiction d’élans profonds. Dans l’œuvre de Silvestre, elle reconnaît « l’enivrement de la matière chez un spiritualiste quand même, qu’on pourrait appeler le spiritualiste malgré lui ». C’est précisément ce spiritualiste malgré lui dont Moscou va irriter jusqu’à l’exaltation la contradiction intime. À Moscou mieux que nulle part ailleurs, il va découvrir un paysage moyenâgeux qui répond à son âme, une spiritualité vivace, presque animale, enracinée dans la matière la plus brute, grouillante, encore suintante d’efforts, primitive, où la prière résonne comme un chant orgiaque.
Intéressé depuis longtemps par la Russie, comme en témoigne un opéra à sujet russe, Dimitri (1876), Armand Silvestre part en 1890 pour la vieille capitale russe « à l’âge où la plus grande partie de la vie appartient déjà au passé », en compagnie d’un dessinateur-caricaturiste, Lanos. Après avoir traversé l’Ukraine dont il admire les paysages en se souvenant de son génial rejeton, Gogol, écrivain tiraillé comme lui entre le rire et le rêve, il visite Saint-Pétersbourg, qui ne lui plaît guère en raison de son style trop occidental, puis prend le train pour Moscou. Dans la capitale spirituelle de l’Empire, il découvre enfin la vraie Russie, et s’y mêle avec une sorte de compréhension faite d’enthousiasme et de pitié. Ce qui ne l’empêche pas d’être attentif à des détails comiques et de raconter avec son talent incomparable d’impayables anecdotes comme celles de sa découverte des bains russes, ou du malheur survenu à son pantalon.
Ce texte de Silvestre, jamais réédité depuis sa première parution, constitue pour le lecteur contemporain le témoignage précieux, attentif, intime, d’un touriste parisien, venu en train pour visiter une ville mythique, qui aujourd’hui n’est plus. « Moscou la Sainte », « ville éperdument orientale », la cité dorée que décrit Silvestre, a été presque entièrement détruite par soixante-dix ans de règne soviétique, moins heureuse en cela que Pétersbourg. Combien restent-ils de ces dizaines de dômes dorés qui éblouissaient Silvestre au sommet de la montagne des Moineaux ? Les églises qui n’ont pas été dynamitées sont enfouies aujourd’hui dans l’ombre des tours gigantesques de l’architecture stalinienne. Le Kremlin lui-même, l’ancien saint des saints de l’orthodoxie, où arrivaient en pèlerinage des fidèles de toute la Russie, le Kremlin n’évoque plus pour nous que le siège d’un pouvoir politique, bureaucratique et obscur. C’est l’un des mérites des descriptions de Silvestre que de repeupler pour nous de leurs masses de pèlerins les cathédrales médiévales qui, transformées plus tard en dépôts de grain ou en musée de l’athéisme, sont encore aujourd’hui, pour la plupart, des murs sans vie où les touristes errent perdus, scrutant les icônes des maîtres comme d’incompréhensibles cartouches pharaoniques.
À la lumière de ce témoignage, c’est avec d’autant plus d’incompréhension que l’on songe à la complaisance des artistes et écrivains français qui apportèrent, trente ans plus tard, leur caution à la démolition du patrimoine religieux de la Russie. Armand Silvestre fut l’un des très rares voyageurs occidentaux qui ont su voir chez les Russes, non un peuple en retard à rééduquer, une argile difforme à remodeler, mais, comme Théophile Gautier ou Pierre Pascal, un mystère vivant qu’on n’approche pas sans modestie, ni quelque maladresse.
Texte extrait de La Russie, impressions, portraits, paysages, 1892L’orthographe des noms a été harmonisée
IAve Moscou
Dans le long paysage qui sépare Saint-Pétersbourg de Moscou, et qui, sans grand accident de terrain, sans rencontre de station vraiment pittoresque, fuit lentement en sens inverse de la marche désespérément modérée du train, rien ne prépare les yeux à l’éblouissement qui les attend, l’esprit à la surprise qui le guette.
C’est seulement quand, de plus loin et comme lassé, le mouvement de la machine s’alanguit comme un essoufflement d’agonie, que, les têtes se passant aux portières, un spectacle absolument féerique et inattendu met comme une angoisse d’admiration dans les poitrines. C’est, à l’horizon et comme à l’infini, un étincellement de dômes s’arrondissant et de tours s’allongeant, carrées avec des toits pointus peints en couleurs éclatantes. C’est comme un coup de vent qui a balayé toutes les brumes, comme un rideau qui se déchire et s’ouvre sur l’Orient.
Tout concourt à nous faire l’illusion plus intense. Durant la nuit du voyage, le ciel s’est éclairci à mesure que nous avancions, une durée d’ombre un peu plus longue permettant aux étoiles de percer l’azur assombri du ciel moins polaire ; en même temps, et par l’effet d’un rayonnement moins intense de la terre échauffée par le jour moins long, la température s’est comme alourdie et une tiédeur troublante flotte dans l’air.
Il est dix heures quand nous arrivons et le soleil frappe en plein sur la ville, allumant des étincelles à toutes ces flèches qui montent vers lui ; descendant, en cascades de lumière, sur ces toits aux arêtes vives, ayant des tons de verdure tendre, comme une patine de bronze très clair, caressant toutes ces pentes douces d’où émergent de véritables collines d’or.
Et les maisons déjà plus distinctes – non plus, l’une contre l’autre, serrées comme dans nos villes occidentales – semblent plutôt le troupeau de quelque pasteur d’Assur sous les feux d’une mystérieuse Aurore.
Et tandis que cet enchantement vous tressaille sous les paupières, c’est comme un bourdonnement d’abeilles lointaines qui vous berce, une rumeur de cuivre palpitant dans les échos, la voix innombrable des cloches s’exhalant de toutes ces chrétiennes mosquées.
Ce bruit de prières, bientôt rythmé par les prosternements des passants, aux coins de toutes les rues où s’élèvent des images saintes, ne nous quittera plus. C’est comme la respiration de Moscou ; l’âme des superstitions éperdues n’ayant plus que ce coin de l’Europe pour asile ; l’antique et idolâtre vision des premiers hommes inquiets d’infini et ne sachant mettre le symbole plus haut que la réalité. Et je ne sais quelle oppression vous prend de ce spectacle à la fois révoltant et sublime où nos scepticismes se fondent dans une forme nouvelle du doute, l’admiration s’y mêlant à la pitié.
Depuis que le grand fleuve humain roule par le monde, arrachant des parcelles à toutes les terres qu’il traverse, mêlant les races dans son cours, faisant notre sang de toutes les épaves moléculaires, abêtissant l’orgueil des souches primitives dans une continuelle promiscuité; depuis que les hasards du voyage et les rendez-vous mystérieux de l’amour ont confondu les familles humaines, sans en éteindre, hélas ! les rancunes séculaires, qui peut dire qu’il ne porte pas dans ses veines le stigmate fluide de quelque origine inconnue et que ses grands-mères n’ont pas failli dans le crime continu et charmant de l’humanité?
Pour qui recule devant cette irrespectueuse pensée, comment s’expliquera le phénomène, certain cependant, des parties mystérieusement retrouvées, des terres jamais vues et cependant reconnues, des sentiments qui vous viennent au cœur comme si quelque aïeule, depuis longtemps endormie dans une tombe dont on ignorait la place, vous ouvrait subitement les bras délivrés du suaire ?
Je ne me connais pas d’aïeux aux croisades. Si quelqu’un de mes ancêtres en a rapporté la gale, il a eu l’exquise attention de s’en guérir. Mon obscure lignée ascendante, de son nid pyrénéen, n’avait jamais rêvé de plus long voyage que celui de Toulouse la Romaine. Que me peut donc avoir de maternel cette terre d’Orient que j’ai failli baiser en fils respectueux, sentant ma tête s’incliner parmi toutes les têtes, et mes genoux ployer, et des prières me monter aux lèvres, dont je ne comprenais pas les mots ? Je vous jure cependant que cela fut ainsi, qu’un véritable attendrissement d’enfant prodigue me vint de cette cité éblouissante dressant en l’air, comme des mâtures, ses grandes croix d’or haubanées ! Et rien ne me sembla ridicule de ces mysticismes exubérants, et j’avais grand-peine à m’en défendre moi-même, comme si quelque souffle schismatique y fût venu sécher, à mon front, les dernières gouttes de mon catholique baptême.
Me voici maintenant par les rues, supportant sans blasphème les coupures d’un pavé vraiment abominable, contemplant avec des vénérations infinies de petites images souvent grotesques dans leur richesse, prêt à me courber sous la bénédiction des popes crasseux aux chevelures inquiétantes et vaguement zoologiques.
Et une fraternité immense m’envahit pour les esclaves d’hier qui sont demeurés des misérables en haillons, avec des gaîtés d’ilotes sur leurs maigres visages et des éclairs illuminés dans les yeux pleins de la caresse du ciel. Des signes de croix à rebours me viennent dans le bras, en fourmillement contagieux. Il me faut retenir d’acheter un petit cierge et de boire de l’eau sainte à la gamelle où trinquent les barbes hirsutes des moujiks ; une haleine d’encens et de malpropreté souffle aux carrefours où des pigeons sacrés s’abattent vers de sordides nourritures.
Ô Moscou la Sainte et la bien nommée, quel trouble tu as mis en moi !
Moscou a eu beau s’étendre, Moscou est demeurée tout entière dans l’enceinte, toujours fermée de murailles et de tours, du Kremlin. C’est bien toujours dans cet amoncellement de cathédrales somptueuses au centre d’une forteresse qu’est resté le cœur, à la fois farouche et mélancolique, de la grande cité. Il y est comme embaumé, dans l’indestructible légende, avec les dépouilles des empereurs qui ont précédé Pierre le Grand et qui dorment dans des tombeaux pareils, auprès de la tour d’Ivan le Terrible dont les cloches semblent sonner encore le réveil des antiques terreurs, à deux pas de cette place Rouge qui vit rouler tant de têtes et où, la nuit, le fantôme de Saint-Basile s’allonge en flèches d’ombre semblant traverser les cœurs.
C’est demain la Pentecôte russe, qui vient après la nôtre. On officie déjà dans la cathédrale de l’Assomption où sont sacrés les tsars. Imaginez l’intérieur sonore d’une pépite immense d’or. Les piliers eux-mêmes en sont couverts sur toute leur hauteur où de grandes images de saints dressent, sur ce fond, une ascendante théorie. L’iconostase est comme fouillée dans le métal dont les déchirures encadrent des Vierges dont les visages et les mains seuls sont peints, tandis que le vêtement est en relief, et qui regardent avec de grands yeux doux, très fendus en longueur, comme ceux des almées.
Dans le nuage d’encens que des diacres épaississent, à hauteur de leurs genoux en balançant nonchalamment leurs cassolettes, le sanctuaire aux portes d’or forgé s’ouvre, et le pope, sous sa dalmatique d’argent finement tissée, qui a des cassures d’armure, s’avance solennel, majestueusement indifférent, coiffé à l’orientale, léonin sous sa crinière retombant aux épaules. Tel est son flegme sacerdotal qu’il semble seul ne pas croire, parmi tous ces croyants, dont la foi épileptique s’évertue en pantomimes vraiment émouvantes à ses pieds.