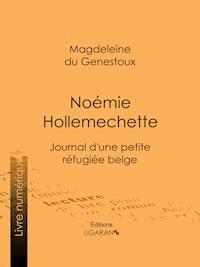
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait : "Maman m'a dit ce matin : « Nous allons partir en vacances, tu vas ainsi passer deux mois au bord de la mer à Heyst. Tu n'auras rien à faire, aucun devoir ; mais je vais te donner une idée qui sera une occupation sans toutefois t'ennuyer, ni te faire perdre beaucoup de ces heures de plaisir dont, moi la première, je désire que tu jouisses : écris donc ton journal de vacances..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louvain, 25 juillet 1914.
Maman m’a dit ce matin : « Nous allons partir en vacances, tu vas ainsi passer deux mois au bord de la mer à Heyst. Tu n’auras rien à faire, aucun devoir ; mais je vais te donner une idée qui sera une occupation sans toutefois t’ennuyer, ni te faire perdre beaucoup de ces heures de plaisir dont, moi la première, je désire que tu jouisses : écris donc ton journal de vacances. Une petite fille de dix ans peut très bien noter ses impressions et les évènements de sa vie. Tu écriras chaque jour, ou plutôt deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi, ce que tu auras vu, ce qui t’aura amusée, enfin tout ce que tu voudras. Si ce journal est bien fait, plus tard il sera un souvenir précieux. Moi, petite fille, j’ai écrit aussi mon journal et je l’ai continué jusqu’au jour de mon mariage, lorsque je suis venue m’installer ici, à Louvain, avec ton papa. »
Oui, c’est cela, je vais écrire mon journal.
J’ai demandé à papa un beau cahier, il m’en a apporté un très joli, recouvert de toile grise, sur lequel il a fait écrire en belle ronde par Jean Moya, son commis, mon nom, Noémie Hollemechette, et ces mots : Journal de ma vie.
Après le déjeuner, vite je commence.
Nous devons partir le 2 août pour Heyst ; papa qui, depuis très longtemps, n’a pas quitté son magasin de livres, tant il craint de manquer la visite d’un de ces « Messieurs de l’Université », comme il dit, vient avec nous ; mon frère Désiré, qui est à la banque, nous rejoindra un peu plus tard. Il prétend toujours qu’il a trop à faire, et papa ne veut jamais qu’il demande un congé quand on ne le lui donne pas ; je suis bien contente que, cette fois-ci, il puisse aller à Heyst, car l’année dernière il nous a beaucoup manqué. Il sait si bien raccommoder les filets, et surtout, quand il est là, maman nous laisse faire tout ce que nous voulons et nous sortons bien davantage.
Mes grands cousins Craenendonck vont aussi venir avec Gertrude et Rosalie.
Quelles bonnes parties nous allons faire ! Je voudrais bien cette année avoir un petit jardin le long de l’allée qui mène à l’entrée de la maison ; je demanderai au vieux Frans, qui porte le poisson et qui nettoie les allées, de nous tracer un jardin et de planter une bordure verte. Ma petite sœur Barbe en voudra un sûrement, mais si Frans en fait un, il peut aussi en faire deux. Et puis Désiré, quand il viendra, l’arrangera.
L’année dernière j’en avais un. J’avais pioché, creusé et semé, je ne me rappelle plus quoi, puis j’avais tassé la terre avec mes mains, comme Frans, mais rien n’a jamais poussé. De temps en temps je faisais un petit trou avec mes doigts pour voir si cela n’avançait pas. Désiré m’a dit que j’avais trop aplati. Cette année, après avoir semé, je n’y toucherai plus. Je laisserai du reste à Frans le plus gros travail.
Il faudra aussi que Désiré fasse une armoire près de mon lit, dans la chambre de Madeleine, pour que j’y mette mes livres et mon cahier. Papa m’a donné pour ma fête une collection de la Bibliothèque Rose que je veux emporter à la campagne, car je la prêterai à Gertrude et à Rosalie qui n’ont pas lu la suite des Petites filles modèles, les Vacances. Sur cette bibliothèque nous rangerons les coquillages et les pierres que chaque année nous ramassons sur la plage.
Et sur la plage que ferons-nous ?
Ma sœur Madeleine, à qui maman a très bien appris à coudre, – du reste elle a quinze ans, – m’a fait des costumes pour « barboter » dans l’eau.
Comme nous emportons beaucoup de bagages, maman nous a donné, à moi et à ma petite sœur Barbe, une malle entière et j’y ai mis toutes nos affaires.
Naturellement, au fond, bien couchée sur ses robes et son linge, nous avons posé la poupée de Barbe. Elle ne pourrait pas se passer de Francine : moi de même, quand j’étais petite, je ne pouvais pas m’en aller sans ma Francine. Alors je comprends ma petite sœur quand elle pleure en voyant la tête brisée de sa fille ! Mais, dans ce cas, on la lui remplace, c’est très facile.
Je lui ai du reste fait une robe, à Francine ; elle est de la même étoffe et de la même forme que celles que nous ont cousues maman et Madeleine. Elles sont en mousseline rose tout unie avec des ceintures de peau blanche. Seulement, pour la poupée, comme nous n’avions pas de ceinture de peau blanche, nous avons mis un ruban. Maman a dit que, pour une poupée, c’était même mieux. Papa, qui a l’air si content de venir avec nous, nous a acheté lui-même de jolis chapeaux de paille d’Italie blanche garnis de petites roses pompon. En les voyant, maman s’est écriée : « Mais c’est une folie ! » Alors papa a répondu : « Oh ! pour une fois, on pouvait bien se le permettre. Il y a si longtemps que j’attends de bonnes vacances comme celles que nous allons passer. Je vais voir ma sœur Craenendonck et je veux lui montrer de gentilles petites nièces. J’ai eu une excellente année et, en revenant, je travaillerai davantage. »
Là-dessus, papa et maman nous ont embrassées ; mon frère, qui était là, s’est mis au piano et a joué la Brabançonne, tandis que Barbe et moi nous dansions autour de nos chapeaux. Tout le monde criait, et Phœbus, notre gros toutou qui doit être du voyage, car il ne se sépare jamais de nous, s’est mis à aboyer si fort que papa lui a dit de se taire ; alors il s’est mis à lécher les joues de Barbe qui est tombée par terre.
Jeudi, 30 juillet.
Quel malheur ! notre voyage est remis. Nous devions partir hier soir, et maman a défait nos paquets en disant qu’elle ne savait pas si nous pourrions quitter Louvain avant dimanche. Mardi soir M. van Tieren, le vieux professeur, est venu voir papa et ils ont causé tous les deux en secret ; ils avaient l’air très triste ; papa a appelé maman. À ce moment, mon frère Désiré est entré en courant dans le magasin : « Je suis convoqué à la caserne, je ne sais pas pourquoi, et, à la Banque, nous sommes affolés ».
Comme les grandes personnes continuaient à parler à voix basse, nous nous sommes assises sur nos petites chaises dans un coin, et Barbe a raconté à sa fille notre ennui de ne pas partir pour Heyst rejoindre nos cousines Gertrude et Rosalie.
Dimanche, 2 août.
Tous les soldats sont appelés à la caserne. Voici ce que mon frère est venu annoncer ce matin à midi. Maman s’est mise à pleurer et papa s’est écrié que la déclaration du Roi était magnifique. Mais je veux raconter tout ce qui est arrivé depuis jeudi soir.
Mon frère, vendredi matin, s’est rendu à la caserne avec tous ses camarades, et la rue de Namur était pleine de gens. Nous étions descendues dans le magasin et, cachées dans un petit coin, nous écoutions ce que l’on disait. Au commencement je ne comprenais pas, ma sœur Madeleine m’a expliqué que les Allemands faisaient la guerre à la France et que, pour arriver plus vite à Paris, ils voulaient traverser la Belgique qui était le plus court chemin ; que le Roi ne le voulait pas, et c’est pourquoi il appelait tous les jeunes gens pour l’aider à défendre le pays.
J’ai pleuré parce que j’ai pensé que notre pauvre Désiré partirait et que nous ne le verrions pas tous les jours comme à l’ordinaire.
Je croyais qu’il allait tout de suite chez le Roi à Bruxelles, mais Madeleine m’a encore dit : « Non, pas encore, il reste à Louvain, à la caserne ». J’ai répondu : « Alors le Roi est tout seul ». Madeleine a repris : « Pour le moment, il a avec lui les garçons de Bruxelles ».
La rue était remplie de gens qui voulaient aussi savoir des nouvelles. Papa ne quittait pas son magasin, à chaque instant il entrait quelqu’un.
« Bonjour, monsieur Hollemechette, votre fils est parti ? » C’était un ami de Désiré, avec un tas de paquets à la main, qui se rendait à la caserne.
« Ah ! mon pauvre Hollemechette, quelle triste histoire ! » Ça, c’était le professeur Velthem qui reste toujours à causer avec papa, qui oublie l’heure du diner et sur lequel maman se désole sans cesse : « Ah ! dit-elle, on voit bien qu’il n’a pas d’enfants et qu’il n’est pas marié ! »
Notre pauvre commis Jean Moya et sa bicyclette ont été appelés. Comme il n’y a plus de place dans la caserne, on loge les soldats dans les écoles et les salles de spectacles.
En face de chez nous, on construit une maison ; tout à coup, hier, les ouvriers sont descendus du toit, les maçons de leur mur et, en chantant la Brabançonne ; ils se sont rendus devant l’Hôtel de Ville. Comme Phœbus voyait tous les gamins courir, il a couru lui aussi ; alors Madeleine a suivi et moi, je me suis accrochée à sa jupe et nous avons été ainsi jusqu’à Saint-Pierre.
Une grande foule était rassemblée, une quantité de jeunes gens réunis devant les marches de l’Hôtel de Ville, chantant encore la Brabançonne ; des femmes en groupes restaient sur le trottoir, et des hommes plus âgés, parmi lesquels je reconnus M. Velthem et M. van Tieren, leur chapeau à la main, étaient montés sur les marches de l’Hôtel de Ville. Tout à coup, une voix cria : Vive la France ! La foule entière se mit à entonner un chant magnifique que je n’avais jamais entendu. Madeleine me dit que c’était la Marseillaise. Je me retournai tout à coup, je vis ma sœur qui pleurait et aussi toutes les femmes qui nous entouraient. Alors nous sommes revenues à la maison, et maman et ma sœur se sont embrassées et nous ont caressées doucement en disant : « Mes petites, mes petites ! Il faut que vous soyez bien sages, et nous, bien courageuses. »
À ce moment sont entrés dans la librairie les fils du professeur Boonen qui n’ont plus leur maman ; ils goûtent souvent chez nous après qu’ils ont pris leur leçon de latin avec papa ; ils annoncent que l’école normale est licenciée afin de loger les soldats. Maman voulait les retenir, mais ils sont vite partis pour rejoindre leur père qui devait les attendre devant l’église du Grand Béguinage.
Le soir à quatre heures, mon frère Désiré est venu nous dire adieu. Il partait pour Bruxelles avec son régiment. Il était très content et nous embrassa tous. Papa avait pris son air grave qui me fait toujours un peu peur, maman pleurait en mettant dans un sac un gros pâté, du saucisson et du pain. Madeleine ne disait rien et je voyais bien qu’elle se forçait pour ne pas pleurer, et Barbe et moi, quand Désiré nous a pris dans ses bras pour nous embrasser, nous riions de voir un si beau soldat. Phœbus avait posé ses deux pattes sur ses épaules et il ne voulait pas lâcher mon frère. Papa lui a dit alors : « Pars et fais ton devoir ! »
Comme nous savions que son régiment prenait le train de Bruxelles, nous sommes allées le voir passer rue de Jodoigne ; mais nous avons laissé Phœbus à la maison ; il aurait pris la fuite pour suivre mon frère. Maman seule est venue avec nous. Le régiment a défilé devant nous, la musique en tête, le drapeau déployé. Le soleil brillait, tous les hommes levaient leur chapeau. Ah ! que c’était beau !
Désiré était le premier de sa compagnie ; quand il est arrivé devant nous, vite il a embrassé maman et, sans plus rien dire, nous sommes revenues à la maison où nous avons trouvé papa tout seul, Phœbus couché à ses pieds.
Jeudi, 6 août.
La guerre avec l’Allemagne a été déclarée mardi, mon frère Désiré est parti – mais je crois que je l’ai déjà dit dans mon journal – et notre bon Phœbus a été pris pour traîner les mitrailleuses.
Mon Dieu, que nous sommes malheureux ! Je l’écris ici, mais maman et Madeleine ne veulent pas que nous soyons tristes. Madeleine est tout à fait douce avec nous et répond à chaque question que nous lui posons, et il faut bien que je la questionne, car il y a beaucoup de choses que je ne peux comprendre. Par exemple, papa disait hier à maman : « Non, notre Roi n’acceptera pas l’ultimatum de l’Allemagne, j’en suis sûr ; pas un Belge ne l’accepterait. »
J’ai tiré Madeleine par le bras et je lui ai demandé tout bas ce que voulait dire ultimatum. Elle m’a répondu que cela signifiait « conditions irrévocables », et que dans notre cas, l’Allemagne avait posé des conditions à la Belgique qu’elle ne pouvait accepter sans se déshonorer ; alors j’ai tout de suite compris ce que disait papa et j’ai pensé comme lui. Le soir, quand M. van Tieren est venu dans le magasin, je me suis assise sur ma petite chaise et j’ai écouté ce qu’on racontait.
Du reste, maman et Madeleine étaient là aussi et personne ne songeait à moi : j’en étais bien contente, car je désirais tout savoir et je veux écrire le mieux possible tout ce que je vois et ce que j’entends.
M. van Tieren était très excité en parlant de la séance qui avait eu lieu au Parlement, où le Roi a déclaré qu’il défendrait la Belgique contre le passage des Allemands et qu’il était sûr que tout le pays serait avec lui.
La Reine et ses enfants étaient là aussi, et il paraît que tout le monde les a acclamés ; on criait : « Vive la Belgique, vive le Roi ! »
Sur le bureau de papa, il y a une photographie de la famille royale, très grande et très bien encadrée, que je regarde souvent parce que je trouve que la petite princesse Marie-José a de très jolies boucles comme je voudrais en avoir.
Pendant que M. van Tieren racontait tout cela, M. Boonen est arrivé. Il avait les yeux plein de larmes.
« Mais qu’avez-vous, mon cher collègue ? demanda M. van Tieren.
– C’est vrai, je suis ému, mais je suis bien fier aussi : mes deux fils s’engagent pour la durée de la guerre ; ils vont à Bruxelles défendre leur pays et leur Roi.
– Oh ! dit maman, quels braves garçons, mais comme ils sont jeunes, dix-sept et dix-huit ans !
– Oui, c’est moi qui aurais dû partir ; je ne suis plus jeune, mais j’aurais eu encore la force de tenir un fusil et de bien viser. Mes chers fils, ils partent demain par un premier train : il y en a toute la journée. Je vais rester seul, je viendrai vous voir souvent. »
J’aime beaucoup M. Boonen, parce qu’il caresse toujours mes joues, et que je pense qu’il doit être très malheureux que ses fils n’aient pas une maman comme la mienne. J’aurais voulu lui dire quelque chose, mais je n’osais pas ; alors je me glissai derrière lui et tout doucement, comme il était assis sur une chaise, je me hissai sur la pointe des pieds, et je mis un baiser sur sa joue.
Surpris, il se retourna et, prenant mes mains dans les siennes, il s’écria : « Ah ! ma petite Noémie, que ta bonté soit récompensée : tu as toute la douceur et la charité d’une femme belge ! »
J’étais cramoisie et je ne pus faire autre chose que de me jeter dans les bras que me tendit papa.
Le lendemain matin, un nouveau chagrin nous arriva. On a demandé les chiens pour traîner les mitrailleuses, et le bon Phœbus, qui est le plus beau chien de Louvain, fut appelé un des premiers.
L’ordre a été affiché sur la porte de l’Hôtel de Ville ; il était inscrit qu’on devait se présenter de midi à trois heures.
Papa est allé prendre chez Tantine Berthe son gros Pataud, le frère de Phœbus. Elle demeure rue de Malines, en face de Sainte-Gertrude, une petite maison très vieille, aussi vieille que l’Hôtel de Ville, dit maman. Derrière, il y a un petit jardin plein de fleurs d’héliotrope et de réséda. Tantine vit seule avec Pataud et n’aime pas beaucoup les enfants, surtout les petites filles « qui ne servent à rien », dit-elle.
J’ai très peur d’elle, mais maman l’aime beaucoup et nous conduit chez elle chaque dimanche dans l’après-midi.
Pataud et Phœbus s’attellent ensemble et, souvent, ils traînent la petite voiture de Barbe quand nous allons faire des promenades à la campagne. Ils ne peuvent aller l’un sans l’autre, c’est pourquoi papa allait chercher Pataud pour le mener à l’Hôtel de Ville en même temps que Phœbus.
Quand ce dernier est parti de la maison, Barbe et moi nous nous sommes pendues à son cou. Barbe l’embrassait et, moi, je lui ai donné beaucoup de morceaux de sucre : il était si content qu’il les mangeait tous à la fois et très vite pour en avoir d’autres. Maman ne pouvait retenir ses larmes et passait doucement sa main sur sa grosse tête. Il faisait ses yeux câlins et tendait sa patte comme lorsqu’il est ému et désire obtenir quelque chose. Madeleine a voulu aussi le conduire pour voir son conducteur ; alors je suis partie avec elle. Nous avons rejoint papa sur la place de l’Hôtel-de-Ville qui était pleine de monde.
Tous nos amis étaient là avec leurs chiens. Il y avait M. Hoodschot, la vieille Mme Bouts qui a deux toutous ; ils sont si entraînés à la marche que les gens disaient que chacun d’eux pourrait bien traîner une mitrailleuse. Tous les jours ils portent le lait dans toutes les maisons de Louvain et aux environs. Heureusement qu’elle les nourrit bien, mais c’est par avarice, car elle économise avec ses chiens plus de quatre employés.
Il y avait aussi Poppen, le concierge de l’Université avec Faraud, et puis Layens, le gardien de l’Hôtel de Ville avec Médor, et le professeur Melken avec Black, enfin tous. Et ils aboyaient, ils tiraient sur leur laisse et c’étaient des cris épouvantables ! Papa a dit au professeur Melken : « Vraiment, le départ de nos chiens est plus bruyant que celui de nos fils. »
Madeleine me montra deux vieilles femmes de l’avenue Jodoigne, célèbres dans toute la ville pour leurs disputes à propos de leurs chiens. L’une vend des légumes au marché, l’autre du lait, et dès qu’elles s’aperçoivent du bout d’une rue, elles commencent à se regarder de travers et finissent par se dire de gros mots, chacune pour prouver que son chien est le plus beau et le plus aimable. Ce qu’il y a de drôle, c’est que les chiens s’aiment beaucoup et ne songent pas à être jaloux : ils vont toujours se dire bonjour, ce qui met ces femmes encore plus en colère. Aujourd’hui, elles ont tant de chagrin de se séparer de leurs chiens qu’elles redeviennent amies, et les voilà qui reviennent ensemble.
Nous avons eu quelques difficultés au passage d’un beau chien qui demeure un peu plus haut que nous, rue de Namur, et qui est l’ennemi mortel de Phœbus. S’ils se rencontrent par hasard, ils se jettent l’un sur l’autre et ils se battraient jusqu’à la mort si on ne les séparait pas. Il appartient à un jeune tailleur, qui est parti le même jour que Désiré ; il était donc conduit par sa jeune femme. Mais ce qui est curieux, c’est que ces chiens semblèrent comprendre les circonstances graves qui les amenaient à cette heure place de l’Hôtel-de-Ville, car, après un coup d’œil haineux lancé l’un sur l’autre, ils restèrent près de leur maître sans bouger.
Quand ce fut le tour de papa, il s’avança avec ses deux chiens et on les remit à un jeune artilleur, conducteur de mitrailleuse, qui avait l’air très bon. Il était de Tirlemont où papa connaît plusieurs personnes ; alors papa lui a parlé de ses chiens que nous aimons tant, et Madeleine lui a demandé, les larmes aux yeux, de bien soigner Phœbus, de lui donner beaucoup à manger et, dans le cas où il recevrait un coup mortel, de bien l’enterrer. Ce jeune homme regarda ma sœur très attentivement et lui dit gentiment :
« Mademoiselle, j’aime beaucoup les chiens, je soignerai donc naturellement ceux-ci, mais du moment que vous me recommandez le vôtre, croyez que je veillerai sur lui particulièrement. »
Là-dessus papa lui remit un gros sac de biscuits pour chiens et, après une dernière caresse à Phœbus, il prit congé de l’artilleur. Madeleine et moi, embrassions Phœbus, mais en nous voyant nous éloigner, il se mit à hurler si fort que tout le monde le regarda. Il fallut la poigne de l’artilleur pour le retenir : je crois qu’il l’attacha à un arbre, tant il tirait.
J’ai oublié de dire que ma sœur a donné notre adresse au nouveau maître de Phœbus pour qu’il puisse nous envoyer des nouvelles.
En revenant, papa a voulu passer à la gare pour voir les trains qui allaient à Liège et à Tirlemont, venant de Bruxelles.
Il en passait une quantité remplis de soldats. Aux arrêts du train, ils chantaient la Brabançonne et aussitôt après l’autre chant, que maintenant je connaissais bien, la Marseillaise. Papa se mit à causer avec plusieurs personnes ; tout à coup sa figure changea et je sentis sa main trembler dans la mienne. Il dit à Madeleine : « Les Allemands sont chez nous, ils ont détruit des baraquements à Visé, et l’on dit même que cent cinquante automobiles remplies de soldats sont entrés dans Liège, mais ils ont été bien reçus et ils ont été obligés de s’enfuir. Tu entends, à Liège ! »
Tout à coup la foule qui était sur les quais et sur la place devant la gare se mit à pousser les cris de « Vive la France ! » répétés cent fois, puis elle se dirigea vers la rue de la Station, arriva à la Grand-Place et tourna pour se rendre devant l’Hôtel de Ville. Là, elle entonna encore la Marseillaise et cria « Vive la France ! Vive la Belgique ! » Papa chantait aussi et Madeleine pleurait. Moi, je tremblais en tenant la main de papa bien serrée, car j’avais peur de le perdre, non pas parce que je craignais de ne pas retrouver ma maison, mais parce que tout ce monde dans les rues m’effrayait.
Le plus gros de la foule s’engouffra dans la rue de Bruxelles. La plupart des magasins étaient fermés, mais toutes les maisons étaient ornées de drapeaux belges, et j’ai demandé à papa si nous en mettrions un. Il m’a répondu que oui, bien entendu, et qu’il fallait vite rentrer.
À la maison, maman nous dit que M. Velthem était venu pour annoncer la nouvelle de l’arrivée des Allemands à Liège. Là-dessus, papa se fâcha en disant que ce n’était pas vrai, qu’il n’y avait que des automobiles qu’on avait vus dans les faubourgs, et qu’en tout cas on LES avait reçus vigoureusement et qu’ILS voyaient ce que c’était que d’entrer en Belgique.
Papa mit aussitôt, au-dessus de la porte du magasin, trois drapeaux : deux belges et, au centre, un français.
Après le dîner, M. Boonen est venu chercher papa. Il voulait sortir avec lui. J’aurais bien voulu aller avec eux, mais maman a dit que non. Nous devions être très sages et très obéissantes pour ne pas augmenter les tourments des grandes personnes, et c’était notre devoir, à nous, petites filles, dans ce malheur qui tombait sur notre pays.
Alors nous sommes allées nous coucher, Barbe et moi. J’ai aidé ma petite sœur à se déshabiller, à plier ses affaires, à faire sa tresse ; nous avons fait notre prière et ensuite je me suis mise dans mon lit mais je ne pouvais dormir. Je pensais à Désiré, qui allait se battre contre les Allemands, à Phoebus, traînant des mitrailleuses, aux fils de M. Boonen, qui laissaient leur père tout seul.
Tout à coup j’entendis papa parler et maman s’écriait : « Mais c’est terrible ! terrible ! »
Je me dressai sur mon lit et j’écoutai.
« Oui, disait papa, on est allé rue de Malines, chez les frères Witman, des Allemands ; on a brisé tout leur magasin, enfoncé les devantures, brisé toutes les vitres, toute la vaisselle, jeté les tables et les chaises au milieu de la rue, et on allait y mettre le feu quand la police est arrivée ; aidée par quelques hommes sérieux comme moi et M. Boonen, elle a réussi à disperser la foule qui a entonné la Marseillaise, mais le magasin était à sac. »
Qu’est-ce que cela pouvait vouloir dire, un magasin à sac ? Je m’endormis là-dessus.
J’ai demandé à Madeleine, ce matin, ce que c’était ; elle m’a dit : « C’est piller un magasin, enlever et briser tout ce qu’il y a dedans. Dieu veuille que les Allemands ne mettent à sac aucune de nos belles villes de Belgique ! »
Louvain, 9 août.
Je me mets à écrire « mon Journal » en revenant de chez Tantine Berthe où nous sommes allés après le déjeuner. Tantine était beaucoup plus douce que d’habitude avec nous ; au lieu de nous regarder d’un œil sévère, elle nous a dit, à Barbe et moi, en posant sa main sur nos têtes : « Allez, mes petites, dans le jardin, soyez bien sages, n’abîmez pas les fleurs, promenez-vous tranquillement en attendant que je vous appelle pour goûter, j’ai à parler avec vos parents ».
Oh ! je sais bien ce qu’elle voulait : c’était lire la lettre de Désiré que nous avons reçue ce matin.
Désiré est son préféré. Elle dit toujours : « C’est un garçon, ça ! » Aussi était-elle heureuse d’avoir de ses nouvelles. Maman avait annoncé : « Oh ! nous avons une lettre bien intéressante de Désiré ». J’ai tout de suite pensé à la copier dans mon cahier comme souvenir ; la voici :
Bruxelles, 3 août.
Chers parents, chères sœurs,
Je me hâte de vous donner de mes nouvelles. Je suis arrivé hier à Bruxelles en excellente santé. Nous nous sommes rendus immédiatement à la caserne d’artillerie qui se trouve à la Chaussée de Terouëren, que papa connaît. Après nous être restaurés, on nous a annoncé que le Roi passerait la revue de notre régiment à deux heures. Alors vous pensez si nous nous sommes astiqués et si tout reluisait merveilleusement à l’heure dite. C’est au champ de manœuvre qu’a eu lieu la revue. Il y avait avec nous les régiments de cavalerie et d’artillerie. Nous étions en position à droite, la cavalerie à notre gauche, les mitrailleuses traînées par des chiens étaient au milieu de nous. Une foule énorme se pressait tout autour, et les agents de police et même les gendarmes la maintenaient avec peine. Le Roi est arrivé après une demi-heure d’attente, à deux heures précises ; il était à cheval, accompagné du major Melotte et de ses aides de camp. La foule entière n’a eu qu’un cri : « Vive le Roi ! » La musique battait aux champs, les soldats frémissaient d’enthousiasme ; le Roi tout pâle se tenait droit sur son cheval ; il avait l’air horriblement ému, et lorsqu’il a passé devant moi – je suis, comme vous savez, le premier du bataillon – j’ai vu que ses yeux étaient pleins de larmes. Il a prononcé quelques paroles que je voudrais vous citer textuellement, tant elles étaient belles et simples : « Oui, la Belgique est un petit pays, mais son honneur est grand ; il saura le sauver et vous tous, jeunes gens, vous vous battrez pour son indépendance et sa liberté. Je serai avec vous et c’est à mes côtés que nous arrêterons les envahisseurs qui trahissent leur serment ! » Nous aurions tous voulu applaudir. Nous avons seulement crié : « Vive le Roi ! vive la Belgique ! »
Nous partons ce soir pour Liège. Je vous embrasse tendrement, mes chers parents, ainsi que Madeleine et les deux petites.
Votre fils,
DÉSIRÉ.
P.-S.– J’oubliais de vous dire qu’à la revue, il y avait un chien attelé à une mitrailleuse qui ressemblait beaucoup à Phœbus mais il n’était pas content du tout d’être attelé et il voulait mordre tous ceux qui s’approchaient de lui. Alors on lui a mis une muselière.
En revenant de chez Tantine, papa a voulu passer devant l’Hôtel de Ville pour savoir s’il n’y avait pas quelque chose de nouveau. Nous avons été arrêtés sur la Grand-Place par M. Van Tieren. Il prévint papa que M. Boonen avait reçu des nouvelles d’un de ses fils. Nous sommes vite allés chez lui. Ce n’était pas très loin, car il demeure avenue Jodoigne.
On nous fit entrer dans la salle à manger où son second fils, habillé en artilleur, tout couvert de poussière et de boue, était assis devant la table et mangeait en hâte ce qu’on avait posé devant lui.
Son père expliqua à papa, afin de le laisser manger qu’il avait été chargé par son général de porter des dépêches importantes au quartier général, à Bruxelles où se trouvait le Roi. Il était arrivé à motocyclette.
Papa lui demanda ce qui se passait à Liège.
Oh ! nous ne sommes pas en bonne posture et les Allemands sont en nombre, et puis, il y a eu l’attentat du général Léman qui commande la forteresse de Liège.
– L’attentat du général Léman ?
– Oui, voilà, je vais vous le raconter en deux mots.
– Mais as-tu assez mangé ?
– Bien sûr, j’étouffe. Voici donc la chose.
« C’était le 6, vers deux heures de l’après-midi ; nous étions au quartier général, établi rué Sainte-Foy ; nous restions dans une maison située en face de celle où était logé le général Léman avec ses aides de camp.
Tout à coup, on entendit des cris et puis du tumulte dans la rue, nous nous précipitons aux fenêtres et sur la porte, et nous apercevons une foule de femmes et d’enfants escortant un groupe d’officiers ou soldats que nous ne distinguons pas bien au milieu de cette masse de gens. On criait : “Voici les Anglais ! Vivent les Anglais !” Ils atteignent la maison du général et pénètrent sous la porte. Le bruit de la rue avait attiré un tas de gens, et on ne pouvait que difficilement se frayer un chemin à travers cette multitude.
– Tout à coup une clameur s’élève : “Allemands, ce sont des Allemands !”
Alors la foule se rua sur la porte, voulant massacrer ces soldats qui avaient pénétré jusque-là à l’aide d’espions ; mais nos soldats arrivèrent à la maintenir, et ce fut dans l’escalier même que la lutte s’engagea.
Un aide de camp du général avait reconnu leur uniforme, et c’est juste à sa porte qu’on les arrêta. Deux parvinrent à s’enfuir et, avec une audace incroyable, se jetèrent dans l’automobile du général qui stationnait dans la rue et tentèrent de fuir, mais il était trop tard ; nous avons saisi nos deux prisonniers qui ont comparu devant le général Léman qui, bien que malade et épuisé les interrogea et les condamna.





























