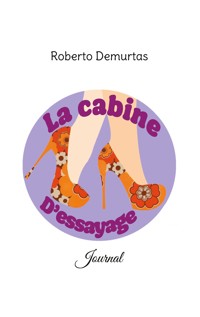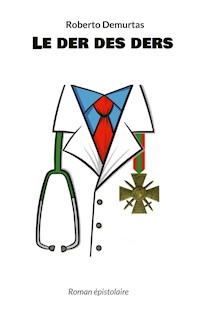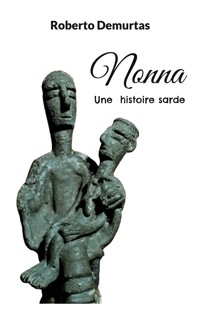
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Que je dorme par terre, sur un rocher, à la belle étoile ou dans un lit, mon sommeil n'est jamais profond. Je suis toujours aux aguets. Mon ouïe est sensible au moindre bruit et mes yeux ont appris à percer l'obscurité des nuits passées dans les montagnes sardes, lorsque enfant, loin de tout, je gardais mon troupeau. Aujourd'hui, lorsque mes rêves trompent ma vigilance et me transportent au loin, je retourne toujours là-bas, sur cette île. Je suis allongé sur un lit, blotti sous une couverture, abrité par un toit. Je grelotte. Le froid me tire de mon sommeil. J'entends, distinctement...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Désordre, Nouvelles.
Le der des ders, Roman épistolaire.
La cabine d’essayage, Journal.
Par ordre d’entrée en scène :
Peppino, Giustina, Luigina, Antonio.
Sommaire
Première partie
Ma mère
Deuxième partie
Ma grand-mère
Troisième partie
Mon père
Première partie
Ma mère
Un frisson me parcourt le corps et me tire de mon sommeil. J’ouvre les yeux sur l'obscurité. Le froid s’est glissé dans le lit. Je ne sens plus la chaleur de votre corps, grand-mère, contre lequel je m’étais endormi. Je tends le bras, ma main se pose sur des draps vides et glacés.
Mes yeux s’accoutument à l'obscurité et parcourent l'espace de cette chambre où je me trouve seul. J’entends une voix qui provient de la pièce d’en bas. C’est celle d’une femme, essoufflée, haletante. Je comprends. C’est la voix de ma mère qui se plaint, qui gémit. Vous êtes auprès d’elle grand-mère, car le moment est venu. Elle sera bientôt libérée de la charge de ce ventre qui était devenu si gros et si lourd qu'il entravait ses gestes répétés au long d’éreintantes journées de travail dans les champs.
Je ferme les yeux. J’écoute et j’imagine ce que je ne peux voir, ce mystère, cette épreuve héroïque que doit accomplir une femme pour qu’au sommet de la douleur un bébé s’échappe de son ventre.
Je me recroqueville, les bras et les jambes repliées contre ma poitrine pour me préserver du froid. Depuis cette chambre plongée dans le noir, j’entends les plaintes de ma mère et éprouve l’étrange sensation d’assister à mon propre enfantement. Blotti dans son ventre, je vis une seconde naissance. À l’aube, je vais ouvrir les yeux sur le monde, le découvrir tel qu’il est, le prendre de plein fouet.
C’est vous, grand-mère, qui allez me mettre au monde. Vous vous occuperez de tout, comme d’habitude. D’ailleurs, c’est vous qui avez choisi mes parents en mariant votre fille à ce berger venu du village voisin, alors que son ventre était déjà gros de celui que j’allais être.
Vous avez de l’expérience. Vous avez eu sept enfants. Mais la vie était si dure sur cette île que tous les frères et sœurs de ma mère sont morts en bas âge. Et puis, il y avait cette maladie. Celle qui te donne la fièvre, des frissons de froid et te vide de tes forces. Elle emporte les vieux et les jeunes enfants, cloue au lit les journaliers qui travaillent au fond de la vallée, au bord du Rio Pardù où pullulent les moustiques. Personne n’est à l’abri. Tout le monde l’attrape un jour ou l’autre. Les vieux prétendent même qu’il suffit de respirer l’air impur des régions marécageuses pour attraper la mal’aria.
Vous saurez prendre soin de moi, grand-mère. Vous allez me panser, me laver, m’essuyer puis me rouler dans un linge pour me préserver du froid qui s’infiltre dans la maison en ce mois de janvier.
Demain, après m’avoir allaité, ma mère retournera travailler dans la campagne, loin du village. Elle ne peut pas se permettre de perdre le revenu d’une journée. C’est vous, grand-mère, qui vous occuperez de moi. Si je pleure, pour tromper ma faim et me faire patienter, vous introduirez un doigt dans ma bouche que je sucerai avant de partager au sein d’une femme du voisinage le lait de son enfant.
Le soir, je m’endormirai sous votre toit, dans ce lit où cette nuit je rêve de ma naissance, porté par les voix et les bruits qui me parviennent de la pièce d’en bas. Je rêve que je sors du ventre de ma mère, qu’elle me prend dans ses mains pour me tenir tout contre elle, une nuit, un instant. Mais au matin, comme chaque jour depuis six ans, c’est dans votre lit que je m’éveillerai, là où vous avez su me préserver, tout bébé, de la fraîcheur des nuits dans ce village égaré dans les montagnes sardes.
C’est comme une seconde chance qui s’offre à moi. Je vais naître à nouveau. Différent peut-être de celui qu’on a présenté à mon père, quelques jours après ma naissance, lorsqu’il est rentré des pâturages où le retenait son troupeau de brebis. Peut-être, cette fois, acceptera-t-il cet enfant qui ne lui ressemble pas, qui n’a ni ses yeux bleus, ni ses cheveux blonds et dont il n’a pas voulu sous son toit ?
J’ai changé en six ans. J’ai observé, j’ai appris, je suis devenu fort depuis le jour où vous m’avez recueilli, grand-mère. À cause de la guerre qui nous condamne à la misère, j’ai appris à trouver ma nourriture et à défendre mon territoire avec la même détermination que le cochon, la chèvre et les quelques poules qui vont et viennent entre la maison et le jardin.
Je suis toujours aux aguets. Le moindre bruit me réveille. Je reconnais ce tapotement rapide et sec qui vient d’en bas. Je me précipite au pied de l’escalier et chasse les poules qui picorent le grain entreposé dans la maison. Je les repousse dehors dans un nuage de poussière que soulèvent leurs battements d’ailes.
Je m’habille. Vous m’avez confié un travail. Je dois surveiller les poules qui traînent derrière elles une longue ficelle. Je les suis par les ruelles où elles se répandent pour fouiller la terre avec leur bec. En voilà une qui se couche. Je bondis, empoigne la cordelette et tire violemment pour l’empêcher de déposer son œuf dans ce nid improvisé. Au levé du jour, d’une main experte, vous avez sondé chacune d’elles et noué une ficelle à la patte des poules qui étaient sur le point de pondre. Je ramène celle-ci cher nous. Les enfants du village seraient trop heureux de trouver un œuf abandonné. Ils se contenteront des couvées de perdrix qu’ils savent dénicher lorsque la faim les tiraille ou des œufs de merles et de pigeons sauvages, minuscules et fragiles, qu’ils dérobent dans leurs nids et absorbent d’une gorgée, perchés sur les arbres.
Sans cette ficelle qu’elles traînent derrière elles, j’aurais bien du mal à attraper ces volatiles. Je n’ai pas votre adresse, grand-mère. Je peux tout juste me saisir de cette poule qui se tient à l’écart des autres et ne se nourrit plus. Je vous l’apporte, car il faut prendre soin de nos animaux. Vous me l’avez assez dit. Ce sont les seuls biens que nous possédons. Vous palpez sa panse dure et gonflée. L’animal a avalé une trop grande quantité de sable en fouillant le sol. Alors, assise sur une chaise, vous immobilisez la poule affaiblie entre vos cuisses. Je vous regarde, les yeux écarquillés, saisir un couteau et ouvrir le ventre de la malheureuse qui s’agite et caquette, avant d’appliquer une pression sur son corps pour expulser ce trop-plein de sable qui gênait sa digestion. Ensuite, vous attrapez une aiguille, un bout de ficelle et vous vous attelez patiemment à recoudre la plaie ouverte de la bête terrorisée.
L’opération terminée, la patiente rejoint ses congénères. Je la suis dans la rue et n’en crois pas mes yeux. Une fois remise de ses émotions, la poule se ragaillardit et se remet à becqueter fébrilement le sol à la recherche de quoi remplir son ventre vide.
Le lendemain, au réveil, je la cherche aux alentours, partout où la faim la conduit d’ordinaire pour dénicher sa pitance. Je la trouve enfin, étendue sur le sol, morte, victime d’une erreur de diagnostic ou des suites de l’opération désespérée que vous avez tentée pour la sauver.
Notre cochon me suit partout, dans la rue, sur les chemins, docile comme un petit chien. Son museau flaire frénétiquement le sol, et déniche ici et là des fruits pourris tombés de leur arbre et des vers qu’il déterre avidement malgré l’anneau qui entrave son groin et l’empêche de ravager le terrain.
L’été, il m’accompagne au pied des figuiers de Barbarie. Contre les feuilles hérissées d’épines de ces cactus, je livre un combat farouche afin de leur dérober leurs fruits juteux. Ces fruits qu’il suspend hors de portée de ceux qui les convoitent, comme on joue à agacer un enfant qui ne peut se saisir de la friandise que l’on tient à bout de bras. Je me suis fait une arme d’une tige de bambou séchée. J’ai entaillé son extrémité avec mon couteau avant d’y glisser une pierre pour écarter les trois doigts d’une pince que j’ai consolidée avec une ficelle. Sans cet instrument, je ne pourrais m’approcher des feuilles du cactus recouvertes de grosses épines. En le tenant à bout de bras, je reste à une distance suffisante de celles, minuscules, qu’emporte le vent lorsque je saisis une figue avec la pince du bambou avant de la détacher de sa feuille d’un mouvement de rotation du manche. Je dévore ce fruit juteux. Notre cochon se régalera de sa peau que vous aurez fait sécher au soleil.
À l’automne. Je le conduis au pied des chênes. Je remplis mes poches de glands avant qu’il ne les ait tous engloutis. Vous dites que ça donnera un bon goût à sa chair, même si vous appréciez moins ce café que vous obtenez en torréfiant la part de ma récolte.
D’où je me tiens, éloigné du lieu de son supplice, j’entends encore les hurlements de notre cochon. Je sais que tout sera terminé lorsque l’odeur de l’elicriso se répandra dans le village. Cette plante aromatique que l’on enflamme pour brûler ses poils. Je me console. On mangera de la viande à Noël. Le soir, sur la place du village, les adultes comparent à la largeur de leurs doigts joints l’épaisseur du lard de leur cochon, tandis que je cours pieds nus avec les autres enfants derrière un éphémère ballon fait de la vessie de l’animal que l’on a empli d’air.
J’ai un nouveau compagnon. Je galope aux trousses d’une chèvre qui bondit de rocher en rocher. Je l’ai baptisé Campidano, même si elle n’est pas à nous. Je l’accompagne et la surveille là où elle saura dénicher des herbes ou des ronces avant que vous ne tiriez son lait pour le partager à parts égales avec l’homme qui nous l’a confié.
Je me lève avant l’aube. Vous me glissez quelques fruits secs dans les poches : des amandes et des figues dont nous avons fait la réserve l’été. Lorsque je sors de la maison, le paysage est encore plongé dans l’obscurité. Le ciel est parsemé d’une poussière lumineuse. En chemin, je fixe longuement l’étoile du berger qui brille encore tandis que l’aurore éclaire lentement le firmament.
J’entends les cris d’autres enfants du village qui courent après leur chèvre sur ce terrain où la végétation se dispute à la rocaille. Nous nous retrouvons pour partager nos provisions. L’un d’eux accepte d’échanger contre des amandes une part de la polenta qu’il porte dans sa besace.
Nous jouons ensuite. Nous livrons des combats. De tiges d’arbres, nous faisons des arcs et des épées. Une branche de sureau nous tient lieu de fusil. Dans son canal évidé, nous introduisons un gland que propulse l’air comprimé par une baguette de bois enfoncée par l’autre extrémité.
Nous poursuivons notre escapade jusqu’au pont qui franchit le Rio Pardù. Nous nous alignons le long du parapet pour relever le défi qu’un garçon a lancé. On rit, on se moque de Daria qui veut participer à une compétition qui n’est pas pour les filles. Mais elle ne renonce pas. Elle retrousse sa jupe, se met à quatre pattes sur le bord du pont, dos au vide, et urine de toutes ses forces au-delà de ce qu’aucun d’entre nous, debout, le pantalon baissé, ne parvient à atteindre.
J’ouvre les yeux. Je me souviens. Je suis dans ma chambre. Vous êtes en bas, dans la pièce au rez-de-chaussée où vous assistez ma mère qui va accoucher.
Je distingue bientôt les moindres objets de cette chambre sans lumière. Mes yeux se sont accoutumés à l’obscurité lorsque j’étais tout petit. Sur ce chemin que j’empruntais avec vous, à la nuit tombée, sous une voûte constellée d’étoiles, pour aller arroser notre potager. L’eau est précieuse ici. Chacun irrigue son bout de terrain à tour de rôle. Le nôtre arrive parfois tard, lorsque le soleil s’est couché, ce qui ne vous déplaît pas, la terre s’en portera mieux.
J’emboîte votre pas, aussi près de vous que possible pour ne pas me perdre. Nous arrivons sur les lieux. Vous m’expliquez le travail que je dois accomplir pour vous aider. Ce n’est pas très difficile pour un enfant de mon âge. Il importe surtout de ne pas succomber au sommeil : perdu dans l’obscurité à l’autre extrémité de la rigole que vous arrosez, je dois, l'instant venu, annoncer l’arrivée de l'eau jusqu’à moi. Elle ne doit pas déborder, je dois rester vigilant, malgré la fatigue. Dans la pénombre, je perçois ce ruissellement, le devine, mais ne distingue l’eau qu’au dernier instant, lorsqu’elle me rejoint. D’une rigole à l'autre, à intervalles réguliers, ma voix rompt le silence de la nuit et éloigne chaque fois plus difficilement le sommeil qui m'assaille. Mais je n’y tiens plus, je m’accroupis, presque vaincu. Pourtant, il ne faut pas défaillir, je ne dois pas vous décevoir. Alors, j’ai une idée. Je me recroqueville sur moi-même, dans une position où je peux m’assoupir sans crainte de sombrer dans le sommeil, dans l’attente d’une eau dont l'extrême fraîcheur suffira à me réveiller au contact de mes pieds nus que j’ai posés au creux de la rigole.
Je sursaute et bondis hors de mon rêve sous la morsure du froid. Je suis dans mon lit, dans cette chambre, toujours seul. J'entends des gémissements, des plaintes, la voix saccadée de ma mère.
Je n’ai pas peur puisque vous êtes auprès d’elle. J’entends les mots que vous prononcez pour rassurer et calmer votre fille. Vous savez ce qu’il faut faire. Je m’apaise, tout va bien se passer.
Ma mère est forte et courageuse. Tout le monde le sait au village. Plusieurs fois, vous m’avez fait le récit du miracle qu’elle a accompli, il y a moins d’un an de cela, lors de la naissance de ma petite sœur. Souvent, j’imagine l’épreuve qu’elle a vécue ce jourlà. Je me rendors, je la vois en rêve.
Elle est vêtue de sa longue robe sombre, porte un foulard autour de la tête. Elle est seule, tout au fond de la vallée, loin de tous, penchée sur la terre qu’elle travaille comme chaque jour, sans faiblir, malgré ce ventre toujours plus lourd. Elle accomplit ces gestes appris enfant, avec une précision et une rapidité que l’expérience lui a permis d’adapter aux contraintes de son état. Elle ne s’inquiète pas lorsque surviennent les douleurs, lorsqu’elle comprend que le moment est venu.