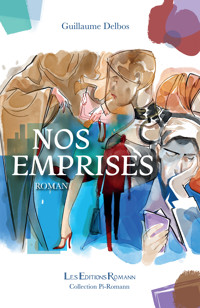
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je suis, comme tout le monde, le téléphone greffé à la main. Je vis au gré des vibrations de ma laisse électronique, mon cœur bat au rythme des notifications d’apps, ma fenêtre sur le monde est un écran.
Lorsque Victor entre en contact avec la célèbre peintre Léopoldine M. sur Instagram pour discuter avec elle de projets professionnels, il ne se doute pas que cette rencontre dériverait en une histoire plus personnelle, proche de l’addiction et de la destruction.
Nos Emprises, c'est l'autopsie d'une emprise relationnelle née des réseaux sociaux, de la déchéance d'une de ses starlettes, et l'analyse de ceux-ci et de cette génération du paraître, déresponsabilisée de ce qu'elle crée, de l’envie, du manque et de l’obsession.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ex-journaliste, Consultant en communication éditoriale, Guillaume Delbos est un amoureux des mots né à Paris en 1979, venu vivre en suisse il y a huit ans. Sa passion de la communication et des mots, il l’a depuis mise au service de sa ville, Genève, en co-créant la Geneva Cocktail Week en 2016, le festival de musique Drone to The bone 10 years fest en 2019, et de nouveaux projets musicaux pour 2023. En dehors de ces activités culturelles et projets de communication qu’il créé au quotidien, son métier, il écrit aussi des poèmes qu’il diffuse sur Instagram, ainsi que des créations de mots, inspirés de jeux de sonorités. Nos Emprises est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Ce livre est dédié à toutes mes futures ex-rencontres.
ZÉRO BATTEMENT PAR MINUTE
LIRE les journaux ne fait pas de mal. Presque toujours. Quelques fois. Là en terrasse de café à en boire un, la clope au bec, je remets ça en doute : gros titres ? « Une femme égorgée à son domicile ». Une photo avec un bandeau noir sur les yeux couvrant un peu le nez et le front. Des lèvres que je reconnaîtrais entre des millions.
Et des larmes de couler silencieusement le long de mes joues.
Birds in Row1 dans mes écouteurs me hurle aux oreilles « It’s us against ourselves and the rest can fucking die » et je ne peux qu’agréer sans entendre, sans me concentrer dessus. Des passants me regardent sans vraiment s’en soucier, le serveur ne m’approche pas, il n’y a que ces mots devant moi en grosses lettres noires. Et les souvenirs qui affluent. J’avais vu le coup venir. Mais avais fait une croix sur elle. Sur ce passé décomposé.
À priori sans vraiment y être parvenu.
Les souvenirs. Nos échanges. Nos rêves, nos envies. Mes craintes. Ses terreurs.
Je pose le journal devant moi et fixe l’autre côté de la rue, sans vraiment avoir de point de contact oculaire.
Je pense sans penser, essaye de trouver un sens.
Me sens lâche aussi. Tellement lâche. Pas battu pour, j’aurais pu. J’aurais dû. Ai fui.
Tellement fui. Il le fallait, je me serais perdu. Encore. Plus que je ne le suis : au contact du vide on s’évide aussi.
La violence psychologique de cette histoire m’avait pris de court et le frissonnement des pleurs sourds sur ma mâchoire m’y replonge.
Je souris un peu en même temps quand même en repensant à tout ce que me disaient mes proches, les « t’en fais pas, il te faut juste du temps, ça va passer » qui en étaient presque devenus un leitmotiv de leur part, ces mêmes personnes qui te font toute une montagne de vraiment rien et qui soudainement, peut-être par peur de ne pas être comme tout le monde, la jalousie malsaine contemporaine de ne pas vivre des problèmes intenses, en étaient devenus philosophes. Ça m’a, ceci dit, permis d’écrémer mon entourage cette histoire. De faire un tri dans mes amitiés.
Même s’ils avaient tous raison sur un point : je n’arrivais plus à penser.
Je ne sais pas si c’est l’époque qui a engendré cela, ce vingt-et-unième siècle angoissant ultra-connecté où tout le monde se travestit derrière un écran, mais nous ne sommes plus que des attentes humaines, et les attentes déçoivent toujours : on se crée nous-mêmes nos attentes, nous faisons nos propres films. Nous accentuons des mots plus que des actes, ne réfléchissons plus, surtout plus avant, tout n’est que réaction. L’aval a avalé l’amont.
Et les conséquences des miennes m’avaient pris de court. Un couple se pose à la table voisine et me dévisage. Sûrement à cause des larmes ai-je pensé, jusqu’à ce que la femme me prenne à partie « je pense que votre cigarette est finie là ».
Effectivement, le mégot est à deux doigts de me les brûler, je ne me rappelle même pas avoir réellement fumé cette clope. Je l’éteins en regardant la femme de mes yeux perdus, et retourne à ma contemplation du trottoir d’en face.
J’ai des choses à régler. Avec moi-même. S’il y a des éclairs de conscience, là, de suite, c’en est un. Six mois que je crois avoir oublié cette femme, la fascination qu’elle avait exercée sur moi, mon envie d’elle, celle qu’elle me disait réciproque. Nos jeux. Six mois apparemment illusoires.
Je repense à ces quatre mois d’elle. De belles angoisses, de beauté, de rires, de contact d’âmes.
De montagnes russes complètes, montées et descentes, de petites notifications sur le téléphone qui m’arrachaient des sourires, pincements de lèvres que je croyais à l’époque tués et enterrés par trop de vécus désagréables.
Je m’égare dans ces pensées sans les parcourir vraiment, vais au-delà sans m’en apercevoir. Pourquoi ne l’ai-je pas aidée quand je le pouvais, quand je le devais ? Comment même avais-je pu me retrouver dans cette relation malsaine qui n’a pas vraiment vu le jour ? Était-ce une relation d’ailleurs ?
Pour elle, oui, c’était son mot, celui qu’elle avait employé. Pour moi, pas exactement, plus l’élan d’un cœur que je croyais mort.
Comme elle aujourd’hui.
Ceci dit, mon complexe du sauveur ne me sauvera jamais, moi. Donc les autres non plus : il faudrait que je le comprenne à force, mais c’est très têtu cette bestiole.
Je me demande si ce complexe n’a pas joué dans cette naissance de désir que j’ai eu envers elle : c’est comme un radar cette merde, il a dû le sentir. M’a fait bifurquer, voir autre chose, croire en autre chose. Sûrement même : je ne savais pas à quoi elle ressemblait quand j’ai commencé à ressentir plus pour elle. Un pur produit de mon époque donc, alimenté par le filtre des écrans.
Je me suis posé beaucoup de questions sans réponses à la suite de cette relation, car ce n’était ni une histoire d’amour avortée, ni de sexe. Plutôt de fascination et de connexion pure. De rires suivis d’incompréhensions, d’incohérences et de mensonges. Je me suis posé des questions. Énormément. Particulièrement sur les connexions que l’on se fait online, celles qui ont pris le pas sur le reste, celles derrière les écrans. Sur les emprises, les obsessions. C’est un peu le récit d’une tristesse trop contemporaine, la nôtre. La vôtre aussi.
Cette femme m’a brisé après m’avoir fait sentir unique.
Nos emprises m’ont détruit.
L’emprise du « pourquoi » m’a mis à terre.
90 BATTEMENTS PAR MINUTE
C’ÉTAIT une autre vie ces quatre mois. Au mois de janvier – nous sommes en novembre d’après le journal –, à mes volontés de projets artistiques que j’avais repoussées d’année en année.
J’avais contacté cette artiste sur un coup de tête, sans même m’en rendre compte, d’un clic inconscient. Son art me parlait. Son univers complet d’ailleurs : ciné, musique, humour, mêmes références, tout concordait.
Tout… c’est bien ce qui a fait merder le tout justement.
Dans osmose, il y a « os ».
J’ai toujours vu comme une injustice du destin de ne savoir ni coudre, ni sculpter, ni peindre, et encore moins dessiner, moi qui ai pourtant grandi en lisant des bandes dessinées, et suis presque incollable en « silver age » de comics Marvel2… mais après avoir essayé maintes fois d’apprendre, je me suis fait une raison : je crains que la coordination entre mes doigts et mon imaginaire ne soit jamais au rendez-vous. Au moins je sais écrire, ça rattrape un peu de ma déception. Me permet de manger aussi, des piges à droite à gauche, bientôt des chroniques. Ça devient compliqué à quarante balais quand même quand on a changé de boîtes, de pays, un peu tout fait. Ça lasse.
Pour comprendre en quoi cette histoire m’a touché – me touche encore – il faut en revenir aux sources, à l’origine du problème.
Je viens de cette génération qui n’a découvert internet qu’à la fin de son adolescence. Celle à qui les parents disaient « sors jouer ». Celle où l’on se donnait rendez-vous avec les potes, des heures en avance. Des cabines téléphoniques où l’on faisait l’effort d’apprendre par cœur les numéros des uns et des autres, sous peine de se rater ou d’attendre indéfiniment pour rien. Celle où l’on invitait les potes des week-ends entiers. Celle où l’on devait réfléchir avant d’agir car les actes avaient plus d’effets que les mots. Mais aussi celle du dialogue, celle où nous nous parlions. Vraiment. De tout, de rien, mais franchement : pas de faux-semblants, quand on s’engueulait – ou non – c’était peut-être la dernière fois que l’on entendait parler de quelqu’un, donc nous vidions le sac.
Ce n’est plus le cas de nos jours avec les réseaux sociaux, et cette illusion de connexion qu’ils créent, en s’y « connectant » : le monde à portée de doigt, mais un doigt, ça bouge de lui-même. « Swipe »3 même, pour reprendre le terme anglais popularisé par une application de rencontre. Je n’ai jamais vraiment eu de véritable connexion – mes mots démissionnaires sont modem, modulent et démodulent – avec quelqu’un en purement online. Il m’a toujours fallu rencontrer la personne pour ça : voir ses mimiques, entendre le ton de sa voix… tout.
Ça fait très vieille école quand je m’écoute penser mais c’est le cas, c’est ce qui fait pour moi la différence entre une connaissance et une connexion.
Léopoldine est mon exception confirmant la règle.
Déjà, j’aimais son prénom : il me faisait penser au morceau du même nom du groupe Ez3kiel. Ensuite, parce que j’ai des besoins d’absolu en culture, je ne peux m’en passer, j’aime lorsque quelqu’un arrive à sublimer le sublime, que le beau me nourrisse et rassasie.
Et il y avait mon projet de livre hybride, celui de nouvelles fantastiques et peintures, ma Divine Comédie de Dante à moi, pour lequel elle aurait été parfaite.
Ce janvier, nous approchions du premier anniversaire de notre ami Covid, d’un an de confinement, et ceci a pu expliquer beaucoup de choses concernant notre perception du monde, car nous nous sommes de plus en plus rivés à nos téléphones et ordinateurs, en constant besoin de contacts même sans contacts. Pour ma part, je vis une période doublement voire triplement compliquée ce mois-ci : des clients mauvais payeurs me doivent une petite fortune, je suis en deuil familial et amical, et je n’ai pas réussi à éprouver quoi que ce soit de sincère, pour qui que ce soit, depuis plusieurs années ; je vivais une espèce d’apathie émotionnelle extrême, de laquelle je me suis presque forcé à sortir de temps en temps, en inventant des sentiments, même faibles, en méthode René Girard, mimant ceux de la personne avec qui je tentais quelque chose. Presque un an de télétravail, avec quelques rendez-vous client de temps à autre quand même, ainsi que les pseudo « déconfinements » partiels, n’ont pas aidé non plus.
Il fallait que je me secoue de ce marasme, comme un cabot de ses puces : avec force et entrain.
Lorsque je contacte Léopoldine via un de ses comptes Instagram, cela fait déjà quelques mois que nous nous suivons mutuellement. Elle avait plusieurs comptes sur ce réseau, comme beaucoup d’artistes, mais chez elle cela dépassait l’entendement. Du moins le mien : un pour ses peintures, un pour ses sculptures, un de secours au cas où ses comptes disparaissent, un personnel, et deux autres… et même aux yeux aguerris d’un communiquant tel que moi, habitué à gérer plusieurs comptes à la fois, ceci était un peu flippant, mais je n’avais pas cette connaissance à l’époque : j’aurais fui avant de l’approcher si j’avais su cela, me méfiant habituellement comme de la Peste des multi-comptes.
Nos échanges de l’époque étaient simples : des likes par-ci par-là, des réactions à des stories, ces partages éphémères de vingt-quatre heures sur les réseaux sociaux devenus plus exutoires que recommandations, mais rien de plus. Enfin, presque, nous faisions déjà pas mal de blagues en accompagnement de nos repartages de stories, ce qui dénotait d’une certaine longueur d’onde commune. Fin décembre je m’étais mis à suivre davantage ce qu’elle faisait, décidé à enfin m’occuper de mon projet plus sérieusement ; lu des interviews qu’elle avait données, dont les contenus étaient assez similaires, et où elle expliquait son art et surtout un point qui me plaisait particulièrement chez elle : la préservation de son anonymat. Léo ne donnait en effet pas son nom de famille, ne se montrait pas, et cela a toujours dénoté à mes yeux une volonté purement artistique, que l’on aime ses œuvres, pas l’individu. Étant donné que de nos jours nous pouvons tout savoir de quelqu’un en écrémant ses réseaux sociaux à partir d’un nom et d’une photo, je trouvais ça bien : quelle que soit la vraie personne derrière ses comptes, cette volonté d’anonymat au profit de son art avait quelque chose de rassurant pour moi. Elle n’est pas la seule à utiliser un pseudo, et c’est d’ailleurs quelque chose que je trouve malin, étant donné qu’être une femme de nos jours, dans notre patriarcat malheureusement loin d’être mort, n’est pas la panacée, alors une artiste, n’en parlons pas : celle-ci a droit au double enfer de sollicitations, pas qu’artistiques.
L’anonymat est de toute façon quelque chose qui me fascine, il me donne toujours envie d’en savoir plus sur la personne même : se protéger à une époque où le peuple ne demande que l’exhibition est attirant au possible. Intelligent aussi, ce mystère faisait indéniablement partie de son succès, et nous nous intéressons bizarrement toujours plus à ce que nous ne savons pas, qu’au connu, la curiosité devenue la norme de notre époque sur-connectée.
Pour être très franc, au-delà de mon envie de travailler avec elle, j’aimais aussi surtout beaucoup ses goûts musicaux, j’ai les mêmes qu’elle à quelques exceptions près : du métal au rap à l’électro, en passant par les classiques, le tout en évitant le mainstream4. J’abhorre le mainstream. Par conséquent, le contact avec elle, tout court, m’intéressait, j’aime parler de son avec les personnes ayant sensiblement les mêmes affinités musicales.
Et artistiquement, ses peintures et sculptures à elle me parlaient particulièrement, justement à cause des sons que j’y voyais, que j’entendais dans son trait. Le bruissement de l’air que je devinais, le frôlement des vêtements sur la peau, les frictions des corps à corps, les clapotements des fluides. La passion fait du bruit, oui, c’est de là que viennent les bruits de la passion.
Les mouvements. C’est une chose particulièrement émouvante pour moi le mouvement : je suis très fêtard, beaucoup de mes amis sont DJ, et je passe énormément de temps à danser. Même seul chez moi les matins en buvant mon café. Et c’est ce qui m’a vraiment attiré dans son art, ce mouvement dans l’immobile : j’ai eu l’impression de me voir moi me mouvoir et ça m’a plu. Son son à elle.
Tout concordait d’accords en accord.
Résultat, nous parlions majoritairement de musique, avant même le projet. Bien avant de me dire « tente, si ça se trouve vous allez collaborer » : c’est primordial pour moi, je n’écris qu’en musique, mes mots sont des notes, un livre ma partition. Les rapports entre les êtres, des sons. Le déclencheur ici ? Un morceau que je n’avais pas entendu depuis dix ans, une plongée en arrière de deux décennies, une track d’électro-punk et les soirées underground communiquées à la dernière minute qui s’y rattachaient dans mes souvenirs, parce que plus qu’à moitié illégales et pleines d’illégal. L’échange avait été poli, bref, rien de bien spécial, mais il m’avait permis de savoir que malgré son importante base de followers5 elle répondait aux messages. Même si ce mois, j’avais aussi commencé à partager son travail, notamment une encyclopédie qu’elle était en train d’illustrer, et à laquelle participaient deux de mes contacts, parce que l’art avant tout.
Mi-janvier ceci dit, Léo elle aussi se mit à partager mes écrits via son compte, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant, et faisait peu – les autres tout court, et je me suis mis à rêver que ma façon d’écrire, mes mots, lui plaisaient. Ça m’a fait du bien, flattait mon peu d’ego, et il faut dire qu’avec ces trois années difficiles que je venais de subir, cette simplicité et – je le pensais – générosité m’ont touché en plein cœur. Surtout que les échanges se faisaient dans le rire. Tellement de rires.
Cette légèreté était donc la bienvenue à ce moment de ma vie. Ce contact aussi : nous sommes en 2021, ça fait vingt-et-un ans que je bosse avec internet, et je suis, comme tout le monde, le téléphone greffé à la main. Je vis au gré des vibrations de ma laisse électronique, mon cœur bat au rythme des notifications d’apps6, ma fenêtre sur le monde est un écran.
Et c’est par conséquent l’esprit un peu embrumé, un matin du 14 janvier, que je lui demande pour mon projet, via une conversation eue sur son compte personnel, celui dont elle ne se sert pas pour travailler, mais sur lequel elle m’avait ajouté fin décembre. Pas une seule seconde je n’avais pensé qu’elle accepterait ma proposition, et j’ai donc été agréablement déçu de mon pessimisme, à la lecture de ces mots « je reste à ta dispo pour parler de ton projet. Pour info je suis bookée jusqu’à fin février ».
Je crois qu’il y a toujours un moment entre deux êtres, que ce soit professionnellement, amicalement, ou plus, qui fait basculer leur dynamique : le mien a été celui-là. Avant, nous n’avions que des échanges cordiaux, comme il y en a tant sur les réseaux sociaux, tous des inconnus se comportant comme de vieilles connaissances les uns avec les autres – quelques fois même plus familièrement que les vieilles connaissances – mais depuis, la personne derrière l’écran m’était devenue réelle. Un être humain, pas seulement une imposition algorithmique, je voyais une personne derrière les un et les zéro.
De cet instant, comme un interrupteur actionné, était aussi née une certaine emprise : l’expectative de voir ses posts, ses stories, ses commentaires et likes sur mes publications, et nos messages et réactions diverses à nos activités, était devenue impérieuse. Une sorte de danse. Une séduction.
Il faut bien avouer que tout est de toute façon un peu « flirt » avec les réseaux sociaux. L’absence de contact floute la frontière et peut empêcher de savoir si c’en est vraiment, ou non. Pour cela que je dis que je n’ai jamais eu de réelle connexion avec quelqu’un en purement digital, et qu’il me faut rencontrer la personne pour que ça arrive, qu’il me faut du physique quand même, y compris pour de l’amitié : les intonations, les gestuelles et les jeux de regard, permettent de mieux savoir. Les appareils photo greffés aux téléphones ont un tout petit peu changé la donne, mais n’étant pas photogénique pour deux sous, j’ai du mal à faire confiance aux personnes l’étant : ce qui semble trop beau cache quelque chose aux yeux des suspicieux. J’ai eu ceci dit quelques histoires nées du digital, pas que sur des sites de rencontre, aussi d’Instagram ou Facebook. Exemple mon ex, une artiste d’une gentillesse et d’une maturité étonnante pour son âge, qui m’avait fait voir un peu différemment mes échecs de rencontre de l’online vers le réel, et je ne m’étais donc pas posé de questions au début avec Léo, surtout que je ne l’avais pas contactée pour ça.
Savoir qu’une peintre, dont le travail et les goûts me fascinaient, acceptait de travailler avec moi, a cependant créé une certaine réalité tangible de la personne, malgré ne l’avoir pourtant jamais vue, pas même en photo. Un peu plus d’être. Moins de paraître. Un peu comme si je l’avais croisée dans la rue. Ça aurait pu, nous avions d’ailleurs déjà été aux mêmes concerts et soirées dans le passé, nous avons découvert cela plus tard.
Léopoldine n’était donc plus un pixel, mais dorénavant une femme. Même lorsque nous avions auparavant blagué sur une story où elle parlait du célibat, sur son compte personnel, elle n’avait pas encore été « humaine » pour ma conscience à ce moment-là, malgré le caractère intime de cette conversation ; juste une image, un concept. Un peu comme dans les films où des voyageurs temporels découvrent la télévision, et pensent qu’il y a dans une lucarne des êtres liliputiens bien dressés et infatigables divertissant le monde. Ceci avait donc changé. Du tout au tout, du sang dans l’éther. Du délétère aussi.
Nos échanges en sont devenus plus fréquents, plus directs. Avec une pointe de séduction pas prévue de ma part – et surtout pas de la sienne – au travers d’une fougue dans les compliments que je fais tout le temps aux gens. Je ne m’en étais pas rendu compte moi, je fais souvent des compliments de façon à voir les personnes autour de moi heureuses. Mais une des femmes que je fréquentais à l’époque – de nos jours, si l’on n’officialise pas une relation, c’est une « fréquentation » – me le fit remarquer, l’ego blessé : « nous, on pue presque quand tu partages nos créations sur Instagram, mais elle, tu ne manques pas de superlatifs, hein ? C’est quoi le truc, tu veux te la faire ? ». Bonne question. Non. Pas à ce moment-là. Ma situation me convenait bien quand j’y songe. Néanmoins je voulais faire cette collaboration.
Léo n’était pas disponible pour que je lui présente mon projet de livre conceptuel en janvier, et il me fallait attendre le mois de mars pour que nous en parlions. Cependant, ce mois et demi de janvier tirant sur le février nous a fait vriller, car au milieu des partages, des promotions faites de nos comptes, des commentaires, de tout, s’est glissé quelque chose d’insidieux : les mots utilisés de part et d’autre étaient peut-être un peu trop enjoués pour être innocents, et en privé les conversations ont commencé à devenir très personnelles. Même actuellement, malgré le recul, je n’arrive pas à comprendre comment cela avait pu basculer. Je trouvais mon comportement normal avec elle, et réciproque : je l’encourageais dans son travail et lui faisais des blagues, la complimentais, pas que sur son art car je l’avais enfin vue, une photo sur son compte personnel, très Godard, qui avait titillé l’amoureux du septième art que je suis. De son côté, elle réagissait peut-être trop à mes activités digitales, et ne cessait de m’envoyer des cœurs et des compliments également, ce qui a pu faire pencher la balance. Nous étions comme des ados devant une nouvelle rencontre. Des prémices du pire.
Lorsque ma fréquentation du moment – appelons-la F. – m’avait fait son reproche, orgueil froissé en étendard, je ne m’étais pas aperçu de certains de mes comportements, mais quelque chose en moi s’était apparemment brisé : ma résistance à ressentir quelque chose. L’inconscient porte très bien son nom ceci dit, sur tous les plans.
Ce début février donc, F., que je ne vois qu’une fois toutes les deux semaines – bien suffisant –, m’expose au grand jour mes désirs inconscients privés, suite à des explosions d’affections publiques. L’une des plus belles prouesses d’internet, ce qu’il y a de bien avec, ou de pernicieux, est que tous nos gestes, actes, paroles, y compris infimes et infirmes, sont auscultés et passés au crible par tous ; relevés pour mise en exergue ; si bien que nous nous mettons à douter de nos propres intentions, jusqu’à en être parfois influencés.
Et F. de me sortir de mes pensées introspectives :
— Alors ? Tu réponds ?
— Non. J’ai envie de bosser avec elle. Pas pareil. Je ne vois pas trop en quoi ça te concerne ceci dit.
— Ça me vexe : quand tu fais sa promo, il y a tellement d’éloges et d’élans qu’on en arrive presque à se sentir nulle. Et moche.
— Écoute, j’adore ce qu’elle fait, il y a une raison au fait que je veuille bosser avec elle. Et oui, elle est belle, je viens de voir ça. Et drôle aussi. Et j’aime son univers. Mais c’est Instagram, pas Instagramunmec, faut arrêter de voir le mal partout, même si de toute façon, ça ne te regarde pas, tu le sais, et le pire, c’est que tu t’en fous, c’est juste ton égo qui parle. Je ne l’ai pas contactée pour me la faire, je m’en fous de ça, donc stop. Merci.
La conversation en était restée là, mais avait jeté un froid sur notre semblant de relation car elle avait vu juste, c’était moi qui m’étais mis des œillères. Nous avons mis un terme à nos rencontres après ce weekend, tout en se promettant mutuellement de rester potes. Le grand truc actuel, c’est soit de coucher avec ses potes, soit de toute façon rester potes. J’ai un peu de mal avec ça, pas de ma génération, la mienne vient d’avant internet, d’avant le concept de « plan cul », ce truc créé par l’industrie des sites de rencontre pour remplacer l’amante et l’amant : pour un site, ce n’est pas assez profitable que tu ne sois pas célibataire, seulement déçu tous les six ou huit mois, tu n’y reviens pas assez. Trois mois, c’est mieux. Et puis, dans « sex friend », il y a ami, donc ces catalogues online de la solitude t’ont appris qu’il était normal de coucher avec ses potes. Comme si ce n’était pas assez compliqué de trouver quelqu’un qui nous plaise et à qui l’on plaît, nous avons de nos jours aussi tué la notion d’amitié, et vu que je trouve qu’il est presque plus difficile de se faire des vrais amis que des partenaires, pourrir aussi ces relations… ? Chapeau internet, je m’incline plus bas que terre, je touche l’Enfer.
Ce que j’entends par « ma génération », c’est ce que les marketeurs ont appelé les Xennials, entre la génération X et la génération Y. La génération abandonnée, celle ayant toutes les tares de la génération X et aucun des avantages de la Y. Nous sommes désabusés, avons dû nous débrouiller par nous-mêmes, sommes nihilistes au possible et avons vécu l’avènement du web en sortant de nos études. À la fois connectés et complètement hors du temps. Je crois d’ailleurs que c’est pour cela que moi j’ai grandi dans les livres et bandes dessinées, et surtout un casque hurlant des sons vissé sur le crâne. Les groupes de musique du début des années quatre-vingt-dix en ont même façonné ma façon d’écrire, et je me reconnais tellement dans les paroles du morceau de F.F.F. « Le Pire et le Meilleur » que celle-ci en sont presque devenues ma ligne de conduite, ma façon de me comporter au jour le jour, tous les jours, depuis toujours. Le plus gros inconvénient à être de cette génération est le fait que l’on est toujours légèrement excentré du reste : nous avons ce recul sur tout, tout le temps, qui nous fait réfléchir à tout, tout le temps. À s’en paralyser souvent. Une retenue qui malheureusement nous fait exploser en cocotte-minute aussi.
Ma génération dérange et se dérange, et c’est probablement pour cela que nous nous bourrons autant la gueule, la défonçons d’autant, et sommes incapables de rester longtemps avec la même personne. Inadaptés complets adaptés à l’incomplet.
Nous sommes néanmoins restés amis F. et moi, malgré mon aversion des obligations générationnelles. Le sommes encore, nous appelons de temps en temps pour se raconter nos galères. Y compris celle que je m’apprête à vivre.
À cette période, je suis aussi, pour une raison que je ne m’explique pas, nostalgique de tout. De mes anciennes relations, de mes vieux potes pas vus depuis très longtemps – nous sommes confinés ceci dit, ce peut être une des raisons –, j’écoute beaucoup de musique des 80s, Bowie en tête, presque chaque matin « Don’t you (forget about me) » de Simple Minds, et danse seul chez moi pour me réveiller. Je me discipline aussi à poster chaque jour un poème mâtiné de sexualité, pour ne pas perdre la main, avant de pouvoir passer à mon œuvre plus papier : Léo me les like et commente tous, que ce soit avec son compte professionnel ou son compte personnel, ou les deux à la fois, comme si la femme et l’artiste me voulaient du bien toutes les deux. Et moi de vraiment me dire que mes écrits lui plaisent, et que fin février nous allons bosser ensemble, ce qui me fait écrire davantage. Ouroboros de l’écriture, auto-alimentation.
La teneur de nos échanges ne se cantonne dorénavant quasiment plus à son art ceci dit, mais plutôt à des blagues en réaction à nos délires en stories : des envolées lyriques sur des films tels que « C’est arrivé près de chez vous » et le petit Grégory – de mauvais goût mais j’aime le trash et elle aussi – résultants à une demande en mariage de ma part pour rire, et qui me fait savoir qu’elle est mariée, ou de Chuck Norris – pour lequel j’assume une passion nanardesque épouvantable – lorsque je place en story sa mythique réplique « je mets les pieds où je veux Little John, et c’est souvent dans la gueule », à laquelle elle me répond en privé que c’est sa citation préférée – mais tout le monde aime Chuck et si pas le cas il vous fera l’aimer. Beaucoup de musique et d’un festival que j’avais organisé avec un pote, ce qu’elle trouve épatant ; me trouve d’ailleurs très humble dans ma façon de présenter la chose, mais je ne me considère que comme l’aide de mon ami concernant cet événement ; l’épatant pour moi, c’est lui. Étant très arrogant en règle générale, ça me fait toujours bizarre lorsque l’on me qualifie d’humble… pas ma plus grande qualité, mais ça m’avait flatté qu’elle le pense.
Début de ce mois donc, nos conversations auxquelles s’ajoutent mes divagations mêlées d’éloges quotidiens, pour moralement l’épauler dans sa tâche – jour et nuit car je suis comme elle, pas un gros dormeur –, m’inspirent même un poème que je lui dédie, sans toutefois la taguer ou la mentionner. Écrit qu’elle adore, au point de me proposer de boire un verre lors d’un de ses prochains vernissages, ce qui finit d’asseoir dans ma tête l’idée que nous allons travailler ensemble une fois son rush terminé, bien que je comptais déjà lui dire de se prendre une semaine de repos avant quand même : j’aime savoir les gens au meilleur de leur forme. Ça m’avait surpris sur le moment d’écrire grâce à elle ceci dit, qu’elle m’inspire, je n’écris pas sur les gens, même sur mes muses, mais là ça avait été le cas, et j’en étais plutôt satisfait : cet écrit autour du son chantait littéralement.
Nos conversations ce mois ont aussi un côté très « schizophrène », car nous parlons ensemble via plusieurs de ses comptes, quelques fois de la même chose, ce qui a pour effet un rendu étrange : les discussions sont les mêmes avec l’artiste et la femme, mais sur deux supports différents, comme s’il y avait deux personnes. Troublant. Des jumelles siamoises par les doigts mais deux discours identiques sur deux supports. Deux voix à l’unisson. Trois avec la mienne. Surtout, celles-ci vont crescendo, deviennent plus intimes, nous parlons de sa santé, de l’envers du décor, et rions. De tout. Beaucoup. Nous dissertons surtout sur nous, de moins en moins d’art et de ce qui entoure les nôtres, ainsi que sur les « mèmes »7 et autres bêtises que nous partageons sans cesse : nous sommes en 2021, le mème bat son plein depuis quelque temps déjà, et davantage depuis ce 2020 empreint d’un confinement planétaire covidesque, de deux longues années ressenties quinze.
Je commence aussi à ne presque plus passer que via son compte personnel pour parler avec elle, et Léo interagit elle-même également plus avec moi sur celui-ci. Une chose pareille, qui a l’apparence de l’anodin, a d’autres significations dans la sphère digitale : un rapprochement sans rapprochement, un pixel après l’autre. Comme si l’on était invité à entrer chez quelqu’un. Une certaine distinction qui a changé davantage nos rapports.
Dernière semaine de février pour être exact. En trois jours :
La comparaison que j’avais faite entre la photo d’elle post-ado sur son compte privé et cette actrice de la Nouvelle Vague que j’aimais beaucoup, à laquelle elle m’avait répondu être plus que flattée.
Suivie le lendemain de ses mots « j’aimerais tellement correspondre à ce que tu penses de moi, c’est si beau… » en réponse à un de mes encouragements quotidiens de lutte contre le burnout, qui disait « tu es une splendide destruction absolue », et de l’idée qu’elle a fait germer en moi que mon regard sur elle lui était précieux.
Suivie le surlendemain d’un de nos délires en réponse à une de ses stories :
— Ce truc est génial, je viens de m’étouffer en buvant hahaha.
— Non, c’est pas le moment de me lâcher dis !
— Je ne pars pas ne t’en fais pas : j’ai étudié le célèbre philosophe Patrick Swayze, il te suffira de faire de la poterie et je me transformerai en gentil fantôme sexy à tes côtés.
— Hahaha, j’adore quand tu pars loin !
— … Oh… merde, tu vas vraiment m’adorer au plus haut d’essieux quand je suis à cent pour cent en roue libre, pas à jeun du tout alors. Oui, je fais des jeux de mots pourris, mais je les assume. Ceci n’a aussi rien à voir avec une proposition de week-end à Agen, je n’y suis jamais allé, mais je ne pense pas que nous raterions grand-chose à part leur musée de la tourista. Et puis, hey, oh, la fille qui imagine des gens faire des sudokus sponsorisés Biactol avec leurs peaux là, c’est moi qui vais loin !? C’est l’hôpital qui se fout de la nudité dis donc !
— Ok on est bien perchés ! C’est un match.
Les folies rapprochent, même éloignés, et deux personnes un peu beaucoup à bout qui ne se connaissent pas, mais se retrouvent dans des divagations assez orbitales, ce n’est pas tous les jours. Résultat, nous ne faisons plus que ça, presque, et de ne parler que de nous, surtout.
Nous sommes fin février, et alors que je ne voulais que travailler avec quelqu’un dont j’admirais le talent, je me retrouve à lui préférer la femme : je ne veux qu’en savoir plus sur elle, n’avoir que des rires, l’art est passé au second plan. Elle n’est pas une pote, pas une amante, pas non plus une relation virtuelle comme il peut y en avoir beaucoup, mais une envie pure dénuée de logique, et je garde en tête que, si nous travaillons ensemble, il faudra bien se rencontrer à un moment donné. Au moins, à ce moment-là, la définition de cette relation était encore simple : un balbutiement. J’aime bien ce mot.





























