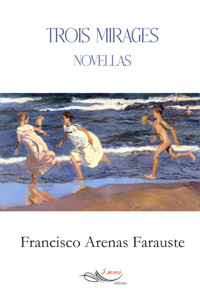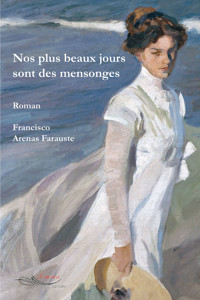
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une simple lettre peut-elle changer le cours d’une vie ? Un courrier inattendu, reçu un jour ordinaire, peut-il subitement éclairer les événements de notre passé d’une lumière nouvelle et ainsi changer notre destin ? Dans le Paris du tournant du XXe siècle, des révélations étonnantes bouleversent notre héroïne, Mathie, et lui font brutalement prendre conscience des mensonges qui ont brouillé sa compréhension des principales étapes de son existence.
« Nos plus beaux jours sont des mensonges » est également un roman moderne sur la puissance de l’écriture au service de l’imagination. Dans quelle mesure, l’écrit peut-il modeler et altérer notre perception de la réalité ? Ce déploiement de fantaisie et d’enchantement nous interroge aussi sur notre conception du bonheur : vaut-il mieux vivre heureux dans l’illusion ou malheureux dans la réalité ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Francisco Arenas Farauste est né en Espagne et vit désormais en Suisse. Autodidacte curieux, il observe le genre humain et essaye, à sa façon, de témoigner des absurdités, des folies de ce monde. Après un premier roman « Le comte foudroyé » et un recueil de nouvelles « Huit mille », « Nos plus beaux jours sont des mensonges » est son deuxième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Arenas Farauste
Nos plus beaux jours sont des mensonges
Du même auteur
– Le comte foudroyé, roman
5 Sens Editions, 2022
– Huit mille, recueil de nouvelles
5 Sens Editions, 2022
Pour Zachary
« La vie et le mensonge sont synonymes. »
Fiodor Dostoïevski
Chapitre I
La lettre arriva ce matin-là.
Rien ne distingua cette aube de novembre des autres petits jours. Le vent froid s’abattait sur Paris, et les rues désertes semblaient grelotter sous la bruine fine qui lustrait les pavés.
L’air humide tremblait par instants, troublé par les brumes opaques qui se dégageaient des entresols. S’évaporant dans l’aurore, ces signaux de fumée grasse signalaient la présence de la multitude invisible et silencieuse des domestiques.
Au numéro 8 de la rue de l’Arcade, tout près de l’Opéra Garnier, s’élevait l’hôtel particulier de Prosper de Barante. Replié sur lui-même, l’élégant édifice sommeillait, encore enveloppé par la chaleur de l’âtre de la cheminée monumentale de la cuisine.
Devant le foyer crépitant, le valet responsable du four attisait frénétiquement les braises dans le dessein d’atteindre la température adéquate à la confection des viennoiseries. La senteur du bois en feu imprégnait la pièce et les charbons fumants étaient placés précautionneusement dans le four à pain qui trônait dans un des angles de l’office.
Le commis boulanger, à peine réveillé, s’était mis à pétrir la pâte, le regard rougi par la fatigue, les mains blanchies par la farine. C’est au milieu de cette agitation matutinale que le second valet Dreymond apporta la lettre trouvée sur le palier de la porte cochère. Il ne s’agissait pas là d’un courrier ordinaire.
Il était très différent de la correspondance habituelle qui arrivait au 8 rue de l’Arcade. Pas de papier vélin au grain soyeux, pas de bristol invitant les propriétaires de l’hôtel à un dîner mondain ; il n’était pas filigrané et ne portait aucunes armoiries.
Au contraire, le pli était épais, rugueux, écrit sur un support grossier. Un papier fabriqué à la cuve comme autrefois et produit feuille à feuille. Le nom de la destinataire avait été apposé sommairement sur la première page qui recouvrait les autres feuillets. Une ficelle de chanvre bien serrée ceignait le tout. On pouvait simplement lire : « Pour Mathie ».
Les feuilles traversèrent l’hôtel particulier tel un bateau porté par sa voile, glissèrent sur les parquets en point de Hongrie, flottèrent au-dessus de l’escalier monumental en pierre blonde. Elles furent portées de main en main jusqu’à un petit secrétaire situé en face d’une fenêtre dont l’espagnolette, aux yeux ovales finement ciselés, semblait regarder avec incrédulité l’arrivée de cette missive.
Le froid au bout des doigts, Mathie se releva. Elle caressa ses cheveux défaits et les rassembla pour créer un chignon sommaire qu’elle fit tenir sur le sommet de sa tête grâce à un petit peigne en or et ivoire.
Debout dans la pièce, vêtue de sa robe de chambre, Mathie observa le courrier en s’interrogeant intérieurement. Qui pouvait bien en être l’expéditeur ? Elle essaya d’inventorier les possibilités, mais l’air glacial qui filtrait à travers les joints des carreaux écourta ses réflexions. Elle se dirigea vers le secrétaire et saisit le paquet de feuillets.
Mathie était une femme délicate d’une cinquantaine d’années, dotée d’une élégance naturelle que rehaussaient ses yeux bleu clair. Un regard sur lequel il était impossible d’ajuster la focale. La dévisager donnait immanquablement la curieuse sensation d’être en face d’une personne malaisée à saisir. Son visage à l’ovale harmonieux la faisait ressembler à une statue grecque dont le marbre blanc aurait été remplacé par le bronze de sa peau cuivrée.
« Belle et mystérieuse », c’est ainsi que l’on décrivait le plus souvent Mathie.
La ficelle céda avec difficulté et l’aide de petits ciseaux à coudre fut nécessaire pour soulager l’impatience de Mathie. La blancheur de la première page apparut sous la faible lumière d’une lampe à incandescence.
La lettre était constituée d’une quinzaine de feuillets pliés en trois, ils n’étaient pas numérotés et aucune date ne figurait sur la première ou la dernière page. Nulle signature et aucun nom ne semblaient se détacher du contenu.
Inconnue, et pourtant familière, l’écriture ressemblait à autant de griffures sur les fibres du papier, l’encre noir délavé avait viré au brun et ses nuances s’apparentaient à du sang séché.
Quelques phrases énigmatiques constituaient l’introduction du courrier.
Mathilde, Mathie, Mon amour,
Je t’ai toujours menti. Du premier jour, lorsque je t’ai aperçue, au dernier instant lorsque tu as disparu. Te souviens-tu de ce matin-là ? Il ne faisait ni chaud ni froid, il n’y avait que toi, ce matin-là…
Elle serra les feuilles entre ses doigts, les froissant légèrement. Le bruissement du papier fut un soupir qui la fit sursauter. Elle leva alors les yeux et fixa la faible lumière du soleil de novembre qui jetait des ombres noires sur la façade de l’aile ouest de l’hôtel particulier.
Chapitre II
Le propriétaire de cette façade ainsi que de l’ensemble du 8 rue de l’Arcade était le baron Prosper de Barante. Issu de la petite noblesse picarde, il possédait cependant une immense fortune. Napoléon Ier avait accordé en son temps ce titre nobiliaire à son père, Antonio Barrantes, qui n’était alors qu’un modeste espion madrilène.
En effet, en 1808, lors de la prise de Madrid par les légions impériales, le patriarche Antonio Barrantes avait fourni à l’état-major français des informations cruciales sur la déliquescente armée espagnole. Il en fut généreusement récompensé. Le titre de baron lui fut attribué, une rente convenable accordée, et quelques terres situées au nord de la Picardie cédées. La taupe castillane fit alors construire un château de style néo-mudéjar non loin d’Amiens.
Dès son inauguration, la demeure attira une foule considérable, surprise par l’audace de l’architecture et charmée par l’épouse du désormais « Baron de Barante ». Sa femme, Edmée, était une beauté locale qui avait eu la faiblesse de céder à l’exotisme du jeune Antonio.
Pendant quelques décennies, la baronnie vécut dans une certaine léthargie jusqu’à l’irruption inopinée d’un tubercule. La betterave sucrière transforma à jamais la relative modestie de la famille de Barante. À partir de 1830, le sucre de betterave l’emporta de fait sur le sucre de raisin et parvint à concurrencer progressivement le sucre de canne.
Or, le fief des barons se prêtait particulièrement bien à la culture betteravière, la famille se lança donc dans le raffinage avec beaucoup de succès. Des raffineries sortirent de terre, des cheminées s’élevèrent, des cuves fumantes ouvrirent leurs gueules pour déverser des tonnes de sucre cristallisé qui envahirent les marchés.
Les barons profitèrent aussitôt de cette manne. Fils aîné d’Antonio, Prosper de Barante fit fructifier la Compagnie des Sucres Picards avec une certaine habileté et un sens inné de la flagornerie. Il bénéficia de la duplicité de fonctionnaires peu scrupuleux qu’il sucrait au passage.
Les permis de construire étaient délivrés en quelques jours, et il n’était pas rare que Prosper obtienne l’aide d’un régiment de dragons de manière à réprimer sévèrement les grèves fort courantes à cette époque.
Les autres membres de la famille s’effacèrent naturellement, et Prosper, qui portait bien son prénom, devint à lui seul le directeur général de la Compagnie. De surcroît, il augmenta exponentiellement les bénéfices de la société en diversifiant sa production grâce à l’importation à moindre coût de sucre de canne provenant de la Martinique.
Mais le baron était aussi un personnage excentrique, et son physique à mi-chemin entre le pingouin et la chouette intriguait. Ses bras courts s’agitaient sans cesse pour souligner une phrase ou une exclamation tandis que ses grands yeux immobiles vous fixaient dans une perpétuelle interrogation. Prosper donnait l’impression d’être un automate constitué de pièces disparates qu’un horloger distrait aurait assemblées dans le désordre.
Lorsque le Palais Garnier sortit de terre en 1875, Prosper décida immédiatement de s’installer à proximité de l’édifice dans le but d’assister fiévreusement à chaque nouvelle représentation. Au 8 rue de l’Arcade, une parcelle qui appartenait à un marchand de vin fut sélectionnée, achetée à grands frais, et l’on fit appel à un architecte prestigieux pour construire un hôtel particulier.
Le luxe et l’élégance caractérisaient l’hôtel de Barante, rien n’avait été laissé au hasard afin que le lieu dégageât une sérénité raffinée. Un escalier monumental, situé à l’entrée, desservait un premier étage composé de salons en enfilade que des cheminées en marbre tentaient d’arracher au froid hivernal. Les chambres de la famille se situaient au deuxième et donnaient sur une cour privée abritant un petit jardin à la française. Enfin, les étages supérieurs logeaient la troupe de domestiques qui assurait l’entretien de l’hôtel et le confort des barons.
Environ une vingtaine d’employés y travaillaient à demeure. Du bas en haut de l’échelle, les commis, les cuisiniers, les femmes de chambre, les valets de deuxième et premier rangs, et enfin Célestin, le majordome, composaient cette brigade.
Tout était à sa place, selon un ordonnancement à la fois complexe et méticuleux.
Désormais centenaire, on attribuait l’extraordinaire longévité de Prosper à son incroyable capacité d’émerveillement, à sa curiosité inextinguible. Au cours de sa vie, il n’avait pas eu assez de temps pour découvrir suffisamment de merveilles, suffisamment de facettes de l’humanité. Aussi la mort attendrait-elle son tour !
Amateur de fêtes excentriques, le baron avait toujours organisé des banquets qui s’étaient succédé au fil des années à un rythme effréné. Particulièrement friand de soirées costumées, il sélectionnait les thèmes les plus saugrenus, tels que « les rois défroqués d’Angleterre », « une pastorale italienne » ou encore « les symphonies barbares ». Le baron était taquin, il aimait surprendre ses hôtes. Parfois, une cantatrice célèbre ou un poète reconnu faisait irruption au beau milieu d’une de ces fameuses soirées afin d’interpréter une aria ou de déclamer quelques vers inédits.
La seule gestion de la Compagnie n’ayant su rassasier son esprit, la dimension festive occupait une part importante de son existence. Même en fin de vie, il continuait de s’amuser, notamment lors des visites de potentiels partenaires en affaires qui lui proposaient des diversifications dans des domaines aussi variés que la vanille de Madagascar ou les essences de bois précieux. Pendant ces entrevues, Prosper de Barante aimait se déguiser en nègre ou en Indochinois dans l’intention de divertir ses visiteurs, mais surtout de manière à éviter d’aborder des sujets qu’il jugeait désormais fastidieux ou peu dignes d’intérêt.
Enfin, son plaisir passait également par sa famille. En effet, outre l’armée de domestiques, l’hôtel hébergeait l’unique héritier, Albert de Barante, un fils à qui la personnalité du père n’avait guère laissé que quelques miettes. Et surtout, le joyau de la demeure, la cadette, la fille chérie du baron, sa préférée, Mathilde de Barante. Veuve depuis quelque temps, elle avait comblé Prosper en lui donnant deux petits-fils.
Chapitre III
Mathilde, Mathie, mon amour,
Je t’ai toujours menti. Du premier jour, lorsque je t’ai aperçue, au dernier instant lorsque tu as disparu. Te souviens-tu de ce matin-là ? Il ne faisait ni chaud ni froid, il n’y avait que toi, ce matin-là…
Longtemps, j’ai cherché les mots, car je ne les possédais pas. Ceux que je maîtrisais étaient trop petits. Alors, quelqu’un m’a aidé à traduire mes sentiments.
Il m’a soufflé les phrases qui te transmettront, peut-être, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je suis. Avec lui, j’ai cessé de prospecter, car les mots prétentieux ne servent finalement qu’à masquer l’exactitude sous une couche de superficialité.
Cet homme m’a affirmé : « Comme la vérité, les mots doivent être simples pour être justes. »
Alors voilà, je suis un menteur.
Et un menteur a toujours une bonne raison de mentir. La peur, la compassion, l’envie. Protéger les siens, s’empêcher de souffrir ou de faire souffrir. Ne pas heurter, ne pas abandonner, ne pas lâcher.
Or mentir, c’est avant tout se perdre. Le mensonge nous désoriente dans son labyrinthe. On ne peut être soi-même dans le mensonge. Il ronge et pourrit nos consciences. Il détruit nos amitiés, gâte nos familles, flétrit nos amants. Ô, crois-moi mon amour, j’ai essayé de ne pas mentir. Mais le mensonge est toujours revenu à moi, sans cesse. D’abord un petit, un tout petit sans importance, si minuscule qu’il était à peine un soupir.
Puis un plus gros, de plus en plus grand, de plus en plus large.
À la fin, en réalité, le mensonge a consumé tout l’oxygène de ma vie. Il entrait par la fenêtre entrouverte et emplissait l’espace, grimpait sur les murs. Envahissait la chambre à coucher, se cachait dans les armoires.
Il était partout ! Ma vie était assiégée par le mensonge ! Je luttais contre cet ennemi invisible que j’avais moi-même créé et qui dévorait chacune de mes minutes. J’étais tellement occupé à survivre au moyen de mes dissimulations que j’en oubliais tout autre chose.
Mathie se laissa tomber sur le lit défait, son esprit tentait de comprendre le sens des mots qui défilaient devant ses yeux telle une procession de fantômes. Elle reprit sa lecture.
Pendant des mois, l’imposture et toi, vous avez constitué mes uniques compagnes. Dès lors, comment t’expliquer mon histoire, la vraie ? Puis-je vraiment la connaître ?
N’est-elle pas qu’une déformation ? N’est-elle pas la fille de mes mensonges ? Je ne sais pas. Je vais essayer de te la raconter avec autant de sincérité que possible, tel que je l’ai ressentie.
Mais au fond, peut-être, ce récit n’est-il aussi qu’un mensonge. Une fable, une aventure que j’ai décidé de créer pour tenter de me rendre plus acceptable, plus présentable à tes yeux.