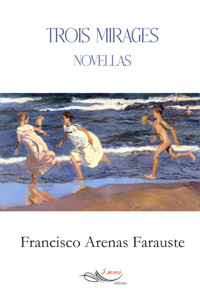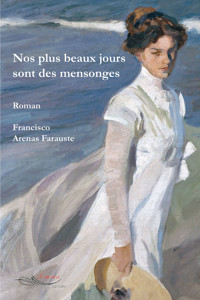Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce récit est celui d’un coup de foudre ! Intense, incontrôlable ! Ce choc va plonger notre héros, un comte sévillan désargenté, dans un voyage à travers l’Europe des « années folles » où sa vie va se mélanger avec celles de trois autres personnages. Leurs existences convergeront lors d’un final inattendu. Mais, le « comte foudroyé » est aussi un roman sur les rêves dont nous nous sommes encombrés. Ceux qui nous font percevoir le monde tel que nous souhaiterions qu’il soit. Avons-nous vraiment conscience des situations réelles dans lesquels nous nous trouvons ? Les apparences ne sont-elles pas reines ? Ne sommes-nous pas tous ensorcelés par ces mirages qui nous masquent la réalité ? Allégorie des illusions numériques si actuelles, l’auteur a voulu projeter l’aveuglement par l’apparence sur le théâtre de l’Europe d’il y a un siècle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Francisco Arenas Farauste est né en Espagne et vit désormais en Suisse. Autodidacte curieux, il observe le genre humain et essaye, à sa façon, de témoigner des absurdités et des folies de ce monde. « Le comte foudroyé » est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francisco Arenas Farauste
Le comte foudroyé
Roman
Pour Lea
Chapitre I – La rencontre
Pedro Sanchez de Tendilla n’aimait pas la lente monotonie des dimanches après-midi lorsque le soleil descendait sur l’horizon et éclairait les visages de sa mère et de sa tante de rayons peu flatteurs pour leurs faciès ridés ornés, ici et là, de verrues velues.
Pedro n’avait qu’une envie lors de ces moments d’oisiveté, prendre ses jambes à son cou et se perdre dans les dédales de la vieille ville. Laisser son esprit vagabonder entre deux ruelles et découvrir des lieux inconnus cachés dans le ventre de la cité.
Comte sévillan désargenté, Pedro aimait à penser qu’il faisait partie de la caste des élus, des privilégiés, des nantis. Persuadé d’être promis à un destin exceptionnel, il avait une haute opinion de sa personne.
Sa mère Dolorès le confortait dans cette idée en lui contant par le menu les exploits imaginaires de feu son père Fernando mort peu avant sa naissance. Le patriarche avait trépassé durant la guerre hispano-américaine de 1898 et était considéré par l’ensemble de la famille Sanchez de Tendilla comme un héros bien qu’il fût mort après avoir contracté le paludisme à Cuba et qu’aucun acte glorieux ne pût être porté à son actif.
La famille habitait dans un petit palais, entretenu tant bien que mal et qui dégageait un parfum étrange, mélange d’urine de chat et de jasmin. Au centre, un patio orné d’une fontaine desservait des pièces en enfilade cachées derrière de massives portes de bois peintes en noir. Les après-midi, lorsque le lourd soleil andalou écrasait les rues, les places et même l’intérieur des églises de Séville, le comte prenait sa canne et son chapeau et marchait seul dans la ville. Les battements de son cœur résonnaient entre ses tempes humides. La cité était assoupie, la sieste étant la seule activité envisageable en cette heure où l’on ne croisait pas une âme qui vive, tout juste quelques chiens errants qui cherchaient de l’ombre et de la fraîcheur.
Pedro trouvait que ces instants étaient les plus agréables pour découvrir les mystères que recelait Séville. La chaleur donnait un halo mystique aux bâtiments et l’air vibrait d’ondes invisibles. Cette illusion était aisément explicable par un phénomène physique lié à la température de l’air, mais il aimait à considérer ce mirage comme magique.
Le chemin de Pedro passait inlassablement devant la cathédrale, vaste monument chrétien dressé sur les fondations d’une ancienne mosquée. La basilique possédait des dimensions considérables. Laide et informe, son seul charme résidait dans un clocher gracieux, un ancien minaret qui s’élevait au milieu d’un ciel diaphane et toujours bleu.
La cathédrale permettait de trouver un peu de fraîcheur, mais Pedro ne s’y arrêtait jamais. Malgré le profond attachement de sa famille aux traditions catholiques, le comte n’était pas croyant. Il considérait l’Église comme une institution corrompue qui s’enrichissait en profitant de la détresse et de la crédulité des pauvres gens.
À ses yeux, les curés étaient des notables gras et apathiques qui abusaient de leurs privilèges. Pedro n’aimait rien de moins que les sermons dominicaux qui culpabilisaient les fidèles en décrivant par le menu leurs tares, leurs péchés, leurs faiblesses. Il abhorrait ces longues heures de prières et détestait plus que tout « la Semaine sainte », lorsque des processions interminables défilaient dans la ville au son des tambours, dans une atmosphère irrespirable de sueur et d’encens.
Afin d’éviter les églises, le gentilhomme se forçait à contourner soigneusement les secteurs les plus dévots de la ville et se dirigeait vers le quartier de Triana. Ce faubourg situé sur l’autre rive du fleuve abritait la communauté gitane, les strates les plus humbles de la société sévillane, et quelques nouveaux commerces.
Une place en particulier jouissait du privilège de ses visites hebdomadaires. Il s’agissait d’un lieu isolé et solitaire. La statue d’un poète désormais oublié ornait l’espace et de majestueux eucalyptus apportaient de l’ombre aux quelques bancs installés aux quatre coins. L’endroit était charmant et paisible, il jouxtait l’arrière d’un grand magasin qui étalait ses vitrines opulentes sur le boulevard voisin. Ces devantures constituaient une nouveauté, car en ce début de siècle, la plupart des commerces de Séville étaient toujours de petites échoppes où des vendeuses débonnaires conseillaient la clientèle.
Le grand magasin, construit loin de la vieille ville pour des raisons pratiques, longeait une grande artère fraîchement ouverte dans le quartier. Les expropriations et les déménagements s’étaient succédé pendant des mois et les travaux avaient ensuite été menés tambour battant par des architectes et ingénieurs français.
Assis sur un banc sous un eucalyptus centenaire, Pedro profitait enfin d’un peu de fraîcheur en cette chaude après-midi d’août. Il n’y avait pas un bruit, pas une feuille ne bougeait.
Plongé dans ses pensées, il songeait à l’affreuse soirée qui l’attendait. Sa mère avait décidé que sa vingt-cinquième année devait être celle de son mariage. Fils unique, le comte avait l’obligation de convoler rapidement dans le but de donner de nombreux descendants à la noble famille Sanchez de Tendilla, car faute de temps, son père n’avait pu accomplir cette tâche avant sa mort.
Dolorès avait jeté son dévolu plus sur un clan que sur une personne, il s’agissait des Lopera, une famille bourgeoise fort aisée qui avait fait fortune dans la transformation de l’huile d’olive en savon. Les Lopera avaient une fille prénommée Carmen qui, par chance, était en âge de se marier. Cette soirée dominicale constituait donc un excellent prétexte pour présenter les deux jeunes gens.
Pedro maugréait en lui-même lorsque soudain, il aperçut dans l’angle opposé de la place une silhouette féminine. Il s’agissait d’une jeune fille âgée d’une vingtaine d’années, assise presque le dos tourné et qui paraissait plongée dans une profonde réflexion.
Le comte n’y voyait pas très clair, car par avarice autant que par coquetterie, il se refusait à porter des lunettes pour corriger sa myopie. Il força donc sa vue afin d’apercevoir les traits de la jeune fille, sa joue, son nez et surtout son cou gracieux qui semblait avoir été spécialement conçu pour qu’on y déposât des baisers. Seule sa main qui lissait machinalement ses cheveux était pourvue de vie tandis que le reste de sa personne immobile dégageait une sérénité et une grâce infinie. Vêtue à la dernière mode parisienne, elle était d’une beauté stupéfiante. Pedro tressaillit. Plus il l’observait, plus il était gagné par son charme, et plus il ressentait la nécessité d’entrer en contact avec elle.
Cependant, en cette époque et en ce lieu, il n’était pas aisé d’approcher une jeune personne du sexe opposé. Il n’était pas envisageable de l’aborder sans la présence d’un chaperon. Par conséquent, il échafauda dans son esprit divers stratagèmes : demander son chemin en prenant l’air égaré, se présenter à elle comme un gentilhomme soucieux de la voir seule en cette heure dans un parc isolé. Car l’endroit était désert, tout juste y avait-il là deux ouvriers affairés qui se tenaient à une certaine distance de la demoiselle.
Mais plus il réfléchissait, plus il trouvait l’entrée en matière maladroite. Il se disait que cette approche n’était pas digne du visage magnifique qui se tournait désormais vers lui. Des traits fins et réguliers, des yeux mi-clos perdus dans leur rêverie et qu’il souhaitait plus que tout voir se lever sur lui.
Toutefois, elle n’en fit rien. Elle restait perdue dans ses songes, insensible aux regards ardents que Pedro posait sur elle.
Il réfléchissait toujours au moyen de l’aborder quand il lui parut que la solution la plus simple était d’établir avec elle une relation épistolaire. Il griffonna quelques mots simples à son attention sur un papier – que par chance il avait sur lui –, et se mit aussitôt à la recherche d’un badaud qui aurait la gentillesse de lui porter le message.
Il tomba nez à nez avec un enfant gitan à l’air malin qui devait traîner dans le quartier en quête d’un mauvais coup. Il lui offrit une chica, soit cinq centimes, pour remettre la précieuse missive à la jeune fille. Puis, il lui communiqua son adresse de façon que le jeune garçon puisse lui apporter une éventuelle réponse. Par bienséance autant que par lâcheté, il lui demanda toutefois d’attendre son départ. Il ne souhaitait pas être présent lorsqu’elle lirait sa lettre, redoutant un rire ou une moue, qui serait signe de moquerie ou de désintérêt.
Le comte prit le chemin du retour pendant que le gitan courait en direction de la jeune fille. En chemin, il pensa à ce destin qui lui avait permis de croiser une si belle demoiselle, enfin une rencontre, une passion qui était digne de sa noble lignée. Lorsqu’il arriva chez lui, sa mère et sa tante étaient dans une grande agitation. Elles l’avaient cherché tout l’après-midi. L’heure du dîner chez les Lopera approchait et il convenait que Pedro s’y présentât sous son meilleur jour.
Ses plus beaux costumes avaient été sortis des penderies, une chemise neuve et des chaussures cirées l’attendaient dans ses appartements. Sa chambre donnait directement sur le patio. Les soirs d’été, il laissait toujours la porte ouverte pour entendre le doux ruissellement de la fontaine qui le berçait avant son sommeil.
Pedro s’apprêta prestement, l’heure avançait. Il n’éprouvait aucun intérêt pour la soirée qui l’attendait. Il baignait encore dans l’euphorie de sa brève rencontre avec la jeune fille du parc. Il guettait le moindre passage dans sa rue, espérant que le gitan viendrait lui apporter une lettre parfumée.
Mais rien ne se passa. Pedro, sa mère et sa tante partirent donc en calèche en direction de la vaste demeure des Lopera. Elle se trouvait en dehors de la ville et étalait son luxe depuis les hauteurs d’une colline avoisinante.
Les Lopera s’apprêtaient à recevoir les Sanchez de Tendilla avec les honneurs dus à leur rang. Des domestiques en livrée vinrent les accueillir et les escortèrent jusqu’à la grande salle à manger où Joaquin Lopera, son épouse Ana et leur fille Carmen les attendaient.
Joaquin Lopera était un homme corpulent et trapu. Sa tête semblait avoir été placée directement sur son tronc sans qu’on eût trouvé de place pour loger un cou. Anna était la figure même de la désolation. Son visage maigre, entouré de cheveux noirs tirés en chignon, était semblable à un champ de bataille où la bouche, le nez et les yeux n’ayant pu trouver un terrain d’entente avaient finalement décidé de s’éloigner au maximum les uns des autres.
Carmen, enfin, ressemblait à un rongeur apeuré, elle jetait des regards craintifs sur le comte, et dans ses petits yeux noirs et fiévreux transparaissait une expression de résignation, comme si ce mariage répondait à une volonté divine.
Joaquin Lopera présenta par le menu les qualités de sa famille, son immense fortune, les vertus de sa fille, qui avait été élevée par des religieuses et qui, selon lui, avait tous les attributs requis pour être une femme dévouée et une excellente mère. Cet inventaire s’apparentait plus au boniment d’un vendeur de chevaux durant une foire aux bestiaux qu’à l’argumentaire d’un père aimant.
Pedro, perdu dans ses pensées, l’écoutait à peine. Le visage de la jeune fille du parc lui revenait sans cesse en mémoire, l’obsédait et l’empêchait de trouver la soirée tout à fait désagréable. Comme si le doux moment vécu l’après-midi se prolongeait encore.
Les Lopera possédaient une œuvre magistrale qu’ils tenaient absolument à faire admirer aux Sanchez de Tendilla. Il s’agissait d’une Madone du XVIIIe siècle qui trônait au milieu d’une chapelle tout spécialement érigée en son honneur au centre de la demeure.
Après le dîner, comme s’il s’agissait d’une procession, l’ensemble des convives se dirigea vers cette fameuse chapelle. Haute d’environ deux mètres, la statue de bois et de plâtre représentait une Vierge à l’enfant couverte d’or, de soieries et de pierres précieuses. Elle ressemblait à une pièce montée où l’on aurait remplacé la crème fouettée par les bijoux de la reine d’Angleterre.
Pedro la trouva hideuse et fut stupéfait par la profonde dévotion manifestée par la famille Lopera. Ils vouaient à cette statue une foi presque païenne et lui attribuaient tous les bienfaits dont la vie avait bien voulu les gratifier. La Vierge del Pilar – ainsi se nommait-elle – était donc à l’origine de la fortune, de la santé, de la beauté imaginaire de Carmen, de la guérison de l’ongle incarné de Joaquin et même de la disparition du furoncle d’Ana. Pedro considérait cette bondieuserie absurde. Il trouvait puéril de vénérer de la sorte une idole en plâtre, un veau d’or rococo. Consterné, il observait les Lopera. Il venait enfin de prendre pleinement conscience que les plans de sa mère consistaient à lier sa vie à celle de ces grenouilles de bénitier pour qui l’absolue vérité se trouvait cachée au milieu de deux mètres de dentelle et de verroterie. Il ne pouvait envisager d’unir sa destinée à celle d’une famille de bourgeois si ordinaires.
Il décida d’écourter la soirée, prétextant un vertige lié au profond choc mystique que lui avait procuré la vision de la Vierge. Il fit appeler sa calèche et rentra chez lui.
Durant le trajet, sa mère et sa tante essayèrent de le rappeler à ses responsabilités. Ce mariage représentait le salut de la famille, une stabilité financière nécessaire pour des nobles qui ne pouvaient se trouver dans la gêne.
De retour chez lui, une lettre l’attendait. Le jeune gitan avait apporté un petit mot écrit d’une main maladroite sur un papier ordinaire. Il disait dans un espagnol hésitant : « Eres encantador, yo también te note, senti algo, vuelve mañana.1 »
Chapitre II – La Madone
Cette nuit-là fut interminable pour le comte. Il imaginait toute sorte d’aventures et de situations : la jeune fille était promise aux griffes d’un malfrat dont il se devait de la tirer ; il parvenait à la sauver d’un mariage arrangé avec un vulgaire roturier ; elle était mélancolique, car elle avait perdu un parent proche et seul l’amour du noble sévillan pouvait consoler sa peine. Il se disait, aux lueurs de l’aube, que l’esprit humain était décidément plein de ressources et que les vies rêvées pouvaient être à la fois extrêmement précises et réalistes.