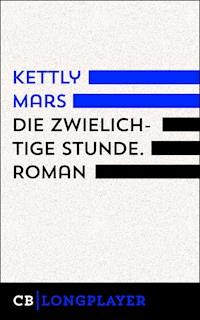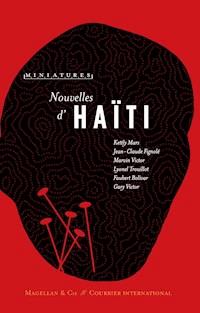
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniatures
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
À la découverte des traditions et de la culture d'Haïti.
Haïti, petit pays tropical d’un peu plus de huit millions d’habitants, pays à l’histoire courte, forte, tragique, s’est forgé une identité que traduisent bien les créateurs qui y vivent autant que ceux de la diaspora. Les blessures de l’histoire, le « colorisme », le Vaudou, les traditions africaines, la femme, la vie populaire et paysanne, le déracinement et l’exil, l’engagement sont autant de thèmes traités par les écrivains haïtiens, et portés, comme le disait Alejo Carpentier de la littérature latino-américaine, à laquelle la littérature haïtienne se rattache, par « le goût des images violentes et d’une écriture virtuose, tropicale ».
Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles haïtiennes de la collection Miniatures !
À PROPOS DES AUTEURS
Kettly Pierre Mars est née en 1958 à Port-au-Prince en Haïti, où elle vit. Passionnée dès son plus jeune âge de lecture et de poésie, elle commence à écrire, au début des années 1990, de la poésie puis des nouvelles. En 1996, elle reçoit le premier prix du Concours Jacques-Stephen Alexis de la Nouvelle. Elle a publié depuis des recueils de poésie, des recueils de nouvelles et des romans. Comprendre cette société meurtrie par un lourd passé colonial et par des années de dictature et de misère qu’est la société haïtienne, scruter les ambivalences spirituelles de ce peuple, libérer la parole « atrophiée » des femmes de ce pays, sont autant de thèmes qui parcourent l’œuvre de Kettly Mars, au service d’une écriture claire et incisive qui en font un des auteurs haïtiens parmi les plus prometteurs. Elle est aussi membre du jury du Prix littéraire Henri-Deschamps.
Jean-Claude Fignolé est né en 1941 à Jérémie en Haïti. Après des études de droit, d'agronomie et d'économie, il commence à écrire et devient critique d'art, journaliste (Petit Samedi soir, années 1970) et enseignant. Il occupe une place de premier plan dans les milieux intellectuels haïtiens pour avoir fondé avec René Philoctète et Frankétienne le mouvement littéraire le « spiralisme » qui a constitué un renouveau dans la littérature haïtienne. Ses premiers romans, publiés au Seuil, sont considérés comme fondateurs de la littérature contemporaine haïtienne. Dans les années 1980, Jean Claude Fignolé assiste les habitants du petit village Les Abricots, dans la Grande Anse, dans un travail de développement (reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture…) tout en poursuivant son œuvre d’écrivain et apportant la pertinence de ses analyses politiques dans Le Nouvelliste.
EXTRAIT
Un dimanche de mars, bravant mauvaise route et temps couvert, la tout-terrain débarqua de bon matin sur une plage des environs d’Aquin. La famille possédait un beau morceau de propriété face à la mer, au milieu des cocotiers. Quelquefois l’an, à Pâques, pendant les vacances d’été et pour Noël, la famille partait pique-niquer sur son bout de paradis, rêvant d’un petit bungalow qui sortirait de terre un jour par là, presque par magie. Et, comme les autres fois, les enfants ne dormirent pas la veille du voyage. Heureux de mettre enfin pied à terre, ils prirent immédiatement possession du lieu. Ils se retrouvèrent presque seuls sur la plage. Très loin d’eux un couple reposait sur des serviettes jaunes. Il y avait quelques barques de pêcheurs qu’on voyait paraître et disparaître sur la crête des hautes vagues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
La « perle noire des Antilles », comme on appela naguère Haïti, terre où ont été exterminés brutalement les Indiens Arawak, Taïnos et Caraïbes, où ont été déportés par les colonisateurs européens des centaines de milliers d’Africains dans les plantations de canne à sucre, fut une base arrière de première importance dans la conquête de l’Amérique, du nord au sud. Première colonie où l’esclavage est aboli en 1793, presque un siècle avant Cuba et le Brésil, et qui s’affranchit très tôt de l’emprise française en se proclamant « république » en 1804, Haïti a payé cher son courage et sa quête d’indépendance.
C’est aujourd’hui un pays ravagé par des décennies d’instabilité politique, par deux dictatures sanglantes – celle de Duvalier père : Papa Doc, puis celle de Duvalier fils : Baby Doc –, par la pauvreté et l’analphabétisme. Un pays où manquent cruellement les cadres institutionnels et où se sont affrontés sans discontinuer des visions politiques et des projets de développement contradictoires. Cette situation s’est encore aggravée depuis 2010, après le tremblement de terre qui a détruit Port-au-Prince et bouleversé de nouveau l’équilibre social du pays.
Dans le même temps, ce petit pays tropical de plus de huit millions d’habitants, territoire à l’histoire forte et tragique, s’est forgé une identité que traduisent ses créateurs : ceux qui y vivent et ceux de la diaspora, composée de plus de deux millions de personnes, dont six cent mille dans la seule ville de New York (la deuxième ville haïtienne au monde). Depuis longtemps, dans toutes les disciplines culturelles, la marque haïtienne est là. En cela, Haïti n’est pas en reste sur ses voisines Cuba ou la Jamaïque, Trinidad ou la République dominicaine. Comme si ces terres d’Amérique, terres de métissage, ces mondes en miniature où s’est déchaînée une violence sans pareille, étaient de véritables laboratoires de la confrontation des cultures, ce que nous observons désormais à l’échelle mondiale.
Cette richesse s’exprime à travers les arts : la merveilleuse peinture naïve haïtienne, et aussi celle de Jean-Michel Basquiat, ou d’Hervé Télémaque ; le cinéma : Sidney Poitier, Raoul Peck ; la soul music : Usher, Gage, Teri Moïse ; le rap américain : Wyclef Jean et Pras Michel, des Fugees, Sean P. Diddy Combs, Toni Yayo ; et la littérature. Celle-ci regorge de romanciers et de poètes magnifiques : de Jacques-Stephen Alexis à Marie Vieux-Chauvet, de Frankétienne à Jean-Claude Fignolé et Lyonel Trouillot, la liste est longue. Les blessures de l’histoire, le « colorisme1 », le vaudou, les traditions africaines, la femme, la vie populaire et paysanne, le déracinement et l’exil, l’engagement, sont autant de thèmes traités par les écrivains haïtiens et portés – comme le disait Alejo Carpentier de la littérature latino-américaine, à laquelle la littérature haïtienne se rattache – par « le goût des images violentes et d’une écriture virtuose, tropicale ».
Pierre Astier
1. Discrimination fondée sur la teinte de la peau. (N.d.É.)
LOBO
par Kettly Mars
À la mémoire de Lobo Dyabavadra
Un dimanche de mars, bravant mauvaise route et temps couvert, la tout-terrain débarqua de bon matin sur une plage des environs d’Aquin. La famille possédait un beau morceau de propriété face à la mer, au milieu des cocotiers. Quelquefois l’an, à Pâques, pendant les vacances d’été et pour Noël, la famille partait pique-niquer sur son bout de paradis, rêvant d’un petit bungalow qui sortirait de terre un jour par là, presque par magie. Et, comme les autres fois, les enfants ne dormirent pas la veille du voyage. Heureux de mettre enfin pied à terre, ils prirent immédiatement possession du lieu. Ils se retrouvèrent presque seuls sur la plage. Très loin d’eux un couple reposait sur des serviettes jaunes. Il y avait quelques barques de pêcheurs qu’on voyait paraître et disparaître sur la crête des hautes vagues. Le mouvement des bancs de nuages faisait alterner des ombres silencieuses et des trouées de soleil sur la mer. L’immensité de l’espace vide les grisa. Ils pouvaient croire que toute la plage leur appartenait, d’un bout à l’autre de leurs regards. Avec les touffes de raisiniers, les trous à crabes dans le sable blanc et l’horizon bleu aussi. C’était un jour de grosse mer. Il avait plu la nuit d’avant. Une pluie plutôt inattendue en cette saison de carême et de vent sec. En certains endroits de la plage, des nappes d’algues mortes étaient échouées. La froideur de l’eau n’encourageait pas la baignade. Les enfants couraient sur le sable, les deux bras déployés, leurs pieds léchés par l’écume, leurs rires s’effilo-chant comme des cris d’oiseaux dans le vent. Lobo suivait ses deux sœurs, heureux, la poitrine ouverte aux embruns. Il suivait partout ses sœurs jumelles, les marassas, comme il les avait suivies dans le passage à la vie. Lobo était dossous, celui qui naît après les marassas. Il avait quatre ans.
Épuisés par la longue route, les parents débarquèrent rapidement victuailles et hamacs. Ils s’installèrent ensuite à l’horizontale sous le couvert des amandiers.
À cette époque de l’année, les raras parcouraient les grands chemins, durant tout le carême, jusqu’au Vendredi saint. Ils s’en allaient dansant et chantant, chamarrés, pailletés, accomplissant un rituel de plaisir, de joie et de peur devant l’immensité du mystère portant leurs pas. Les groupes de raras se croisaient dans la plaine, se fondaient en un seul mouvement de danse, rivalisaient de puissance et de rythme, et se séparaient. Ils se rencontraient aussi en des points désignés pour confronter la dextérité des majors-joncs, la virtuosité des musiciens et l’éclat des reines de raras, ou pour saluer les invisibles. Pour faire un faisceau de leur vérité. Le tafia donnait du cœur au ventre et de l’endurance aux pieds. Et les vaccines vibraient en accompagnant la vie. Des souffles montant et descendant en harmonie tiraient des cônes de bambou des modulations pleines, profondes, saccadées ou longues. Les tambours se mariaient aux vaccines et aux katas. Les corps des hommes, des femmes et des enfants pris dans la houle de la musique devenaient rythme, joie, angoisse, poussière, terre et végétal, ciel et mer mélangés.
Sur tout le trajet, depuis Carrefour-Fauché jusqu’aux Cayes, Lobo s’intéressa aux raras. Il s’émerveillait de leurs costumes aux paillettes brillant comme des grains de soleil. Dès qu’il entendait à distance l’écho des tambours, il s’agitait dans la voiture, excité, impatient d’arriver jusqu’à eux. Pour traverser les bandes de raras occupant toute la chaussée, la voiture devait rouler lentement, au milieu des chants, des relents de tafia et des visages luisants de sueur. Lobo souriait, montrait du doigt les danseurs. Il n’avait pas peur des claquements de fouets que lançaient à tour de bras les chefs de bande. La mère se sentait mal à l’aise dans cette ambiance païenne. « Lobo devrait arrêter de sourire à ces personnes », pensait-elle. À un moment, une vieille borgne glissa prestement la main par la fenêtre du véhicule et toucha l’enfant. Un geste si vif que les occupants de la voiture ne s’en aperçurent point, sauf la mère. « Mais qu’est-ce qui lui prend à cette vieille folle ? » Excédée, elle ordonna de monter toutes les fenêtres malgré la panne du climatiseur.
Jouant sur le sable, Lobo entendit l’appel d’un tambour. Les raras. La peau de cabri tendue sur le tronc de bois fouillé disait son nom, « Lobo… Lobo… Lobo… », presque comme une voix humaine. Lobo prêta attention un moment et retourna à ses jeux. Ilda, Ilia et Lobo creusaient de grands bassins sur le rivage et les remplissaient d’eau de mer. Le garçon effectuait les corvées d’eau. « Lobo… Lobo… » L’enfant écouta encore. Qui l’appelait ? Une supplique qui semblait venir de tout près et de très loin à la fois. Quelqu’un se cachait-il quelque part pour lui faire une surprise ? Il adorait les surprises, Lobo. Et s’il allait voir un peu ? Il regarda indécis dans la direction de ses sœurs. L’eau de mer une fois au repos dans les tranchées devenait bleue, un beau bleu où se reflétaient leurs deux visages semblables, leurs tresses mouillées et un morceau du ciel. Bon, comme elles ne faisaient pas attention à lui, il ferait vite. Juste un petit coup de pied au détour de la plage, derrière le bouquet de raisiniers. C’est de là que lui parvenait l’appel.
C’était presque la mi-journée. Le père et la mère s’affairaient autour du déjeuner, enfin détendus après s’être laissé imprégner par le vent salé et les senteurs profondes de la mer. Ils ne s’inquiétaient pas trop puisque les enfants ne couraient aucun danger hors de l’eau.
Lobo s’éloigna doucement, le cœur battant car il savait qu’il faisait quelque chose que la famille n’aurait pas approuvé. Mais ce n’était qu’à quelques pas, juste pour aller voir et revenir en parler aux marassas. Ce n’était même pas désobéir puisqu’il n’y avait pas d’interdiction. Il voulait juste voir. Les notes de musique devenaient plus claires au fur et à mesure de son avancée. Ils l’attendaient. Une quinzaine de personnes, hommes, femmes et enfants, les pieds couverts de la poussière des chemins. Deux tambours et deux vaccines. Ils dansaient sous une tonnelle de branchages, dans une clairière au sol de terre battue. Ils l’attendaient.
Dès qu’il parut, les tambours et les vaccines se turent. Une vieille à laquelle il manquait un œil se détacha du groupe et vint à la rencontre de Lobo. Elle se prosterna et lui baisa les pieds. Une autre femme s’approcha, portant sur la tête un gallon de clairin. Lobo regardait les couleurs et les mouvements autour de lui, un peu inquiet mais dévoré de curiosité. La vieille prit la bouteille de clairin, versa du liquide sur le sol en dessinant un cercle autour de Lobo. Il se laissa faire, fasciné par les couleurs vives et les paillettes des costumes portés par les danseurs. La vieille fit coucher l’enfant dans le cercle tracé par l’eau-forte. Là, elle lui baigna la tête avec le reste du clairin. Il toussa un peu à cause des vapeurs de l’alcool. L’inquiétude avait disparu de son âme, la perspective des réprimandes perdait de sa lourdeur. Puis, la même femme tira d’une profonde poche de sa jupe un paquet de farine. Et tout autour du corps de Lobo encore allongé sur le sol, elle traça lentement un grand vèvè en pinçant la poudre fine entre ses doigts. Elle s’activait en silence, dessinant des figures tout en angles et en boucles qui s’ouvraient comme une fleur parfaitement symétrique de part et d’autre du petit corps. Quand la vieille eut terminé son travail, un tambourinier frappa sur son instrument quelques coups secs qui claquèrent dans le vent. On releva Lobo, qui fut placé sur les épaules d’un homme aux muscles puissants. Le groupe s’en alla, laissa la plage, et s’en retourna sur la nationale continuer son périple.
Ilda fut la première à remarquer la disparition de Lobo. Elle cherchait le petit pour l’envoyer quérir du ravitaillement auprès des parents. Midi sonnait. Le vent de la mer donnait faim. Ne le voyant pas, elle demanda à sa sœur jumelle où était passé Lobo. Ilia ne savait pas non plus. Alors les filles s’en allèrent trouver leurs parents pour savoir si l’enfant ne les avait pas rejoints. Au bout de quelques minutes d’absolue incompréhension, d’incertitude et de flottement, on finit par comprendre que Lobo n’était avec personne. Lobo ne se trouvait nulle part.
Pendant plus de trois heures on chercha Lobo. Sur toute la longueur de la plage, dans le repli des vagues, à l’intérieur des terres, dans les arbres, partout. Le nom de Lobo crié sans arrêt dans le vent allait mourir contre le corps des hautes lames. « Lo… boooooo ! Lo… boooooo ! Lo… boooooo ! » Au fur et à mesure des recherches infructueuses, l’inquiétude grandissait dans la poitrine, les yeux, les mains de tous les membres de la famille. On mangea du bout des lèvres, pour ne pas faiblir, espérant secrètement que cet acte soutenant la vie ramènerait la réalité au dernier instant où Lobo avait été vu en chair et en os. La mer, le sable, les petits crabes aux carapaces diaphanes, tous les arbres aux postures tourmentées, recelaient à présent une hostilité angoissante. L’euphorie et le bien-être d’une journée d’évasion avaient disparu, laissant place à un profond malaise.
Aucune des personnes questionnées n’avait vu Lobo, ne savait quoi que ce soit. Nul ne se souvenait du passage d’un enfant dans le secteur. Aucune trace, aucun indice ne suggérait une direction ni un motif à la disparition de Lobo. Le couple de la plage s’approcha de la famille. Ils n’avaient rien vu mais offraient leur aide. La mère trouva un air suspect à la jeune femme. Un air trop innocent. Souvent, des jeunes femmes dans l’incapacité d’avoir des enfants enlevaient ceux des autres. La mère gardait les yeux fixés sur le ventre trop plat de la demoiselle. Elle en était littéralement hypnotisée, s’attendant à chaque seconde à en voir surgir son Lobo. Comment pouvait-elle imaginer une chose pareille ? Mais toute folie lui était permise tant que Lobo n’était pas retrouvé. Des pêcheurs s’en revenant du fond de la mer dirent que, s’il s’était noyé, la marée du soir rejetterait le corps sur le sable. La mère se sentit défaillir en entendant ces paroles. Elle refusa d’y croire. Son fils vivait, elle le savait, elle le voulait.
Comme la lumière du jour s’étiolait, le père décida d’embarquer la famille dans la tout-terrain et d’aller déclarer la disparition de son fils aux autorités de la ville des Cayes. Il n’y avait pour le moment rien d’autre à faire. Les recherches dans l’obscurité seraient vaines et même dangereuses. La mort dans l’âme, ils quittèrent la plage.
À la croisée des Quatre-Chemins, la voiture dut ralentir. Sur cette bretelle située quelques kilomètres avant Les Cayes, toutes les bandes de raras s’arrêtaient pour saluer Legba, le maître des carrefours. Un rassemblement bruyant et coloré où dominait la couleur rouge. La nuit tombée, le spectacle devenait plus impressionnant à cause des grands chandeliers en forme de croix portés comme des étendards, jetant de l’or en fusion sur les mouvements des danseurs et le strass des costumes. Dans la campagne alentour, le ciel et la terre se fondaient dans la même obscurité. De temps à autre éclatait le claquement sec des fouets de sisal ouvrant un passage invisible sous les pieds des raras.
Le véhicule avançait au milieu de la foule. Des visages en sueur, aux regards illuminés par l’alcool et la transe de la danse, passaient devant les fenêtres fermées de la voiture. Les raras n’étaient plus les mêmes la nuit. Quelque chose différait dans l’air ambiant. Tout ce qui vivait en cet instant, dans cet espace restreint, semblait appartenir à une autre dimension. Les profanes qui aiment danser au cœur des raras savent bien qu’ils doivent se retirer dès que tombent les premières ombres du soir. Dans l’habitacle régnait un calme pesant contrastant avec les trépidations de l’extérieur. Le silence, comme une traînée de froid, avait transi les cœurs. Un silence qui faisait mal, nulle part et partout à la fois. Soudain, Ilia pointa le doigt dans la direction d’un petit groupe. Son cri perçant brisa en milliers de parcelles l’écran glacial du silence.
– Papa ! Maman ! Je l’ai vu, je l’ai vu ! Le voilà, je le vois sur les épaules d’un monsieur ! Lobo, Lobo !
Ilia, au bord de l’hystérie, appelait Lobo, oubliant les fenêtres closes de la voiture et la musique des raras.
– Mais où ? disait le père incrédule.
– Là !… Lààààà ! Au milieu du groupe qui se tient devant la station essence !
Une décharge électrique traversa la cabine du véhicule. Le père, les yeux fous, pila net en plein