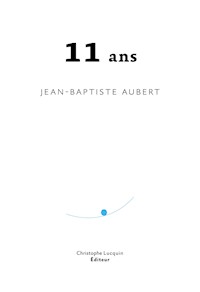
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christophe Lucquin Éditeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Kévin, un enfant de onze ans hypersensible, a du mal à comprendre le monde et doit supporter un stress important, au point de songer, sérieusement mais non sans humour, au suicide...
On peine à imaginer qu’un enfant, Kévin, le protagoniste du livre, puisse être mal au point de vouloir mettre fin à ses jours. Et si l’idée du suicide d’un petit garçon, tellement éloignée de la vision que nous avons de l’enfance, n’était pas qu’une monstrueuse exception ? Chaque année, cette exception concerne plus d’une centaine d’enfants âgés de 10 à 14 ans. Sans pathos et avec une certaine dose d’innocence et d’humour, le premier roman de Jean-Baptiste Aubert pointe ce tabou majeur.
Kévin est hypersensible, il écoute le monde et a décidément beaucoup de mal à le comprendre, d’autant plus qu’il subit un stress important dû à des tensions incessantes entre ses parents. Comment peut-il, sans le cocon famille de protection, apprendre à percevoir le monde ?
Naturellement, ce climat oppressant gangrène le reste de sa vie : il est plus perméable aux choses, se pose des questions, ses résultats scolaires et ses relations avec ses camarades s’en trouvent affectés. Kévin s’interroge sur la nécessité d’une vie faite de disputes et de malaises. Il finit par se retrouver dans une institution pour enfants en difficultés. Kévin arrivera-t-il à se sortir de ce lot d’enfants qui, comme le dit le neuro-psychiatre Boris Cyrulnik, pensent à la mort tant ils sont anxieux et malheureux ?
Nous sommes immergés dans la conscience de Kévin qui raconte dans un carnet les événements marquants de sa vie et ses observations sur le monde qui l’entoure, avec un ton juste et des réflexions qui confirment que la vérité sort de la bouche des enfants.
Une lecture qui ne peut que nous interpeler et nous émouvoir.
Immergez-vous dans la conscience d'un enfant de onze ans qui tient le compte-rendu des faits marquants de sa vie. Un premier roman interpelant et émouvant qui aborde ce sujet encore tabou avec innocence et légèreté.
EXTRAIT
Quelqu’un va-t-il me dire ce que c’est que vivre ? Quelqu’un va-t-il me dire ce que nous faisons sur cette terre ? Chez moi, personne ne parle normalement et ça crie souvent. La plupart du temps je ne dis rien, sauf « oui » pour répondre à la question qu’on me pose presque tous les jours : « Ça va ? T’as pas l’air bien… ». À chaque repas, mon père met la radio très fort. Je comprends maintenant que c’est pour ne pas crier. Peut-être que lui aussi se pose les mêmes questions que moi. Le samedi, on mange du poulet et des frites. Ma sœur a l’air heureuse. Aujourd’hui, j’ai décidé de mourir pour en finir avec toute cette bizarrerie. Au fond, je ne comprends pas pourquoi je veux mourir. Il faut que j’essaie quelque chose, voilà tout.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Une petite perle de finesse et d'émotion ! le récit d'une enfance malmenée écrit à la première personne, juste, surprenant, émouvant. Il n'est jamais simple de se glisser dans la peau d'un enfant sans tomber dans la caricature. Jean-Baptiste Aubert a trouvé un équilibre entre le fond et la forme qui épouse le rythme du récit ; il parvient à n'être jamais mélodramatique ou naïf. -
okada, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Baptiste Aubert est professeur agrégé de lettres modernes dans un lycée de Strasbourg depuis une dizaine d’années. En juin 2014 paraît son recueil de poèmes
Pandémonium (Bibliocratie). Également pianiste de jazz et de musiques improvisées, il a publié trois albums :
Diaphanie (2010),
Images italiennes (2011) et
Infant eyes (2015). Son site personnel : www.jeanbaptisteaubert.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Onze ans
Onze ans
Jean-Baptiste Aubert
Christophe Lucquin Éditeur
Préface de l’éditeur
Cet ouvrage retranscrit le contenu de cahiers qui nous ont été envoyés avec le mot suivant :
« J’ai trouvé ces deux cahiers il y a quelques années dans l’armoire d’un enfant que j’ai connu. Je les ai précieusement conservés. Après avoir longuement réfléchi, je pense que leur publication est nécessaire. Irène ».
Le texte original ne présente presque aucune rature et n’a nécessité que quelques corrections.
J’ai onze ans, et je veux mourir. Je vais essayer de me pendre tout à l’heure. Dans ma classe, tout est bizarre. Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Quand je regarde tout ce que la maîtresse écrit chaque jour au tableau, ça s’embrouille dans ma tête. Pourquoi être assis là, à écouter de longues heures tous ces mots et toutes ces histoires qui sont très loin de moi ? C’est peut-être bête de dire ça, mais je ne sais pas qui je suis, ni pourquoi je suis là. Quelqu’un va-t-il me dire ce que c’est que vivre ? Quelqu’un va-t-il me dire ce que nous faisons sur cette terre ? Chez moi, personne ne parle normalement et ça crie souvent. La plupart du temps je ne dis rien, sauf « oui » pour répondre à la question qu’on me pose presque tous les jours : « Ça va ? T’as pas l’air bien… ». À chaque repas, mon père met la radio très fort. Je comprends maintenant que c’est pour ne pas crier. Peut-être que lui aussi se pose les mêmes questions que moi. Le samedi, on mange du poulet et des frites. Ma sœur a l’air heureuse. Aujourd’hui, j’ai décidé de mourir pour en finir avec toute cette bizarrerie. Au fond, je ne comprends pas pourquoi je veux mourir. Il faut que j’essaie quelque chose, voilà tout. J’ai pris une écharpe et je l’ai mise dans mon sac. Je ne sais pas encore où j’essaierai de l’accrocher pour y pendre mon cou. Pendant les récréations, je m’ennuie énormément. Il m’arrive de me mettre dans un coin et de ne rien faire. De temps en temps, je joue avec d’autres élèves. Il y a une fille de ma classe que je trouve très belle. Comme moi, elle court très vite quand il le faut. Un jour, j’ai triché. J’ai caché sous la table un cahier ouvert sur mes genoux. Je ne sais même plus si j’ai réussi à m’en servir. Tout ce dont je me souviens, c’est qu’un autre élève m’a vu et l’a dit aux autres à la récréation. J’ai eu honte, alors je n’ai plus jamais triché. L’écharpe que j’ai dans le sac ne peut pas tricher. Pour une fois, je vais être dans le vrai et ça me réjouit presque. L’étude surveillée se termine bientôt. Bon, comme ma décision de mourir est prise, je peux repousser mon acte d’un jour. J’ai encore des choses à raconter.
J’ai un but ! Mourir me donne un but ! J’ai hâte que la séance se termine. Je veux me pendre parce qu’un jour dans mon quartier un homme s’est pendu. Il y avait les pompiers devant sa maison qui elle aussi semblait morte. Les autres enfants disaient que l’homme s’était pendu avec une ceinture. Cela m’a intrigué. Je pense que l’écharpe rendra la mort plus douce. D’ailleurs, je ne sais pas ce qui tue dans la pendaison. On doit s’étouffer. Ça doit faire bizarre de s’étouffer. Mais il est trop tard pour revenir en arrière, mon but est clair. Je fais beaucoup de gribouillis dans mes cahiers. La plupart du temps ce sont des têtes, des visages déformés très effrayants. C’est peut-être moi que je dessine, mais alors pourquoi ces déformations ne se voient-elles pas sur mon vrai visage ? Au contraire, je crois que j’ai une tête très banale. La seule fois où j’ai eu l’impression que mon visage se déformait, c’était dans mon lit, un matin. J’étais en train de me réveiller dans le noir. Mon père est entré après avoir toqué, ce qu’il ne fait jamais. Il a dit doucement : « Tu sais, mémé, elle est morte. » Et il est sorti en refermant délicatement la porte. J’ai pleuré comme jamais je n’avais pleuré auparavant. Je croyais que mes yeux et ma bouche allaient déchirer mon visage. Mémé, c’était la mère de mon père, donc ma grand-mère. Elle aussi pleurait beaucoup au moment où on devait la quitter après nos visites. Ses grands yeux bleus resteront à jamais gravés dans mon âme. Donc je me suis retrouvé tout seul dans mon lit à pleurer une morte, sans savoir ce que c’est que la mort. J’ai été seul avec les mots de mon père, dans le noir, et y repenser me glace. Mon autre grand-mère, elle, vit toujours. Elle est très calme et très douce. Un jour, peut-être le plus doux de ma vie, elle m’a fait un câlin, elle m’a caressé le visage avec ses mains de soie. J’étais comme un petit chat dans les nuages : que c’était bon ! Je commence à avoir sommeil. Il fait très chaud dans la salle de classe. Nous ne sommes que quatre élèves, ceux qu’on appelle les plus « faibles » ou les plus « difficiles ». Mais nous sommes aussi les plus bizarres. Il y a d’abord Estéban. Comme son prénom l’indique, il est d’origine portugaise. Il habite dans le même quartier que moi. Il a souvent des trous dans ses habits et semble ne rien comprendre, lui non plus, à ce qu’il se passe autour de lui. On ne se parle jamais. Peut-être parce qu’on pense la même chose. Il y a aussi Lucas. Ses parents sont très violents. Il est toujours très sale. Il a déjà volé plusieurs fois des objets ou de l’argent à d’autres élèves de la classe. Il est souvent puni par les instituteurs, parfois même quand il n’a rien fait. C’est injuste, mais ça arrange tout le monde. Enfin, il y a Faysal. Lui, il sent souvent mauvais. Parfois certains l’appellent « fesses sales ». On n’a jamais dû lui apprendre à changer ses slips, le pauvre. Nous voilà donc tous les quatre, répartis aux quatre coins de la salle par le surveillant. Je commence à comprendre que nous avons un point commun : nous ne comprenons rien. Ça veut dire aussi qu’au départ, on se pose peut-être la question de savoir ce qu’il y a à comprendre. Les autres doivent avoir la chance de ne même pas se la poser. Ils sont insouciants.
Je ne me suis pas encore pendu. J’aimerais encore écrire. Avant-hier, j’ai parlé d’Estéban, de Lucas et de Faysal. Je me sens proche d’eux. C’est peut-être la crasse, le silence et la violence qui font qu’on se retrouve tous les quatre ici, à faire semblant de travailler. Estéban est en train de découper discrètement sa gomme sur ses genoux. Faysal doit être en train de dessiner des femmes nues, comme souvent. Lucas dort, la tête posée sur ses poings fermés. Et moi, j’écris, en faisant semblant de recopier le passage d’un livre. Une idée me vient. Je laisserai ce cahier dans le casier sous la table. Je ne l’ai pas dit, mais je suis en train d’écrire dans mon cahier de brouillon qui est presque neuf. J’ai commencé l’autre jour sur une nouvelle page. Je regarde tout ce que j’ai déjà écrit et je me dis que ça fait déjà beaucoup. On me dit toujours que j’écris bien, que j’ai même un don pour écrire, mais que je n’en fais qu’à ma tête. C’est vrai, j’écris quand c’est nécessaire, c’est-à-dire en ce moment. En tout cas, c’est la première fois que j’écris comme ça. Ça vient tout seul. Encore trente minutes. En début d’année, on a fait une bêtise dans cette salle de classe. Avec trois autres copains, Clément, David et Mohammed, on est restés dans la salle pendant la récréation, alors que c’est interdit. On a fait semblant de sortir dans la cour et, au dernier moment, on a fait demi-tour. La maîtresse n’a rien remarqué. Une fois retournés dans la salle, on est montés debout sur les tables et on a sauté de l’une à l’autre, en marchant au passage sur les cahiers et les livres. C’était excitant de faire n’importe quoi et de se sentir libre. Mais hélas, la séance s’est mal terminée pour moi. J’ai glissé et je suis tombé. Je me suis cogné le visage sur le coin d’une table. J’ai saigné et ma lèvre supérieure a vite enflé. On est sortis l’air de rien, et Clément a eu l’idée de dire à la maîtresse que je m’étais cogné à une porte dans les toilettes. Cela me rappelle un autre moment très marquant quand j’étais plus petit. Je venais d’acheter avec ma mère une nouvelle paire de baskets, d’un blanc éclatant. J’étais fier et très content. En rentrant dans l’appartement, je les ai laissées dans l’entrée pour ne pas les abîmer. J’ai donc joué en chaussettes dans le salon. Avec ma sœur, on s’est amusés à courir autour du canapé. À un moment, en pleine course, j’ai glissé sur le carrelage. Zut, je ne peux pas terminer mon histoire, il est bientôt six heures. Cela m’ennuie, j’aimerais bien la terminer. Je reviens demain, cher cahier.
Donc, j’ai glissé sur le carrelage. Je suis tombé d’un coup et ma tête a heurté le coin d’un bac à fleurs jaune clair. Je revois encore parfaitement cette couleur. Ma mère appelait ça un « bac Riviera ». J’ai longtemps pensé qu’il s’agissait d’un seul mot mystérieux comme « bacriviera » ou « bacsiviera ». Bref, j’ai réussi à casser le coin de ce bac en plastique très épais. Heureusement, c’est mon os juste au-dessus de l’œil gauche qui a cogné le plastique. Ma peau s’est ouverte en plein milieu du sourcil. À un centimètre près, je devenais borgne. J’ai eu peur. J’ai saigné. Il a fallu aller en urgence chez le médecin. Je me souviens très bien qu’il fallait mettre rapidement des chaussures, et là je crois que j’ai hésité à enfiler mes baskets neuves. Eh bien oui ! dehors il pleuvait, alors blessure ou pas il fallait préserver leur éclat. Le docteur m’a fait plusieurs points de suture (j’ai encore une petite cicatrice). Je revois encore ses mains s’approcher de mon œil. Par contre, j’ai oublié la douleur que j’ai dû ressentir. C’est la blessure la plus importante que j’aie jamais eue, j’ai les os plutôt solides. Le surveillant feuillette un magazine de sport. Le sport, j’aime beaucoup. D’ailleurs, c’est la seule discipline où je suis toujours parmi les premiers de la classe. Au mois de décembre, une sortie ski de fond a été organisée pour notre classe. La maîtresse avait prévu une course sur un parcours assez long. Rapidement, j’ai pris la première position, mais dans une montée une de mes chaussures est sortie de la fixation et j’ai dû m’arrêter, assez de temps pour être rattrapé et dépassé par d’autres élèves, ce qui m’a beaucoup énervé alors que je ne m’énerve jamais. Dans ma tête, je me voyais déjà gagner. Alors, dès que j’ai remis ma chaussure en place, j’ai tout fait pour rattraper les autres un à un. Mais hélas, je n’ai pas réussi à revenir sur Samia, la fille de la classe la meilleure en sport. Je ne digère toujours pas cette deuxième place. C’est dommage, comme je veux mourir tout à l’heure, je ne connaîtrai pas le destin de Zack. Zack est un corbeau. Clément l’a trouvé en rentrant de l’école il y a quelques jours. Hier, avec Mohammed et David, je suis allé chez lui pour le voir. Apparemment, il est un peu blessé et ne parvient plus à voler. En tout cas, on lui a trouvé de gros vers de terre qui ont fait son bonheur, si on peut parler de bonheur pour des corbeaux. J’aime assez les animaux. Pour eux, la vie semble simple, ils ne voient ni le passé ni le futur. Ils vivent ou ils meurent. Pour eux, le choix est facile, alors que certains êtres humains sont à la fois dans la vie et dans la mort. Moi, j’en ai assez d’être entre les deux. Je veux que tout bascule d’un côté. Comme je ne parviens pas à vivre, parce que je ne sais pas ce que c’est, alors je veux mourir. Mon chat sera peut-être triste quand il ne me verra plus dans l’appartement. Il s’appelle Pacha. Il faudra absolument que j’en parle la semaine prochaine.





























