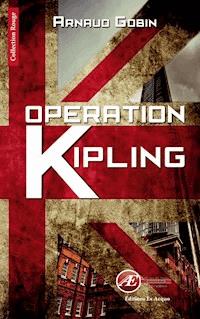
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rouge
- Sprache: Französisch
Attentats, disparitions, meurtres et guerre en Syrie sont les ingrédients de ce polar intriguant...
Alex Dembsky travaille à la protection des cétacés. Un attentat vient de se produire dans le métro de Londres tandis qu’il rentrait d’un mystérieux périple en Irlande. Son fils a disparu, sa compagne l’a quitté avant son départ et il trouve la vieille dame, qu’il accompagnait dans sa fin de vie, abandonnée morte dans sa maison. Après la série d’agressions qu’Alex a subie, le drame s’alourdit un peu plus.
L’agent Lester Bennet, quant à lui, supervise à contrecœur un hasardeux stratagème du MI5. Il tente aussi de découvrir qui a tué son jeune collègue et quand il lui reste du temps, il traque les escrocs du net pendant que la maladie le ronge.
Entre les lieux les plus interlopes de la capitale britannique, les calmes paysages de l’ile d’émeraude et les artères bouillonnantes de Lagos, un chassé-croisé s’installe.
Les trusts pétroliers sont-ils responsables des déboires d’Alex ou bien la guerre en Syrie en est-elle indirectement la cause ?
Quel est le véritable but de l’Opération « Kipling » ?
Bennet découvrira-t-il l’assassin de son jeune collègue Sam ?
Qui sont, en réalité, Abby et sa belle-fille Shirley ?
Ce qu’Alex apprendra de l’Opération Kipling lors d’une unique rencontre avec Bennet, lui fera froid dans le dos.
Deux intrigues croisées pour un thriller politique palpitant !
EXTRAIT
— C’est à cause de l’attentat, sir, me répond-il avec gravité.
Le mot me fige sur la banquette.
— Quel attentat ?
— Hier soir, un engin a explosé dans le métro entre Bond Street et Green Park. Il y a des contrôles partout. Ça fiche la pagaille dans la circulation et dans les gares.
J’ai un mauvais pressentiment.
— Il y a beaucoup de victimes ?
— Oh ! yes my God. Le Seigneur a rappelé à lui dix-neuf innocents, dont quatre petits jeunes. Faudra prier pour eux, sir. La bombe a blessé aussi une centaine de personnes. Aux infos, ils ont dit qu’un voyageur courageux avait cassé une vitre pour la jeter dans le tunnel juste avant que la rame entre dans la station. Sinon, ça aurait fait un carnage. L’homme a été déchiqueté. Croyez-moi, sir, pour son sacrifice il montera au paradis avec la Croix de Georges.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Arnaud Gobin est né en Lorraine quelques années avant qu’on découvre une plage sous les pavés du Boul’Mich. Après des études aux Arts déco de Paris, pas mal de bourlingues et divers métiers, il est aujourd’hui réalisateur de documentaires pour la télévision. Dans ses films comme dans ses romans noirs, il aime explorer toutes les facettes de notre société, de notre histoire et des turpitudes de l’âme humaine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Résumé
Opération Kipling
Résumé
Alex Dembsky travaille à la protection des cétacés. Un attentat vient de se produire dans le métro de Londres tandis qu’il rentrait d’un mystérieux périple en Irlande. Son fils a disparu, sa compagne l’a quitté avant son départ et il trouve la vieille dame, qu’il accompagnait dans sa fin de vie, abandonnée morte dans sa maison. Après la série d’agressions qu’Alex a subie, le drame s’alourdit un peu plus.
L’agent Lester Bennet, quant à lui, supervise à contrecœur un hasardeux stratagème du MI5. Il tente aussi de découvrir qui a tué son jeune collègue et quand il lui reste du temps, il traque les escrocs du net pendant que la maladie le ronge.
Entre les lieux les plus interlopes de la capitale britannique, les calmes paysages de l’ile d’émeraude et les artères bouillonnantes de Lagos, un chassé-croisé s’installe.
Les trusts pétroliers sont-ils responsables des déboires d’Alex ou bien la guerre en Syrie en est-elle indirectement la cause ?
Quel est le véritable but de l’Opération « Kipling » ?
Bennet découvrira-t-il l’assassin de son jeune collègue Sam ?
Qui sont, en réalité, Abby et sa belle-fille Shirley ?
Ce qu’Alex apprendra de l’Opération Kipling lors d’une unique rencontre avec Bennet, lui fera froid dans le dos.
Arnaud Gobin est née en Lorraine quelques années avant qu’on découvre une plage sous les pavés du Boul’Mich. Après des études aux Arts déco de Paris, pas mal de bourlingues et divers métiers, il est aujourd’hui réalisateur de documentaires pour la télévision. Dans films comme dans ses romans noirs, il aime explorer toutes les facettes de notre société, de notre histoire et des turpitudes de l’âme humaine.
Arnaud Gobin
Opération Kipling
Thriller
ISBN : 978-2-35962-882-1
Collection Rouge : 2108-6273
Dépôt légal Décembre 2016
© couverture Arnaud Gobin pour Ex Aequo
© 2016 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de
traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
Éditions Ex Aequo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières les bains
www.editions-exaequo.fr
***
1
L’employée épluche mon passeport au comptoir d’enregistrement. Oui, je m’appelle Alex Dembsky et c’est bien moi sur la photo. Il paraît que j’ai eu un jour vingt-sept ans. Quand ? Je ne sais plus, mais c’était pas hier. Je me suis arrêté de vieillir à l’âge de Jim Morrison, Janis Joplin et de tous les clamsés du Forever 27 Club. Pour être honnête, j’ai pas inventé l’élixir de jouvence, je fais juste semblant d’oublier mes anniversaires à la manière d’une bourgeoise liftée. Je vis au présent. Le temps qui passe me fout les jetons, surtout ces derniers temps. Même si vous vous en fichez, sachez aussi que je suis biologiste, spécialiste des cétacés. Mes ancêtres polonais m’ayant légué un teint pâle et une tignasse blond cendré on me surnomme naturellement « Beluga », « Bélou » pour les intimes. Comme je suis gourmand, mon embonpoint me vaut aussi de la part de quelques cons le sobriquet de « Moby Dick ». Je les emmerde ! Le jour où on n’aura plus rien à bouffer, ils crèveront avant moi. Mon petit sac à dos disparaît sur le tapis roulant. La nana me tend une carte d’embarquement avec un sourire crispé.
Porte B. Je vide mes poches avant de passer le portique. L’agent de sécurité me confisque le caillou ramassé près de la maison des Carbery. Il pense que je vais déménager l’Irlande pierre par pierre ou attaquer le pilote à coups de galet. Humour ? Je mets quelques minutes à réaliser que le vigile est sérieux. Je crois rêver ! J’essaye de négocier. Rien n’y fait. « Rules are rules{1} ». La petite tortue en granit vert échoue dans une corbeille en plastique. Cet abruti vient d’aggraver mon humeur de chien. Le troupeau embarque. Je le rejoins sans enthousiasme. J’entre dans la carlingue en dernier. Il ne reste qu’une place de libre. Je suis maudit ! Mon voisin est un gamin qui voyage seul avec son badge autour du cou. Je le vois déjà s’agiter près du hublot. Il a plutôt intérêt à fermer son clapet pendant une heure. C’est vraiment pas le moment de me contrarier. Dépressurisation… masques à oxygène… gilets de sauvetage sous les sièges… je serre déjà les fesses. Mon ventre cache la boucle de ceinture. L’hôtesse doit se pencher pour s’assurer que je suis bien attaché. Hurlement des réacteurs. C’est parti !
Je ne décolle pas de Dublin comme prévu. Hier, j’ai loupé l’avion. Saleté de bagnole ! Je venais à peine de quitter Julia quand le moteur s’est mis à hoqueter. Deux bornes plus loin, c’était la panne en rase campagne. J’ai vérifié les fusibles, soulevé le capot et soufflé dans les cosses de bougies. Je me suis acharné sur le démarreur jusqu’à épuiser la batterie, impossible de repartir. La Japonaise s’était fait hara-kiri. J’ai appelé le loueur. La petite agence de Nenagh n’avait plus une seule voiture disponible. J’ai râlé comme un phoque, mais ça n’a rien changé. Ils m’ont envoyé un garagiste. J’ai attendu une bonne demi-heure en regardant les vaches brouter. Quand la cavalerie s’est pointée, j’avais déjà fait une croix sur mon avion. Le type a démonté le carburateur sans trouver la cause du problème. Il a hissé la caisse sur sa remorque. Je lui ai demandé de me ramener au manoir. Le van de Julia n’était plus là. Elle avait dû emprunter une autre route. Je suis reparti dans la dépanneuse. Le mécano se roulait le même tabac moisi que Garret, le matelot du John Oxley. L’odeur a failli me rendre malade. J’ai pu modifier mon billet pour le vol de ce matin. Sinon je serais rentré en ferry ou à la nage. Je me suis enfilé un chicken ships devant la gare avant de sauter dans le premier train pour Cork. J’ai traîné jusqu’au soir dans le quartier historique. J’ai écumé quelques pubs et je suis allé me coucher. La chambre que j’avais louée chez une mamie puait la naphtaline. Ce qui m’angoisse depuis hier, c’est que je n’ai pas pu joindre Madhi. J’ai encore essayé depuis la salle d’embarquement. Son portable est toujours sur répondeur et le fixe de Shirley n’a plus de tonalité. Je trouve ça vraiment inquiétant.
« Température extérieure huit degrés. Veuillez rester assis jusqu’à l’extinction du signal lumineux… » Je respire mieux. Des militaires arpentent le terminal mitraillette en bandoulière. L’aéroport de Gatwick grouille de flics. Je vais prendre l’express qui me déposera à Victoria. Ce n’est pas une bonne idée. Les quais sont bondés. Le trafic est complètement perturbé. Des annonces par haut-parleurs invitent les voyageurs à se rabattre sur les navettes routières. Dehors, la situation n’est pas meilleure. Les bus sont pris d’assaut. Je me résigne à faire la queue pour choper un taxi. L’attente est interminable. Je tente une fois de plus de joindre Madhi sans résultat. C’est enfin mon tour. Un black charge mon sac dans le coffre en roulant des yeux à la Louis Armstrong. J’ai pris place dans un tacot sous protection divine. Accrochée au tableau de bord, une Sainte Vierge phosphorescente agrippe son lardon dans les virages. Un chapelet se balance au rétroviseur pendant que des chérubins autocollants jouent de la trompette sur les accoudoirs. Il ne manque plus que les cierges et l’encens. À l’entrée de Brixton, nous doublons plusieurs véhicules des Security Companies, puis des patrouilles à cheval comme à la parade. Je n’ai jamais vu autant de bobbies en gilet fluo dans les rues. L’état d’urgence a été décrété ? On a enlevé la reine ? Je n’ai pas entendu une seule info depuis deux jours. J’interroge le chauffeur sur cette flopée d’uniformes. Il cesse de fredonner son gospel.
— C’est à cause de l’attentat, sir, me répond-il avec gravité.
Le mot me fige sur la banquette.
— Quel attentat ?
— Hier soir, un engin a explosé dans le métro entre Bond Street et Green Park. Il y a des contrôles partout. Ça fiche la pagaille dans la circulation et dans les gares.
J’ai un mauvais pressentiment.
— Il y a beaucoup de victimes ?
— Oh ! yes my God. Le Seigneur a rappelé à lui dix-neuf innocents, dont quatre petits jeunes. Faudra prier pour eux, sir. La bombe a blessé aussi une centaine de personnes. Aux infos, ils ont dit qu’un voyageur courageux avait cassé une vitre pour la jeter dans le tunnel juste avant que la rame entre dans la station. Sinon, ça aurait fait un carnage. L’homme a été déchiqueté. Croyez-moi, sir, pour son sacrifice il montera au paradis avec la Croix de Georges.
« Quatre petits jeunes ». La précision me terrifie. Je pense à mon fils Madhi. J’ai les lèvres qui tremblent.
— À quelle heure ça s’est passé ?
— Quand tout le monde rentrait du travail. Ces damnés bandits voulaient tuer beaucoup de gens.
J’essaye de me maîtriser pour réfléchir. Si Shirley et Mahdi avaient été dans le métro à ce moment-là, Édouard m’aurait rappelé. Mais alors pourquoi les téléphones sonnent-ils dans le vide ? Je poserai mon sac plus tard. J’impose au chauffeur un changement de direction vers Portobello Road. Si Shirley n’est pas chez elle, Abby pourra m’expliquer ce qui se passe. Après une série de détours et de raccourcis à rallonge, le taxi se gare enfin en double file. Je demande au black canonisé de m’attendre en laissant tourner le compteur. Je remarque immédiatement que les volets sont fermés. Je me laisse envahir par la panique. Mes jambes sont en coton. J’ai du mal à monter les marches du perron. Je frappe. Personne ne m’ouvre. Je ne perçois aucun bruit à l’intérieur. Je cogne plus fort. Ça ne sert à rien. Je passe chez Abby. Chez elle aussi les rideaux sont tirés. Pourtant à cette heure-ci, la garde-malade devrait être présente. J’entends bien la sonnette et les sifflements du cacatoès. Abby a peut-être été emmenée à l’hôpital. Ça expliquerait tout. Cette idée me peine, mais elle me rassure. Madhi serait simplement retourné m’attendre à la maison. J’appelle chez nous. Il ne décroche pas. Le cauchemar de l’attentat revient au galop. Je tourne machinalement la poignée de la serrure. La porte n’est pas fermée. J’entre dans le vestibule obscur. Attaché à son perchoir, Coco se met à hurler des « Grüss Gott » stridents. J’allume l’interrupteur de l’escalier et je grimpe au premier. Je veux m’assurer qu’Abby n’est plus chez elle. Je pousse la porte de sa chambre. Une odeur d’urine et de fruit pourri me prend à la gorge. Je distingue une forme dans le lit. Je m’approche doucement. Si Abby dort, je ne veux pas la réveiller en sursaut. Je m’incline vers elle. Elle serre contre sa poitrine le précieux flacon de parfum en forme de perruche. Son autre bras pend le long du drap. Je le repose sur la couverture. Les articulations sont raides. La main est froide. Je soulève un coin de l’oreiller. Son visage est livide. Du bout des doigts, je relève ses paupières gonflées. Les yeux sont vitreux. Un frisson me parcourt. Abby est morte, abandonnée à son sort comme une sans-abri au fond d’une cave. Je suis secoué. Je quitte la pièce en réprimant un haut-le-cœur. L’air frais m’empêche de tomber dans les vapes. Je claque la portière du taxi en pataugeant dans la cinquième dimension. Les craintes et les doutes me chahutent. Il faut d’abord que je sache si Madhi et Shirley sont parmi les victimes de l’attentat. Ensuite je raconterai mon histoire aux flics. Hors de question que je retourne voir le bigorneau du commissariat d’Hampstead. Je bredouille une nouvelle adresse. Le taxi redémarre. Je suis emporté dans une tornade d’émotions. Le chauffeur essaye de reprendre la conversation. Je suis incapable de lui répondre. Il en perd sa foi et sa bonne humeur. Nous sommes bloqués dans les embouteillages. Au terme d’un trajet fastidieux, il me largue sans regret devant l’entrée de New Scotland Yard.
Le planton me fait accompagner dans un couloir. Une rangée de chaises s’étire entre deux portes. Je dois attendre ici. Je n’arrive pas à rester assis. Je me contrôle pour ne pas hurler ou m’exploser les phalanges sur les murs. Putain ! Ce que j’endure depuis des semaines, c’est pas de la variétoche sirupeuse, c’est du black métal bien crasseux qui m’a déchiré les tripes. Après une intro presque en douceur de trémolo piking, le blast beat ne m’a laissé aucun répit. L’interminable morceau a débuté un peu avant Noël. Je me souviens de chaque note et de chaque parole hurlée dans mes oreilles. En attendant qu’un inspecteur me reçoive, je revis le cauchemar heure après heure, jour après jour. C’était un samedi. Le John Oxley venait de rejoindre les côtes anglaises…
***
2
Il fait un froid de chien sur le pont, mais je ne suis pas mécontent de revoir la terre ferme. Garret vérifie une dernière fois l’enroulement des haussières sur les treuils d’amarrage. Il vient se poster à côté de moi en étirant jusqu’aux oreilles son sourire édenté de mataf irlandais. Même s’il a quitté depuis un bail les verts rivages du Wekford pour une bicoque low-cost de Portsmouth, il semble aussi vachement heureux de retrouver sa femme et leur marmaille de rouquins pisseurs de Guinness. À l’entrée de l’estuaire, il me montre, tout excité, la cheminée de la centrale électrique de Fawley. L’immense cylindre dressé dans le crépuscule sert de balise aux plaisanciers du coin quand la brume a bouffé la côte. C’est du moins ce que je crois comprendre en déchiffrant son épouvantable accent Irish qui ressemble plus à du masticage de cordages qu’à de la poésie gaélique. Pour se réchauffer les pieds, il se met à danser la Jig devant le bastingage comme un gosse à vermifuger. Le vacarme de ses godasses de sécurité sur la tôle rivetée va sûrement effrayer la lune.
La nuit est tombée plus noire qu’une tranche de black pudding et ce fichu cargo norvégien n’a toujours pas largué ses amarres. En attendant de prendre sa place à quai, on tourne en rond depuis une demi-heure en brassant les poissons crevés et les rejets d’égouts. Le port de Southampton s’étire à perte de vue dans l’humidité glacée. Les milliers d’ampoules qui éclairent ses raffineries, ses grues monumentales et ses alignements de containers, ressemblent un peu aux décorations de Noël d’un Covent Garden géant. La comparaison s’arrête là. Car au lieu de sentir le Christmas cake au gingembre, ses bassins dégagent une puanteur de mazout et de soupe d’huîtres avariées qui me donne la nausée. Pour ne rien arranger, Garret vient d’allumer une roulée de tabac de contrebande. Il me souffle dans le nez une fumée âcre aux relents de pneus cramés. Je ferais mieux de rentrer si je ne veux pas dégueuler les scones dont je me suis goinfré au large de l’île de Wight.
Du jaune au noir en passant par le vert pour ceux qui ne supportent pas la houle, l’équipage et le groupe de scientifiques embarqués à bord déclinent toutes les couleurs de peau. Cham, hindi ou encore russe et français, on y baragouine huit langues de la proue à la poupe. Nous avons quitté Izmit dans les dernières chaleurs de l’automne ottoman. Puis, durant plus d’un mois, nous nous sommes traînés à quatre nœuds entre les côtes de Turquie et le détroit de Gibraltar. Le John Oxley est un navire sismique chargé de la prospection pétrolière des fonds marins. Sa mission consiste à tracter péniblement une douzaine de canons à air comprimé accrochés en éventail à des câbles d’acier. Les géophysiciens examinent les échos des explosions. S’ils découvrent une strate rocheuse susceptible de contenir de l’or noir, on a droit à un festival de cris de joie et d’embrassades de museaux. Ceux qui ne rigolent pas de cette joyeuse aventure sont surtout les mammifères marins désorientés par les détonations qui bousillent leur sonar. C’est à cause de ce vacarme qu’on retrouve régulièrement des milliers de marsouins échoués sur les plages ou de pauvres baleines à l’agonie dans les eaux de la Tamise. Pour faire bonne figure et calmer les écolos, chaque navire sismique embarque un type ou une nana qui surveille les vagues à la jumelle. À la moindre nageoire en vue, les tirs sont suspendus. Ça rend fous de rage les sondeurs. Surtout la pause n’accorde qu’un maigre répit aux bestioles. Après plusieurs expéditions passées à me niquer les yeux pour sauver une poignée de dauphins, j’ai été chargé d’une nouvelle expertise sur l’impact de cette méthode d’exploration. Je travaille désormais pour le compte de la plus haute autorité environnementale des Nations Unies. Avec une telle carte de visite, j’ai été choyé comme un nabab : cabine individuelle, place à la table des officiers, pinard aux repas et draps changés toutes les deux semaines. En contrepartie, la moitié des techniciens me regardaient de travers, convaincus, à juste titre, que je n’étais pas là pour les aider à dégoter le gisement du siècle, mais pour les empêcher de massacrer la faune. Le plus remonté contre moi était sûrement Bran Moelwyn, le chef de mission. Ce Gallois a une tronche de baudroie. Je n’ai jamais lu dans ses yeux autre chose qu’une furieuse envie de me balancer à la flotte. Je dois admettre que le compte-rendu que je m’apprête à rédiger ne va pas plaire du tout aux huiles de la Discovery Oil Company, le trust qui finance ces recherches. Après avoir examiné toute une batterie de prélèvements, j’ai découvert que les études publiées jusqu’à présent cachaient salement la vérité. Contrairement à ce que veulent faire croire les enfoirés qui les ont falsifiées, je suis en mesure de prouver que les déflagrations détruisent les alevins, provoquent des hémorragies chez les poissons et rendent les tortues aveugles. Pour les baleines, le coup de grâce se prépare. Deux cadavres de rorquals communs, dont une femelle pleine, ont été aperçus à la pointe Benghisa deux jours après notre navigation au sud de Malte. J’appelle pas ça une « fâcheuse coïncidence ». Si cette technique assassine révèle des filons rentables et que des permis d’exploitation sont accordés en Méditerranée, on court à la catastrophe. C’est pas un gugusse rivé à sa lorgnette sur la passerelle de leurs maudits rafiots péteurs et des types ramassant le mazout à la pelle dans les zones protégées qui changeront quelque chose au carnage. Voilà ce que je compte expliquer très clairement à mes employeurs. Si mon rapport est enterré sous la pression des pétroliers, j’alerterai la presse. Ça sera peut-être pas le scandale du siècle, mais ça pourrait bien faire du bruit… et du bon celui-là !
Je me suis à peine dégelé les oreilles que les haut-parleurs crachotent dans les coursives. Avec un humour très british, le second nous informe qu’on va enfin accoster à l’endroit même où le Titanic a appareillé pour son rencard avec un iceberg. Je renfile ma parka et remonte sur le pont assister à la manœuvre. Le gaillard d’avant est inondé de lumière. Nous longeons le flanc d’un paquebot de dix étages plus éclairé que le palais de Westminster. À côté de ce monstre blanc, le John Oxley a l’air d’une chaloupe. Telle une nounou attentionnée, la pilotine nous guide dans l’Ocean Dock. Déposé en douceur dans son berceau par ses propulseurs d’étrave, notre bateau s’approche lentement du quai. Sa coque caresse les énormes coussins en caoutchouc qui l’empêchent de racler le béton. Dix mètres plus bas, dans la lueur orange des lampes au sodium, les lamaneurs s’agitent. Ils fixent les amarres aux lourds bollards de fonte, crachent par terre, gueulent un coup et disparaissent dans l’obscurité brumeuse. Le John Oxley couine encore un peu avant de s’endormir comme un gros bébé. On ne perçoit plus que le ronronnement de ses moteurs au point mort. Nouvelle annonce : Le pacha nous invite à fêter le retour. Je croise Garret qui file changer son pull taché de graisse contre une chemise froissée.
Je me retrouve sans enthousiasme au milieu des quarante gaillards serrés dans la salle à manger. Histoire de m’entourer de visages imberbes, je me faufile vers les deux seules femmes de l’équipe : une étudiante de Glasgow et Ielena, une belle Ukrainienne spécialiste des sédiments marins. Le capitaine a fait sortir de la cambuse trois magnums de mousseux italiens et quelques bouteilles de soda fluo. Tout le monde lève son verre aux résultats prometteurs de la prospection. Je garde discrètement mon coude baissé en songeant aux dauphins bleus et aux tortues Caouanne qui doivent trinquer à l’eau de mer de nous savoir enfin barrés de leur jardin. Je préfère porter un toast à la santé du vieux Brian qui m’a promis de ne pas mourir avant que je repasse le voir. J’espère que son palpitant en fin de course lui en aura laissé le temps.
La petite réunion ne s’éternise pas. Je m’en réjouis. Je m’apprête à regagner ma cabine quand une voix me chope dans l’escalier.
— Alex, on va boire un verre à la marina avant d’aller manger un morceau. T’es de la partie ?
Kerry est un jeune ingénieur qui m’a pris en sympathie depuis notre départ. Je pense qu’il partage mon combat sans se risquer à me le dire. Il est bardé de diplômes, mais se contrefout de l’acharnement de ses collègues à flairer des milliers de barils sous la grande bleue. Sa passion, c’est la musique. On discute souvent pop-rock. Ça lui donne l’occasion de chambrer mes références vintages. Il a fondé un groupe avec des potes. Un soir, il a sorti sa guitare et nous a offert un aperçu de leur répertoire. Ce mec a une voix à faire chialer une orque. J’admets tout aussi jalousement que sous sa crinière frisée, sa petite gueule à la Bert Sommer doit affoler les sirènes. D’ailleurs, il n’a échappé à personne que la thésarde écossaise aurait donné ses ongles pour se retrouver seule avec lui dans un radeau de survie. Il attend ma réponse en pianotant sur la rampe.
— Je sais pas. Je suis un peu naze et puis je crois que j’ai chopé un rhume.
— Ielena est partante. Osman et Garret aussi.
J’hésite. L’Asti tiède me ballonne un peu, mais je crève la dalle. La perspective du reste de nouilles sautées que va nous réchauffer le cuistot ne m’enchante guère.
— La morue bouffie qui te sert de boss n’est pas de la partie au moins ?
— Question idiote ! Allez, viens. Garret connaît un pub sympa où la bouffe est bonne.
Je laisse parler ma fringale et promets de les rejoindre dans un quart d’heure. J’appelle la maison pour prévenir qu’on a touché le bitume à peu près dans les temps. Samia est aussi impatiente de me revoir que contrariée de ne pas pouvoir venir me chercher. Elle s’est fait une entorse à la gym et le toubib lui interdit de conduire. Moi qui voulais jouer au cap-hornier enlaçant sa moitié sur le débarcadère, c’est loupé ! Tant pis pour nos retrouvailles romantiques sur le parking d’à côté. Je rentrerai en train ou en voiture de location si je ne trouve personne pour me ramener à Londres. J’aurais aimé dire deux mots à mon fils Mahdi, mais il glande chez un copain, scotché aux jeux vidéo. J’envoie à Samia des milliers de baisers avant de raccrocher. Je jette un œil à travers le hublot. Le temps ne s’est pas arrangé. J’extirpe du fond de mon sac un bonnet et une écharpe en laine pour affronter la neige fondue qui joue maintenant les éphémères dans la lueur des lampadaires.
Le bosco nous traîne par erreur dans un piano-bar pour rupins donnant sur un alignement de porte-savons flottants. On écourte la punition. Heureusement, l’adresse de Garret nous convient nettement mieux. Dockers et touristes égarés semblent se retrouver ici pour l’ambiance plutôt chaude. La patronne nous case dans un coin de la salle décorée d’un incroyable bric-à-brac à la gloire de la marine royale. Près d’un poêle à bois qui enfume la galerie, une brunette mignonne enchaîne les chansons de gabiers, accompagnée par un accordéoniste à trogne de naufrageur. Les pintes s’accumulent sur la table. Je sens que la cuite se pointe à l’horizon. Si je veux éviter la casquette de plomb, il faut que je mette du solide en cale. J’opte pour l’agneau à la menthe. Chacun y va de ses souvenirs, de ses blagues ou de ses vantardises. On rigole des mésaventures loufoques d’Ielena sur un brise-glace norvégien. Osman, le mécanicien ghanéen, nous raconte ses désopilantes combines de môme pour piquer des sacs de noix de cajou sur le port de Takoradi. Garret nous abreuve d’histoires de cul et de tournées qu’il commande avant qu’on ait eu le temps de vider nos verres. Boostés par des litres de bière, les fous rires s’enchaînent. Je pourrais leur avouer que je vais bientôt les foutre au chômage que ça les ferait marrer comme des bossus. Je préfère leur sortir mon grand classique : celui du jour où j’ai autopsié une baleine de Minke dont le long nez d’un Pinocchio en bois avait perforé l’estomac. Personne ne veut me croire à part le bosco qui prétend avoir trouvé un pied chaussé de semelles à clous dans la panse d’un requin marteau…
On a continué à s’en raconter des pas tristes. On a braillé quelques refrains avec la brunette. Après, je ne me souviens plus très bien. Il est une heure du matin. Kerry m’aide à remonter la passerelle qui a tendance à tanguer sous mes pompes à bascule. Je vais prendre une douche, deux sachets d’aspirine et m’écrouler sur ma couchette. Une dernière nuit à bord et je regagne mon home sweet home.
***
3
Le navire file à bonne allure sur la mer agitée. L’aube s’étire en bâillant sur l’horizon. Dans la salle des radars, les bips lancinants des sonars rythment le silence. Depuis minuit, la veille infrarouge n’a détecté aucun avion ennemi. Le balayage des écrans circulaires dessine inlassablement les contours de l’île. La côte est à moins de vingt miles. Trop proche. Ce n’est plus qu’une question d’heures, mais Port Stanley n’est pas encore tombé. L’équipage a hâte que cette guerre se termine, hâte d’une meilleure météo, hâte de disputer des parties de hockey sur le pont d’envol, hâte d’être accueilli en héros. Le sous-lieutenant Lester Bennet va bientôt retrouver ses parents et amis. Il fera la tournée des pubs de Portsmouth pour fêter son retour. Son quart s’achève. Il signe le carnet de veille. Un autre officier vient prendre la relève. Avant de regagner sa cabine, il relève le col de sa vareuse et sort s’aérer. Sous ces latitudes, le mois de juin est glacial. La cheminée arrière diffuse un peu de chaleur. Bennet plisse les yeux. Il croit distinguer une traînée blanche sous le voile nuageux. Barre à tribord toute, le destroyer change brutalement de cap. Bennet s’accroche au bastingage. La manœuvre est désespérée. Un bruit sec siffle au-dessus de sa tête. Un engin antimissile s’élève dans le ciel. Trop tard ! L’exocet tiré depuis la terre percute la hiloire à hauteur du hangar. L’explosion est terrible. Lester Bennet est arraché du sol puis projeté à l’autre bout de la coursive par la violence du souffle. La coque vibre à se disloquer. Un bossoir se rompt. Une chaloupe se fracasse contre l’échelle de coupée. Des débris métalliques se plantent dans la tôle. Les réservoirs des hélicoptères s’embrasent. Une énorme langue de feu tourbillonnante jaillit dans un grondement d’enfer. Bennet est dévoré par une épaisse fumée noire. Il suffoque. Ses poumons lui brûlent la poitrine. Il a les tympans crevés. C’est à peine s’il perçoit les hurlements de la sirène d’alarme. Du sang et des cendres lui brouillent la vue. L’impact a taillé une large brèche dans la structure. L’incendie se propage. Des camarades sont bloqués dans la fournaise. Pour les libérer, trois hommes tentent d’ouvrir une trappe à coups de masse. Bennet doit aller les aider. Il parvient à se mettre à genoux. Il veut prendre appui pour se relever, mais il ressent une étrange sensation. Sa main gauche n’est plus qu’un lambeau de chair ensanglantée. Les os de son avant-bras font une saillie obscène hors de sa manche d’uniforme. Pourtant, il n’éprouve aucune douleur. Il observe, incrédule, son poignet déchiqueté. Un matelot lui bricole un garrot et un pansement de fortune. Il descend le sous-lieutenant à l’infirmerie. La place manque. On l’allonge dans le couloir. L’infirmier lui pose une perfusion. La morphine le met dans un état étrange. Le temps s’écoule hors du temps. Une frégate s’est portée à leur secours. On remonte sa civière. Bennet et les autres blessés vont être évacués. Il grelotte sous sa couverture. Une odeur de kérosène et de caoutchouc fondu empuantit l’air. Avant d’être embarqué, il aperçoit une dizaine de corps recouverts par des bâches. Les morts vont être inhumés dans la profondeur des eaux glacées. La panique a raison des calmants. Lester Bennet sort de sa torpeur. Il pleure comme un enfant. Entre deux sanglots, il supplie le brancardier d’aller chercher sa main… sa main…
Bennet se redresse d’un bond. Le cauchemar l’a tiré du sommeil sans vraiment l’effrayer. Ce mauvais rêve hante ses nuits depuis plus de trente ans. Il a eu le temps de l’apprivoiser. Le gyrophare d’une benne à ordure illumine les rideaux. Bennet allume la lampe de chevet. L’abat-jour étend son ombre jusqu’au plafond. Au pied du lit, Churchill observe son maître d’un œil inquiet. Rassuré, le chat ébroue sa fourrure pelée. Il étire ses quatre pattes en frémissant et retourne à ses propres songes. Bennet n’a pas besoin de regarder le réveil. Il sait qu’il indique 6 h 31. L’heure à laquelle le missile argentin les a frappés est gravée dans ses neurones à la minute près. Il glisse ses pieds dans des chaussons en feutre. Churchill le suit aussitôt. Bennet ne supporte plus les meubles en formica de la cuisine, les tiroirs qui coincent et la table en marbre aux allures de pierre tombale. Il verse de l’eau dans la bouilloire et dépose dans la gamelle du chat une poignée de croquettes censées soulager ses démangeaisons. Quand sa mère a dû quitter Londres, il a hérité de l’appartement et de son chat dont il trouve le nom ridicule. Tout a mal vieilli. Churchill fait de l’eczéma. Les papiers peints transpirent de fatigue. Sur les lattes gémissantes du parquet, les tapis du Cachemire sont usés jusqu’à la trame. Bennet n’a jamais pu se débarrasser du fatras de souvenirs rapportés par son père à chaque escale. Entre les estampes inuit, les bibelots de Hong Kong et les masques africains, le salon ressemble à un hôtel des ventes. Pendant que son thé infuse, Bennet se rend dans la minuscule salle de bain. Après sa douche, il essuie ses rares cheveux avec une serviette rêche. Il enfile un peignoir et entame, comme un rituel, la toilette journalière de son gant en silicone. Il le savonne, le sèche puis l’enduit délicatement d’une lotion assouplissante. Il apprécie le réalisme des rides, la brillance des ongles et le tracé bleuté des veines. Cette peau artificielle n’a rien à voir avec ses premiers modèles en plastique jaunâtre. Il met sa prothèse en place. Il déroule une chaussette en mousseline sur son moignon avant de le glisser dans le fourreau de la main électrique. Le gant cosmétique recouvre le tout, rendant l’appareillage presque indécelable. Les doigts s’ouvrent et se ferment en réponse aux impulsions transmises par des capteurs. Il peut serrer la poêle sans craindre de la lâcher. Il cuit ses œufs sur les deux faces et laisse bien griller le bacon. Son breakfast avalé, il rince son assiette sous le robinet.
Bennet pose sa tasse à côté du clavier. Son bureau est vide. Il ne ramène jamais aucun dossier ni document chez lui. C’est la règle. Rien ne doit être livré à la merci d’un cambriolage ou d’un piratage. Son ordinateur ne contient que des données strictement personnelles. La muraille érigée autour du PC en fait une forteresse imprenable. Un logiciel en dissimule même l’adresse IP. Bennet adresse un regard au portrait de son père. Le commodore pose devant l’Union Jack en tenue d’apparat. Le rêve d’être anobli par la reine se lit déjà dans son regard. Une rupture d’anévrisme ayant écourté la suite de sa carrière au ministère de la Défense, il ne devint jamais Lord et ne fut élevé au grade de vice-amiral qu’à titre posthume. La photo date du temps où il dirigeait la base de l’OTAN à Gibraltar. Le jeune Lester n’a découvert le rude climat britannique qu’à l’âge de quinze ans. Vers la fenêtre, un autre cliché montre sa mère en robe d’été dans le Jardin botanique de La Alameda. Quand elle a rencontré le capitaine Edgar Bennet, Moira MacGrégor enseignait la grammaire celtique à la faculté. Elle a abandonné les amphis pour élever son fils unique à l’ombre d’un rocher peuplé de macaques. Aujourd’hui, elle court après sa mémoire dans une maison de retraite du Kent. Son caractère à la Thatcher ne facilite pas le travail du personnel. Bennet pense qu’elle doit cet inflexible tempérament à son ancêtre Robert Roy MacGregor, le Robin des Bois écossais. D’ailleurs, aux batailles navales à la gloire des Bennet, Lester préfère largement le dernier fait d’armes de sa roturière lignée maternelle. Il n’oublie pas que dans quelques jours, les MacGrégor célébreront les soixante-trois ans de « l’exploit ». La nuit de Noël, son oncle Murdoch et trois autres étudiants patriotes sont allés récupérer la mythique pierre de Scone en plein cœur de Westminster et l’ont restituée à son pays d’origine. Après d’âpres négociations, on décréta que la relique resterait conservée au château d’Édimbourg. La coutume obligeant les rois d’Angleterre à s’asseoir sur ce bloc de granit le jour de leur couronnement, les Écossais le prêtent à leurs vieux ennemis à chaque nouveau sacre. Enfant, Lester adorait que sa mère lui raconte ainsi les prouesses de l’oncle Murdoch pour l’endormir. Son père en revanche n’appréciait guère qu’elle évoque cet événement dans les dîners et les réceptions. Issu d’une gentry d’aristocrates qui guerroient sur les vaisseaux de Sa Majesté depuis la victoire de Trafalgar, il préférait que son épouse reste discrète sur les frasques nationalistes de son beau-frère.
Churchill grimpe se blottir derrière l’ordinateur. Il adore la chaleur qui se dégage de l’écran, autant que le ronronnement des ventilateurs. Bennet va déposer un vinyle sur le plateau de la chaîne stéréo. Les premières notes des Pêcheurs de Perles se répondent en sourdine. Le disque craque un peu. Dans cette ancienne version enregistrée à l’Opéra de Paris, Nikolaj Gädda interprète le rôle de Nadir. Bennet se délecte de la voix du ténor pleine de douceur et d’émotion. Il fredonne le « Je crois entendre encore » de l’acte I pendant que ses antivirus chassent l’intrus dans un grésillement de processeurs. Les icônes apparaissent à l’écran sur fond de plage tropicale. Il se connecte à Internet et rédige un mail :
« Chère Soureya, je suis sincèrement peiné de votre triste sort. Soyez sans crainte, je vous aiderai à rapatrier votre argent. Donnez-moi vite les coordonnées de votre banque afin que je puisse procéder à ce transfert. Votre sourire est un enchantement. Vous ne m’avez pas dit si vous étiez déjà fiancée. Si ce n’est pas le cas, un cœur si généreux et si meurtri que le vôtre ne devrait pas rester esseulé. Dès que vos ennuis financiers seront réglés, j’attends votre venue avec empressement. Nous pourrons nous découvrir plus intimement. À très bientôt. Votre Douglas qui pense bien fort à vous. »
Bennet clique sur la touche « envoi ». À Lagos, le cybercafé n’ouvre que dans une heure. « Divin ravissement ! Folle ivresse ! Doux rêve ! » Soureya est déjà impatiente de lire son message. Le jour s’est levé. Bennet doit partir travailler. Il n’est jamais en retard. Il retourne aux toilettes pour la troisième fois. Sa vessie se vide au compte-gouttes. La douleur est moins vive qu’avant son opération. Il sait que ça ne durera pas. Comme chaque matin, il prépare son traitement. Il avale les gélules pour sa prostate et bien plus d’antalgiques que nécessaire. Aux opiacés qui soulagent depuis des années les séquelles de son amputation, il ajoute ceux prescrits par l’urologue. Bennet est parfaitement conscient de son addiction aux stupéfiants. Elle est comme ses cauchemars. Il s’en accommode. Même si elle l’oblige à absorber d’autres poisons pour empêcher les hallucinations et la somnolence, il ne déteste pas les effets euphorisants qu’elle lui procure. Bennet replace méticuleusement les médicaments dans l’armoire à pharmacie. Il ajuste le col de sa chemise, serre son nœud de cravate et enfile un lourd duffle-coat. La casquette en laine des Highlands que l’oncle Murdoch lui a léguée avant d’aller rejoindre les guerriers en kilt de William Wallace{2}, tiendra au chaud son crâne dégarni. Il quitte l’appartement en fermant sa porte blindée à double tour.
Lester Bennet n’a pas besoin de louer un garage. En tant que mutilé de la guerre des Falklands, il a droit aux places pour handicapés. Il en occupe une, commodément délimitée, au pied de son immeuble. Dans une rue fréquentée à deux pas de Kensington Gardens, ça semble tenir de la providence. En réalité, ses supérieurs n’ont eu aucun mal à faire aménager ce stationnement spécialement pour lui. Le moteur de sa Rover déteste le froid. Les gémissements du démarreur épuisent la batterie. Bennet redoute la panne. Le pot d’échappement crache enfin un nuage de vapeur blanche. Il pousse la poignée de la boîte automatique et s’engage bientôt dans Pembroke road en direction de la Tamise. Il n’a qu’un court trajet à faire pour rejoindre Thames House.
***
4
Je me réveille avec la langue pâteuse. Le fantôme de John Bonham répète un riff de batterie entre mes tempes. Il me faut une douche tiède, de l’air frais et du café bouillant. Je dois finir de ranger les dernières affaires qui traînent et vider ma cabine. J’empile les graphiques imprimés dans des classeurs en carton. Je vais vérifier le conditionnement des prélèvements et l’étiquetage des disques externes dans le local des ordinateurs. On me fera transporter tout ça à mon bureau. Je teste le réseau Wifi du port. Il est moins capricieux que la connexion satellite que nous avions en mer. J’en profite pour transférer les données les plus importantes sur notre unité de stockage. Là-bas au moins, elles seront protégées. Enfin, je l’espère. Je ne suis pas parano, mais je préfère « traverser la rivière avant d’insulter le crocodile », comme le suggère un proverbe kenyan.
Il est grand temps d’abandonner le navire. Je vais dire au revoir à ceux qui ne me détestent pas trop. Ielena m’offre un œuf porte-bonheur en bois peint. Belle occasion d’embrasser ses joues veloutées. Je croise sans le vouloir le chef de mission. Ce faux-cul m’inflige une cordiale poignée de main à classer au patrimoine mondial de l’hypocrisie. Heureusement, la virile et sincère accolade de Garret me réconcilie aussitôt avec le genre humain. Je jette un dernier coup d’œil au John Oxley dont la coque vert émeraude ruisselle d’humidité. Désolé vieux, mais pas de regrets !
Je rentre à Londres avec Kerry. Sa copine Faith a garé leur Combi Volkswagen orange devant la capitainerie. Je fais remarquer qu’un gars qui se trimbale dans l’icône du Flower Power ne devrait pas se moquer de ma collection de vinyles. L’intérieur est raccord : banquettes recouvertes de coton indien, odeur d’encens et bidule en perles de verre pendouillant au rétroviseur. En route pour Katmandou !
Je regrette de ne pas avoir connu le trip hippy, les déserteurs du Vietnam, l’ambiance peace and love des déesses de l’amour libre offrant leurs corps parfumés au patchouli dans les vapeurs de haschich… Manque de bol ! Je ne suis pas né dans La maison bleue de San Francisco avec Joan Baez comme marraine, mais bien trop tard dans une petite clinique libanaise. Ce sont les chansons de Fairuz qui m’ont bercé pendant que je sirotais mes biberons à la fleur d’oranger. C’est aussi là-bas que j’ai appris à baragouiner mes premiers mots de français. Mes parents s’étaient barrés en douce de Pologne après la répression des émeutes de Gdansk. Un compatriote en exil leur avait trouvé une place au soleil loin des milices politiques et du joug soviétique. Mon père était un jeune toubib intrépide, débordant d’idéal. Même s’il soignait surtout les familles friquées d’Achrafieh, j’aime encore en parler comme d’une sorte de chevalier croisé de l’ordre du stéthoscope allant combattre le choléra dans les bidonvilles de Nabaa. Ma mère était plus sage. Lunettes papillon et chignon blond tressé sur la nuque, elle enseignait l’architecture à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Le soir, elle jouait du Vivaldi à la flûte traversière ou peignait des paysages au ciel toujours bleu qui sentaient bon le jasmin et l’olivier. Tous deux étaient nostalgiques de leur pays natal et fiers de leur nouvelle patrie. Je me rappelle encore les deux drapeaux accrochés dans notre salon. Quand je montrais d’un doigt interrogateur l’aigle couronné et l’arbre vert sur fond de bandes rouges et blanches, ma mère m’expliquait de sa voix la plus douce : « C’est parce que nous sommes des oiseaux perchés sur un cèdre dans le jardin du monde ». À quatre ans, va comprendre ! Ça me faisait une belle jambe. Déjà à cet âge-là, je ne voulais pas être copain avec un rapace niché dans un sapin, mais nager avec les dauphins. Quand on partait faire une balade en mer, ceux qui bondissaient autour du bateau dans la baie de Saint-Georges me fascinaient. Walt Disney pouvait aller se rhabiller. J’aurais jamais échangé un spectacle pareil contre un dessin animé. C’est ce qui s’appelle une vocation précoce. Dans le genre apprentissage, je dois aussi avouer que les montagnes de baklavas aux pistaches dont ma mère me gavait au goûter ont largement forgé mon penchant pour les sucreries. L’aiguille de la balance m’invite toujours aux doux souvenirs de la mélasse de caroube et de la confiture de roses.
Hélas, notre bonheur fut de courte durée. J’ai encore dans les oreilles le bruit d’une balle perdue traversant les carreaux de ma classe de maternelle. C’était le début du chaos, du crépitement des rafales, du fracas assourdissant des explosions, de la terreur et des pleurs. J’en veux encore à mon père d’être allé soigner des phalangistes alors que ma mère le suppliait de rester à la maison. Ce soir-là, un obus a fait un orphelin et une jeune veuve de plus. Le lendemain d’un enterrement à la sauvette, la maman oiseau et son poussin sont redescendus du cèdre déchiqueté au lance-roquettes. Nous avons fui le jardin à feu et à sang avec nos larmes pour seuls bagages et volé à tire-d’aile nous réfugier en Jordanie. On a séjourné à Ankara, à Bruxelles et enfin à Paris où l’on a reconstruit un nid. J’étais né dans un pays où le droit du sol n’existe pas. Après l’obtention de notre naturalisation, je suis donc devenu franco-polonais. Vingt ans plus tard, ma mère dessinait des plans d’HLM, tandis que j’apprenais la biologie marine dans les amphis de Jussieu.
La paix consolidée, nous sommes retournés tous les deux au Liban. Le pays était en ruine, ses côtes saccagées par la pollution. Je devais évaluer l’état du littoral pour le compte d’une ONG. Ce fut mon premier job sérieux, mon premier coup de foudre aussi. J’ai rencontré Samia un matin où je prélevais des échantillons d’eau dans le Nahr Ghadir. Son regard m’avait liquéfié le cœur et probablement dissout au passage les tonnes de pesticide et d’huile de vidange que le fleuve charriait vers la mer. Samia étudiait l’archéologie à Alep. Elle venait gratter la terre autour de la nécropole royale de Byblos. Ses longs cheveux bruns caressaient le ciel tandis qu’elle se tenait en équilibre dans l’air surchauffé avec l’élégance d’une funambule. Sa grâce orientale était féline. Moi, avec mes coups de soleil et ma tignasse blanche, je ressemblais à un gros loukoum saupoudré de sucre glace. Ça ne m’avait pas empêché de lui bredouiller en arabe une invitation à se revoir. À mon grand étonnement, elle avait accepté la proposition. Le soir même, on buvait un verre dans un bar de la Corniche. Ce fut le début d’une histoire passionnée, ponctuée d’éloignements et de retrouvailles. Quant à ma mère, surmontant la douleur ravivée, elle participait à la reconstruction d’une ville dévastée par quinze ans de guerre. Je crois que son plus cher désir aurait été de pouvoir se recueillir sur la tombe de mon père. Situé sur une ligne de front, le petit cimetière avait été ravagé par les bombes. Il n’était plus qu’un terrain vague jonché de stèles pulvérisées. Ma mère ne retrouva jamais les restes du chevalier croisé, dispersés à tout jamais dans la poussière du Levant. Ce fut pour elle un autre coup dur. Quand cette chienne de maladie lui a planté ses crocs dans les reins, elle est retournée achever sa vie en Pologne. Je l’ai accompagnée jusqu’au bout du chemin.
Mes souvenirs sont brutalement balayés par un long coup de klaxon. On frôle dangereusement la glissière de sécurité.
« Shit ! Son of a bitch{3} ! »
Kerry a hurlé son injure en redressant le camping-car. Un camion a failli nous envoyer dans le décor en doublant sans visibilité. Le bidule en perles de verre se balance furieusement devant le pare-brise. Faith se mord les lèvres. J’en mène pas large sur la banquette arrière.
— Y a trop de brouillard. Je vais prendre l’autoroute.
— Je suis d’accord, mon pote. On fera du tourisme un autre jour.
Faith m’approuve en remuant la tête. Elle monte le son de l’autoradio. Un vieux morceau de Graham Nash nous remet de nos émotions.
Les deux tourtereaux nichent dans un trou perdu à l’ouest de Londres. Faith doit repasser chez eux récupérer un lot de fringues qu’elle a oublié d’emporter. Elle vend des vêtements d’occasion pour bobos branchés. Kerry la déposera devant la boutique qu’elle tient dans Camden Town. Ensuite, il me ramènera chez moi. J’ai parfois du mal à confesser qu’on habite Hampstead. Ça fait un peu golden boy de la City ou célébrité sur le retour. On n’a pas choisi ce quartier pour son côté rupin. Pour nous, c’est juste un beau coin de verdure éloigné du boucan du centre-ville. Si l’on voulait supporter le choc, il nous fallait absolument un peu de nature à portée de main. Ici comme ailleurs, la chlorophylle est hors de prix. Sans mes primes de missions, on ne pourrait même pas payer le loyer. Notre appart est un ancien atelier d’artiste planqué au fond d’une cour pavée de dalles usées. Luxe suprême, on a même un bout de jardin ou plutôt une jungle broussailleuse que je n’ai pas eu le temps de défricher. Avant de débarquer au royaume en juin dernier, nous vivions au Kenya. J’étais en poste à Nairobi au siège de l’United nation for environment program entant que coordinateur des actions de protections marines. Samia, qui est maintenant une spécialiste reconnue des forteresses médiévales musulmanes, se rendait souvent au Proche-Orient pour superviser les fouilles menées par l’Institut français de Damas. Quand Bachar el-Assad s’est mis à flinguer ses opposants par milliers, elle s’est retrouvée en vacances forcées. Mon patron lui a déniché un job provisoire au département des antiquités arabes du British Museum. Notre fils Madhi marche vers ses quatorze ans en traînant des pieds. Le déménagement l’a déstabilisé. Il est un peu paumé au collège. Ses premières notes sont catastrophiques. Son seul copain est un petit Pakistanais coincé dont je désespère de croiser le regard. Quand il n’est pas rivé à sa console de jeux, Madhi regarde la pluie tomber et les boutons lui pousser sur le nez. Le choc climatique est rude pour nous trois. On va devoir apprendre à supporter le froid, la neige et les bottes fourrées. La faune sauvage nous manque terriblement. On se contente des renards qui rôdent parfois autour des poubelles et des centaines de cerfs en liberté dans Richmond park.
On quitte l’autoroute à Camberley. Le défilé ininterrompu de maisons jumelées derrière la vitre embuée a un effet hypnotique. Mes paupières s’engourdissent pour se réveiller dans la cambrousse. Kerry gare le combi devant un grillage bordant un bois. Il descend ouvrir un portail branlant. Au bout du chemin, une caravane américaine en aluminium trône au milieu des arbres déplumés. Et Faith de se balader dans le décor avec sa tignasse rouge, sa doudoune bleue et son futal écossais. J’y crois pas ! Moi qui suis fan des vieux tubes de Cyndi Lauper, j’hallucine un peu. J’ai l’impression d’être dans le clip où la rockeuse dodue plaque le ringard qui n’aime pas sa nouvelle coiffure. Kerry n’est pas surpris de ma réaction. On leur a fait cent fois la remarque. Je ne peux pas m’empêcher de faire une photo avec mon portable. Faith charge son carton dans le coffre. On reprend la route. On se farcit les embouteillages autour de l’aéroport d’Heathrow. Je regrette presque de ne pas avoir pris le train. Faith me devine impatient. Elle me sert le reste de tchai qui tiédit dans le thermos. Thé noir, miel, cardamome… Allez, patience. Je rentre au bercail. La vie est belle, time after time{4}!
***
5
Thames House fut longtemps le plus bel édifice commercial de l’Empire britannique. Une fois franchies l’arche sculptée qui surplombe l’entrée principale et les bornes de sécurité biométriques alignées dans le hall, il n’abrite plus aujourd’hui que des pièces froides et impersonnelles. Au sixième étage, Lester Bennet résiste depuis trente ans aux mêmes posters d’art abstrait et à la lumière crue des lampes halogènes. La fenêtre de son bureau donne sur l’alignement de platanes qui masque Lambeth Bridge. Le déménagement sur les rives de la Tamise n’avait pas fait l’unanimité. Bennet regrette toujours l’ancien bâtiment de Gower Street. Les boiseries patinées et les parquets vermoulus embaumaient l’encaustique. Les secrétaires fumaient des mentholées dans les étroits couloirs. De simples badges magnétiques faisaient office de sésame. C’est dans ce décor vétuste qu’il avait entamé sa reconversion. Fan de films d’espionnage, Bennet rêvait de traquer les ennemis du royaume dans les pubs de l’Ulster et les plaines du Caucase. Pour décrocher ses galons d’agent de terrain, il avait rejoint une unité de soutien aux forces spéciales engagées aux Falklands. L’explosion du missile argentin avait pulvérisé ses ambitions. À la fin de sa convalescence, son père lui avait obtenu une planque d’analystedans les services de renseignements britanniques. Son infirmité s’accommodait du traitement de données courantes et des enregistrements informatiques de second ordre dont il avait la charge. Les plus jaloux l’avaient surnommé « daddy's boy{5}





























