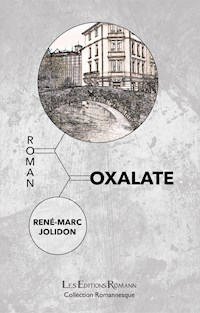
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Fred est enseignant en biologie et quelque peu désabusé. Il est appelé au chevet d’un ami de jeunesse qui sort de prison, Lorenzo, rongé par un cancer qui l’emporte. Cette ultime rencontre l’amène à refaçonner l’histoire de son ami, influencée par les différents acteurs qui ont participé à ce destin sans gloire apparente. Angelo, Gaby, Luigi, et même Alice, tous apportent une nuance à ce tableau ou plus simplement un sens à ce trajet. Ce plongeon dans le passé ravive le sentiment du temps qui n’attend pas, des choix que l’on croit libres mais qui butent aux contraintes qui jalonnent l’existence et confèrent à chaque parcours de vie une couleur si singulière.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sitôt son diplôme de médecin en poche,
René-Marc Jolidon passe quelques mois par la case prison pour objection de conscience. Embastillé, il se sent pourtant libre et rêve d'Afrique. Entre 1984 et 1992, il effectue trois missions sur ce continent : Rwanda, Cameroun et Zimbabwe. Vingt ans plus tard, le médecin s’est assagi. Il écrit trois romans dont les décors sont puisés dans ses expériences et publiés à L’Âge d’Homme. En 2002, avec
Comptes inrendus, il raconte le Cameroun.
Zaccharie ou une histoire sans vie décrit l’enfer du Rwanda avant le génocide de 1994. Le Zimbabwe gangréné par la pauvreté, le racisme et le SIDA complètera cette trilogie africaine avec Le Cœur du Jacaranda. La boucle semble bouclée, mais d’autres combats ont réveillé son besoin d'écriture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Isabelle, pour son soutien.
À Charlotte et Mélodie, pour leur bienveillance.
« Le rôle de la douleur, des déceptions ou des idées noires n’est pas de nous aigrir, mais de nous purifier. »
Hermann Hesse, « Peter Camenzind »
PROPOS D’AVANT-PROPOS
C’ÉTAIT hier, ou le jour précédent, un fait-divers dans le journal. Il relatait l’aventure d’un gamin chutant du cinquième étage et sauvé par un quidam qui se trouvait au pied de l’immeuble. La bonne fortune. Le bon moment, le bon endroit. Le magasin occupant le rez-de-chaussée était fermé et le commerçant n’avait pas enroulé la toile rayée qui lui servait d’auvent. Bêtement, le mécanisme était tombé en panne la veille. Le môme a rebondi sur le tissu et le badaud, un médecin, l’a attrapé au vol et sauvé d’une mort certaine. Un jardinier ou un ferblantier en auraient certainement fait tout autant, je suppose. Ce genre de détail journalistique m’agace. Chance, destin ? Le journaleux expliquait que le promeneur passait là par hasard, en ajoutant un pathétique « si le hasard existe… » Prenez un enfant, une chute, un auvent, des rayures, un passant dont la profession est médecin et mettez chaque mot dans un article différent. Il n’y a plus de hasard, plus de destin. Parce qu’il n’y a même pas d’histoire. Qu’un ensemble de faits qui, s’ils ne sont pas établis dans un ordre intelligible, ne produisent rien. De même, regardez un âne, un chien, un chat et un coq : il n’en émane, à la rigueur, qu’une image de campagne bucolique. Attifez-les en musicien et laissez-les s’ébattre dans la région de Brême : ça change tout. Parmi les milliards de milliards d’événements auxquels nos sens ont accès, les seuls qu’on retient sont ceux qui, mis bout à bout et dans un ordre qui convient à notre intelligence, évoquent une histoire qui tient la route. Par association naturelle ou par fantaisie. Peu importe. Et le reste, on s’en fiche… parce qu’on ne le perçoit pas.
Je ne crois ni au miracle ni au hasard. Pas plus qu’à la nécessité, d’ailleurs. Peut-être ne crois-je en rien, tout simplement ? Par rejet calculé et par peur d’être dupé. Un scepticisme fondamental pour que personne ne puisse un jour m’accuser de naïveté coupable. Par commodité aussi. Ou par paresse intellectuelle. La foi demande assurément des efforts importants et une bonne dose de travail sur soi. Or, en ce qui concerne les théories endoctrinantes, d’où qu’elles viennent, j’ai la paresse facile et je me définis plutôt du genre tout feu tout flemme. Cette indolence m’arrange. Tout comme elle convient à mon banquier qui ne voit pas, dans la foi, d’intérêts particuliers à l’exigeant boulot sans solde qu’elle exige. Sauf évidemment quand il s’agit d’admettre la réalité de ses montages financiers tordus, à peine lisibles, écrits en lettres minuscules, juste en dessous de l’espace réservé à la signature du contrat, que vous n’avez pas le choix de refuser.
Je ne reconnais pas l’existence d’un ordre des choses, forcé ou aléatoire, dans lequel tout s’emboîterait parfaitement en un tout cohérent, parce que la fortune l’a voulu ou que la vie de chacun est consignée dans un agenda divin. Je sais trop bien que l’être humain se plaît à habiller sa réalité d’un tissu de circonstances, chanceuses ou non, déterministes ou pas, pour expliquer l’inexplicable. J’y ai aussi recours dans mes instants de faiblesse. À travers des reliques de bénitier ou des reliquats de diableries, des morceaux de convictions vacillantes ou d’affirmations péremptoires, souvent farfelues, qui tirent davantage leur substrat de la magie pure que de la science établie. Inquiétante et apaisante sorcellerie de la pensée ou du langage qui peut transformer un mystère des plus insondables en spectacle mirobolant d’évidences. Expliquant tout. Rassurant sur tout.
L’homo erectus se plaît à user de ce genre de pratiques lorsqu’un matin, un vendredi treize de surcroît, mal luné, et les yeux encore rougis par une nuit agitée de rêves hypothétiquement prémonitoires, il se rend au tabac du coin pour vérifier son billet de loterie. Voulant éviter de passer sous l’échelle d’un ramoneur bossu, au nez crochu, nettoyant la cheminée d’une maison abritant un chat noir au regard fourbe, l’ahuri écrase alors, du pied gauche, une immonde et pâteuse crotte de chien. Il semble donc écrit que ce crétin ne touchera pas le gros lot ce jour-là. Non. Ni la crotte, ni l’échelle, ni le chat n’ont d’influence sur la chance de revenir bredouille du bar-tabac. La probabilité n’est qu’un rapport du nombre des cas favorables au nombre des cas possibles. Le joueur oublie trop facilement, dans son engouement épanoui à conquérir le quasi impossible, qu’il est bien plus proche de la certitude d’être quasi-perdant.
La vie ne se résume pas à une longue lutte, assurément vaine, contre les « quasi » qui la composent. Mais c’est tout comme. Au mieux, les interprétations plus ou moins foireuses que l’homme apporte à ses interrogations métaphysiques lui permettent de tempérer ses angoisses et de supporter le fait qu’il n’y a pas de réponses valables et apaisantes aux questions fondamentales. Il se voit dès lors dans l’obligation de se forger l’illusion de comprendre l’agencement des événements qui jalonnent son existence pour s’éloigner du constat qu’il est poussière, insignifiante particule au milieu de son amas, et qu’il aura grand mal à résister à l’ultime passage de l’aspirateur vorace de la Grande Ménagère. Tôt ou tard.
CHAPITRE IFRED
JE regarde par la fenêtre. Quelques personnes boivent un café sur la terrasse de la cafétéria. J’aime observer les foules. Dans les manifs ou sur les marchés. De prime abord, les amorphes qui s’y pressent ne représentent à mes yeux qu’un amoncellement de molécules en quête d’énergie pour leur propre fonctionnement dans un environnement en équilibre précaire. Sans valeur, sans utilité et sans but véritable. Ils ne prennent une signification vivifiante que dans les histoires qu’ils expriment ou que je leur prête. Un trait de visage m’inspire, un sourire, une posture particulière, un mot plus sonore qu’un autre ou une interaction. Regarder, écouter, sentir, user de ses sens, c’est inventer des histoires. Créer une trame m’est indispensable pour rendre ce théâtre moléculaire comestible. Sinon, je me sens comme une boule de flipper, ballottée d’une alvéole à l’autre, de champignons de plastique en champignons métalliques, à travers des passages sombres ou des couloirs luminescents. En plus ou moins de temps, j’atteindrai le game over après avoir été chahuté de part et d’autre de la surface de jeu sans un quelconque pouvoir d’en modifier les règles. Et après avoir marqué des points probablement inutiles. Même pour mon banquier. Ou alors, lamentablement, tous feux éteints, je rejoindrai directement le trou final, sans bruit, avec le frisson dans le dos accompagnant le tilt. Un tilt ultime semant l’effroi chez ceux qui restent en course. Il leur rappellera le néant qui m’aura englouti et les menacera à leur tour en leur imposant une prudence aussi maladive que castratrice. Le néant, ce vide abyssal d’où nous venons et qui reste notre destination finale. Issus et issue. La boucle est bouclée quand la boule disparaît dans son trou.
— Bonsoir ! Je vous dérange ?
Je sursaute. Pris en faute, je retire mes pieds du cadre du lit métallique en face de moi et me repositionne dans le fauteuil. Occupé à ma divagation, je n’ai pas entendu l’infirmière entrer dans la chambre. Elle a la discrétion d’un chat. Elle chuchote presque et semble s’excuser de rompre la quiétude de la pièce. Elle est jeune, la trentaine, brune, les cheveux frisés rassemblés en une queue-de-cheval qui lui descend jusqu’au milieu du dos. De grandes boucles d’oreilles contrastent les traits fins de son visage allongé. Elle doit être espagnole ou portugaise. Italienne peut-être. Elle sent la mer, les embruns, la plage de sable blond. Elle transpire l’huile d’olive. Elle a un sourire magnifique et me regarde avec un regard mêlé de curiosité, de gentillesse et de compassion. Son regard est avenant. Attractif. Quelque chose qui me rappelle celui de… Mais la comparaison s’arrête là.
— Non, je rêvasse, lui répondis-je.
— Je viens voir si tout va bien. Je finis mon service bientôt.
Elle vérifie le débit de l’oxygène. Elle frappe délicatement le drap qui recouvre le matelas pour en faire disparaître les quelques plis. Je lui demande hardiment :
— Vous êtes du Sud ?
— Oui, répond-elle.
— Je le sentais bien, lui lancé-je, fièrement.
— De la Belgique. De Charleroi. Vous connaissez ?
Mes joues se colorent de honte. Mes préjugés faciles font un bond obligé de mille cinq cents kilomètres. La brise marine troque ses relents d’iode contre ceux de la moule à l’ail et de la frite huileuse, le sable devient tourbe, les embruns se transforment en un brouillard épais et glacial. Et mon esprit patine sur un canal de Bruges enrobé d’hiver.
— De nom. De nom seulement. Je suis déjà allé à Bruxelles.
Je bredouille maladroitement espérant me dédouaner.
— Ce n’est pas très loin. Mais ce n’est pas la même chose, rétorque-t-elle malicieusement.
Il faudrait rebondir. Je me sens lourdaud. Je préfère le silence. Elle sourit avec une ironie sucrée.
En faisant mine de ne pas y toucher, je la dévisage pendant qu’elle poursuit de douces manœuvres auprès de son malade. C’est agréable de l’observer. Je la trouve belle. Ses manières sont aisées. Elle me plaît. Avec l’impression de la connaître déjà, je me dis qu’elle est faite pour ce métier. Je passe négligemment la main dans mes cheveux et m’inquiète instinctivement de ma tenue. Je me sens à l’affût comme un chasseur. L’érotomanie qui m’habite depuis mon divorce frise parfois le pathologique. Le regard à peine appuyé d’une femme, n’importe laquelle, n’importe où, m’embarque dans un monde virtuel régi par la fusion des corps et des esprits et la profusion de sentiments romantiques et de plaisirs sans fin. Pourtant, le constat est que mes échecs et le manque d’affection qui perdure m’engluent dans une frustration qui façonne mon existence depuis des mois.
Combien de fois avons-nous pensé, mon ex et moi (j’ai toujours eu du mal à dire ma femme) que nous étions faits l’un pour l’autre, qu’entre nous ce serait pour la vie ? Nous le pensions jusqu’au jour où elle a rencontré un autre type. Objectivement, il n’avait rien de plus que moi, mais il semblait mieux convenir. Elle est partie un matin et n’a pas réapparu. J’en suis resté sidéré. Pas désespéré. Juste sidéré. Parce que je n’ai rien compris. Comprendre quoi, d’ailleurs ? Je ne cherche plus à comprendre. Je ne perçois plus qu’un ensemble de faits à l’assemblage inintelligible. Ma vie était sans éclat. Elle s’opacifiait un peu plus. L’ex avait trouvé des frémissements clarifiants dans les bras d’un autre, moins sombre que moi. Elle troquait un illuminé pour un illuminant. Je me suis retrouvé seul comme un chanteur d’opéra devant un parterre de malentendants. Était-ce le hasard ou ma destinée ? Le résultat est le même. Passé la quarantaine, je me retrouve dans le rôle du vieux mâle solitaire à la recherche d’une nouvelle compagnie.
Ma présence ici, dans cette chambre d’hôpital, est aussi un fait qui ne souffre ni du sort ni d’un déterminisme quelconque. J’aurais pu ne pas répondre au téléphone il y a deux semaines quand une voix teintée de mansuétude, et un brin gênée m’a annoncé que Lorenzo avait été admis dans cet établissement.
— Lorenzo ? avais-je répliqué étonné. Je croyais qu’il était en prison. Tiens, il est encore vivant, avais-je poursuivi avec une tonalité aussi légère qu’inadéquate.
— Oui, mais ça pourrait vite changer, avait rétorqué la voix. Il nous a été transféré et il ne va pas bien. Lorenzo a donné votre nom. Ça n’a pas été facile de vous trouver. Il voudrait vous voir.
La conversation s’était arrêtée là. Je n’ai même pas demandé s’il était malade. La question aurait été superflue. On hospitalise rarement les bien-portants. Et son pronostic semblait déjà défini. Les autres détails dépendaient de ma curiosité qui n’avait pas eu le temps de s’aiguiser durant le court entretien téléphonique. J’avais raccroché le combiné et m’étais affalé sur le futon qui occupe une bonne moitié de la surface de mon studio. Les souvenirs s’allumaient les uns après les autres, comme les étoiles dans le ciel du soir naissant, au fur et à mesure que la nuit s’installe. Avec la lenteur d’un allumeur de réverbères, dans un autre temps, s’arrêtant méthodiquement au pied de chaque lampadaire longeant la grand-rue. Je n’avais pas revu Lorenzo depuis une dizaine d’années. Son souvenir me revenait parfois quoique de moins en moins fréquemment, je l’avoue. Ce que nous avions vécu ensemble avait pris des contours arrondis, flous, impalpables. Et là, d’un coup, des images revenaient, nettes, anguleuses et précises. Il manquait ces dix dernières années, bien sûr.
Le téléphone m’annonçant la présence de Lorenzo à l’hôpital a eu l’effet d’un coup de fouet. Je n’ai pas hésité. J’ai réservé une chambre dans cet hôtel situé en face de la gare et je suis venu dès que j’ai pu. J’ai pris le train le vendredi suivant, il y a déjà dix jours, après mon dernier cours. Je suis enseignant en biologie dans un lycée à deux cents kilomètres d’ici. Ma tâche consiste à graver dans des cerveaux peu perméables des théories sur des organelles qui produisent de la chlorophylle et des classifications fastidieuses de poissons composés d’os ou de cartilage. Rien qui ne puisse les captiver vraiment. Trop affairés à scruter leurs téléphones portables, pourtant interdits dans les classes, et à imaginer leur prochaine after psychédélique imbibée de Vodka-Red Bull. L’absence d’intérêt qu’ils portent à mon enseignement déteint sur moi. Je m’ennuie autant à préparer mes exposés imposés par le programme officiel qu’eux à les subir. Je rempile inexorablement les heures, patiemment, en attendant des jours meilleurs.
Je me pose parfois la question de savoir si ce sont mes élèves qui manquent totalement d’intérêt ou si le tort m’incombe entièrement parce que je ne sais pas enflammer leur désir de connaissances. Peut-être une combinaison de différents facteurs. En ce qui me concerne, c’est bien de la curiosité qui m’a décidé à revoir Lorenzo. Par devoir d’assistance et avec un certain esprit de loyauté envers un ami trop longtemps négligé. Une envie de compléter les faits manquants pour tisser une histoire qui tient la route. Et puis j’ai le temps. Sans obligations particulières, personne ne m’attend. La solitude depuis quelques mois est à la fois ma punition et mon refuge. Manque de volonté d’ouverture ou d’opportunités, de rencontres hasardeuses ou déterminées. Absence de faits saillants qui signe désespérément une histoire plate et vide. L’âme en jachère. Le bourdon, quoi.
Je me suis dit que ce retour aux sources me permettrait de changer d’air sans trop d’efforts. Je connais bien cette ville. Elle exhale le fumet de mon enfance. On pourrait croire que cette petite localité du Jura – petite capitale d’un petit canton d’un petit pays – n’a de grand que le sentiment d’ennui qui en émane. J’ai quitté ce coin de brousse depuis si longtemps que je m’y sens totalement étranger. Mes parents y sont morts il y a un bail et mes amis du temps des études se sont dispersés aux quatre coins du pays. Je n’ai plus aucune attache à cette portion de terre. Elle m’a toujours semblé trop exiguë, trop excentrée pour combler mes éphémères ambitions d’aventurier avide d’espaces. Des images subsistent, mais rien qui me pousse à y revenir. Si ce n’est en passant, par hasard, pour m’y imprégner de souvenirs qui sont autant de boulets que de sources de nostalgie tranquille.
L’hôtel que j’ai choisi se situe en face de la gare. La fenêtre de ma petite chambre surplombe les quartiers agglutinés au nord, au pied de la vieille ville, le centre historique de la bourgade. L’église Saint-Marcel et le château transformé en école depuis des décennies font les fiers en haut de la butte. Ils dominent quelques grands immeubles cossus, imaginés par des bâtisseurs haussmanniens au pays de Lilliput. Ces bâtiments au charme indubitable sont de plus en plus noyés et épars dans une marée de bâtisses cubiques et sans fioritures consacrées à une religion marchande. Les amas de béton ternes des centres commerciaux ont, petit à petit, défloré l’agencement plaisant des vieilles pierres. Ces cinquante dernières années, cette partie de la cité a été livrée sans discernement aux appétits démesurés de promoteurs et d’architectes, plus enclins à satisfaire leur livret d’épargne qu’à offrir une unité esthétique à l’ensemble. Sous l’œil complice des politiciens de tous bords qui n’ont toujours de l’avenir qu’une vision quadriennale de législature et qui n’habitent jamais les quartiers pourris pour lesquels ils octroient allègrement les permis de construire.
C’est un peu au-dessus de ce champ d’immeubles gris que j’ai grandi. Dans les quartiers à l’ouest de la ville où la classe moyenne – mon père était instituteur – avait eu l’opportunité de construire des petites villas sans luxe qui semblaient, pour mes parents, le signe extérieur de la réussite indéniable, fruit de la pierre et du travail des gnomes. Nous avions géographiquement une vision hautaine de ce quartier situé près de la gare, dans le bas de la ville. Pour ceux du haut, il était le passage obligé du samedi matin où on allait faire les courses pour remplir un frigo gigantesque – autre signe de réussite sociale – qui prenait une place importante dans la petite cuisine où ma mère siégeait la plupart de son temps. À cette époque, le côté inesthétique de la basse ville ne me dérangeait pas le moins du monde. Au contraire. La grisaille de l’ensemble se mariait avec enchantement à celle de mon enfance.
Au Moyen Âge, cette petite localité aurait joui d’une importance stratégique dont mes professeurs d’Histoire aimaient à penser qu’elle fut cruciale. Fallait-il les décevoir en ne les croyant pas ? L’histoire de l’humanité se borne à l’histoire des guerres, amalgame tenace dans l’enseignement moderne. Celle de ce pays, et celle de cette région encore plus, est sans aspérités ni saveur. Pas de hauts faits d’armes, de conquêtes ou de révolution. Nos militaires avaient été mercenaires et ont concouru à la gloire de nos voisins européens. Mais notre armée actuelle, depuis sa création, a réussi à n’effrayer et ne tuer que ses propres concitoyens dans quelques manifestations pour le maintien de l’ordre ou à l’occasion de malheureux accidents. Ce pays a été à l’abri des guerres et des révoltes depuis des siècles. Non à cause de remparts infranchissables ou d’une bravoure quelconque qui auraient apeuré ceux qui le convoitaient. Les banques nous ont servi de forteresses. Il suffisait d’abriter l’argent des puissants du monde entier pour que le pays ne craigne plus l’invasion. Pourquoi attaquer sa banque alors qu’il suffit de passer au guichet ? Une histoire sans éclats comme une mer sans vagues. L’Histoire, factice ou enjolivée, que l’on a tenté de m’enseigner m’arrangeait. Le faste imaginaire de cette cité de province, gardienne de gorges escarpées crevassant les montagnes qui l’isolaient, comblait la morne quiétude de ma jeunesse.
Heureusement, il y avait eu l’Histoire récente. Et un symbole : le drapeau du Jura tracé sur les rochers qui surplombent le nord de l’agglomération, l’énorme écusson rouge et blanc, symbole des périodes de lutte pour l’autonomie du Canton dans les années 70, semblait apporter du relief à l’ennui historique qui collait à cette vallée. Parce que cette lutte-là, j’en avais été le témoin. Innocent, mais direct. Très jeune à l’époque, je ne comprenais pas tout ce qui se tramait. Mais je sentais l’effervescence joyeuse suscitée chez mon père, chaud partisan de la cause. Et la crainte de ma mère qui pensait que l’engagement politique de mon père représentait un danger pour la stabilité du cocon qu’ils s’étaient bâtis. L’odeur du gaz lacrymogène qui collait aux habits de mon père lorsqu’il revenait d’une manif avait la valeur de la poudre ramenée de la plaine de Waterloo. Il était mon héros.
Un jour, mon père est rentré tardivement d’une réunion du Rassemblement jurassien, le mouvement autonomiste dont il était fervent militant de la première heure. Maculé de sang séché, il revenait de l’hôpital avec quelques points de suture sur l’arcade sourcilière. Ma mère m’avait envoyé me coucher et je les entendais parler à voix basse dans la cuisine. J’imaginais mille périls affrontés pour sauver sa famille. Je voyais les agents des forces antiémeutes, véreux, redoutables ennemis vêtus de leurs tuniques bleues, bardés de munitions et d’armes destructrices, matraquant mon père qui ne craignait pas de les affronter pour sa noble cause. C’était la guerre. Même s’il n’y avait pas de morts au combat. J’appris bien plus tard que mon père avait malencontreusement heurté une poutre dans le réduit qui abritait le stock de drapeaux et de pancartes qui attendaient les militants pour la prochaine manifestation. Heureusement, la révolte des Jurassiens avait abouti et elle était source de fierté pour ceux qui y avaient participé. Je fais partie de ces élus, grâce à mon père.
Au cours de cette semaine, l’état de santé de Lorenzo s’était nettement aggravé. Les quelques forces qui l’habitaient encore l’abandonnaient plus que jamais. Hier soir, j’ai discuté avec lui. J’avais de la difficulté à saisir ses mots. Ses paroles devenaient plus rares, plus pénibles à produire et à comprendre. Il ne pouvait plus quitter son lit. Mais il semblait qu’il eût déjà relaté l’essentiel. Il a même dit : « Je crois que je peux tirer ma révérence maintenant. » Je me suis fendu d’un peu crédible « mais non, ça ira mieux demain ! » Je l’ai ensuite abandonné dans les effluves d’éther hospitalier et suis allé manger seul en observant nonchalamment les habitués du bistrot. Ils semblaient tous s’amuser. À la fin du repas, je me suis planté au bar, invisible, pour siroter quelques bières avant de retourner dans la petite chambre coquette de l’hôtel. Je me suis affalé sur le lit et j’ai très mal dormi jusqu’à ce matin.
Quand je suis revenu tout à l’heure à son chevet, Lorenzo était déjà parti dans son monde comateux. On ne le nourrit plus. Juste un apport d’eau sucrée, d’oxygène et de beaucoup de morphine. Le lion n’est pas mort, encore moins incinéré, mais il n’est pas loin du columbarium. Et moi je le regarde s’en aller, sans tristesse véritable, sans soulagement non plus. Parce qu’il m’a dit qu’il était fatigué de la vie et des souffrances ressenties ces dernières années. Je le crois. Le visage émacié, pâle et cireux, raconte sans ambiguïté que sa maladie l’a usé jusqu’à la corde. Ses fières bacchantes contrastent avec l’apparence flétrie de ce faciès agonisant. Putain de cancer. Un cancer de l’estomac qui l’a fait fondre en quelques mois, réduit à un état de faiblesse extrême, l’a bouffé de l’intérieur pour ne lui laisser qu’une enveloppe de peau fanée protégeant des organes inutiles et truffés de métastases. Rien de plus. Une fin biologiquement explicable. Sans concessions. Si l’on se réfère à la sagesse populaire, Lorenzo n’aura pas de belle mort. Mais c’est quoi une belle mort ? Une mort inopinée, sans souffrance et sans angoisse ? Je n’en sais rien. Je ne vois rien de beau là-dedans de toute façon. Parallèlement, on ne parle jamais de belles naissances. L’accouchement est un événement toujours violent, sanguinolent. Et pourtant, on n’en retient que le cliché magique où le bébé est lavé de son vernix, du sang et de ses glaires verdies de méconium. « Il a eu une belle naissance ! » Ridicule, non ? La sagesse populaire est à géométrie variable.
Depuis vendredi dernier, mis à part quelques échappées solitaires pour aller prendre l’air ou manger dans un bistrot de la vieille ville, sur la place Neuve, nous avons beaucoup parlé, Lorenzo et moi. Enfin, lui surtout. Comme s’il devait vider son sac. J’en ai été retourné toute la semaine qui a suivi. Et quand je dis vider son sac, je devrais plutôt dire : vider ses sacs. Lorenzo avait en effet sorti du casier qui lui était réservé dans sa chambre un sac-poubelle qui contenait une vingtaine de vieux cahiers épais et reliés par une grosse spirale de métal rouge. Il m’a tendu le sac en me disant que c’était pour moi. J’ai compris tout de suite. Lorenzo n’aimait ni lire ni écrire quand j’ai fait sa connaissance. Je lui apportais ou lui envoyais régulièrement des bouquins en prison. Lors d’une visite au début de son incarcération je lui avais proposé l’écriture d’un journal.
— Pour quoi faire ? m’avait-il rétorqué.
— Pour rien. Enfin, ça te fera peut-être du bien de t’exprimer autrement qu’avec tes bougonnements habituels d’ours mal léché. Pour laisser des traces.
— Bof. On se fait toujours pincer quand on laisse des traces…
— Même si l’effort te semble inutile sur le moment, tu verras dans quelques mois si tu as envie de poursuivre. De toute manière, ça reste ton jardin secret. Cela ne t’engage à rien. Tout au plus, tu pourras juger si tes idées changent ou si rien ne bouge. Enfin, j’en sais rien. Fais ce que tu veux. Voilà de quoi faire, si tu te décides.
Je lui avais remis le premier cahier vierge et un stylo, sans trop y croire. Et voilà que le premier avait eu de nombreux petits. J’avais réussi à le convaincre et il me faisait cadeau du tout. Présent inattendu et magnifique. Je n’en revenais pas.
— Tiens, je te les confie. Je voulais les jeter. Mais j’ai pas eu le courage. Tout ce travail n’aurait servi à rien. Déjà que je ne suis pas sûr de son utilité… Tu t’en débarrasseras plus tard. Après moi.
— Pour ne pas laisser de traces ? avais-je rajouté, pensant être drôle.
Et, depuis une semaine, je me promène avec l’un ou l’autre de ces carnets et les parcours avec avidité. Avec une émotion certaine aussi.
Je tente d’attraper une mouche qui parcourt frénétiquement le bord du lit sur lequel Lorenzo semble dormir paisiblement. Ses lèvres gercées et entrouvertes exposent quelques chicots déchaussés pleins de tartre. Les tubulures de plastique qui lui amènent l’oxygène irritent vraisemblablement ses narines qui se bombent par instants, comme pour s’en débarrasser. Des spasmes discrets font sporadiquement frétiller l’épaisse moustache qu’il porte depuis que je le connais. Il semble sourire. Il respire par vagues, de plus en plus amples et bruyantes, qui s’arrêtent subitement pendant de longues secondes, presque une minute, avant de reprendre leurs cycles d’abord petits, inutiles, puis de plus en plus imposants. L’hémoglobine saturée semble alors dire à son cerveau qu’il peut s’arrêter là. Pour un temps. Le temps d’accumuler le gaz carbonique qui va réveiller son centre respiratoire déboussolé par cet assoupissement morbide. Une respiration anormale, presque agonique, qui ne prédit qu’une chose : ce gars ne passera pas l’hiver. Ni l’été, d’ailleurs.
— Vous croyez qu’il en a pour longtemps ? demandé-je à l’infirmière qui s’affaire délicatement autour du moribond.
Elle met l’index sur sa bouche bien dessinée, une moue destinée à me faire comprendre qu’il y a des mots qu’on ne prononce pas devant un agonisant. Parler de la mort à un mourant, c’est tabou. Elle poursuit comme si je n’avais rien dit.
— Vous pensez qu’il est confortable ?
Confortable ? Quelle drôle de formulation. Elle veut savoir si, dans le cas présent, la souffrance est palpable, visible, audible. Mesurable. Mais je ne sais pas, moi. Sans doute. Quelle est l’unité de mesure du confort ? Comment cette carcasse mourante peut-elle encore indiquer une quelconque échelle de valeurs ? Je réponds sans certitude :
— Oui, je crois… Il semble se reposer. Sereinement.
— Je peux augmenter la morphine. Le docteur nous a donné une marge de manœuvre.
Un langage de militaire pour une lutte finale. Où l’on octroie le délicat pouvoir d’intervenir sur la distribution de drogues apaisantes pour assurer le repos du guerrier évincé sans pitié du champ de bataille.
Je suis vautré dans un fauteuil réservé généralement aux malades, en cuir vert pomme et que l’on a recouvert, par souci d’hygiène, d’une alèse blanche à mon intention. On ne mélange pas les miasmes de ce monde-ci avec celui des bien-portants. Au coin de cette chambre claire et propre, près de la fenêtre grande ouverte, je m’y cantonne depuis des heures, les pieds appuyés sur les tubulures du lit électrique de Lorenzo. Je passe mon temps à scruter les mouvements incohérents de ce thorax rescapé d’un camp de concentration et à tenter de m’habituer aux différentes odeurs qui envahissent la chambre par vagues sournoises et successives. L’alcool mentholé pour les moments les plus doux. L’odeur âcre et rance de sa respiration qui sent déjà la mort. Les relents de selles diarrhéiques et noirâtres que Lorenzo relâche sans horaires fixes et qui mobilisent l’infirmière et son aide. Elles me demandent alors, dans un accès de pudeur, de sortir un instant. Quand je reviens, je perçois une brume de gouttelettes en suspension, propulsées d’un atomiseur dont seule l’étiquette force à croire que l’aérosol est sorti d’un champ de lavande.
C’est l’été. L’air est lourd. Il n’y a pas un filet de brise, pas une ondée capable de dissiper les remugles de l’agonie. Quelques mouches se donnent des allures de vautours, et volettent en polygone sur le lit, pressées que le malade se transforme en charogne. Il est neuf heures du soir et le soleil tente avec peine de disparaître derrière la barrière de sapins de la chaîne du Jura. Les chants des oiseaux couvrent, par instants, le bruit ronronnant de la respiration chaotique de Lorenzo. L’infirmière passe un gant de toilette sur le visage du malade.
— Vous le connaissez bien ? Vous êtes de la famille ? Son frère, peut-être ?
L’infirmière a deviné que Lorenzo et moi sommes à peu près du même âge. Même si, à mon humble avis, cette charpente décharnée en train de laper l’air de la chambre surchauffée accuse dix ou quinze ans de plus que moi. Malgré le côté peu flatteur de la question, je ne lui en veux pas. Ses gestes traduisent tant de délicatesse que le plus rigide des procureurs ne pourrait que tout lui pardonner. Je réponds :
— C’est un ami proche. Un peu mon frère. On a vécu quelques bouts de vie ensemble. Il vous a raconté son histoire ?
— Non, j’ai seulement lu son dossier médical. Je ne suis pas de la région, mais mes collègues m’ont dit qu’il a eu une vie… comment dire… originale. Il vient d’ici, n’est-ce pas ? Enfin, je pense que vous connaissez mieux son trajet que moi.
Ayant fini les soins, elle s’assied sur le bord du lit et caresse doucement la main de Lorenzo.





























