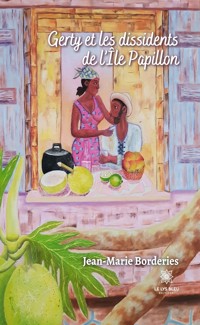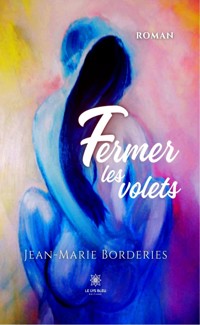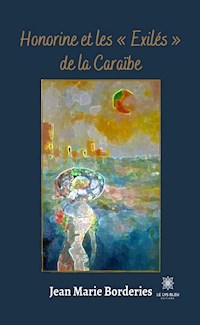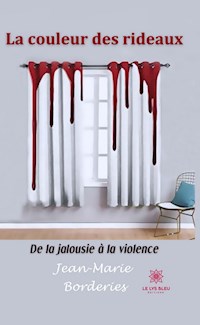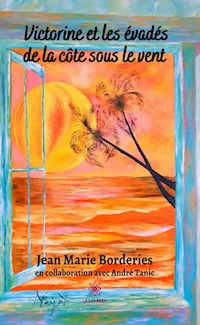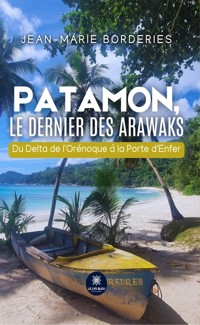
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Des rives du Delta de l’Orénoque aux falaises escarpées de la Porte d’Enfer, l’auteur retrace l’itinéraire de Patamon, dernier survivant des Arawaks, peuple premier des Antilles. Né d’une légende, il traverse les siècles, témoin de la conquête des îles, de l’arrivée de Christophe Colomb et du brutal effacement de sa civilisation. Il assiste ensuite aux grandes mutations du territoire : l’exploitation coloniale, l’essor de l’esclavage africain, puis la déportation des travailleurs engagés venus d’Asie. Réfugié dans une réserve de la Dominique avant de gagner les rivages de la Guadeloupe, Patamon porte en lui la mémoire d’un monde bouleversé. Mais au-delà du drame de la disparition, ce récit éclaire la construction d’une identité antillaise, où la fierté des origines s’allie à un profond attachement à la Nation française.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Marie Borderies se tourne vers l’écriture après avoir mené une carrière bien établie dans le secteur bancaire. Fort de ses expériences et de sa passion pour l’histoire, il plonge dans les racines profondes du peuple antillais, explorant ses origines, ses luttes et son évolution à travers des récits poignants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Marie Borderies
Patamon, le dernier des Arawaks
Du Delta de l’Orénoque à la Porte d’Enfer
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Marie Borderies
ISBN : 979-10-422-6635-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
À Jocelyne, avec une pensée respectueuse
pour ses parents et tous ceux qui les ont précédés
dans l’histoire du peuple antillais.
À tous les amoureux de l’histoire de France
et des Antilles dans la France.
Je ne suis pas prisonnier de l’histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée…
Je n’ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé…
Je ne suis pas esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères.
Frantz Fanon,
Peau noire, masques blancs
Prologue
Ce livre n’a pas la prétention d’être un livre d’histoire. C’est tout simplement une histoire inspirée de ma rencontre impromptue avec un personnage étrange qui m’est apparu, surgissant de nulle part alors que j’étais parti me balader avec ma fille le long de la plage de la Porte d’Enfer du côté d’Anse Bertrand en Guadeloupe.
L’histoire des Arawaks a fait l’objet de nombreuses recherches, mais la véritable histoire se nourrit souvent de belles légendes comme celle de Sésé et de ses graines de balata se dispersant au gré des vents pour envahir les Grandes et les Petites Antilles.
Tout est possible, mais rien n’est certain, alors pourquoi ne pas faire preuve d’imagination et se laisser porter par le récit de Patamon, « Le dernier des Arawaks » ?
La seule chose qui soit certaine, c’est que les Arawaks, qui ont peuplé les Antilles au cours des précédents millénaires, n’ont rien à voir avec « nos ancêtres les Gaulois » comme cela a été longtemps professé dans les écoles ultramarines.
Mais il est tout aussi erroné de prétendre que les Antilles ne sont peuplées que de descendants d’esclaves venus d’Afrique dans le cadre du Commerce triangulaire comme certains en sont persuadés1.
L’histoire de tous les peuples du monde est faite de couches successives venant au gré des incursions, enrichir les précédentes.
L’auteur, Jean Marie Borderies
P.S. : Mes bêta-lecteurs se sont interrogés pour savoir s’il s’agissait d’une fiction, d’un roman historique, d’un documentaire voire d’un guide touristique.
Je vous laisse le soin de découvrir ce roman et de répondre à votre question.
1
Une mystérieuse rencontre
Anselme et sa fille Laura
Laura avait été marquée par la peluche que je lui avais offerte alors qu’elle avait tout juste un an.
J’avais acheté une « affreuse2 » peluche représentant un diable rouge et noir à longues cornes à bord de l’avion qui me conduisait vers la Guadeloupe pour rejoindre sa maman partie avec elle quelques jours plus tôt3.
Plusieurs années plus tard, Laura avait grandi sans oublier ce petit diable qu’elle cajolait toutes les nuits (elle le conservera jusqu’à la fin de son adolescence).
Elle avait lu dans un guide touristique que plusieurs sites de la Guadeloupe portaient le nom de « Porte d’enfer » et me dit un jour qu’elle aimerait se rendre dans l’un d’eux pour découvrir ce qui se cachait dans un lieu ainsi dénommé et pourquoi pas rencontrer les ancêtres de son petit « diablotin ».
Je lui proposai, à l’occasion d’un nouveau séjour sur l’Ile papillon, d’aller passer une journée à la « Porte d’Enfer » d’Anse Bertrand.
C’est avec enthousiasme qu’elle en accepta l’augure et quelques jours plus tard nous décidâmes de nous y rendre.
Nous étions partis très tôt du gîte, loué pour quelques semaines, près du Gosier.
Après une petite halte chez Jean, le boulanger de Saint-Félix, pour déguster ses pains nattés avec une bonne tasse de chocolat maison, nous nous sommes mis en route.
Nous avions pris la direction de Morne-à-l’Eau puis celle d’Anse-Bertrand, à l’extrême Nord de la Grande Terre, pour atteindre finalement « La Porte d’Enfer », ce lieu au nom plutôt intrigant.
En chemin, Laura s’était amusée à lire à haute voix les noms inscrits sur les panneaux directionnels. Elle se montrait curieuse au sujet de chacun d’entre eux. Elle fut particulièrement intriguée par « Les Grands Fonds », amusée par le lieu-dit « Boisvin », surprise par un d’entre eux : « Matignon » dont elle avait entendu parler aux informations télévisées puisque pour elle il s’agissait de la résidence du Premier ministre de la France. Je m’empressai de l’éclairer sur l’histoire particulière de ce site connu comme étant le lieu historique d’un peuple connu sous le nom de « Blancs-Matignons » et lui promis d’approfondir plus tard.
Tout au long de la route, nous nous étions émerveillés des paysages de la Grande Terre. Nous avions aperçu les plages de sable blanc, les forêts luxuriantes et les mornes verdoyantes. Nous avions souvent ralenti pour laisser passer, ici un cabri tout affolé, là une vache qui s’était « évadée » du pieu qui la maintenait attachée par un paysan dans le creux d’un fossé. Nous nous étions arrêtés sur le bord du chemin pour cueillir et déguster quelques prunes de Cythère4 ou une mangue sauvage.
Après avoir garé notre voiture sur le parking, nous sommes montés, environ cinquante mètres plus haut, pour jouir d’un panorama exceptionnel.
Le tableau de ce bras de mer aux mille nuances de bleu qui s’enfonce dans les falaises calcaires est juste fantastique.
Nous pûmes respirer à pleins poumons l’air du grand large.
Le soleil était déjà haut lorsque nous atteignîmes la plage de Grande Anse. Nous avions commencé notre balade vers la fameuse « Porte d’Enfer ».
Nous avions suivi un sentier sinueux à travers les rochers, en admirant la faune grouillante et la flore foisonnante, avant d’arriver au bas de cette falaise escarpée qui surplombe la mer des Caraïbes.
La descente vers la plage avait été périlleuse. La vue du bas des falaises fut tout aussi exceptionnelle. Les vagues de l’Océan venaient se fracasser sur les rochers comme si les éléments se déchaînaient pour savoir qui de l’eau ou de la terre sortirait vainqueur du combat qu’ils se livraient sous l’œil narquois de l’air venu du ciel.
Tout paraissait surnaturel, mais l’atmosphère ambiante était inquiétante compte tenu du nom de ce lieu.
Nous voulions savoir pourquoi ce site était ainsi baptisé.
Notre curiosité grandit lorsque nous vîmes apparaître une silhouette qui avançait dans notre direction.
Une étrange créature venait vers nous, brandissant un large coutelas. Elle semblait sortie de nulle part ou plutôt d’un point noir à l’orée de la mangrove, aux limites de l’horizon entre terre et mer.
En haillons, pieds nus, hirsute, avec des dreadlocks qui lui arrivaient jusqu’au bas du dos, il semblait s’être échoué là, sur la berge, comme un naufragé rescapé d’un vieil esquif, victime d’une terrible tempête.
Nous n’osions pas nous approcher, mais nous comprîmes très vite à ses gestes qu’il voulait nous parler.
*******
Une avalanche de questions déboula dans ma tête et je me dis :
« Comment un tel énergumène avait-il pu atterrir sur cette plage si peu accessible ? Avait-il besoin d’aide ?Pourquoi et de quoi voulait-il nous parler ? »
À notre grande surprise, l’inconnu s’adressa à nous dans un français parfait avec une pointe d’accent antillais. Il nous interpella sans agressivité : Qui êtes-vous ? Que venez-vous faire chez moi ?
Voulait-il dire que nous étions des intrus qui venaient violer son territoire ? Nous comprîmes que nous devions jouer carte sur table et nous excuser pour notre immixtion dans son territoire.
Je sortis d’un seul trait cette longue phrase, masquant difficilement mon appréhension :
Puis reprenant confiance je poursuivis :
Il nous répondit en bombant le torse :
Et d’un ton plus posé, il poursuivit :
Avant même que je n’aie eu le temps de répondre, l’individu tira la gourde en peau qui était accrochée à sa ceinture et me la tendit en me proposant d’en boire une gorgée après lui.
Je vous propose de nous retrouver plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires plus tôt.
Surpris mais curieux devant une telle proposition, je m’exécutai en me saisissant de la gourde pour me verser, à la régalade6, quelques gouttes de cet étrange breuvage sous les yeux inquiets de ma fille.
Très vite dans un état second, je tombai à terre, les yeux révulsés, agité de légers tremblements. Je me mis à ânonner avec difficulté quelques mots totalement inaudibles :
Il répondit sans détour :
*********
Patamon entama alors le récit de la longue histoire de son peuple à travers les siècles.
« Il était une fois… »
2
« Je suis le dernier des Arawaks »,
la légende de Sésé7
La mère et l’enfant (Tableau de Fred Nerjat)
De nombreuses légendes ont encore cours au sujet de Sésé, notre mère à tous.
Un amant mystérieux ?
Parmi les plus souvent reprises par les conteurs, il y a celle qui révèle l’histoire de cette jeune fille qui vivait dans une case avec sa maman et son frère.
Chaque nuit, elle recevait la visite d’un amant qu’elle ne pouvait reconnaître dans l’obscurité.
Or un jour, sa maman s’aperçut qu’elle attendait un bébé. Elle se mit alors en quête de démasquer le visiteur nocturne. Quand celui-ci revint, quelques nuits plus tard, un guetteur posté dans un coin de la case lui barbouilla le visage de sa main trempée dans du jus de génipa8 afin qu’au petit matin il soit confondu.
À la surprise générale, le lendemain, on s’aperçut qu’il s’agissait du propre frère de la jeune fille.
Tout le Carbet fut désappointé et le coupable, honteux, dut s’enfuir.
La légende dit que le goujat s’envola dans le ciel pour se transformer en un astre lumineux, qui pourrait être la Lune, sur laquelle on voit les traces de cette poisse encore collée sur son visage.
Sésé mit au monde son enfant et, se souvenant de son amant, elle demanda à un colibri de monter jusqu’à la lune avec le petit enfant pour le faire voir à son père.
Le colibri s’acquitta de la tâche et c’est en récompense qu’il reçut de si belles plumes sur son corps et une couronne sur son front.
*********
Mais il existe une autre version du mythe de Sésé qui pourrait paraître plus crédible pour comprendre mon histoire et saisir la genèse de mes deux peuples, les Arawaks et les Caraïbes.
La voici, en substance, telle que l’a racontée l’auteur9 cité en référence :
Un serpent audacieux ?
Il y avait jadis un indien de la tribu des Arawaks qui recommanda à sa fille Sésé de ne pas aller se baigner dans un bassin de la rivière quand elle n’était pas bien portante.
Malgré cela, un jour, Sésé, oubliant le conseil, se jeta à l’eau alors qu’elle était dans sa période féconde. Or dans le bassin vivait un serpent « tête chien » (acayouman en caraïbe) qui, s’emparant de la fille, la rendit mère.
On dit que l’animal se transformait en homme chaque nuit et la fille prit l’habitude d’aller le rejoindre près de la rivière, à l’insu de ses parents, lorsque le jour était tombé.
Sésé mit son enfant au monde dans la case de sa mère et très rapidement l’enfant aurait pris l’habitude d’aller s’ébattre dans le bassin avec son père.
Le frère de Sésé constata qu’elle avait souvent auprès d’elle des graines de balata10 alors qu’elle n’avait pas de coutelas pour les cueillir.
Un soir, il la suivit. Il la vit se diriger vers un gros pied de balata où elle s’arrêta. Alors le serpent apparut comme sortant de son ventre et monta à l’arbre puis, soudain transformé en homme, il secoua les branches pour en faire tomber des graines.
Mais était-ce vraiment des graines de balata que l’homme faisait tomber de l’arbre ? N’était-ce pas plutôt de ces graines qui mettent les femmes enceintes ?
Tout ceci fâcha le jeune frère de Sésé qui décida de tuer le serpent, ce qu’il fit le lendemain au moment où l’animal montait de nouveau dans l’arbre. Il le coupa en mille pièces. Sésé, toute peinée, ramassa jusqu’aux plus petits morceaux ; elle les enterra et les recouvrit de feuilles.
Quelques mois plus tard, tandis qu’il chassait de ce côté, le même frère entendit un grand bruit à l’endroit où le serpent était enterré. S’étant approché, il aperçut quatre cases remplies d’Amérindiens : c’était les enfants du « serpent » cher à Sésé.
Ceux de la première case furent contents de voir leur oncle, il devait s’agir des Kalinagos, mais ceux des trois autres cases11 se montrèrent hostiles parce qu’il avait tué le serpent.
Malgré cela les chefs conseillèrent de ne pas tuer leur oncle et Kalinagos et Taïnos échangèrent des cadeaux et vécurent comme des amis jusqu’au jour où Sésé, devenue vieille et toujours inconsolée, dit aux Kalinagos de tuer un petit Taïnos pour venger le serpent.
Ainsi fut fait. Mais les Taïnos tuèrent à leur tour un petit Kalinago. C’est ainsi que commença la guerre entre nos deux peuples.
*******
La dernière légende révèle une parenté originelle entre Taïnos et Kalinagos, mais tend aussi à expliquer la guerre que se livrèrent nos deux peuples au cours de la période précolombienne.
Ces récits légendaires nous confirment que les deux ethnies ont la même origine, celle des Arawaks.
Nous sommes tous des enfants de Sésé
Ainsi plus de la moitié de la population installée à cette époque dans les Grandes Antilles, à savoir les Cubains, les Haïtiens, les Portoricains et les Dominicains, a des origines taïnos.
Cette ethnie a souvent été identifiée à tort par le terme générique d’Arawaks en opposition à celui de Caraïbes qui correspond aux Kalinagos.
Ces derniers, dont je suis issu, sont originaires du nord du Venezuela. Ils ont migré vers les îles des Caraïbes un peu plus tard, vers la fin du IXe siècle de notre ère. Lorsque nous sommes arrivés, ces îles étaient donc loin d’être inoccupées. En effet, depuis le Ve siècle avant notre ère, elles étaient habitées par les Taïnos.