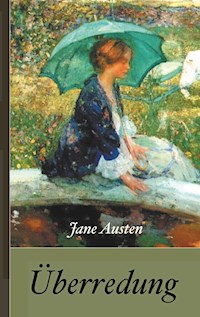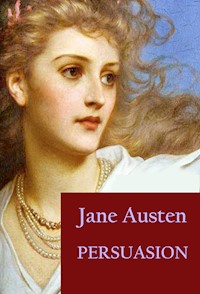
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Anne Elliot, beauté fanée et effacée de vingt-sept ans, est la seconde fille de Sir Walter Elliot, un baronnet veuf et vaniteux. Sa mère, une femme intelligente, est morte quatorze ans auparavant, en 1800; sa sœur aînée, Elizabeth, tient de son père la vanité de sa position. Sa plus jeune sœur, Mary, encline à se plaindre sans cesse, a épousé Charles Musgrove de Modèle:Lan, l'héritier d'un riche propriétaire des environs. Encore célibataire, sans personne dans son entourage qui soit digne de son esprit raffiné, Anne est en passe de devenir une vieille fille sans avenir...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
@page:first { }
www
Jane Austen
PERSUASION
(1818)
Traduit de l’anglais par Mme Letorsay
idb
ISBN 9783964847393
wwwwwwwwww
CHAPITRE PREMIER
Sir Walter Elliot, de Kellynch-Hall, dans le comté de Somerset, n’avait jamais touché un livre pour son propre amusement, si ce n’est le livre héraldique.
Là il trouvait de l’occupation dans les heures de désœuvrement, et de la consolation dans les heures de chagrin. Devant ces vieux parchemins, il éprouvait un sentiment de respect et d’admiration. Là, toutes les sensations désagréables provenant des affaires domestiques se changeaient en pitié et en mépris. Quand il feuilletait les innombrables titres créés dans le siècle dernier, si chaque feuille lui était indifférente, une seule avait constamment pour lui le même intérêt, c’était la page où le volume favori s’ouvrait toujours :
Famille Elliot, de Kellynch-Hall :
Walter Elliot, né le 1ermars 1760 ; épousa, le 15 juillet 1784,
Élisabeth, fille de Jacques Stevenson, esquire de South-Park, comté de Glocester, laquelle mourut en 1800. Il en eut :
Élisabeth, née le 1erjuin 1785,
Anna, née le 9 aoust 1787,
Un fils mort-né le 5 novembre 1789,
et Marie, née le 20 novembre 1791.
Tel était le paragraphe sorti des mains de l’imprimeur ; mais Sir Walter y avait ajouté pour sa propre instruction, et pour celle de sa famille, à la suite de la date de naissance de Marie :
« Mariée le 16 décembre 1810 à Charles Musgrove, esquire d’Uppercross, comté de Somerset. »
Puis venait l’histoire de l’ancienne et respectable famille : le premier de ses membres s’établissant dans Cheshire, exerçant la fonction de haut shérif ; représentant un bourg dans trois parlements successifs, et créé baronnet dans la première année du règne de Charles II. Le livre mentionnait aussi les femmes ; le tout formant deux pages in-folio, accompagné des armoiries et terminé par l’indication suivante : « Résidence principale : Kellynch-Hall, comté de Somerset. »
Puis, de la main de Sir Walter :
« Héritier présomptif : William Walter Elliot, esquire, arrière-petit-fils du second Sir Walter. »
La vanité était le commencement et la fin du caractère de Sir Elliot : vanité personnelle, et vanité de rang.
Il avait été remarquablement beau dans sa jeunesse, et à cinquante-quatre ans, étant très bien conservé, il avait plus de prétentions à la beauté que bien des femmes, et il était plus satisfait de sa place dans la société que le valet d’un lord de fraîche date. À ses yeux, la beauté n’était inférieure qu’à la noblesse, et le Sir Walter Elliot, qui réunissait tous ces dons, était l’objet constant de son propre respect et de sa vénération.
Il dut à sa belle figure et à sa noblesse d’épouser une femme très supérieure à lui. Lady Elliot avait été une excellente femme, sensée et aimable, dont le jugement et la raison ne la trompèrent jamais, si ce n’est en s’éprenant de Sir Walter.
Elle supporta, cacha ou déguisa ses défauts, et pendant dix-sept ans le fit respecter. Elle ne fut pas très heureuse, mais ses devoirs, ses amis, ses enfants l’attachèrent assez à la vie, pour qu’elle la quittât avec regret.
Trois filles, dont les aînées avaient, l’une seize ans, l’autre quatorze, furent un terrible héritage et une lourde charge pour un père faible et vain. Mais elle avait une amie, femme sensée et respectable, qui s’était décidée, par attachement pour elle, à habiter tout près, au village de Kellynch. Lady Elliot se reposa sur elle pour maintenir les bons principes qu’elle avait tâché de donner à ses filles.
Cette amie n’épousa pas Sir Walter, quoique leur connaissance eût pu le faire supposer.
Treize années s’étaient écoulées depuis la mort de lady Elliot, et ils restaient proches voisins et amis intimes, mais rien de plus.
Il n’est pas étonnant que lady Russel n’eût pas songé à un second mariage ; car elle possédait une belle fortune, était d’un âge mûr, et d’un caractère sérieux, mais le célibat de Sir Walter s’explique moins facilement.
La vérité est qu’il avait essuyé plusieurs refus à des demandes en mariage très déraisonnables. Dès lors, il se posa comme un bon père qui se dévoue pour ses filles. En réalité, pour l’aînée seule, il était disposé à faire quelque chose, mais à condition de ne pas se gêner. Élisabeth, à seize ans, avait succédé à tous les droits et à la considération de sa mère.
Elle était fort belle et ressemblait à son père, sur qui elle avait une grande influence ; aussi avaient-ils toujours été d’accord. Les deux autres filles de Sir Walter étaient, à son avis, d’une valeur inférieure.
Marie avait acquis une légère importance en devenant Mme Musgrove ; mais Anna, avec une distinction d’esprit et une douceur de caractère que toute personne intelligente savait apprécier, n’était rien pour son père, ni pour sa sœur.
On ne faisait aucun cas de ce qu’elle disait, et elle devait toujours s’effacer ; enfin elle n’était qu’Anna.
Lady Russel aimait ses sœurs, mais dans Anna seulement elle voyait revivre son amie.
Quelques années auparavant, Anna était une très jolie fille, mais sa fraîcheur disparut vite, et son père, qui ne l’admirait guère quand elle était dans tout son éclat, car ses traits délicats et ses doux yeux bruns étaient trop différents des siens, ne trouvait plus rien en elle qui pût exciter son estime, maintenant qu’elle était fanée et amincie.
Il n’avait jamais espéré voir le nom d’Anna sur une autre page de son livre favori. Toute alliance égale reposait sur Élisabeth, car Marie, entrée dans une notable et riche famille de province, lui avait fait plus d’honneur qu’elle n’en avait reçu. Un jour ou l’autre, Élisabeth se marierait selon son rang.
Il arrive parfois qu’une femme est plus belle à vingt-neuf ans que dix ans plus tôt. Quand elle n’a eu ni chagrins, ni maladies, c’est souvent une époque de la vie où la beauté n’a rien perdu de ses charmes.
Chez Élisabeth, il en était ainsi : c’était toujours la belle miss Elliot, et Sir Elliot était à moitié excusable d’oublier l’âge de sa fille, et de se croire lui-même aussi jeune qu’autrefois au milieu des ruines qui l’entouraient. Il voyait avec chagrin Anna se faner, Marie grossir, ses voisins vieillir et les rides se creuser rapidement autour des yeux de lady Russel.
Élisabeth n’était pas aussi satisfaite que son père. Depuis treize ans, elle était maîtresse de Kellynch-Hall, présidant et dirigeant avec une assurance et une décision qui ne la rajeunissaient pas.
Pendant treize ans, elle avait fait les honneurs du logis, établissant les lois domestiques, assise dans le landau à la place d’honneur, et ayant le pas immédiatement après lady Russel dans tous les salons et à tous les dîners. Treize hivers l’avaient vue ouvrir chaque bal de cérémonie donné dans le voisinage, et les fleurs de treize printemps avaient fleuri depuis qu’elle allait, avec son père, jouir des plaisirs de Londres pendant quelques semaines. Elle se rappelait tout cela, et la conscience de ses vingt-neuf ans lui donnait des appréhensions et quelques regrets. Elle se savait aussi belle que jamais, mais elle sentait s’approcher les années dangereuses, et aurait voulu être demandée par quelque baronnet avant la fin de l’année. Elle aurait pu alors feuilleter le livre par excellence avec autant de joie qu’autrefois ; mais voir toujours la date de sa naissance, et pas d’autre mariage que celui de sa jeune sœur, lui rendait le livre odieux ; et plus d’une fois, le voyant ouvert, elle le repoussa en détournant les yeux.
D’ailleurs elle avait eu une déception que ce livre lui rappelait toujours. L’héritier présomptif, ce même William Walter Elliot dont les droits avaient été si généreusement reconnus par son père, avait refusé sa main. Quand elle était toute petite fille, et qu’elle espérait n’avoir point de frère, elle avait songé déjà à épouser William, et c’était aussi l’intention de son père. Après la mort de sa femme, Sir Walter rechercha la connaissance d’Elliot. Ses ouvertures ne furent pas reçues avec empressement, mais il persévéra, mettant tout sur le compte de la timidité du jeune homme. Dans un de leurs voyages à Londres, Élisabeth était alors dans tout l’éclat de sa beauté et de sa fraîcheur, William ne put refuser une invitation.
C’était alors un jeune étudiant en droit, Élisabeth le trouva extrêmement agréable et se confirma dans ses projets. Il fut invité à Kellynch. On en parla et on l’attendit jusqu’au bout de l’année, mais il ne vint pas. Le printemps suivant, on le revit à Londres. Les mêmes avances lui furent faites, mais en vain. Enfin on apprit qu’il était marié.
Au lieu de chercher fortune dans la voie tracée à l’héritier de Sir Walter, il avait acheté l’indépendance en épousant une femme riche, de naissance inférieure.
Sir Walter fut irrité ; il aurait voulu être consulté, comme chef de famille, surtout après avoir fait si publiquement des avances au jeune homme ; car on les avait vus ensemble au Tattersall et à la Chambre des Communes. Il exprima son mécontentement.
Mais M. Elliot n’y fit guère attention, et même n’essaya point de s’excuser ; il se montra aussi peu désireux d’être compté dans la famille que Sir Walter l’en jugeait indigne, et toute relation cessa.
Élisabeth se rappelait cette histoire avec colère ; elle avait aimé l’homme pour lui-même et plus encore parce qu’il était l’héritier de Sir Walter ; avec lui seul, son orgueil voyait un mariage convenable, elle le reconnaissait pour son égal. Cependant il s’était si mal conduit, qu’il méritait d’être oublié. On aurait pu lui pardonner son mariage, car on ne lui supposait pas d’enfants, mais il avait parlé légèrement et même avec mépris de la famille Elliot et des honneurs qui devaient être les siens. On ne pouvait lui pardonner cela. Telles étaient les pensées d’Élisabeth ; telles étaient les préoccupations et les agitations destinées à varier la monotonie de sa vie élégante, oisive et somptueuse, et à remplir les vides qu’aucune habitude utile au dehors, aucuns talents à l’intérieur ne venaient occuper.
Mais bientôt d’autres préoccupations s’ajoutèrent à celles-là : son père avait des embarras d’argent. Elle savait qu’il était venu habiter la baronnie pour payer ses lourdes dettes, et pour mettre fin aux insinuations désagréables de son homme d’affaires, M. Shepherd. Le domaine de Kellynch était bon, mais insuffisant pour la représentation que Sir Walter jugeait nécessaire. Tant qu’avait vécu lady Elliot, l’ordre, la modération et l’économie avaient contenu les dépenses dans les limites des revenus ; mais cet équilibre avait disparu avec elle : les dettes augmentaient ; elles étaient connues, et il devenait impossible de les cacher entièrement à Élisabeth. L’hiver dernier, Sir Walter avait proposé déjà quelques diminutions dans les dépenses, et, pour rendre justice à Élisabeth, elle avait indiqué deux réformes : supprimer quelques charités inutiles, et ne point renouveler l’ameublement du salon. Elle eut aussi l’heureuse idée de ne plus donner d’étrennes à Anna. Mais ces mesures étaient insuffisantes ; Sir Walter fut obligé de le confesser, et Élisabeth ne trouva pas d’autre remède plus efficace. Comme lui, elle se trouvait malheureuse et maltraitée par le sort.
Sir Walter ne pouvait disposer que d’une petite partie de son domaine, et encore était-elle hypothéquée. Jamais il n’aurait voulu vendre, se déshonorer à ce point. Le domaine de Kellynch devait être transmis intact à ses héritiers.
Les deux amis intimes, M. Shepherd et lady Russel, furent appelés à donner un conseil ; ils devaient trouver quelque expédient pour réduire les dépenses sans faire souffrir Sir Walter et sa fille dans leur orgueil ou dans leurs fantaisies.
CHAPITRE II
M. Shepherd était un homme habile et prudent. Quelle que fût son opinion sur Sir Walter, il voulait laisser à un autre que lui le rôle désagréable ; il s’excusa, se permettant toutefois de recommander une déférence absolue pour l’excellent jugement de lady Russel.
Celle-ci prit le sujet en grande considération et y apporta un zèle inquiet. C’était plutôt une femme de bon sens que d’imagination. La difficulté à résoudre était grande : lady Russel avait une stricte intégrité et un délicat sentiment d’honneur ; mais elle souhaitait de ménager les sentiments de Sir Walter et le rang de la famille. C’était une personne bonne, bienveillante, charitable et capable d’une solide amitié ; très correcte dans sa conduite, stricte dans ses idées de décorum, et un modèle de savoir-vivre.
Son esprit était très pratique et cultivé ; mais elle donnait au rang et à la noblesse une valeur exagérée, qui la rendait aveugle aux défauts des possesseurs de ces biens.
Veuve d’un simple chevalier, elle estimait très haut un baronnet, et Sir Walter avait droit à sa compassion et à ses attentions, non seulement comme un vieil ami, un voisin attentif, un seigneur obligeant, mari de son amie, père d’Anna et de ses sœurs, mais parce qu’il était Sir Walter.
Il fallait faire des réformes sans aucun doute, mais elle se tourmentait pour donner à ses amis le moins d’ennuis possible. Elle traça des plans d’économie, fit d’exacts calculs, et enfin prit l’avis d’Anna, qu’on n’avait pas jugé à propos de consulter, et elle subit son influence. Les réformes d’Anna portèrent sur l’honorabilité aux dépens de l’ostentation. Elle voulait des mesures plus énergiques, un plus prompt acquittement des dettes, une plus grande indifférence pour tout ce qui n’était pas justice et équité.
« Si nous pouvons persuader tout cela à votre père, dit lady Russel en relisant ses notes, ce sera beaucoup. S’il adopte ces réformes, dans sept ans il sera libéré, et j’espère le convaincre que sa considération n’en sera pas ébranlée, et que sa vraie dignité sera loin d’en être amoindrie aux yeux des gens raisonnables.
« En réalité, que fera-t-il, si ce n’est ce que beaucoup de nos premières familles ont fait, ou devraient faire ? Il n’y aura rien là de singulier, et c’est de la singularité que nous souffrons le plus. Après tout, celui qui a fait des dettes doit les payer ; et tout en faisant la part des idées d’un gentilhomme, le caractère d’honnête homme passe avant tout. »
C’était d’après ce principe qu’Anna voulait voir son père agir. Elle considérait comme un devoir indispensable de satisfaire les créanciers en faisant rapidement toutes les réformes possibles, et ne voyait aucune dignité en dehors de cela.
Elle comptait sur l’influence de lady Russel pour persuader une réforme complète ; elle savait que le sacrifice de deux chevaux ne serait guère moins pénible que celui de quatre, ainsi que toutes les légères réductions proposées par son amie. Comment les sévères réformes d’Anna auraient-elles été acceptées, puisque celles de lady Russel n’eurent aucun succès ?
Quoi ! supprimer tout confortable ! Les voyages, Londres, les domestiques et les chevaux, la table ; retranchements de tous côtés ! Ne pas vivre décemment comme un simple gentilhomme ! Non !
On aimait mieux quitter Kellynch que de rester dans des conditions si déshonorantes !
Quitter Kellynch ! L’idée fut aussitôt saisie par Shepherd, qui avait un intérêt aux réformes de Sir Walter, et qui était persuadé qu’on ne pouvait rien faire sans un changement de résidence. Puisque l’idée en était venue, il n’eut aucun scrupule à confesser qu’il était du même avis. Il ne croyait pas que Sir Walter pût réellement changer sa manière de vivre dans une maison qui avait à soutenir un tel caractère d’honorabilité et de représentation. Partout ailleurs il pourrait faire ce qu’il voudrait, et sa maison serait toujours prise pour modèle. Après quelques jours de doute et d’indécision, la grande question du changement de résidence fut décidée.
On pouvait choisir Londres, Bath, ou une autre habitation aux environs de Kellynch. L’objet de l’ambition d’Anna eût été de posséder une petite maison dans le voisinage de lady Russel, près de Marie, et de voir parfois les ombrages et les prairies de Kellynch. Mais sa destinée était d’avoir toujours l’inverse de ce qu’elle désirait. Elle n’aimait pas Bath, mais Bath devait être sa résidence.
Sir Walter penchait pour Londres, mais M. Shepherd n’en voulait pas pour lui, et il fut assez habile pour le dissuader et lui faire préférer Bath : là il pourrait comparativement faire figure à peu de frais.
Les deux avantages de Bath avaient été pris en grande considération : sa distance de Kellynch, seulement cinquante milles, et le séjour qu’y faisait lady Russel pendant une partie de l’hiver. À la grande satisfaction de cette dernière, Sir Walter et Élisabeth en arrivèrent à croire qu’ils ne perdraient rien à Bath en considération et en plaisirs. Lady Russel fut obligée d’aller contre les désirs de sa chère Anna. C’était en demander trop à Sir Walter que de s’établir dans une petite maison du voisinage. Anna, elle-même, y aurait trouvé des mortifications plus grandes qu’elle ne le prévoyait, et pour Sir Walter, elles eussent été terribles. Lady Russel considérait l’antipathie d’Anna pour Bath comme une prévention erronée provenant de trois années de pension passées là après la mort de sa mère, et en second lieu de ce qu’elle n’était pas en bonne disposition d’esprit pendant le seul hiver qu’elle y eût passé avec elle.
Lady Russel adorait Bath et s’imaginait que tout le monde devait penser comme elle. Sa jeune amie pourrait passer les mois les plus chauds avec elle à Kellynch-Lodge. Ce changement serait bon pour sa santé et pour son esprit. Anna avait trop peu vu le monde ; elle n’était pas gaie : plus de société lui ferait du bien.
Puis, Sir Walter, habitant dans le voisinage de Kellynch, aurait souffert de voir sa maison aux mains d’un autre ; c’eût été une trop rude épreuve. Il fallait louer Kellynch-Hall. Mais ce fut un profond secret, renfermé dans leur petit cercle.
Sir Walter eût été trop humilié qu’on l’apprît. M. Shepherd avait prononcé une fois le mot « avertissement », mais n’avait pas osé le redire.
Sir Walter en méprisait la seule idée et défendait qu’on y fît la moindre allusion. Il ne consentirait à louer que comme sollicité à l’imprévu, par un locataire exceptionnel, acceptant toutes ses conditions comme une grande faveur.
Nous approuvons bien vite ce que nous aimons. Lady Russel avait encore une autre raison d’être contente du départ projeté de Sir Walter. Élisabeth avait formé une intimité qu’il était désirable de rompre.
La fille de M. Shepherd, mal mariée, était revenue chez son père, avec deux enfants. C’était une femme habile qui connaissait l’art de plaire, au moins à Kellynch-Hall. Elle avait si bien su se faire accepter de miss Elliot, qu’elle y avait fait plusieurs séjours, malgré les prudentes insinuations de lady Russel, qui trouvait cette amitié déplacée.
Lady Russel avait peu d’influence sur Élisabeth et semblait l’aimer plutôt par devoir que par inclination. Celle-ci n’avait pour elle que des égards et de la politesse, mais jamais lady Russel n’avait réussi à faire prévaloir ses avis ; elle était très peinée de voir Anna exclue si injustement des voyages à Londres et avait insisté fortement à plusieurs reprises pour qu’elle en fît partie. Elle s’était efforcée souvent de faire profiter Élisabeth de son jugement et de son expérience, mais toujours en vain. Miss Elliot avait sa volonté, et jamais elle n’avait fait une opposition plus décidée à lady Russel, qu’en choisissant Mme Clay et en délaissant une sœur si distinguée, pour donner son affection et sa confiance là où il ne devait y avoir que de simples relations de politesse.
Lady Russel considérait Mme Clay comme une amie dangereuse, et d’une position inférieure ; et son changement de résidence, qui la laisserait de côté et permettrait à miss Elliot de choisir une intimité plus convenable, lui semblait une chose de première importance.
CHAPITRE III
« Permettez-moi de vous faire observer, Sir Walter, » dit M. Shepherd un matin à Kellynch-Hall, en dépliant le journal, « que la situation actuelle nous est très favorable. Cette paix ramènera à terre tous les riches officiers de la marine. Ils auront besoin de maisons. Est-il un meilleur moment pour choisir de bons locataires ? Si un riche amiral se présentait, Sir Walter ?
– Ce serait un heureux mortel, Shepherd, » répondit Sir Walter. « C’est tout ce que j’ai à remarquer. En vérité, Kellynch-Hall serait pour lui la plus belle de toutes les prises, n’est-ce pas, Shepherd ? »
M. Shepherd sourit, comme c’était son devoir, à ce jeu de mots, et ajouta :
« J’ose affirmer, Sir Walter, qu’en fait d’affaires les officiers de marine sont très accommodants. J’en sais quelque chose. Ils ont des idées libérales, et ce sont les meilleurs locataires qu’on puisse voir. Permettez-moi donc de suggérer que si votre intention venait à être connue, ce qui est très possible (car il est très difficile à Sir Walter de celer à la curiosité publique ses actions et ses desseins ; tandis que moi, John Shepherd, je puis cacher mes affaires, car personne ne perd son temps à m’observer) ; je dis donc que je ne serais pas surpris, malgré notre prudence, si quelque rumeur de la vérité transpirait au dehors ; dans ce cas, des offres seront faites, et je pense que quelque riche commandant de la marine sera digne de notre attention, et permettez-moi d’ajouter que deux heures me suffisent pour accourir ici, et vous épargner la peine de répondre. »
Sir Walter ne répondit que par un signe de tête ; mais bientôt, se levant et arpentant la chambre, il dit ironiquement :
« Il y a peu d’officiers de marine qui ne soient surpris, j’imagine, d’habiter un tel domaine.
– Ils béniront leur bonne fortune, » dit Mme Clay (son père l’avait amenée, rien n’étant si bon pour sa santé qu’une promenade à Kellynch). « Mais je pense, comme mon père, qu’un marin serait un très désirable locataire. J’en ai connu beaucoup. Ils sont si scrupuleux, et si larges en affaires ! Si vous leur laissez vos beaux tableaux, Sir Walter, ils seront en sûreté : tout sera parfaitement soigné. Les jardins et les massifs seront presque aussi bien entretenus qu’actuellement. Ne craignez pas, miss Elliot, que vos jolies fleurs soient négligées.
– Quant à cela, répondit froidement Sir Walter, si je me décidais à louer, j’hésiterais à accorder certains privilèges ; je ne suis pas disposé à faire des faveurs à un locataire. Sans doute le parc lui sera ouvert, et il n’en trouverait pas beaucoup d’aussi vastes.
» Quant aux restrictions que je puis imposer sur la jouissance des réserves de chasse, c’est autre chose. L’idée d’en donner l’entrée ne me sourit guère, et je recommanderais volontiers à miss Elliot de se tenir en garde pour ses parterres. »
Après un court silence, M. Shepherd hasarda : « Dans ce cas, il y a des usages établis, qui rendent chaque chose simple et facile entre propriétaire et locataire. Vos intérêts, Sir Walter, sont en mains sûres : comptez sur moi pour qu’on n’empiète pas sur vos droits. Qu’on me permette de le dire : je suis plus jaloux des droits de Sir Walter, qu’il ne l’est lui-même. »
Ici, Anna prit la parole.
« Il me semble que l’armée navale, qui a tant fait pour nous, a autant de droits que toute autre classe à une maison confortable. La vie des marins est assez rude pour cela, il faut le reconnaître.
– Ce que dit miss Anna est très vrai, répondit M. Shepherd.
– Certainement, » ajouta sa fille.
Mais bientôt après, Sir Walter fit cette remarque : « La profession a son utilité, mais je serais très fâché qu’un de mes amis lui appartînt.
– Vraiment ? répondit-on avec un regard de surprise.
– Oui ; sous deux rapports elle me déplaît. D’abord c’est un moyen pour un homme de naissance obscure d’obtenir une distinction qui ne lui est pas due, d’arriver à des honneurs que ses ancêtres n’ont jamais rêvés ; puis elle détruit totalement la beauté et la jeunesse. Un marin vieillit plus vite qu’un autre. J’ai toujours remarqué cela. Il risque par sa laideur de devenir un objet d’horreur pour lui-même, et il court la chance de voir le fils d’un domestique de son père arrivera un grade au-dessus du sien.
» Voici un exemple à l’appui de ce que je dis. Au printemps dernier, j’étais en compagnie de deux hommes :
» Lord Saint-Yves, dont le père a été ministre de campagne, presque sans pain. Je dus céder le pas à Lord Saint-Yves, et à un certain amiral Baldwin, le plus laid personnage qu’on puisse imaginer. Une figure martelée couleur d’acajou ; tout était lignes et rides : trois cheveux gris d’un côté, et rien qu’un soupçon de poudre. « Au nom du ciel ! quel est ce vieux garçon ? dis-je à un ami qui se trouvait là. – Mon cher, c’est l’amiral Baldwin. Quel âge lui donnez-vous ? – Soixante ans, dis-je. – Quarante, répondit-il. Pas davantage. »
» Figurez-vous mon étonnement. Je n’oublierai pas facilement l’amiral Baldwin. Je n’ai jamais vu un exemple si déplorable de la vie de mer ; et c’est la même chose pour tous, à quelque différence près. Ballottés par tous les temps, dans tous les climats, ils arrivent à n’avoir plus figure humaine. C’est fâcheux qu’ils ne meurent pas subitement avant d’arriver à l’âge de l’amiral Baldwin.
– Ah ! vraiment, Sir Walter, vous êtes trop sévère, dit Mme Clay. Ayez un peu de pitié des pauvres gens. Nous ne sommes pas tous nés beaux, et la mer n’embellit pas certainement. J’ai souvent remarqué que les marins vivent longtemps. Ils perdent de bonne heure l’air jeune. Mais n’en est-il pas ainsi dans beaucoup d’autres professions ? Les soldats ne sont pas mieux traités, et même dans les professions plus tranquilles, il y a une fatigue d’esprit, sinon de corps, qui s’ajoute dans le visage d’un homme au travail du temps. Le légiste se consume, le médecin sort à toute heure, et par tous les temps, et même le prêtre est obligé d’entrer dans des chambres infectes, et d’exposer sa santé et sa personne à des miasmes empoisonnés. En réalité, les avantages physiques n’appartiennent qu’à ceux qui ne sont pas forcés d’avoir un état ; qui vivent sur leur propriété, employant le temps à leur guise, sans se tourmenter pour acquérir. À ceux-là seuls sont réservés les dons de la santé et les plus grands avantages physiques. »
Il semblait que M. Shepherd, dans ses efforts pour disposer Sir Walter en faveur d’un marin, eût été doué d’une seconde vue, car la première offre vint d’un amiral Croft, dont son correspondant de Londres lui avait parlé.
Selon le rapport qu’il se hâta d’en faire à Kellynch, l’amiral, natif de Somersetshire et possesseur d’une très belle fortune, désirait s’établir dans son pays, et était venu à Tauton chercher dans les annonces s’il trouverait quelque chose à sa convenance dans le voisinage ; n’en trouvant pas et entendant dire que Kellynch était peut-être à louer, il s’était présenté chez M. Shepherd pour avoir des renseignements détaillés.
Il avait montré un vif désir de louer, et fourni la preuve qu’il était un locataire recommandable.
« Qui est-ce que l’amiral Croft ? » demanda Sir Walter d’un ton froid et soupçonneux.
M. Shepherd répondit qu’il était noble, et Anna ajouta :
« Il est vice-amiral : il était à Trafalgar ; depuis, il a été aux Indes, et y est resté, je crois, plusieurs années.
– Alors il est convenu, dit Sir Walter, que sa figure est aussi jaune que les parements et les collets d’habits de ma livrée. »
M. Shepherd se hâta de l’assurer que l’amiral avait une figure cordiale, avenante, un peu hâlée et fatiguée, il est vrai ; mais qu’il avait des manières de parfait gentleman ; que probablement il ne ferait aucune difficulté quant aux conditions ; qu’il cherchait avant tout, et immédiatement, une maison confortable ; qu’il payerait la convenance, et n’aurait pas été surpris si Sir Walter avait demandé davantage. M. Shepherd fut éloquent, et donna sur la famille de l’amiral tous les détails qui faisaient de celui-ci un locataire désirable. Il était marié et sans enfants, c’est ce qu’on pouvait désirer de mieux. Il avait vu Mme Croft, qui avait assisté à leur conversation.
« C’est une vraie Lady, fine, et qui cause bien. Elle a fait plus de questions sur la maison, les conditions, les impôts, que l’amiral lui-même. Elle semble plus familière que lui avec les affaires. J’ai appris aussi qu’elle n’est pas inconnue dans cette contrée, pas plus que son mari. Elle est la sœur d’un gentilhomme qui demeurait à Montfort, il y a quelques années. Quel était donc son nom, Pénélope ? ma chère, aidez-moi. Le frère de Mme Croft ? »
Mme Clay causait avec miss Elliot d’une façon si animée, qu’elle n’entendit pas.
« Je n’ai aucune idée de ce que vous voulez dire, Shepherd, dit Sir Walter. Je ne me rappelle aucun gentilhomme demeurant à Montfort, depuis le vieux gouverneur Trent.
– Par exemple, c’est trop fort, je crois que j’oublierai bientôt mon nom. Un nom que je connaissais si bien ; ainsi que le gentleman, je l’ai vu cent fois. Il vint me consulter sur un délit de voisin, saisi sur le fait : un des domestiques du fermier s’introduisant dans son jardin, un mur éboulé, des pommes volées ; puis, malgré mon avis, une transaction eut lieu. C’est vraiment singulier.
– Je suppose que vous voulez parler de M. Wenvorth, dit Anna.
– C’est bien cela. Il eut la cure de Montfort pendant deux ans. Vous devez vous le rappeler.
– Wenvorth ? ah ! oui, le ministre de Montfort, vous m’avez dérouté par le mot gentilhomme. Je croyais que vous parliez d’un homme possédant des propriétés. M. Wenvorth n’en avait aucune, je crois. C’est un nom inconnu, il n’est pas allié aux Straffort. On se demande comment les noms de notre noblesse deviennent si communs ? »




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)