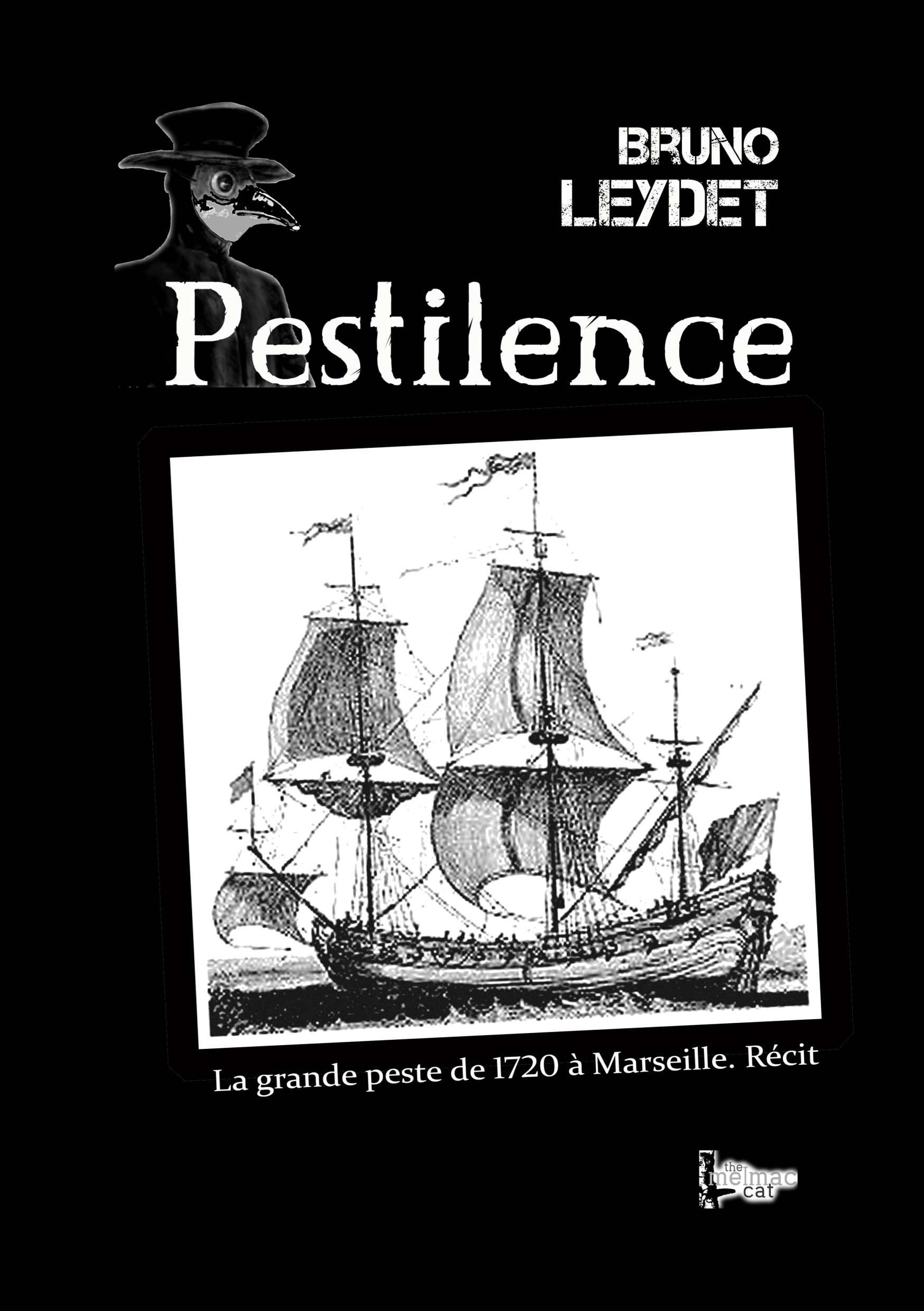
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Publié pour la première fois sous le titre "Sortez vos morts", ce romande Bruno Leydet retrace l'enquête du peintre marseillais Michel Serre, auteur des deux tableaux les plus importants témoignant de la Grande Peste de 1720 à Marseille. Quelque temps après l'épidémie, Michel Serre cherche à comprendre comment elle advint. Si la peste elle-même tient ici le principal rôle dramatique, c'est pourtant bien de corruption, de magouilles et d'arrangements commerciaux et financiers qu'il est question tout au long de cet ouvrage. Pas à pas, porté par un témoin qui a déjà mené une enquête, Michel Serre découvre comment le "Grand Saint-Antoine", trois-mâts revenant des Echelles du Levant chargé d'étoffes et de cotonnades, put entrer dans le port de Marseille sans aller en quarantaine alors que la peste était avérée à son bord, comment les échevins de la ville, qui avaient engagé beaucoup d'argent dans sa cargaison, firent pression sur les autorités sanitaires et comment, in fine, le tout fut étouffé, la politique et l'argent prenant le dessus sur le bien public. Bien entendu, il ne s'agit là officiellement que de spéculations, de "théorie du complot" dirait-on aujourd'hui, mais cette enquête sur le passé éclaire, trois cents ans plus tard, d'une lumière bien morbide l'actualité "épidémique" contemporaine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sommaire
Avant-propos
Prologue
I.
Chapitre
II.
Chapitre
III.
Chapitre
Epilogue
Avant-propos.
Le 11 septembre 2001 fut un point de non-retour mondial. Je veux dire qu’il exista un monde avant cette date, et qu’il en exista un autre après. Je suis allé à New York à peine deux ans après « 9/11 » ; une immense croix formée des débris des tours jumelles était plantée sur Ground Zero, s’imposant comme la représentation d’un Golgotha contemporain.
Plus tard, dans la même journée, je suis allé assister à une messe dans Harlem et le prédicateur dans son sermon parla de « Pestilence ».
Je me dis aussitôt que « Pestilence » serait le titre de mon prochain roman.
En effet, je voulais moi aussi écrire sur ce thème ; le thème d’une menace qui plane sur une civilisation. Et il est vrai que la polysémie du mot pestilence est intéressante : d’une part pestilence est le terme désuet pour désigner la peste se répandant dans un pays, en second lieu, c’est un terme vieilli qui signifie « corruption de l’air » et enfin – et il s’agit du sens shakespearien du terme – pestilence signifie ce qui est funeste ou pernicieux. La Grande Peste de Marseille en 1720 me semblait l’événement pour illustrer cette pestilence aux trois sens du mot. De plus, à l’instar de « 9/11 », la Peste de Marseille représente un point de non-retour à l’échelle mondiale (en 1720, l’Europe est le monde), car ce qui se passe à Marseille en cette année-là, restera à la postérité comme le scrupuleux et méticuleux détournement de mesures de santé efficaces pour protéger la population, au profit d’intérêts strictement privés et mercantiles.
Même si le roman en 2006 ne sortit pas sous le titre de « Pestilence », il connut néanmoins son succès et fut récompensé par le 44e Grand Prix Littéraire de Provence.
Seize ans plus tard, en 2020, je me suis dit qu’il fallait commémorer le tricentenaire de l’épidémie de Peste à Marseille. Il n’était pas encore question de Covid19. Mon intention était juste de réaliser une performance publique artistique afin de rappeler à la mémoire collective que l’intérêt général doit toujours primer sur l’intérêt individuel de celui qui est en charge des affaires gouvernementales.
L’épidémie de coronavirus décida d’en décider autrement.
Tout d’abord parce qu’elle marquera elle aussi, entre autres, un point de non-retour, comme « 9/11 » ou comme la Peste de Marseille… De plus cette épidémie décrète à son tour qu’il y a une pestilence sur cette terre. Peu importe la nature de la Pestilence, qu’elle soit terroriste, mercantile, écologique, climatique… Quelque chose de funeste et de pernicieux menace le monde tel que nous le connaissons et tel que finalement nous l’aimons. Ce que nous mesurons pleinement aujourd’hui, contraints par un confinement strict de ne pas vivre comme nous devrions vivre.
Voilà pourquoi il est apparu bon de republier ce texte, tout d’abord pour statuer que toute épidémie se ressemble (épidémie, littéralement signifie ce qui circule parmi le peuple) ; parce qu’elle implique des gestes barrières, des protections, des gestes de prudence, des conjectures, des mesures de confinement, de quarantaine, d’isolement… Mais aussi et surtout que l’épidémie instaure la suspicion, la méfiance dans la population, obligeant chacun à garder un œil pour surveiller le voisin, histoire que celui-ci ne constitue pas à son tour une menace pour sa tranquillité et sécurité. Tel est le thème de la Pestilence ; peu importe ce qui la charrie dans la population (virus, terrorisme religieux, esprit mercantile…) lorsqu’elle s’installe, elle fait la preuve qu’elle détruit les constituants fondamentaux de notre civilisation et c’est à ce titre qu’elle s’érige en point de non-retour, subsumant que rien ne sera plus comme avant.
Si ce texte, « Pestilence », pouvait faire entrer quelque peu dans les esprits que lorsque tout sera revenu à la normale, avant de revenir goulûment à nos fondamentaux de consommateurs, il ne faudrait pas oublier d’éliminer de près ou de loin toute pestilence qui menace notre civilisation... Notre civilisation est comme notre santé : elle n’apparaît jamais aussi précieuse que lorsque nous sommes sur le point de la perdre.
Bruno Leydet
2020-04-11
« La consomption est facile à guérir au début, et difficile à comprendre ; mais si elle n’a pas été décelée en temps voulu ni traitée de manière correcte, elle devient facile à comprendre et difficile à guérir. La même chose se produit dans les affaires d’Etat ; lorsqu’on les prévoit suffisamment tôt, ce qui n’est l’œuvre que d’hommes de talent, les maux qu’elles pourraient faire naître sont bientôt guéris ; mais si par manque de prévision, on les laisse se développer jusqu’à ce qu’ils soient perceptibles à tous, il n’y a plus de remède. »
Machiavel.
Prologue.
Mon nom est Michel Serre. J’ai 65 ans. Je les ai eus ce 10 janvier 1723. Je suis considéré, sinon comme le meilleur peintre de Marseille, du moins comme l’un des plus talentueux. Je dis cela sans fausse modestie, ni suffisance, car aujourd’hui, si je savoure cette renommée, c’est parce que le grand Pierre Puget n’est plus. Toutefois, un artiste doit savoir s’évaluer. Il ne peut pas, il ne doit pas compter sur autrui, pour s’estimer à sa juste valeur. A quoi bon vouer sa vie à l’Art, si on ne possède pas quelque lanterne intérieure pour se guider ? Sans cela, créer n’est jamais que conduire un char tiré par des chevaux aveugles. Très tôt, j’ai eu la chance de comprendre cela. Peut-être parce que la vie ne m’a pas épargné ; moi qui dus quitter ma mère et ma Catalogne natale à l’âge de huit ans. Mais je n’ai pas envie de m’attarder sur les malheurs de mon enfance. Je ne suis pas ici pour raconter mes mémoires. Lorsqu’il sera opportun de parler de moi, je le ferai. Pour le moment, il est bien plus important pour mon lecteur que je sois décrit tel que je suis aujourd’hui ; c'est-à-dire un notable. Oh ! Je n’y suis pas arrivé sans me battre… Ce fut tout d’abord grâce à mes peintures religieuses, que les consuls de la Ville m’octroyèrent un certificat de citadinage, (c’était, si ma mémoire est bonne, en 1690). Trois années plus tard, j’obtenais la place convoitée de dessinateur pour les galères du Roy. Et fort de cette place au soleil dans le milieu artistique marseillais, je me fis admettre à l’Académie Royale de Peinture à Paris, où, par lettres de patente, je reçus quelques privilèges de noblesse. Mais je n’ai pas été anobli. Toutefois – honneur considérable – je pus signer mes courriers : « chevalier Serre » ; ce qui fit saliver nombre de bourgeois dans cette ville.
Alors, pourquoi écrire contre cette notabilité marseillaise dont je fais aussi partie ? Pourquoi donc ? Je vais l’expliquer, consciencieusement. Que l’on me pardonne toutefois, car mon art n’est pas l’écriture ; je ne pourrai jamais y exceller comme je le fais lorsque je peins. Mais je le promets : je ferais de mon mieux. Pour l’heure, je souhaite avertir mon lecteur de cela : je suis conscient de jeter l’opprobre sur des familles célèbres de cette ville ; des familles puissantes, influentes, que tout le monde craint… Je ne veux donc pas que l’on considère mes écrits comme un fatras de propos irraisonnés, exposés sans discernement ni esprit de conséquence. Je sais très bien ce que je fais ; qu’on se le tienne pour dit ! La tâche que j’ai entreprise n’est pas le produit de quelque imagination scabreuse ; encore moins d’un esprit raffolant de scandale. Et pour conclure laissez moi vous rappeler ce proverbe du Levant : « Le vieux chien avertit lorsqu’il aboie ». Que mon lecteur garde bien cette allégorie en tête ! Je suis tout, sauf un jeune chien.
Ma renommée, aujourd’hui, est bien réelle. L’abondance de ma production en est la cause. De Marseille jusqu’à Aix, il est peu d’églises dans lesquelles on ne trouve pas quelque œuvre signée de moi. De nombreuses commandes m’honorent et des critiques distingués me rendent hommage. J’enseigne aussi à l’Académie. J’ai peint tous les sujets, en abordant tous les styles : Mythologie, Allégorie, Peinture Religieuse… en passant du portrait aux décors plafonnants. Même avec l’âge, ce don de la profusion ne s’altère pas. Je suis toujours capable de peindre en toutes heures, en tous lieux et en toutes circonstances… en jouant aux dames lorsque l’adversaire est occupé à mûrir son coup, en tenant une discussion… Il m’est même arrivé de peindre des deux mains. Et ne pariez pas sur ma capacité à peindre un tableau le temps d’un repas, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous vous lèverez de table ! …
Il est vrai que d’une telle abondance, il n’en est pas ressorti que des chefs d’œuvre. Bien souvent, je n’ai pas pris le temps de travailler comme il aurait fallu. Mais je devais surtout penser à ce que mon prix soit le plus bas pour attirer les commanditaires. Nonobstant, je reste fier de cette diversité. Car j’ai peint pour les couvents, pour les confréries, pour les paroisses et les chapelles … et pour l’Hôtel de Ville, aussi. J’ai conçu des décors de théâtre et d’opéra, comme ceux de Phaéton de Jean-Baptiste Lully, qui fut joué à Marseille, juste avant l’horrible été 1720. Pour mes bienfaiteurs et mécènes, je suis et resterai le dévoué Michel Serre, celui qui rend son travail dans les délais, en y apportant, de surcroît, une enchère artistique, grâce à l’émotion qu’il met dans chaque toile qu’il signe. Oui, tel est mon don, mon talent, mon style ! Car je n’ai jamais été un besogneux. Travailleur oui : l’Art est difficile. Mais besogneux, non, certes pas ! De mes origines catalanes, j’ai conservé l’instinct… des formes, des couleurs et de la lumière. Ensuite, j’ai appris – de l’Italie et de ses maîtres – que l’Art est comme l’Amour : s’il se complique, il devient un tourment.
Le destin a voulut que je m’établisse à Marseille où j’ai atteint, tout d’abord, la notoriété – ce qui constitue le premier salaire de l’artiste – et ensuite, le bien-être et la prospérité. De mauvaises langues ont insinué que j’avais choisi Marseille parce que, à Gênes, la concurrence entre artistes était trop aiguisée pour mon modeste talent. Mais c’est faux ! Ou alors, c’est trop facile … Je n’avais que 17 ans lorsque je suis arrivé ici. Comment un si jeune homme aurait-il pu rester insensible à Massalia ? Comment ne pouvait-il pas être subjugué par l’extraordinaire activité de ce port, étourdi par ce remue-ménage qui est audible même sur l’autre rive de la Méditerranée ?… Oui, j’étais jeune et j’ai choisi Marseille parce qu’elle n’est que commerce, tractations, échanges… parce que ses femmes sont si belles qu’elles quémandent toujours, en échange de leurs faveurs, l’éternelle damnation. J’ai choisi Marseille parce que l’Orient et ses cargaisons y affluent : épices, étoffes, fruits, alcools… J’ai aussi choisi Marseille parce que je la trouvais si italienne, même si elle se disait française. J’aurais juré me trouver dans un morceau d’Italie, ayant appris, vaille que vaille, le français. Vous en voulez un exemple ? Ici, les noms se féminisent comme dans la langue de Rome : Monsieur Fort se présente avec Madame Forte, Richaud avec Richaude, Pasquier avec Pasquière, Pascal avec Pascale… Certes, je mentirais si je ne concédais pas que l’immense richesse de la France a rendue Marseille si attractive à mes yeux. Mais ce n’est pas la raison essentielle de mon choix ; la seule, la vraie, l’irréfutable, est que je me suis attaché à Marseille parce que j’étais jeune. Comment la jeunesse peut-elle résister au mouvement, à la couleur, aux chocs, aux émotions et surtout… à la lumière ! Oui, j’ai choisi Marseille parce qu’elle est avant tout lumière comme nulle autre cité. Car, je l’affirme, moi, qui ai tant voyagé, la lumière de Marseille est unique : elle n’est pas que plaisir visuel ; elle est aussi appréciable par le corps, selon la chaleur qu’elle irradie sur les pores de la peau. Et si vous allez l’admirer, un jour, sur le Port, ne vous contentez pas seulement de la regarder, mais ressentez là aussi, en lui tendant vos joues, vos bras, votre torse… Oui, il faut tâter de cette lumière, car il n’existe que ce moyen pour mesurer toute sa sensualité. Cette sensualité qu’elle irradie sur la toute la ville, lui donnant, ainsi, son étrange pulsation.
Etrange ! le mot est bien trouvé. Je viens d’évoquer ce jeune homme qui s’enthousiasmait naguère pour cette ville et son fantastique mouvement. Comme il est loin de l’homme d’expérience que je suis à présent, et qui, à chaque nouveau jour, s’effraie à l’idée d’affronter cette païenne sans foi ni loi. Marseille est vraiment une ville étrange ; que l’on soit, d’ailleurs, étranger ou non… Au début, on ne s’en rend pas du tout compte. On est si ébloui. Puis, au plus on commence à la connaître, au plus on glisse dans les bas fonds de son âme, au plus elle nous apparaît complexe comme une société secrète. Rome m’avait aussi procuré ce genre de sentiment, sauf qu’à Rome, ce mystère, cette énigme, qui fascine autant qu’il fait frissonner, je pouvais me l’expliquer par l’originelle démesure des Césars. Mais à Marseille, il m’a fallut attendre, l’été de l’année 1720 – l’année de la Peste – pour comprendre à quel point cette ville pouvait être dangereuse.
C’est pourquoi, j’ai tenu à raconter comment cette vérité est venue à moi, comment elle m’a été révélée. Mes tableaux, hélas, ne peuvent pas l’expliquer. Ils ne peuvent que montrer ce qui s’est passé pendant l’épidémie de peste, lorsque les eaux du Styx ruisselaient dans la ville, mais ils n’exposeront jamais les causes de telles horreurs et abominations. C’est pourquoi, j’ai préféré, momentanément, la plume et l’encrier au pinceau et à la gouache.
I.
Revenons, donc, au milieu de l’hiver 1721! L’épidémie de peste qui avait étranglé Marseille de juin à novembre 1720, se terminait. Toutefois, en vertu du principe de prudence, la ville restait coupée du territoire. Les autorités provençales avaient même décidé de construire un mur de pierre – « le mur de la Peste » comme on l’appela – pour isoler Marseille et protéger Avignon. Mais le fléau se propageait plus vite que ne travaillaient les maçons. Le mur, une fois achevé, servit surtout à isoler la ville d’Avignon, à son tour contaminée, que de la préserver de l’épidémie. La troupe, pour cela, n’eut qu’à passer de l’autre côté du mur. La peste, du latin « pestis » : le fléau ! La peste, le mal absolu… Tout le monde – préfet, armée, médecins… – la disait derrière nous, nonobstant, personne n’avait oublié le tintement glacé de la cloche des fossoyeurs, entrecoupé des lugubres : « Sortez vos morts ! … » ; ni, non plus, les incessants défilés de tombereaux, à ce point remplis de cadavres que les chevaux trébuchaient sous la charge ; ni surtout, ces lugubres silhouettes : les « corbeaux », les docteurs de la peste ; ces médecins coiffés d’un large chapeau, le visage dissimulé sous un masque au long bec crochu, vêtus d’une longue chasuble en toile cirée ; leurs mains gantées tenaient une tige de fer terminée par un scalpel avec lequel ils incisaient, à distance, les bubons. Mon Dieu quel chaos ! Car la troupe, bien qu’omniprésente, était surtout prompte à dégainer le sabre pour rappeler aux bagnards qu’en échange de leur amnistie, ils devaient manipuler, charrier tous les corps avant de les jeter dans la chaux vive puis ensuite, les brûler. En contrepartie, elle laissait la ville ouverte aux pillards et aux brigands ; comme si cette charge là lui était impossible à assumer en même temps.
Non, personne ne pourra jamais oublier de telles images car de telles images ne peuvent être oubliées. Maudites, elles resteront à jamais dans le souvenir commun et hanteront ceux qui y étaient, jusqu’au dernier soupir : le macabre carrousel des tombereaux, le fracas de leurs roues sur les pavés, la cloche des fossoyeurs, la puanteur des cadavres en décomposition, les hurlements de douleur, les cris de chagrin, les actes de déraison et de délire… Et cette inquiétude permanente qui faisait se réveiller, en sursaut, la nuit, pour se palper les aisselles et l’aine, dans la crainte de sentir des bubons. Inquiétude pour soi, pour sa santé, sa prospérité… Mais inquiétude vis-à-vis des autres… Que dis-je inquiétude ! Méfiance, crainte, suspicion, frayeur, qui-vive permanent, perte irréversible de la tranquillité… Tout ce qui se passait effrayait. Plus personne ne pouvait quoi que ce soit pour autrui. Et même, en cet hiver 1721, alors que l’épidémie était désormais derrière nous, qui, pour autant, regardait un navire entrant dans le Port, sans le moindre soupçon ? Qui ne s’affolait pas d’un décès foudroyant suite à de violentes fièvres ? Quel médecin se dépêchait d’aller soigner un tel malade ? Et je ne veux même pas parler du prêtre mandé pour l’extrême-onction… D’ailleurs, qui, même aujourd’hui, se promène sans peur dans la ville ? Qui ? …
* * *
Moi, le Catalan, venu de Rome, j’ai prouvé, lors de cette tragédie, à quel point j’étais attaché à Marseille. Car je suis resté ; resté à me battre contre le fléau… Ce n’était que justice ! Marseille m’a toujours fait vivre ; pourquoi l’aurais-je laissée tomber ? Ni je ne me suis enfui, comme tant de notables qui se réfugièrent dans leurs campagnes et bastides de Saint-Marcel, de La Plaine ou de Cassis … (ces fuyards d’ailleurs, ne firent que transporter le fléau avec eux, communiquant ainsi le mal à toute la Provence) ; ni je ne me suis isolé jusqu’à me couper du monde, comme le firent, entres autres, les moines de Saint-Victor, qui, à peine aujourd’hui, acceptent de mettre le nez hors de leur église. Je n’ai pas peur d’insister : je suis fier de mon comportement pendant l’épidémie. Et le dire de la sorte ne m’apparaît pas comme un péché d’orgueil. Car je peux prouver ce que j’affirme. Au plus fort de la contagion, les plus hautes autorités m’ont fait confiance : les officiers de galère, en septembre 1720, me gratifièrent du commandement d’une brigade de forçats, pour déblayer la ville des cadavres et les porter en terre commune. Je me souviens encore de cet avis au public, placardé sur les murs de la ville au début de septembre 1720, où les échevins déclaraient que rien n’était plus nécessaire que de « faire enlever et enterrer les cadavres… » Enfin, les autorités réagissaient avec énergie et courage. Jusqu’à maintenant, le seul préservatif que nous avions opposé au fléau avait été d’allumer des feux et des brasiers – cela aux premiers jours d’août – pour nettoyer l’air de la pestilence. Je le concède, ce n’était pas bien intelligent mais nous pensions qu’en agissant ainsi, arrêter la contagion était encore possible. Car nous faisions encore confiance à ces médecins qui ne croyaient pas que la Peste fût contagieuse. Comme eux, nous étions enclins à croire que la Pestilence était logée dans l’air et qu’on risquait de l’attraper en respirant ses miasmes. (Et je profite de cette occasion, pour, moi aussi, fustiger ces imbéciles, en citant cette maxime que j’ai naguère entendue dans une pièce de Molière : « Après la mort, le médecin !… ») Induits en erreur par ces incapables, nous ne ménageâmes pas nos forces pour jeter dans les flammes tout le mobilier disponible ; qui l’apportant de chez lui, qui allant le chercher dans les maisons délaissées ou désertes, ou peuplées d’agonisants… Et ensuite, nous priions la Vierge Marie et Saint Roch puis nous entonnions notre hymne provençal. Nous pensions que nos prières, nos chants et nos feux allaient faire reculer l’épidémie. Pécaïre ! Pauvre de nous !…
Heureusement que le bon sens ne me quitta jamais ! Grâce à lui, je mis à l’abri ma famille en l’obligeant, à rester dans notre maison et de n’en sortir sous aucun prétexte. Des chandeliers et des braseros brûlaient en permanence dans chaque pièce et des vapeurs soufrées purifiaient notre air. J’aspergeais chaque jour le pas de ma porte ainsi que les abords de ma rue avec du vinaigre. L’asepsie était ma seule préoccupation, mon idée fixe… Peu de choses sont aussi dangereuses que la crasse ou la sueur. C’est pourquoi, j’avais très vite congédié mes domestiques et m’étais attaché les services d’un pourvoyeur. Celui-ci ne communiquait jamais directement avec moi et ma famille. Il jetait par la fenêtre des denrées de première nécessité qui tombaient dans une cuve pleine d’eau. Ensuite, seulement avec des pinces, je retirais les aliments et les refaisais tremper dans une seconde cuve, celle-la remplie à moitié d’eau et de vinaigre. Ensuite nous les pendions à des crochets en attendant qu’ils soient secs.
Le plus intelligent était certes de rester chez soi et de refuser de sortir sous aucun prétexte. Toutefois, si je devais prendre le risque d’aller dehors – ce qui m’arrivait assez souvent à cause de mes fonctions – je le faisais toujours muni d’un mouchoir imbibé de parfum que je maintenais sur un mon visage. Oui, je l’avoue, je tremblais d’épouvante lorsque j’avais à sortir. Mais je le fis chaque fois que ce fut nécessaire, toujours vêtu de vêtements de soie ; ce qui constitue – à défaut des toiles cirées dans lesquelles s’enveloppent les médecins – une précaution plus qu’efficace. Pour autant, je faisais toujours attention où je mettais les pieds ; évitant de marcher sur un morceau de coton ou un vêtement de laine, encore moins sur du chanvre… un anodin bout de ficelle introduit dans une maison suffisait à y porter la peste. Et si j’étais forcé de parler, je maintenais entre moi et mon interlocuteur, un réchaud où brûlait du parfum. Mais il était de notre devoir, nous, les notables – il popolo grasso comme disent les italiens – d’aller et venir malgré le fléau. Car c’étaient les pauvres gens, mal nourris et en mauvaise santé, qui tombaient comme des mouches. Quels espoirs leur donnaient ces nobles, gras et peureux, qui fuyaient la cité ? Quelles raisons de se battre contre le fléau pouvaient-ils bien inspirer en se comportant ainsi ? En revanche, ceux qui jouissaient du pouvoir et des responsabilités et qui, malgré tout, combattaient la Peste, en restant dans la ville ; ceux là, au moins, montraient l’exemple.
* * *
De ce groupe d’hommes là, de ceux qui n’ont pas été lâches, il faut mettre sur un piédestal deux d’entre eux ; deux, qui montèrent jusqu’aux plus hautes marches de l’héroïsme : Monseigneur de Belsunce et le Chevalier Nicolas Roze. Eux – le religieux et le civil – ont laissé béat d’admiration toute la population de Marseille, tant ils s’opposèrent aux ravages de l’épidémie. Mais si l’Histoire ne doit jamais oublier ces deux héros, elle doit néanmoins parler des autres, de tous les autres… Et c’est là que le scandale commence. Car je ne citerais que quatre noms : Estelle, Moustier, Dieudé et Audimar… Les quatre échevins de Marseille, que l’on vit se démener dans la Ville et ne pas épargner leur prospérité dans la lutte contre le fléau. Aujourd’hui, sachant ce que je sais, je trouve indécent leur comportement. Ainsi débute le paradoxe tragique qui est le sujet de mon récit… Paradoxe ! que dis-je paradoxe ! Mieux vaudrait parler d’oxymore : cette figure de rhétorique, que nos orateurs définissent comme la résolution des contraires. Et, en ce qui concerne les échevins, cet oxymore pourrait être : « dévoués car traîtres » ! Non, pardonnez moi, j’anticipe trop. Il n’est pas encore temps d’exposer ces faits dans mon récit. Que mon lecteur me pardonne mon manque d’intelligence littéraire, car mes idées débordent de ma plume et mon esprit voudrait dire bien plus que ne me permet ma science des mots.
Je reviens donc à ces hommes qui participèrent à l’assainissement de la Cité. Souffrez que moi, Michel Serre, fasse partie de cette escouade. Il est vrai, j’étais là ! Disponible. C’est ainsi que je conçois le rôle d’un vrai citoyen. Si la chrétienté demande la charité et l’amour du prochain, la citoyenneté, elle, exige de lui sa disponibilité. Et aussi de ne jamais céder à la panique, à la folie… Je me souviens aussi de ces barbares qui décidèrent d’abattre tous les chiens de la ville, parce qu’ils ne supportaient plus qu’ils se nourrissent de la chair des cadavres. Les imbéciles ! Ils ne firent qu’emplir inutilement la cité de charognes et souiller davantage la ville, sans se rendre compte que l’épidémie ne demandait pas mieux. Vanités ! Vanités de vanités… Ces brutes avaient même oublié, que, comme l’on sait en Provence, qui tue un chien est voué à sept ans d’infortune.
* * *
L’épidémie de peste, si elle m’épargna de la maladie, mit mes finances à mal. Tous les biens que j’avais amassés furent emportés par les efforts que, par solidarité, je fis pour sauver les populations des quartiers Saint-Ferréol et de la Porte de Rome. Rome, parlons-en ! Je ne regrette pas ma générosité car elle fait partie de l’antique mentalité romaine. Les Romains importants ne craignaient pas les dépenses somptuaires, consenties pour affermir leur position sociale. Et c’est l’attitude que j’adoptai, sans me poser de questions et sans remarquer que nombre de notables de Marseille demeuraient plus réservés et moins enclins à la dépense, tout en feignant le plus expressif dévouement. Ceci étant dit, il m’apparut très vite, en cet hiver 1721, que le seul moyen de me refaire une fortune était d’utiliser mon art.
L’idée d’achever quelques vues de la Peste qui ravagea Marseille, très vite, s’imposa à moi. Je pourrais même certifier que l’inspiration me titilla à ce propos alors que l’épidémie faisait rage. Je ne suis d’ailleurs pas le seul peintre à avoir trouvé matière à création sur ce thème-là. J’avais entendu parler d’une vue de la Piazza del Mercatello de Micco Spadaro pendant la Peste de Naples. Et comment ne pas citer le bas-relief de l’illustre Pierre Puget, sur la Peste à Milan !… Peindre l’épidémie, témoigner sur la Grande Maladie, me parut donc une chose excellente pour me « refaire », comme l’on dit, c'est-à-dire, retrouver l’aisance et la prospérité. C’est pourquoi, dès que l’épidémie déclina, je pus sortir, l’âme tranquille, dans les rues avec mes crayons et fusains et me mis à esquisser ces scènes sorties de l’enfer. Peindre fut aussi pour moi un moyen de guérir. Rien ne pouvait mieux extirper l’horreur de mon âme. Tel est le privilège de l’artiste : il vit et prospère du soulagement de sa sensibilité tout en permettant aux multitudes d’exorciser, à travers lui, leurs traumatismes les plus profonds.





























