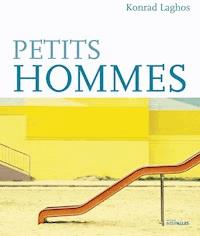
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À dix ans, André est un garçon à peu près comme les autres.
Il vit avec sa mère, professeur de littérature, et aime jouer aux cow-boys avec son meilleur ami Jean. Mais André a un don : le piano. Un jour, pour la première fois, son père, un homme d’un certain âge, vient le chercher à la sortie de l’école. Cet évènement, banal pour tant d’autres enfants, bouleverse sa vie.
Un roman qui exprime la relation père-fils à travers les yeux d'un enfant.
EXTRAIT
André posa son blouson et son cartable à côté du buffet, Jean posa Macar, son cartable et son blouson. Dans le salon, deux étagères se faisaient face. Elles filaient jusqu’au plafond et le long du mur. Il y avait une échelle en bois pour attraper les livres tout en haut. Jean reprit Macar, et André monta sur l’échelle et saisit un gros, vieux livre. Il redescendit.
— Tu vois ? dit-il.
— Ouvre.
André posa le livre sur la table et l’ouvrit à la première page. Jean se baissa pour le sentir. Macar le sentit aussi.
— Ça pue.
— Oui, ça sent le vieux.
— 1781, quand même.
— C’est mon père qui me l’a donné.
Jean se pencha sur le livre. Il fronça les sourcils et tenta de déchiffrer l’écriture gothique sur le papier jauni.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Chronique sensible d’une enfance plus tout à fait insouciante, ce premier roman révèle la fibre délicate de Konrad Laghos. -
Delphine Peras, L’Express
Un roman touchant sur l’apprentissage de la vie, les premiers grands chagrins, la relation au père. L’univers des enfants entre cruauté de certains entre eux, courage et solidarité est parfaitement décrit. C’est un joli premier roman que l’on quitte à regret ! -
Librairie La Parenthèse
Tout est ambivalence et délicatesse dans ce roman. -
Daniel Fattore
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Paris en 1989,
Konrad Laghos, a suivi sa scolarité à Blois et fait ses études à Canterbury puis à Bruges. Il réside depuis quelques années à Zurich, où il a été journaliste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À ma mèreÀ papasmou
C’était dans une ville ni petite ni grande, un temps plus royale que Paris, au cœur de laquelle se trouvait un château qui aurait pu figurer dans un conte pour enfants si un duc n’y avait pas été assassiné. Il y faisait bon vivre. Le fleuve coulait le long de berges sauvages. L’été, des îlots se formaient et on pouvait pique-niquer sur les pierres en traversant à gué. L’hiver, quand il faisait très froid, le fleuve était huileux et les eaux tourbillonnaient sous les arches du pont.
La campagne n’était jamais bien loin. Au mois d’août, on prenait la voiture et on était au milieu des champs en moins de vingt minutes. Là, on s’allongeait sur une couverture, les pieds sur les blés et les yeux au ciel, les météores filant au-dessus de nous. On se sentait minuscule et on se demandait ce que tout ça pouvait bien signifier. On se disait que quand on meurt, on devient une étoile. On est tous des poussières d’étoiles.
Ce jour-là, l’herbe était recouverte d’un tapis de gelée blanche que la nuit avait laissé derrière elle. Mais l’odeur d’hiver avait disparu. Les crocus sortaient, les jonquilles perçaient. La nature renaissait.
Le cimetière se trouvait aux abords de la ville, à l’orée de la forêt. Les maisons des environs étaient petites et espacées, et un champ de blé vert courait le long de la route.
La tombe était sobre et belle. Une dalle, un nom, deux dates. Debout devant elle, André souriait, une barbe naissante sur les joues et des ridules au coin des yeux. Sa mère se tenait près de lui et le soleil dorait ses cheveux encore blonds. André tripotait quelque chose dans sa poche de manteau. C’est étrange, ce sentiment de marcher parmi les morts. Un jour, il faudrait y passer aussi. Mais André ne pensait pas à ça. Il pensait à autre chose. Et il souriait toujours.
1
La pluie s’était arrêtée. Les ardoises de la gare luisaient comme un miroir. Ça sentait bon l’automne et la pluie sur les feuilles mortes, et l’air piquait un peu. Il avait fait chaud jusque-là. Les uns parlaient d’été indien et en avaient profité pour faire griller des saucisses au jardin en rentrant du travail. Les autres parlaient de réchauffement climatique. Les uns se réjouissaient de bientôt faire pousser des oranges au nord de la Loire, les autres prédisaient l’apocalypse avant la fin du siècle à venir. Les uns et les autres s’écharpaient, mais il était généralement de bon ton de dire que l’Homme était coupable.
Dans la gare, il y avait des hommes et des femmes, des enfants aussi. Ils s’enlaçaient et s’embrassaient, certains pleuraient, certains riaient, d’autres riaient et pleuraient en même temps. Parmi eux, devant le kiosque à journaux, une femme regardait les titres. René Lacoste venait de mourir.
Au-dessus des portes en verre entre les quais et le hall, le grand panneau indicateur fit flap ! flap ! flap ! flap ! Giulia Dumont se posta au milieu du hall et attendit en mâchant un chewing-gum. Elle avait les cheveux roux et courts avec des boucles et les yeux de la couleur des feuilles quand elles bourgeonnent au printemps. Des gens la regardèrent par-dessus l’épaule d’autres gens.
La mélodie de la SNCF sortit des haut-parleurs et un train entra en gare. Marguerite et André apparurent entre les portes en verre. Ils rejoignirent Giulia.
— Salut, mes chéris, vous avez fait bon voyage ? dit-elle en faisant chanter les mots.
Elle posa deux bises sur les joues de Marguerite et deux sur celles d’André.
— Impeccable, dit Marguerite, le train est parti en retard mais il l’a rattrapé.
— Il est allé vraiment vite ! dit André.
Tous les trois, ils sortirent de la gare. Le ciel était bleu maintenant. Un nuage blanc flottait au-dessus du soleil.
— Le bahut est là-bas, dit Giulia. Elle pointait du doigt vers un break Citroën avec des bandes rouges et bleues et Police écrit dessus.
Giulia s’installa derrière le volant, Marguerite à côté et André à l’arrière. Au-dessus de la boîte à gants était posée une édition du tome premier du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir.
Sur la banquette arrière, André regarda les arbres défiler sur le bord de la route. Avec la vitesse, ils formaient une guirlande rouge et jaune, et puis la voiture tourna là où il n’y avait plus d’arbres. En face, le soleil éclairait la façade des Loges et on voyait bien les bas-reliefs des Douze travaux d’Hercule. Giulia s’arrêta au feu, au pied du château. Elle se tourna vers Marguerite.
— Et alors, William, comment il va ?
— Oh, il va, il va, hein André ?
— Oui.
— Il nous a emmenés au Train Bleu hier soir, continua Marguerite, je savais pas où me mettre.
— Comment ça ?
— Ben tu sais, le Train Bleu, gare de Lyon. Ce genre de resto, c’est pas trop pour moi. Trop BCBG.
— Oui, dit Giulia, je te comprends. Moi non plus, ça me dit rien. De toute façon, avec la misère que paye la boîte, c’est pas demain la veille que j’irai ripailler là-bas.
Elle démarra. La voiture longea le square face au château et André observa le gigantesque conifère au milieu. Sa mère lui avait dit le nom de cet arbre mais il l’avait oublié. Ce qui était certain, c’est qu’il était vieux parce que sa cime dépassait les cheminées du toit du château. André se demanda qui l’avait planté, cet arbre. Il n’eut pas le temps de s’épancher sur la question parce que Giulia le regardait dans le rétroviseur avec ses pattes au coin des yeux.
— Qu’est-ce que tu as pris, mon grand ?
— Un magret de canard avec des patates douces et de l’ananas confit.
— Mmmh ! Mais c’est que tu vas me donner faim si tu continues !
— C’est vrai que c’était bon, dit Marguerite.
Marguerite sortit de son sac à main un foulard qu’elle enroula autour de son cou.
— Tu veux que je mette le chauffage ? dit Giulia.
— Surtout sur les pieds, tu sais bien.
Giulia tourna la molette du chauffage à côté de la radio dont s’échappaient des crépitements, des bribes et plein de noms codés qu’André ne comprenait pas mais qu’il trouvait captivants. Bien sûr, ça donnait mieux en anglais mais c’était chouette quand même.
— C’est vrai qu’il a pas fait chaud, ce week-end, dit Giulia. Hier, les collègues ont ramassé le premier picard de la saison juste là, là, derrière.
Giulia montrait du doigt la bibliothèque Abbé-Grégoire où André allait lire des BD le samedi.
— Un picard ? dit André.
Giulia regarda dans le rétroviseur.
— Eh bé oui, tu sais, mon grand, plus tard, il faudra pas que tu dormes dehors quand il fait zéro.
André comprit et décida qu’il n’irait pas lire de BD le samedi suivant.
Finalement, Giulia gara la voiture à un endroit où les voitures normales n’ont pas le droit de se garer. Elle sortit, Marguerite sortit, André sortit. Ils étaient devant une résidence fermée par une barrière rouge et blanche. Les immeubles en arc de cercle étaient blancs, coupés au milieu par une large bande noire. Il y avait un petit parc avec des marronniers. À l’automne, Marguerite chargeait André de ramasser les marrons. Il se piquait souvent avec les bogues mais les marrons dans des bols, ça faisait joli dans le salon. Avec les marronniers, il y avait des bouleaux et d’autres arbres aussi dont André avait oublié le nom.
Ils passèrent la barrière et s’avancèrent vers le premier immeuble. Une mésange zinzinulait quelque part. Il aimait bien ce mot, André. Zinzinuler. Il le tenait de son grand-père, le père de sa mère, et il trouvait que ça faisait savant.
Dans le petit hall de l’immeuble, Marguerite ouvrit la boîte aux lettres. Un grand miroir mural permettait de se coiffer une deuxième fois avant de partir pour de bon le matin. Giulia se regarda dedans.
— J’ai mauvaise mine, dit-elle.
Elle se tourna vers Marguerite qui tenait une lettre dont la petite figurine en haut faisait penser à la statue de la Liberté.
— Tu trouves pas que j’ai mauvaise mine ?
— Au contraire, je te trouve rayonnante, dit Marguerite.
— Mais t’as vu ces valises ?
Marguerite considéra Giulia un moment. André les considéra toutes les deux, puis il prit les clefs des mains de sa mère pour ouvrir la porte en verre qui menait à l’escalier et à l’ascenseur.
L’appartement se trouvait au premier étage, qu’il partageait avec deux autres appartements. L’un d’eux était occupé par une petite vieille qu’on ne voyait jamais mais qui mettait des mots en bas quand elle voulait se plaindre de quelque chose.
André tourna la clef dans la serrure et un miaulement sourd traversa la porte. Derrière, un gros chat gris avec des yeux d’or était assis sur ses pattes arrière. Quand André entra, le chat se leva, la queue dressée en l’air, pour aller se frotter contre ses jambes. Ensuite, il partit zigzaguer entre les mollets de Marguerite et de Giulia.
Marguerite referma la porte. Giulia ôta son blouson et le posa sur la chaise Zafimaniry rapportée de Madagascar par le grand-père aux mésanges quand il n’était pas encore grand-père. Marguerite et Giulia se glissèrent dans la cuisine et André prit le chat dans ses bras. Le chat ronronnait comme une locomotive. « Alors mon gros Macar, la vie est dure, hein ? » André souleva Macar vers lui et enfouit son visage contre son ventre. Les ronronnements vibrèrent dans toute sa tête et il se sentit chez lui.
Puis, relevant la tête, il vit une petite lumière rouge clignoter sur le téléphone du buffet. Il posa Macar sur le buffet et appuya sur un bouton.
« C’est moi. Je voulais savoir si vous étiez bien rentrés et si Macar allait bien. Je suis très heureux d’avoir vu André, même si c’était court. Je vous embrasse. À bientôt. »
André sourit. C’était une voix d’homme grave et douce, si profonde qu’on la sentait vibrer dans le ventre, avec un léger accent indéfinissable. André reprit Macar qui ronronnait toujours et se précipita dans le salon.
— Maman ! Maman ! Il y a un message de p…
Il s’arrêta au milieu de sa phrase et du salon. Sur le canapé recouvert d’un damas, Marguerite étreignait Giulia, et Giulia avait des larmes et beaucoup de rides sur le visage.
— André, dit Marguerite, va dans ta chambre, s’il te plaît. André posa Macar sur la moquette. Il sortit du salon, repassa dans l’entrée prendre son sac et disparut dans sa chambre en passant devant le mur en face de la salle de bains. Ce mur, André l’avait jugé trop fade quand il était petit. Depuis, il y avait toujours eu de grandes figurines noires aux bras comme des bâtons. Il y avait eu des rouges aussi, mais l’encre de Chine laisse des souvenirs plus définitifs.
La chambre d’André était adjacente à celle de sa mère. C’était commode parce que parfois, André rêvait d’un loup qui venait lui manger la main et le loup n’osait pas se montrer dans la chambre de Marguerite. C’était une petite chambre recouverte de moquette bleu foncé. Par-dessus la moquette, il y avait un tapis de petites voitures et de Playmobil, de slips et de chaussettes, lesquels appartenaient initialement aux tiroirs de l’armoire à glace et à trois portes qui touchait le plafond. Sur les murs étaient collés toutes sortes de cartes et de posters, de France mais surtout du Far West. Et il y avait une affiche en meilleur état que toutes les autres. Elle était accrochée au-dessus de la tête du lit sans oreiller. Elle était blanche, rouge et noire. Le noir venait du piano à queue qui était dessiné dessus. Sur l’affiche, on pouvait lire : Du 11 au 13 janvier 1997, 11e concours départemental de piano. Ouvert à tous les pianistes, débutants ou confirmés.
André enjamba la banque et le bureau du shérif, posa son sac sur le lit et s’assit à côté. Il en ressortit un assez gros carton qui contenait une diligence et un coffre rempli d’or. Dans le sac se trouvait aussi un petit livre en anglais sur la couverture duquel on voyait un cow-boy avec des chaps sur les jambes. Puis, André sortit une partition toute rouge. Dessus, en gros, était écrit J.-S. Bach, Kleine Präludien und Fughetten. André laissa la diligence et le cow-boy en chaps, et il ouvrit une page.
Assis en tailleur sur son lit, André pianotait sur ses genoux quand Marguerite frappa à la porte et passa le nez dans l’embrasure.
— Mon p’tit cœur, Giulia nous invite à aller dîner chez elle puisqu’on n’a plus rien dans le frigo.
André leva la tête.
— Oh oui ! oui ! oui ! oui !
— On y va, mais à condition que tu aies rangé ta chambre, d’accord ?
André baissa la tête et Marguerite sortit. Il balaya du regard le tapis de jouets et de sous-vêtements qui recouvrait la moquette et se dit que ce n’était pas juste. Il souffla. Est-ce qu’il lui demandait, à sa mère, de ranger sa chambre ? Après tout, on ne voyait pas non plus beaucoup la moquette à cause des tas de livres, et son bureau était plein de rubans de machine à écrire et de papiers froissés. Mais c’était une grande personne et les grandes personnes ont toujours raison, c’est bien connu.
André souffla encore. Et puis son visage s’illumina. Il se leva d’un bond, s’approcha de son armoire et ouvrit les trois tiroirs du bas. Il s’accroupit, prit tous les slips et les chaussettes qu’il put et les fourra dans les tiroirs. Ensuite, il prit des petites voitures et des Playmobil et les mit par-dessus. Quand il ferma les tiroirs, il restait encore beaucoup de petites voitures et de Playmobil mais on commençait à voir la moquette. Alors, il s’agenouilla et balaya le sol avec sa main droite. Il se releva et se dit qu’il était un grand génie d’avoir aussi intelligemment exploité la moquette de dessous le lit parce qu’on ne la voyait pas de toute façon et qu’il fallait bien qu’elle serve à quelque chose. Il s’assit à son bureau face à la fenêtre. Sur le bureau, il y avait un globe rouge, des papiers partout et un petit cadre-photo retourné. André fit un tas de tous les papiers. Puis, délicatement, il saisit le cadre, un vieux cadre en bois de noyer. Il l’essuya avec l’index par-dessous sa manche, le porta à ses lèvres, le reposa, le tourna un peu, et il fut satisfait.
2
Les nuages moutonnaient au-dessus des toits. Ils étaient roses et rouges et oranges, et le soleil avait presque disparu. C’était un de ces jours où l’air du soir est plus doux que durant la journée. Les couples de vieux flânaient le long du fleuve à l’heure où les couples pas encore vieux faisaient griller des saucisses au jardin, que les enfants criaient et pleuraient, et que les couples sans enfants encore juraient que les leurs ne seraient jamais comme ça.
C’était dimanche soir, le moment où tant de gens pensent déjà au lendemain en oubliant que demain n’est pas encore là. De l’autre côté du fleuve, en allant vers les étangs de Sologne, c’était Vineuil et puis Saint-Gervais. C’est là qu’habitaient les Dumont, dans une maison au calme d’une impasse.
« On te vengera, Joe. »
Jean ouvrit les yeux. Ils étaient grands et verts, et ils faisaient penser aux feuilles des marronniers quand l’été s’en va et que l’automne arrive. Jean avait les traits fins et les cheveux noirs et lisses. Malgré tout ce qu’il avalait, il n’était pas bien gros. Il bégayait un peu, parfois, surtout quand il devait réciter des poèmes devant la classe. Autour de sa bouche était dessiné un épais bouc noir.
« Amen. »
À côté de Jean, avec un bouc aussi, André se signa comme Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand. Comme Jean, il était à genoux dans l’herbe. Jean se signa aussi. Devant eux, un trou rectangulaire. Dans le trou, un pigeon crevé. À côté du trou, un tas de terre. Jean en prit une poignée, André en prit une poignée et, ensemble, ils recouvrirent Joe. Jean prit un petit bâton et le planta sur la tombe. Puis ils se levèrent et remirent leur chapeau.
— Il est en paix maintenant, dit Jean.
— Oui, dit André, il y a pas de coyotes de l’autre côté.
— Comment va ton épaule ?
— Ça va, la balle l’a juste effleurée. Et ta jambe ?
— Rien de grave, mais il faut aller voir le toubib, faudrait pas qu’on chope la gangrène.
Ils s’enfoncèrent dans le jardin, entre lauriers et rosiers, des traces de terre et d’herbe sur leur pantalon.
Dans le salon, la première chose qu’on voyait était un aquarium contre le mur du fond, près de la porte-fenêtre qui menait au jardin. C’était un gros aquarium et Jean pensait souvent que toute cette eau et ces poissons multicolores, ça mettait du calme dans la maison.
Le salon, dans son ensemble, était aussi multicolore que les poissons. Il y avait beaucoup d’étagères et de livres, et un chevalet avec une toile dessus. Un fauteuil en cuir noir et ridé avec son canapé assorti faisait face à la télévision. Dans le canapé étaient assises Marguerite et Giulia qui se faisaient resservir du guignolet par Bernard. Bernard avait épousé Giulia au début des années 1980. Il avait toujours porté une épaisse barbe noire qui était devenue blanche sur le menton et près des tempes.
Giulia avait troqué son uniforme contre un jean vert, un chemisier blanc et une larme de jade qui pendait à son cou. Bernard reposa la bouteille sur la table basse devant le canapé et se rassit dans le fauteuil. Dans la main, il tenait un exemplaire de L’Herbe du diable et la petite fumée de Carlos Castaneda.
— Je comprends toujours pas pourquoi le ministère ne veut pas l’intégrer au programme, dit Bernard. Mais ça me fait penser, Giulia, tu peux montrer ta dernière toile à Marguerite, non ?
— C’est vrai, tiens !
Giulia se leva et revint avec la toile. Entre le chevalet et le canapé, elle était devenue rouge.
— Elle n’est pas tout à fait finie mais enfin…
— … enfin, enfin, c’est magnifique, ce que tu fais, dit Marguerite.
— Je m’épuise à lui dire, à ma femme, qu’il faut qu’elle expose, ajouta Bernard.
Sur la toile, un couple et un petit garçon dormaient étalés dans un champ de blé parsemé de coquelicots. Au loin, l’orage menaçait. Giulia reposa la toile sur le chevalet, se rassit, but une gorgée et alluma une cigarette.
— Si seulement c’était possible d’exposer…
— Pourquoi pas ? demanda Marguerite.
— Bien sûr, je pourrais essayer, mais pour avoir une chance d’être vu, simplement vu, il faut se faire coopter. Tous ces gens-là, des putains de consanguins.
— Oui, dit Marguerite, c’est pareil dans l’édition. Bernard prit une gorgée et se leva.
— Tiens, Marguerite, viens voir, je vais te montrer quelque chose qui va te faire oublier les éditeurs.
— En attendant, dit Giulia, je vais mettre la table.
Marguerite but une gorgée, posa son verre sur la table basse et suivit Bernard dans l’escalier. L’escalier débouchait sur une pièce sombre qui servait de pièce de travail à Bernard. Par terre, à côté du bureau, était enroulé un tapis de yoga.
Au fond de la pièce, Jean et André s’étaient barricadés derrière une montagne de chaises et de coussins et ils tiraient, armés de revolvers, contre les ennemis que leur imagination leur envoyait. À la vue de Bernard et de Marguerite, ils cessèrent le feu et se réfugièrent dans une pièce isolée.
À côté du tapis de yoga, contre la fenêtre, un télescope. Bernard se pencha dessus, le plaça bien devant la fenêtre, manipula des boutons, posa son œil sur l’oculaire, se releva et dit à Marguerite de regarder. Marguerite regarda. Elle vit une bille jaune pâle entourée d’anneaux flotter dans une mer d’obscurité.
— C’est splendide, dit-elle, c’est Saturne ?
— Oui.
— Elle est à combien de kilomètres ?
— En ce moment, elle doit être à un milliard trois.
— C’est vertigineux.
— Oui. Il faut en profiter, la semaine prochaine, on ne pourra plus la voir.
Marguerite releva la tête.
— Elle disparaît ?
— Pendant quelques mois. En mars, elle reviendra.
Marguerite se pencha de nouveau sur l’oculaire. Un frisson lui parcourut le dos jusqu’à la racine des cheveux. Bernard s’assit dans le fauteuil de son bureau. En bas, Giulia appela Jean et André à table.
Jean et André passèrent avec leur bouc et leur chapeau devant Bernard et Marguerite et descendirent l’escalier jusqu’à la cuisine. Il y avait une table ronde sur la gauche en entrant et quatre chaises autour. Sur la table était posées une grande bouteille de Coca, deux assiettes et deux parts de lasagnes dedans. Ils s’assirent. En face d’eux, Giulia, de dos, remuait quelque chose dans une casserole.
— J’espère que tu aimes les lasagnes, André, dit-elle.
— Oh oui, il faudrait être fou pour ne pas aimer.
— Surtout celles de ma mère ! dit Jean. Merci, maman !
— Merci, Giulia ! dit André.
Giulia se retourna en souriant.
— Attaquez tant que c’est chaud. Mais ne vous brûlez pas !
Elle empoigna des deux mains le gros plat à lasagnes posé à côté d’elle et sortit de la cuisine.
— Si vous en voulez plus, cria-t-elle, venez à la salle à manger !
André et Jean, devant leur assiette, se mirent à rigoler sans raison. André attrapa la bouteille de Coca et servit un grand verre à Jean, puis à lui-même. Ils burent d’une traite. Ils se regardèrent. Ils rotèrent. Et ils rirent tous les deux.
Sur la table de la salle à manger adjacente au salon, les lasagnes avaient presque disparu du plat. Une bouteille de vin était vide. Bernard mâchait un morceau de roquefort et avait les joues de la couleur du vin qu’il buvait, Giulia inhalait la fumée de sa cigarette, Marguerite allumait une cigarette. Un nuage flottait au-dessus de la table.
— Oui, dit Marguerite.
Elle souffla la fumée en contorsionnant sa bouche.
— Mais c’était le but, après tout, continua-t-elle. S’installer hors de Paris, pas trop près, mais pas trop loin non plus pour qu’André puisse continuer à voir son père souvent.





























