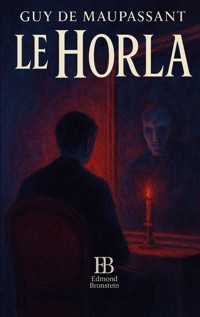Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans Pierre et Jean, Guy de Maupassant entraîne le lecteur au coeur d'un drame familial où l'héritage devient une épreuve de vérité. Entre deux frères, l'un favorisé, l'autre délaissé, naît une jalousie qui dévoile peu à peu les secrets enfouis. Avec son style sobre, incisif et d'une intensité rare, Maupassant met en lumière la fragilité des liens familiaux, les blessures de l'orgueil et la quête insatiable de reconnaissance. Chaque page plonge dans un réalisme psychologique saisissant, où la passion, la suspicion et la vérité se heurtent sans concession. Un roman court, puissant et inoubliable, qui questionne encore aujourd'hui notre rapport à la famille, à l'amour et à la justice intérieure. Laissez-vous emporter par ce chef-d'oeuvre intemporel et ajoutez-le dès maintenant à votre bibliothèque : une lecture qui ne vous laissera pas indemne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À propos de Guy de Maupassant
Guy de Maupassant (1850-1893) occupe une place centrale dans l’histoire littéraire française du XIXᵉ siècle. Romancier, nouvelliste, chroniqueur et poète, il demeure l’un des représentants les plus accomplis du réalisme et du naturalisme, tout en affirmant une voix singulière et indépendante. Son œuvre, d’une richesse et d’une intensité exceptionnelles, reflète à la fois l’héritage de son maître Gustave Flaubert et une sensibilité profondément originale, attentive aux passions humaines, aux contradictions sociales et aux illusions de la modernité.
Né le 5 août 1850 à Tourville-sur-Arques, en Normandie, Guy de Maupassant est issu d’une famille de petite noblesse. Ses parents, d’un caractère opposé, se séparent lorsqu’il est encore enfant, et cette rupture imprime à sa vie un sentiment durable de fragilité familiale. Sa mère, Laure Le Poittevin, femme cultivée et amie d’enfance de Gustave Flaubert, joue un rôle décisif dans son éducation et dans son orientation vers la littérature. La Normandie, ses paysages marins et ruraux, deviendra l’un des cadres privilégiés de son univers littéraire.
Ses études à Rouen puis à Paris le mettent très tôt en contact avec les milieux intellectuels de son temps. Mais c’est surtout la rencontre avec Flaubert, dès l’adolescence, qui marque un tournant. L’auteur de Madame Bovary lui enseigne l’art de l’observation minutieuse, le culte de la phrase juste et l’exigence d’un style dépouillé de tout superflu. Cette discipline littéraire, Maupassant la portera à son point culminant dans l’économie expressive de ses nouvelles.
Après avoir participé à la guerre de 1870, où il sert comme soldat, Maupassant s’installe à Paris. Pour vivre, il entre comme employé au ministère de la Marine, puis à celui de l’Instruction publique, tout en consacrant ses loisirs à l’écriture. Ses débuts littéraires sont hésitants, mais il fréquente les cercles naturalistes autour de Zola. En 1880, la publication de Boule de Suif, dans le recueil collectif Les Soirées de Médan, le propulse au premier plan : unanimement saluée comme un chef-d’œuvre, cette nouvelle lui ouvre les portes d’une carrière fulgurante.
Durant la décennie qui suit, Maupassant déploie une activité créatrice vertigineuse : plus de trois cents nouvelles et contes, six romans majeurs (Une vie, 1883 ; Bel-Ami, 1885 ; Pierre et Jean, 1888 ; Mont-Oriol, 1887 ; Fort comme la mort, 1889 ; Notre Cœur, 1890), des récits de voyage, des chroniques journalistiques et quelques recueils poétiques. La nouvelle, forme brève qu’il porte à un degré inégalé de perfection, devient son terrain de prédilection. Ses textes, souvent ancrés dans la vie quotidienne, explorent les passions humaines – l’amour, la jalousie, la cupidité, la lâcheté – avec un réalisme incisif, une ironie mordante et parfois une vision désenchantée de l’existence.
Maupassant se distingue par son style limpide, précis et vigoureux. Loin des excès rhétoriques, son écriture vise à restituer la vérité nue des comportements et des situations. On y retrouve la marque flaubertienne – l’exactitude du mot juste – mais aussi une veine personnelle, où l’humour noir, le sens du tragique et l’intuition psychologique se combinent pour donner des récits d’une intensité remarquable. La mer, la campagne normande, la bourgeoisie provinciale et le Paris journalistique de la Troisième République constituent ses principaux décors.
Derrière ce succès littéraire se cache toutefois une vie tourmentée. Atteint très tôt de syphilis, Maupassant souffre d’une lente dégradation physique et mentale. Si ses premières années de gloire sont marquées par une vitalité débordante et une sociabilité joyeuse, les dernières années de sa vie voient s’aggraver la maladie : migraines, hallucinations, sentiment d’angoisse et obsession de la mort. Sa lucidité extrême, qui faisait sa force d’écrivain, devient une source de désespoir. En janvier 1892, après une tentative de suicide, il est interné à la clinique du docteur Blanche, où il vit dans l’ombre de la folie jusqu’à sa mort, le 6 juillet 1893 à Paris, à l’âge de quarante-deux ans.
L’héritage de Maupassant est immense. Sa maîtrise de la nouvelle en fait un précurseur reconnu de la littérature moderne et un modèle pour des générations d’écrivains en France comme à l’étranger. Traduit dans de nombreuses langues, lu dans le monde entier, il est considéré, avec Balzac et Zola, comme l’un des grands peintres de la société française du XIXᵉ siècle. Mais au-delà de son époque, Maupassant touche par l’universalité de ses thèmes : la fragilité des liens familiaux, l’obsession de l’argent, la cruauté des passions et l’inévitable désillusion de l’existence humaine.
Ainsi, Maupassant demeure, plus d’un siècle après sa mort, l’un des écrivains les plus lus et étudiés, incarnant l’alliance rare entre la clarté classique, l’acuité réaliste et une vision profondément moderne de l’homme.
À propos de l’œuvre : Pierre et Jean
Publié en 1889, Pierre et Jean est sans doute l’un des romans les plus accomplis de Guy de Maupassant, et celui qui illustre avec le plus de rigueur son projet réaliste. Il s’agit du quatrième roman de l’auteur, écrit alors qu’il est au sommet de sa carrière littéraire, déjà reconnu comme un maître de la nouvelle. Avec ce récit plus resserré et d’une grande intensité psychologique, Maupassant démontre qu’il peut exceller également dans la forme romanesque.
Le roman met en scène deux frères, Pierre et Jean Roland, issus de la bourgeoisie normande du Havre. Leur existence, jusque-là paisible, bascule lorsqu’un riche ami de la famille lègue toute sa fortune à Jean, le cadet. Cet héritage inattendu suscite d’abord l’étonnement, puis la jalousie, avant de laisser place au soupçon : pourquoi un tel legs, et pourquoi à Jean seul ? Progressivement, Pierre, l’aîné, laisse son esprit s’empoisonner par l’idée d’un secret inavouable, celui de la légitimité de son frère. Le roman devient alors l’exploration subtile des tensions intimes et familiales que provoque la révélation d’une vérité cachée.
À travers cette intrigue apparemment simple, Maupassant déploie une analyse pénétrante des sentiments humains : l’orgueil blessé, la jalousie fraternelle, la quête de reconnaissance sociale, mais aussi la fragilité des équilibres familiaux et conjugaux. Le contraste entre Pierre, l’aîné inquiet, instable et envieux, et Jean, le cadet équilibré, conciliant et désormais favorisé, illustre la manière dont le destin peut accentuer les différences intimes et transformer l’amour fraternel en rivalité destructrice.
Ce qui fait la force de Pierre et Jean, ce n’est pas seulement son sujet, mais aussi la sobriété et la précision du style. Maupassant y pratique un réalisme rigoureux, attentif aux gestes, aux regards et aux silences, où chaque détail devient révélateur d’un état d’âme. Le décor normand, les promenades sur le port, les intérieurs bourgeois, tout contribue à ancrer le récit dans une réalité concrète et vraisemblable, en accord avec la théorie du roman qu’il développe dans sa célèbre préface, Le Roman.
La publication de Pierre et Jean fut saluée par la critique comme un modèle de roman réaliste, au point qu’il est encore aujourd’hui considéré comme l’une des œuvres majeures de Maupassant. Le texte condense ce qui fait sa singularité : une écriture claire, incisive, sans ornement inutile ; une lucidité parfois cruelle sur les relations humaines ; et une maîtrise rare de l’art de suggérer l’indicible, en laissant le lecteur entrevoir ce que les personnages taisent.
En définitive, Pierre et Jean n’est pas seulement l’histoire d’un héritage qui divise une famille : c’est une méditation universelle sur la vérité et le mensonge, la jalousie et l’amour, le poids du destin et l’impossibilité d’échapper à ses origines. Ce roman, à la fois intime et universel, continue d’émouvoir par sa justesse psychologique et son intensité dramatique, et demeure une porte d’entrée idéale dans l’univers littéraire de Maupassant.
Sommaire
– I –
– II –
– III –
– IV –
– V –
– VI –
– VII –
– VIII –
– IX –
– I –
« Zut ! » s’écria tout à coup le père Roland qui depuis un quart d’heure demeurait immobile, les yeux fixés sur l’eau, et soulevant par moments, d’un mouvement très léger, sa ligne descendue au fond de la mer.
Mme Roland, assoupie à l’arrière du bateau, à côté de Mme Rosémilly invitée à cette partie de pêche, se réveilla, et tournant la tête vers son mari :
« Eh bien, … eh bien, … Jérôme ! » Le bonhomme, furieux, répondit :
« Ça ne mord plus du tout. Depuis midi je n’ai rien pris. On ne devrait jamais pêcher qu’entre hommes ; les femmes vous font embarquer toujours trop tard. » Ses deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient, l’un à bâbord, l’autre à tribord, chacun une ligne enroulée à l’index, se mirent à rire en même temps et Jean répondit :
« Tu n’es pas galant pour notre invitée, papa. »
M. Roland fut confus et s’excusa :
« Je vous demande pardon, madame Rosémilly, je suis comme ça. J’invite les dames parce que j’aime me trouver avec elles, et puis, dès que je sens de l’eau sous moi, je ne pense plus qu’au poisson. » Mme Roland s’était tout à fait réveillée et regardait d’un air attendri le large horizon de falaises et de mer. Elle murmura :
« Vous avez cependant fait une belle pêche. » Mais son mari remuait la tête pour dire non, tout en jetant un coup d’œil bienveillant sur le panier où le poisson capturé par les trois hommes palpitait vaguement encore, avec un bruit doux d’écailles gluantes et de nageoires soulevées, d’efforts impuissants et mous, et de bâillements dans l’air mortel.
Le père Roland saisit la manne entre ses genoux, la pencha, fit couler jusqu’au bord le flot d’argent des bêtes pour voir celles du fond, et leur palpitation d’agonie s’accentua, et l’odeur forte de leur corps, une saine puanteur de marée, monta du ventre plein de la corbeille.
Le vieux pêcheur la huma vivement, comme on sent des roses, et déclara :
« Cristi ! ils sont frais, ceux-là ! » Puis il continua :
« Combien en as-tu pris, toi, docteur ? » Son fils aîné, Pierre, un homme de trente ans à favoris noirs coupés comme ceux des magistrats, moustaches et menton rasés, répondit :
« Oh ! pas grand-chose, trois ou quatre. » Le père se tourna vers le cadet :
« Et toi, Jean ? » Jean, un grand garçon blond, très barbu, beaucoup plus jeune que son frère, sourit et murmura :
« À peu près comme Pierre, quatre ou cinq. » Ils faisaient, chaque fois, le même mensonge qui ravissait le père Roland.
Il avait enroulé son fil au tolet d’un aviron, et, croisant ses bras, il annonça :
« Je n’essayerai plus jamais de pêcher l’après-midi. Une fois dix heures passées, c’est fini. Il ne mord plus, le gredin, il fait la sieste au soleil. » Le bonhomme regardait la mer autour de lui avec un air satisfait de propriétaire.
C’était un ancien bijoutier parisien qu’un amour immodéré de la navigation et de la pêche avait arraché au comptoir dès qu’il eut assez d’aisance pour vivre modestement de ses rentes.
Il se retira donc au Havre, acheta une barque et devint matelot amateur. Ses deux fils, Pierre et Jean, restèrent à Paris pour continuer leurs études et vinrent en congé de temps en temps partager les plaisirs de leur père.
À la sortie du collège, l’aîné, Pierre, de cinq ans plus âgé que Jean, s’étant senti successivement de la vocation pour des professions variées, en avait essayé, l’une après l’autre, une demi-douzaine, et, vite dégoûté de chacune, se lançait aussitôt dans de nouvelles espérances.
En dernier lieu la médecine l’avait tenté, et il s’était mis au travail avec tant d’ardeur qu’il venait d’être reçu docteur après d’assez courtes études et es dispenses de temps obtenues du ministre. Il était exalté, intelligent, changeant et tenace, plein d’utopies, et d’idées philosophiques.
Jean, aussi blond que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son frère était rancunier, avait fait tranquillement son droit et venait d’obtenir son diplôme de licencié en même temps que Pierre obtenait celui de docteur.
Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille, et tous les deux formaient le projet de s’établir au Havre s’ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes.
Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent presque invisibles entre frères ou entre sœurs jusqu’à la maturité et qui éclatent à l’occasion d’un mariage ou d’un bonheur tombant sur l’un, les tenait en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes ils s’aimaient, mais ils s’épiaient. Pierre, âgé de cinq ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité de petite bête gâtée cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son père et de sa mère, et tant aimée, tant caressée par eux.
Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal ; et Pierre s’était énervé, peu à peu, à entendre vanter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l’aveuglement. Ses parents, gens placides, qui rêvaient pour leurs fils des situations honorables et médiocres, lui reprochaient ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées, tous ses élans impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives.
Depuis qu’il était homme, on ne lui disait plus : « Regarde Jean et imite-le ! » mais chaque fois qu’il entendait répéter :
« Jean a fait ceci, Jean a fait cela », il comprenait bien le sens et l’allusion cachés sous ces paroles.
Leur mère, une femme d’ordre, une économe bourgeoise un peu sentimentale, douée d’une âme tendre de caissière, apaisait sans cesse les petites rivalités nées chaque jour entre ses deux grands fils, de tous les menus faits de la vie commune.
Un léger événement, d’ailleurs, troublait en ce moment sa quiétude, et elle craignait une complication, car elle avait fait la connaissance pendant l’hiver, pendant que ses enfants achevaient l’un et l’autre leurs études spéciales, d’une voisine, Mme Rosémilly, veuve d’un capitaine au long cours, mort à la mer deux ans auparavant. La jeune veuve, toute jeune, vingt-trois ans, une maîtresse femme qui connaissait l’existence d’instinct, comme un animal libre, comme si elle eût vu, subi, compris et pesé tous les événements possibles, qu’elle jugeait avec un esprit sain, étroit et bienveillant, avait pris l’habitude de venir faire un bout de tapisserie et de causette, le soir, chez ces voisins aimables qui lui offraient une tasse de thé.
Le père Roland, que sa manie de pose marine aiguillonnait sans cesse, interrogeait leur nouvelle amie sur le défunt capitaine, et elle parlait de lui, de ses voyages, de ses anciens récits, sans embarras, en femme raisonnable et résignée qui aime la vie et respecte la mort.
Les deux fils, à leur retour, trouvant cette jolie veuve installée dans la maison, avaient aussitôt commencé à la courtiser, moins par désir de lui plaire que par envie de se supplanter.
Leur mère, prudente et pratique, espérait vivement qu’un des deux triompherait, car la jeune femme était riche, mais elle aurait aussi bien voulu que l’autre n’en eût point de chagrin.
Mme Rosémilly était blonde avec des yeux bleus, une couronne de cheveux follets envolés à la moindre brise et un petit air crâne, hardi, batailleur, qui ne concordait point du tout avec la sage méthode de son esprit.
Déjà elle semblait préférer Jean, portée vers lui par une similitude de nature. Cette préférence d’ailleurs ne se montrait que par une presque insensible différence dans la voix et le regard, et en ceci encore qu’elle prenait quelquefois son avis.
Elle semblait deviner que l’opinion de Jean fortifierait la sienne propre, tandis que l’opinion de Pierre devait fatalement être différente. Quand elle parlait des idées du docteur, de ses idées politiques, artistiques, philosophiques, morales, elle disait par moments : « Vos billevesées. » Alors, il la regardait d’un regard froid de magistrat qui instruit le procès des femmes, de toutes les femmes, ces pauvres êtres !
Jamais, avant le retour de ses fils, le père Roland ne l’avait invitée à ses parties de pêche où il n’emmenait jamais non plus sa femme, car il aimait s’embarquer avant le jour, avec le capitaine Beausire, un long-courrier retraité, rencontré aux heures de marée sur le port et devenu intime ami, et le vieux matelot Papagris, surnommé Jean-Bart, chargé de là garde du bateau.
Or, un soir de la semaine précédente, comme Mme Rosémilly qui avait dîné chez lui disait : « Ça doit être très amusant, la pêche ? » l’ancien bijoutier, flatté dans sa passion, et saisi de l’envie de la communiquer, de faire des croyants à la façon des prêtres, s’écria :
« Voulez-vous y venir ?
– Mais oui.
– Mardi prochain ?
– Oui, mardi prochain.
– Êtes-vous femme à partir à cinq heures du matin ? »
Elle poussa un cri de stupeur :
« Ah ! mais non, par exemple. » Il fut désappointé, refroidi, et il douta tout à coup de cette vocation.
Il demanda cependant :
« À quelle heure pourriez-vous partir ?
– Mais… à neuf heures !
– Pas avant ?
– Non, pas avant, c’est déjà très tôt ! » Le bonhomme hésitait. Assurément on ne prendrait rien, car si le soleil chauffe, le poisson ne mord plus ; mais les deux frères s’étaient empressés d’arranger la partie, de tout organiser et de tout régler séance tenante.
Donc, le mardi suivant, la Perle avait été jeter l’ancre sous les rochers blancs du cap de la Hève ; et on avait pêché jusqu’à midi, puis sommeillé, puis repêché, sans rien prendre, et le père Roland, comprenant un peu tard que Mme Rosémilly n’aimait et n’appréciait en vérité que la promenade en mer, et voyant que ses lignes ne tressaillaient plus, avait jeté, dans un mouvement d’impatience irraisonnée, un zut énergique qui s’adressait autant à la veuve indifférente qu’aux bêtes insaisissables.
Maintenant, il regardait le poisson capturé, son poisson, avec une joie vibrante d’avare ; puis il leva les yeux vers le ciel, remarqua que le soleil baissait : « Eh bien ! les enfants, dit-il, si nous revenions un peu ? » Tous deux tirèrent leurs fils, les roulèrent, accrochèrent dans les bouchons de liège les hameçons nettoyés et attendirent.
Roland s’était levé pour interroger l’horizon à la façon d’un capitaine :
« Plus de vent, dit-il, on va ramer, les gars ! » Et soudain, le bras allongé vers le nord, il ajouta :
« Tiens, tiens, le bateau de Southampton. ».
Sur la mer plate, tendue comme une étoffe bleue, immense, luisante, aux reflets d’or et de feu, s’élevait là-bas, dans la direction indiquée, un nuage noirâtre sur le ciel rose. Et on apercevait, au-dessous, le navire qui semblait tout petit de si loin.
Vers le sud, on voyait encore d’autres fumées, nombreuses, venant toutes vers la jetée du Havre dont on distinguait à peine la ligne blanche et le phare, droit comme une corne sur le bout.
Roland demanda :
« N’est-ce pas aujourd’hui que doit entrer la Normandie ? »
Jean répondit :
« Oui, papa.
– Donne-moi ma longue-vue, je crois que c’est elle, là-bas. » Le père déploya le tube de cuivre, l’ajusta contre son œil, chercha le point, et soudain, ravi d’avoir vu :
« Oui, oui, c’est elle, je reconnais ses deux cheminées.
Voulez-vous regarder, madame Rosémilly ? » Elle prit l’objet qu’elle dirigea vers le transatlantique lointain, sans parvenir sans doute à le mettre en face de lui, car elle ne distinguait rien, rien que du bleu, avec un cercle de couleur, un arc-en-ciel tout rond, et puis des choses bizarres, des espèces d’éclipses, qui lui faisaient tourner le cœur. Elle dit en rendant la longue-vue :
« D’ailleurs je n’ai jamais su me servir de cet instrument-là.
Ça mettait même en colère mon mari qui restait des heures la fenêtre à regarder passer les navires. » Le père Roland, vexé, reprit :
« Cela doit tenir à un défaut de votre œil, car ma lunette est excellente. » Puis il l’offrit à sa femme :
« Veux-tu voir ?
– Non, merci, je sais d’avance que je ne pourrais pas. » Mme Roland, une femme de quarante-huit ans et qui ne les portait pas, semblait jouir, plus que tout le monde, de cette promenade et de cette fin de jour.
Ses cheveux châtains commençaient seulement à blanchir.
Elle avait un air calme et raisonnable, un air heureux et bon qui plaisait à voir. Selon le mot de son fils Pierre, elle savait le prix de l’argent, ce qui ne l’empêchait point de goûter le charme du rêve. Elle aimait les lectures, les romans et les poésies, non pour leur valeur d’art, mais pour la songerie mélancolique et tendre qu’ils éveillaient en elle. Un vers, souvent banal, souvent mauvais, faisait vibrer la petite corde, comme elle disait, lui donnait la sensation d’un désir mystérieux presque réalisé. Et elle se complaisait à ces émotions légères qui troublaient un peu son âme bien tenue comme un livre de comptes.
Elle prenait, depuis son arrivée au Havre, un embonpoint assez visible qui alourdissait sa taille autrefois très souple et très mince.
Cette sortie en mer l’avait ravie. Son mari, sans être méchant, la rudoyait comme rudoient sans colère et sans haine les despotes en boutique pour qui commander équivaut à jurer. Devant tout étranger il se tenait, mais dans sa famille il s’abandonnait et se donnait des airs terribles, bien qu’il eût peur de tout le monde. Elle, par horreur du bruit, des scènes, des explications inutiles, cédait toujours et ne demandait jamais rien ; aussi n’osait-elle plus, depuis bien longtemps, prier Roland de la promener en mer. Elle avait donc saisi avec joie cette occasion, et elle savourait ce plaisir rare et nouveau.
Depuis le départ elle s’abandonnait tout entière, tout son esprit et toute sa chair, à ce doux glissement sur l’eau. Elle ne pensait point, elle ne vagabondait ni dans les souvenirs ni dans es espérances, il lui semblait que son cœur flottait comme son corps sur quelque chose de moelleux, de fluide, de délicieux, qui la berçait et l’engourdissait.
Quand le père commanda le retour : « Allons, en place pour la nage ! » elle sourit en voyant ses fils, ses deux grands fils, ôter leurs jaquettes et relever sur leurs bras nus les manches de leur chemise.
Pierre, le plus rapproché des deux femmes, prit l’aviron de tribord, Jean l’aviron de bâbord, et ils attendirent que le patron criât : « Avant partout ! » car il tenait à ce que les manœuvres fussent exécutées régulièrement.
Ensemble, d’un même effort, ils laissèrent tomber les rames, puis se couchèrent en arrière en tirant de toutes leurs forces ; et une lutte commença pour montrer leur vigueur. Ils étaient venus à la voile tout doucement, mais la brise était tombée et l’orgueil de mâles des deux frères s’éveilla tout à coup à la perspective de se mesurer l’un contre l’autre.
Quand ils allaient pêcher seuls avec le père, ils ramaient ainsi sans que personne gouvernât, car Roland préparait les lignes tout en surveillant la marche de l’embarcation, qu’il dirigeait d’un geste ou d’un mot : « Jean, mollis ! » – « À toi, Pierre, souque. » Ou bien il disait : « Allons le un, allons le deux, un peu d’huile de bras. » Celui qui rêvassait tirait plus fort, celui qui s’emballait devenait moins ardent, et le bateau se redressait.
Aujourd’hui ils allaient montrer leurs biceps. Les bras de Pierre étaient velus, un peu maigres, mais nerveux ; ceux de Jean gras et blancs, un peu roses, avec une bosse de muscles qui roulait sous la peau.
Pierre eut d’abord l’avantage. Les dents serrées, le front plissé, les jambes tendues, les mains crispées sur l’aviron, qu’il faisait plier dans toute sa longueur à chacun de ses efforts ; et la Père s’en venait vers la côte. Le père Roland, assis à l’avant afin de laisser tout le banc d’arrière aux deux femmes, s’époumonait à commander : « Doucement, le un – souque, le deux. » Le un redoublait de rage et le deux ne pouvait répondre à cette nage désordonnée.
Le patron, enfin, ordonna : « Stop ! » Les deux rames se levèrent ensemble, et Jean, sur l’ordre de son père, tira seul quelques instants. Mais à partir de ce moment l’avantage lui resta ; il s’animait, s’échauffait, tandis que Pierre, essoufflé, épuisé par sa crise de vigueur, faiblissait et haletait. Quatre fois de suite, le père Roland fit stopper pour permettre à l’aîné de reprendre haleine et de redresser a barque dérivant. Le docteur alors, le front en sueur, les joues pâles, humilié et rageur, balbutiait :
« Je ne sais pas ce qui me prend, j’ai un spasme au cœur.
J’étais très bien parti, et cela m’a coupé les bras. » Jean demandait :
« Veux-tu que je tire seul avec les avirons de couple ?
– Non, merci, cela passera. » La mère, ennuyée, disait :
« Voyons, Pierre, à quoi cela rime-t-il de se mettre dans un état pareil, tu n’es pourtant pas un enfant. » Il haussait les épaules et recommençait à ramer.
Mme Rosémilly semblait ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas entendre. Sa petite tête blonde, à chaque mouvement du bateau, faisait en amère un mouvement brusque et joli qui soulevait sur les tempes ses fins cheveux.
Mais le père Roland cria : « Tenez, voici le Prince-Albert qui nous rattrape. » Et tout le monde regarda. Long, bas, avec ses deux cheminées inclinées en arrière et ses deux tambours jaunes, ronds comme des joues, le bateau de Southampton arrivait à toute vapeur, chargé de passagers et d’ombrelles ouvertes. Ses roues rapides, bruyantes, battant l’eau qui retombait en écume, lui donnaient un air de hâte, un air de courrier pressé ; et l’avant tout droit coupait la mer en soulevant deux lames minces et transparentes qui plissaient le long des bords.
Quand il fut tout près de la Perle, le père Roland leva son chapeau, les deux femmes agitèrent leurs mouchoirs, et une demi-douzaine d’ombrelles répondirent à ces saluts en se balançant vivement sur le paquebot qui s’éloigna, laissant derrière lui, sur la surface paisible et luisante de la mer, quelques lentes ondulations.
Et on voyait d’autres navires, coiffés aussi de fumée, accourant de tous les points de l’horizon vers la jetée courte et blanche qui les avalait comme une bouche, l’un après l’autre.
Et les barques de pêche et les grands voiliers aux mâtures légères glissant sur le ciel, traînés par d’imperceptibles remorqueurs, arrivaient tous, vite ou lentement, vers cet ogre dévorant, qui, de temps en temps, semblait repu, et rejetait vers la pleine mer une autre flotte de paquebots, de bricks, de goélettes, de trois-mâts chargés de ramures emmêlées. Les steamers hâtifs s’enfuyaient à droite, à gauche, sur le ventre plat de l’Océan, tandis que les bâtiments à voile, abandonnés par les mouches qui les avaient halés, demeuraient immobiles, tout en s’habillant de la grande hune au petit perroquet, de toile blanche ou de toile brune qui semblait rouge au soleil couchant.
Mme Roland, les jeux mi-clos, murmura :
« Dieu ! que c’est beau, cette mer ! » Mme Rosémilly répondit, avec un soupir prolongé, qui n’avait cependant rien de triste :
« Oui, mais elle fait bien du mal quelquefois. » Roland s’écria :