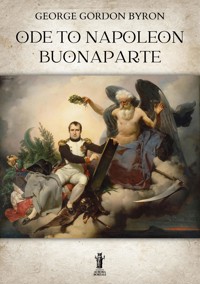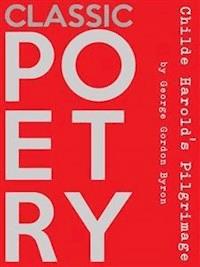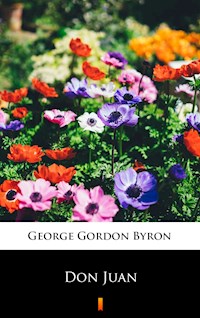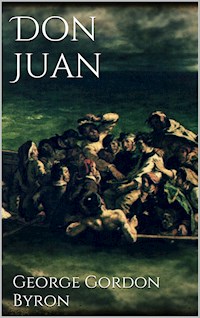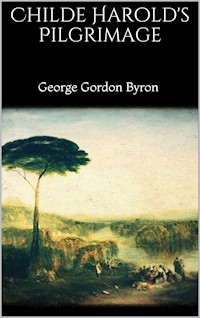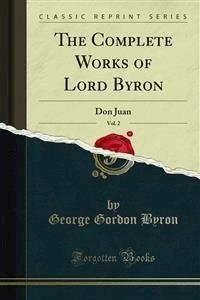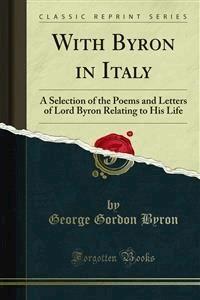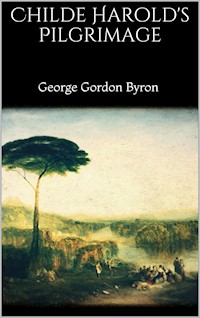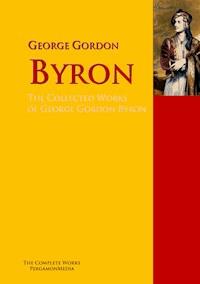Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Poésies diverses" de George Gordon Byron est une collection captivante de poèmes qui reflète la profondeur émotionnelle et la complexité intellectuelle de l'un des poètes les plus emblématiques du romantisme anglais. Cette oeuvre rassemble une variété de poèmes qui explorent des thèmes universels tels que l'amour, la nature, la mélancolie et la quête de sens. Byron, avec sa plume incisive et son style lyrique, parvient à capturer les nuances de l'expérience humaine, invitant le lecteur à une introspection profonde. Chaque poème est une fenêtre sur l'âme tourmentée de l'auteur, révélant ses luttes intérieures et ses réflexions philosophiques. La richesse stylistique et la diversité des sujets abordés témoignent de la maîtrise littéraire de Byron et de sa capacité à toucher l'âme de ses lecteurs. À travers cette collection, Byron ne se contente pas de décrire le monde qui l'entoure, mais transcende les simples observations pour offrir une vision poétique qui résonne encore aujourd'hui. "Poésies diverses" est ainsi une invitation à découvrir ou redécouvrir la beauté intemporelle de la poésie byronienne, où chaque vers est une exploration de la condition humaine et une célébration de l'art poétique. L'AUTEUR : George Gordon Byron, plus connu sous le nom de Lord Byron, est né le 22 janvier 1788 à Londres. Il est l'un des poètes les plus célèbres du mouvement romantique anglais. Byron est issu d'une famille noble, mais sa jeunesse est marquée par des difficultés financières et personnelles. Il étudie à l'université de Cambridge, où il commence à écrire ses premiers poèmes. Sa carrière littéraire décolle avec la publication de "Childe Harold's Pilgrimage" en 1812, qui le propulse au rang de célébrité littéraire. Byron est connu pour son charme, son esprit rebelle et sa vie tumultueuse. Il voyage à travers l'Europe, s'installant notamment en Italie et en Grèce, où il s'implique dans la lutte pour l'indépendance grecque. Ses oeuvres, telles que "Don Juan" et "Manfred", sont caractérisées par leur intensité émotionnelle et leur critique sociale. Byron meurt prématurément en 1824 à Missolonghi, en Grèce, à l'âge de 36 ans. Sa vie et ses oeuvres continuent d'influencer la littérature et la culture modernes, faisant de lui une figure emblématique du romantisme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Poésies diverses, composées en 1807 et 1808
Poésies diverses, composées en 1809 et 1810
Poésies diverses, composées de 1811 à 1815
Poésies domestiques
Poésies diverses, composées en 1814-15-16
Poésies diverses, composées de 1817 à 1821
Page de copyright
Poésies diverses, composées en 1807 et 1808
L’Adieu, écrit à une époque où l’auteur croyait qu’il allait bientôt mourir
Adieu, colline où les joies de l’enfance ont couronné de roses mon jeune front, où la Science appelle l’écolier paresseux pour lui dispenser ses trésors ; adieu, amis ou ennemis de mon jeune âge, compagnons de mes premiers plaisirs, de mes premières peines ; nous né parcourrons plus ensemble les sentiers d’Ida ; je descendrai bientôt dans l’étroite et sombre demeure où il fait toujours nuit et où l’on dort d’un éternel sommeil.
Adieu, vénérables et royales demeures qui élevez vos spirales dans la vallée de Cranta, où règnent l’Étude en robe noire et la Mélancolie au front pâle. Compagnons de mes heures joyeuses, habitants du classique séjour que baigne le Cam aux verdoyantes rives, recevez mes adieux pendant que la mémoire me reste encore ; car pour moi bientôt ces souvenirs s’effaceront, immolés sur l’autel de l’Oubli.
Adieu, montagnes des contrées qui ont vu grandir mes jeunes années, où le Loch na Garr, neigeux et sublime, lève son front géant. Pourquoi, régions du Nord, mon enfance s’éloigna-t-elle de vous, et alla-t-elle, se mêler aux fils de l’Orgueil ? Pourquoi ai-je échangé contre le séjour du Midi ma caverne highlandaise, Marr et ses sombres bruyères, la Dée et son flot limpide ?
Manoir de mes pères, adieu pour longtemps ! Mais pourquoi te dirais-je adieu ? L’écho de tes voûtes répétera mon glas de mort ; tes tours contempleront ma tombe. La voix défaillante qui a chanté la ruine actuelle et la gloire passée, ne peut plus faire entendre ses simples accents ; mais la lyre a conservé ses cordes, et parfois le souffle des vents y éveillera les sons mourants d’une éolienne mélodie.
Campagnes qui entourez cette cabane rustique, adieu pendant que je respire encore ; en ce moment vous n’êtes point oubliées, et votre souvenir m’est cher. Rivière qui m’as vu souvent, pendant la chaleur du jour, m’élancer de ton rivage et fendre d’un cours agile ton onde frémissante, tes flots ne baigneront plus ce corps aujourd’hui sans force.
Et dois-je oublier ici le lieu le plus cher à mon cœur ? Des rochers se dressent, des fleuves coulent entre moi et ce séjour où je savourai le bonheur d’aimer ; et pourtant, ô Marie ! ta beauté m’apparaît vivante, comme naguère dans le rêve enchanteur de l’amour, né d’un de tes sourires. Jusqu’à ce que le mal lent qui me consume ait abandonné sa proie à la Mort, mère de la Destruction, ton image ne saurait s’effacer de ma mémoire.
Et toi, mon ami, dont la douce affection fait vibrer encore les fibres de mon cœur, oh ! combien ton amitié était au-dessus de ce que des paroles peuvent exprimer ! Je porte encore sur mon cœur ta cornaline, don sacré de la tendresse la plus pure, que mouilla naguère une larme de tes yeux émus. Nos âmes étaient de niveau en ce moment si doux, et la différence de nos destinées était oubliée : l’orgueil seul pourra m’en faire un sujet de reproche.
Tout, tout maintenant est triste et sombre ! Nul souvenir d’un amour décevant ne peut réchauffer mes veines ni me rendre les pulsations de la vie ; l’espérance même d’un immortel avenir ne pourrait, par l’appât de ses couronnes imaginaires, ranimer mon épuisement et réveiller ma langueur. J’aurai vécu sans gloire, pour cacher ma face dans la poussière et me mêler à la foule des morts.
Ô Gloire ! divinité de mon cœur, heureux celui à qui tu daignes sourire ! Embrasé par tes feux immortels, la Mort ne peut rien sur lui, et son dard tombe émoussé. Mais moi, elle me fait signe de la suivre, et je meurs obscur et sans nom. Nul n’aura remarqué ma naissance ; ma vie n’aura été qu’un rêve court et vulgaire. Confondu dans la foule, un linceul, voilà tout mon espoir ; l’oubli, voilà ma destinée.
Quand je dormirai oublié sous le sol et dans l’argile que foulaient naguère mes jeux enfantins et où doit maintenant reposer ma tête, ma tombe chétive ne sera arrosée que par les vapeurs de la nuit ou les pleurs de l’orage. Les yeux d’aucun mortel ne daigneront humecter d’une larme le gazon funéraire qui recouvrira un nom inconnu.
Âme agitée, oublie ce monde ! Tourne, tourne tes pensées vers le ciel : c’est là que bientôt tu dois diriger ton vol, si toutefois tes fautes sont pardonnées. Étrangère aux bigots et aux sectes, prosterne-toi devant le trône du Tout-Puissant ; adresse-lui ta prière tremblante. Il est miséricordieux et juste ; il ne repoussera pas un fils de la poussière, l’objet le plus chétif de sa sollicitude.
Père de la lumière, c’est toi que j’implore ! Les ténèbres remplissent mon âme ; toi qui remarques la chute du passereau, éloigne de moi la mort du péché. Toi qui guides l’étoile errante, qui apaises la guerre des éléments, qui as pour manteau le firmament sans limite, pardonne-moi mes pensées, mes paroles, mes fautes ; et puisque je dois bientôt cesser de vivre, apprends-moi à mourir.
1807.
À une dame vaine
Insensée ! pourquoi révéler ce qui ne devait jamais arriver à d’autres oreilles ? Pourquoi détruire ainsi ton repos, et te creuser dans l’avenir une source de larmes ?
Oh ! tu pleureras, fille imprudente, pendant que souriront secrètement tes ennemis jaloux ; tu pleureras l’indiscrétion qui t’a fait redire les paroles décevantes qu’on t’adressait.
Fille vaine, tes jours d’affliction s’approchent, si tu crois ce que te disent les jeunes hommes. Oh ! fuis les pièges de la tentation, et ne deviens pas la proie du corrupteur habile.
Ainsi donc, tu redis avec un orgueil d’enfant les discours qu’on ne te tient que pour te tromper ! Si tu as le malheur d’y ajouter foi, c’en est fait de ton repos, de tes espérances, de toi !
Pendant qu’au milieu de tes compagnes, tu répètes ces doux entretiens, vois sur leurs lèvres ces sourires ironiques que la duplicité voudrait en vain cacher.
Ces choses, couvre-les du voile du silence ; n’appelle pas sur toi les regards du public : quelle vierge modeste pourra sans rougir répéter les adulations d’un fat !
Le jeune homme ne méprisera-t-il pas celle qui se plaît à répéter les flatteries obligeantes qu’on lui adresse ; qui, s’imaginant que le ciel est dans ses yeux, ne sait point pourtant découvrir l’imposture sous son voile transparent ?
Car la femme qui aime à révéler tous ces riens amoureux que sa vanité l’empêche de tenir secrets, doit nécessairement croire tout ce qu’on lui dit et lui écrit.
Corrige-toi donc, si tu mets quelque prix à l’empire de ta beauté ! Ce n’est pas la jalousie qui me fait parler. Celle que la Nature fit si vaine, je puis en avoir pitié ; mais je ne puis l’aimer.
15 janvier 1807.
À Anna
Ô Anna ! vous avez été bien coupable envers moi ! J’ai cru qu’aucune expiation ne désarmerait mon courroux ; mais la femme fut créée pour nous commander et nous tromper ; j’ai revu votre visage, et je vous ai presque pardonné !
J’avais juré que vous n’occuperiez plus un seul moment ma pensée, et pourtant un jour de séparation me parut long : quand je vous revis, j’étais résolu à ne pas me fier à vous ; votre sourire m’a convaincu bientôt de l’erreur de mes soupçons.
J’avais juré, dans le transport de ma jeune indignation, de vous vouer désormais le plus froid mépris : je vous vis, – ma colère se changea en admiration ; et maintenant tous mes vœux, tout mon espoir, sont de vous reconquérir.
Contre une beauté telle que la vôtre, combien il est insensé de lutter ! Je m’incline humblement devant vous pour obtenir mon pardon. Pour terminer une discussion aussi inutile, je n’ajoute plus qu’un mot : trahissez-moi, ma douce Anna, le jour où je cesserai de vous adorer.
16 janvier 1807.
À la même
Oh ! ne dites point, douce Anna, que la destinée avait résolu que le cœur qui vous adore chercherait à briser ses liens. C’eût été pour moi une destinée ennemie que celle qui m’eût enlevé à jamais à l’amour et à la beauté.
Votre froideur, fille charmante, voilà la destinée qui seule m’obligea à imposer silence à ma tendre admiration. Ce fut elle qui détruisit tout mon espoir et tous mes vœux, jusqu’au jour où un sourire fit renaître mon ravissement.
Ainsi qu’on voit dans la forêt le chêne et le lierre, entrelacés, affronter réunis la fureur de la tempête, ainsi ma vie et mon amour ont été destinés par la nature à fleurir en même temps ou à mourir ensemble.
Ne dites donc point, ma douce Anna, que la destinée avait résolu que votre amant vous dît un éternel adieu : tant que la destinée n’aura pas ordonné à ce cœur de cesser de battre, mon âme, mon existence, seront absorbées dans vous.
1807.
À l’auteur d’un sonnet commençant par ces mots :
« Mon vers est triste, et ne fait point pleurer. »
Ton vers est « triste, » on n’en saurait douter, beaucoup plus triste que spirituel ! Je ne vois pas trop pourquoi nous pleurerions, à moins de pleurer de pitié pour toi.
Mais il est quelqu’un que je plains davantage encore, et certes, celui-là le mérite ; car, j’en suis sûr, celui qui te lit doit horriblement souffrir.
On pourra te lire une fois ; mais à moins d’être sorcier, on ne te lira pas une seconde. Assurément tes vers n’ont rien de tragique ; ils feraient même rire s’ils n’étaient pas trop ennuyeux.
Mais veux-tu nous mettre le désespoir au cœur, nous imposer une souffrance réelle, nous faire enfin pleurer tout de bon ? Je vais l’en dire le moyen : c’est de nous faire une seconde lecture de tes productions.
8 mars 1807.
Sur un éventail
Dans un cœur qui sentirait aujourd’hui comme il sentait autrefois, cet éventail eût pu raviver sa flamme ; mais aujourd’hui ce cœur ne peut s’attendrir, parce qu’il n’est plus ce qu’il était.
Lorsqu’un feu est prêt à s’éteindre, ce qui en redoublait l’activité et le faisait brûler avec plus de force, ne fait plus que hâter l’extinction des dernières étincelles.
Comme plus d’un jouvenceau, plus d’une jeune fille en a mémoire, il en est de même des feux de l’amour, alors que toute espérance meurt, et qu’ils disparaissent ensevelis sous leurs propres cendres.
Le premier feu, bien qu’il n’en reste plus une étincelle, une main soigneuse peut le rallumer. Hélas ! il n’en est pas de même du dernier ; nul n’a la puissance de le faire renaître.
Ou si, par hasard, il se réveille, si la flamme n’est pas étouffée pour toujours, c’est sur un autre objet (ainsi l’ordonne la capricieuse Destinée) qu’il répand sa première chaleur.
1807.
Adieu à la muse
Divinité qui régnas sur les jours de mon premier âge, jeune enfant de l’imagination, il est temps de nous séparer ; que les vents emportent donc encore sur leurs ailes ce chant qui sera le dernier, cette effusion de mon cœur, la plus froide de toutes !
Ce cœur, sourd maintenant à l’enthousiasme, imposera silence à tes accents émus, et ne te demandera plus des chants ; les sentiments de mon adolescence, qui avaient soutenu ton essor, se sont envolés au loin sur les ailes de l’Apathie.
Quelque simples que fussent les sujets qui faisaient résonner ma lyre grossière, ces sujets ont disparu pour toujours ; les yeux qui inspiraient mon rêve ont cessé de briller ; mes visions sont parties, hélas ! pour ne plus revenir.
Lorsqu’est bu le nectar qui remplissait la coupe, pourquoi chercher en vain à prolonger la joie du festin ? Lorsqu’est froide la Beauté qui vivait dans mon âme, quelle puissance de l’imagination pourrait ranimer mes chants ?
Mes lèvres peuvent-elles parler d’amour dans la solitude, de baisers et de sourires auxquels il leur faut dire adieu ? Peuvent-elles s’entretenir avec délices des heures écoulées ? Oh ! non ; car ces heures ne peuvent plus être à moi.
Parleront-elles des amis à l’affection desquels j’avais voué ma vie ? Ah ! l’amitié sans doute ennoblirait mes chants ; mais quelle sympathie éveilleront mes vers dans leur âme, lorsque je puis à peine espérer de les revoir ?
Dirai-je les hauts faits de mes pères, et consacrerai-je les sons éclatants de ma harpe à célébrer leur gloire ? Mais combien ma voix est faible pour de telles renommées ! combien sera insuffisante mon inspiration pour chanter les exploits des héros !
Je dépose ma lyre, encore vierge ; je laisse aux vents à faire résonner ses cordes : qu’elle se taise ! mettons fin à mes faibles efforts. Ceux qui l’ont entendue me pardonneront le passé, sachant que sa voix murmurante a vibré pour la dernière fois.
Son errante et irrégulière mélodie sera bientôt oubliée, maintenant que j’ai dit adieu à l’amitié et à l’amour. Heureux eût été mon destin, fortuné mon partage, si mon premier chant d’amour eût aussi été le dernier !
Adieu, ma jeune Muse, puisque maintenant nous ne devons plus nous revoir ! Si nos chants ont été faibles, du moins ils sont peu nombreux ; espérons que le présent nous sera doux, le présent qui met le sceau à notre éternel adieu.
À un chêne de Newstead
Jeune chêne, quand mes mains t’ont piaulé, j’espérais que tes jours seraient plus nombreux que les miens ; que tu balancerais au loin ton épais feuillage, et qu’autour de ton tronc vigoureux serpenterait le lierre.
Tel était mon espoir lorsqu’aux jours de mon enfance, sur le sol de mes pères, je le voyais croître avec orgueil. Ils sont passés, ces jours ! et voilà que j’arrose ta tige de mes larmes. Les herbes dont tu es entouré ne peuvent me cacher ton déclin.
Je t’ai quitté, ô mon, chêne ! et depuis cette heure fatale, un étranger a fixé son séjour dans le manoir de mes pères. Tant que je ne serai point homme, je ne pourrai rien pour toi ; ce pouvoir appartient à celui dont la négligence a failli te laisser mourir.
Oh ! tu étais fort ! et maintenant encore quelques soins suffiraient pour raviver ta jeune tête, pour cicatriser doucement tes blessures ; mais tu n’étais point destiné à partager son affection. Eh ! que pouvait sentir pour toi un étranger ?
Oh ! ne t’incline point ainsi, mon jeune chêne ; relève un moment ta tête ; avant que ce globe ait fait deux fois le tour de l’astre radieux que tu vois, mon adolescence aura complété ses années d’épreuve, et tu souriras de nouveau sous la main de ton maître.
Vis donc, ô mon chêne ! lève ton front au-dessus des herbes parasites qui entravent ta croissance et hâtent ton déclin ; car tu as encore au cœur des germes de jeunesse et de vie, et tes branches peuvent encore se déployer dans leur mâle beauté.
Oui, des années de maturité te sont encore réservées ; quand je dormirai dans la caverne de la mort, tu braveras le temps et le souffle glacé des hivers ; et pendant des siècles les rayons de l’aurore viendront dorer ton feuillage.
Pendant des siècles tu balanceras légèrement tes branches sur la tombe de ton maître, qu’elles couvriront comme d’un pavillon ; pendant qu’ainsi ton feuillage ombragera gracieusement sa tombe, ton nouveau possesseur s’étendra sous ton ombre.
Lorsque accompagné de ses enfants il visitera ce lieu, il leur dira tout bas de marcher doucement. Oh ! sans doute mon nom vivra flans leur mémoire : le souvenir sanctifie la cendre des morts.
« C’est ici, » diront-ils, « quand sa vie était à son aurore, qu’il a exhalé les simples chants de sa jeunesse ; c’est ici qu’il dort jusqu’au jour où le Temps disparaîtra dans l’Éternité. »
1807
Lors d’une visite à Harrow
Ici les yeux de l’étranger lisaient naguère quelques mots simples tracés par l’Amitié ; ces mots étaient en petit nombre, et néanmoins la main du Ressentiment voulut les détruire.
Malgré ses incisions profondes, les mots n’étaient point effacés ; on les voyait encore si lisiblement, qu’un jour l’Amitié, de retour, y jeta les yeux, et soudain les mots se reproduisirent à la Mémoire charmée.
Le Repentir les rétablit dans leur premier état ; le Pardon y joignit son doux nom ; et l’inscription redevint si belle, que l’Amitié crut que c’était la même.
Elle existerait encore maintenant ; mais, hélas ! malgré les efforts de l’Espérance et les larmes de l’Amitié, l’Orgueil accourut et effaça l’inscription pour toujours.
Septembre 1807.
Épitaphe de John Adams, voiturier de Southwell, mort d’un excès de boisson
Le voiturier Adams ici repose en terre.
À sa bouche sans peine il voiturait son verre.
Il en voitura tant, que, tout considéré,
La Mort dans l’autre monde enfin l’a voituré
Septembre 1807.
À mon fils
Cette chevelure blonde, ces yeux d’azur, brillants comme ceux de ta mère ; ces lèvres roses, au séduisant sourire, me rappellent un bonheur qui n’est plus, et touchent le cœur de ton père, ô mon fils !
Et tu balbuties déjà le nom de ton père ! Ah ! William, que ce nom n’est-il le tien. Mais écartons d’affligeants reproches et d’amers souvenirs, Va, mes soins paternels expieront mes torts ; l’ombre de ta mère sourira joyeuse ; elle me pardonnera tout le passé, ô mon fils !