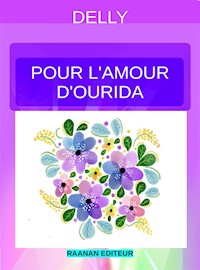
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait
| I
Ourida n’avait même pas la ressource de confier son anxiété à Mlle de Francueil. Celle-ci, complètement épuisée par le travail intensif de ces derniers jours, devait garder le lit. Sa vue, tout particulièrement, était en fort mauvais état. Mais elle n’avait pas les moyens de se rendre à Clermont pour consulter un oculiste. Mme de Varouze – sans doute afin de la tenir dans une plus stricte dépendance – s’abstenait depuis cinq ans de lui envoyer les cinquante francs mensuels qu’elle lui avait généreusement alloués. Le peu d’économies qui lui restait avait servi à payer quelques médicaments pour fortifier Ourida, un vêtement plus chaud ou des chaussures supplémentaires pour l’enfant qui souffrait du froid dans ce rude climat. Elle se trouvait donc maintenant sans ressources, au grand chagrin de la jeune fille qui se désolait de ne pouvoir rien pour elle.
– Oh ! si j’étais libre de travailler à mon compte, disait-elle avec une douloureuse impatience. Mais non, il faut que notre labeur profite à cette femme, qui vous tue ainsi à petit feu !
Mlle Luce hochait la tête sans répondre. Elle semblait plus froide, plus concentrée que jamais... Ourida en ressentit une impression fort pénible en ce moment où elle aurait eu tant besoin d’affection et de réconfort moral. Déjà décidée à ne pas faire partager son souci à cette femme abattue, fatiguée, elle s’affermit davantage encore dans sa résolution. Il fallait qu’elle portât seule le poids de ses craintes, de même que, quelques jours auparavant, elle avait conservé en elle l’espoir que lui avait donné le prince Falnerra.
Comme, le dimanche matin, Mlle Luce était incapable de se rendre à l’église, Brigida déclara que « Claire » viendrait avec elle. La perspective n’avait rien d’agréable pour Ourida. Néanmoins, puisqu’il s’agissait d’accomplir son devoir dominical, elle se soumit sans murmurer à la corvée que représentait ce trajet en compagnie de la femme de charge.
Au début de la messe, Lionel apparut dans le banc du château, où avait pris place Brigida et la jeune fille. Sa présence parut fort pénible à Ourida, qui se félicita d’être séparée de lui par la femme de charge.
Il sortit le premier, quelques instants avant la fin de la messe, et, dehors, la jeune fille ne l’aperçut pas. Mais comme les deux femmes s’engageaient dans le sentier de la forêt, elles le virent qui les attendait...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
PROLOGUE
PREMIÈRE PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
DEUXIÈME PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Série 11: Ourida |3|
POUR L'AMOUR D'OURIDA
Ce roman fait suite à Salvatore Falnerra
et fin à la saga Ourida
DELLY
Série 11: Ourida |3|
POUR L'AMOUR D'OURIDA
roman
Raanan Editeur
Livre 625 | édition 1
PROLOGUE
Quelle tragique destinée que celle d’Ourida ! Son grand-oncle, le comte Marcien de Varouze, malade et incapable de lutter contre les manœuvres de sa seconde épouse Angelica, a recueilli les confidences de la fillette, à qui il promet aide et protection. Il l’assure de la délivrer de l’autorité méchante d’Angelica, de la soustraire à la surveillance despotique de Brigida, sa complice ; en un mot, le comte Marcien de Varouze s’engage à protéger Ourida et son frère Étienne, et aussi leur mère Medjine dont la santé chancelante est pour les deux enfants un souci constant. Tous les trois vivent à l’écart du château de la Roche-Soreix, dans une maison délabrée située à une centaine de mètres de la belle demeure. Ils sont l’objet d’une surveillance serrée de la part d’Angelica et de Brigida. Ourida subit des sévices de ces femmes qui la détestent. Même Lea, la fille de Marcien de Varouze et d’Angelica, ne l’aime pas. La préceptrice de Lea, la belle Mlle Luce de Francueil, est la seule amie d’Ourida.
Malgré la défense formelle d’Angelica, Ourida a donc pu rencontrer son grand-oncle. Elle lui a raconté les étapes de son déjà douloureux passé : la mort, à Alep, de son père, Gérault de Varouze, neveu du comte ; le voyage exténuant qui les ramena, sa mère, son frère et elle, de l’Orient en France où, selon les dernières volontés exprimées par son époux, Medjine devait venir frapper, en toute confiance, à la porte du château de la Roche-Soreix ; l’accueil glacial d’Angelica, qui mit tout en œuvre pour cacher à son mari leur présence. Le comte Marcien de Varouze se rend compte que l’intérêt seul guide sa cupide épouse ; c’est pour accaparer sa fortune à son profit et à celui de ses enfants, Lionel et Lea, qu’Angelica a voulu lui dissimuler l’existence, au château, de Medjine, d’Ourida et d’Étienne.
Malheureusement, les circonstances semblent favoriser les diaboliques manœuvres d’Angelica, impatiente d’entrer en possession de l’immense fortune de son mari. Elle y est aidée par Orso Manbelli, son cousin. Celui-ci enlève Étienne. Medjine ne survivra pas à sa douleur. Voilà Ourida seule, livrée sans défense aux griffes de la féroce Angelica. Une seule solution s’offre à elle : prévenir à la première occasion le comte Marcien de Varouze, laissé bien entendu par Angelica dans l’ignorance complète des faits, des tragiques événements. Le comte, qui sent ses forces diminuer chaque jour (sa femme lui fait verser du poison dans les potions), mis au courant par Ourida, rédige en sa faveur un testament qui stipule, en autres clauses, qu’Étienne deviendra à sa majorité le propriétaire du château de la Roche-Soreix. Ce testament est libellé sous le socle d’une statue posée sur la cheminée de la chambre du malade. Quelques jours plus tard, le comte Marcien de Varouze meurt.
Qu’est devenu Étienne ? Sous le nom de Michelino, il est entré au service du prince Salvatore Falnerra, dans son magnifique palais situé à une vingtaine de kilomètres de Palerme, en Sicile, après avoir travaillé durement chez des paysans pour le compte de Dorghèse, parent éloigné du prince Falnerra, dont il convoite la fortune.
Le prince, ami des arts, mécène à l’occasion, toujours à la recherche d’un talent, d’une jolie voix, car il adore la musique, prend en pitié le pauvre Michelino, dont l’histoire touchante émouvra son cœur. Il le confie à Lormès, son secrétaire, qui découvrira chez le jeune homme la qualité extraordinaire de sa voix. Michelino apprendra le chant et la musique. Salvatore Falnerra revient à Paris, où il retrouve les Varouze, – Angelica et sa clique, – qui ont quitté le château de la Roche-Soreix, en y laissant Ourida sous la surveillance de Mlle Luce de Francueil. Le prince se rappelle sa rencontre, au château de la Roche-Soreix, quelques années auparavant, avec Ourida – fillette alors – dont il avait découvert un matin, à l’improviste, la voix magnifique. Il décide de partir pour la retrouver. Et c’est une délicieuse jeune fille qui se présente à lui. Confiante, elle lui raconte sa désolante histoire, et le prince, ému par la situation d’Ourida, lui promet de lui venir en aide, de faire reconnaître sa véritable identité, c’est-à-dire sa parenté avec le comte Marcien de Varouze.
PREMIÈRE PARTIE
I
Ourida n’avait même pas la ressource de confier son anxiété à Mlle de Francueil. Celle-ci, complètement épuisée par le travail intensif de ces derniers jours, devait garder le lit. Sa vue, tout particulièrement, était en fort mauvais état. Mais elle n’avait pas les moyens de se rendre à Clermont pour consulter un oculiste. Mme de Varouze – sans doute afin de la tenir dans une plus stricte dépendance – s’abstenait depuis cinq ans de lui envoyer les cinquante francs mensuels qu’elle lui avait généreusement alloués. Le peu d’économies qui lui restait avait servi à payer quelques médicaments pour fortifier Ourida, un vêtement plus chaud ou des chaussures supplémentaires pour l’enfant qui souffrait du froid dans ce rude climat. Elle se trouvait donc maintenant sans ressources, au grand chagrin de la jeune fille qui se désolait de ne pouvoir rien pour elle.
– Oh ! si j’étais libre de travailler à mon compte, disait-elle avec une douloureuse impatience. Mais non, il faut que notre labeur profite à cette femme, qui vous tue ainsi à petit feu !
Mlle Luce hochait la tête sans répondre. Elle semblait plus froide, plus concentrée que jamais... Ourida en ressentit une impression fort pénible en ce moment où elle aurait eu tant besoin d’affection et de réconfort moral. Déjà décidée à ne pas faire partager son souci à cette femme abattue, fatiguée, elle s’affermit davantage encore dans sa résolution. Il fallait qu’elle portât seule le poids de ses craintes, de même que, quelques jours auparavant, elle avait conservé en elle l’espoir que lui avait donné le prince Falnerra.
Comme, le dimanche matin, Mlle Luce était incapable de se rendre à l’église, Brigida déclara que « Claire » viendrait avec elle. La perspective n’avait rien d’agréable pour Ourida. Néanmoins, puisqu’il s’agissait d’accomplir son devoir dominical, elle se soumit sans murmurer à la corvée que représentait ce trajet en compagnie de la femme de charge.
Au début de la messe, Lionel apparut dans le banc du château, où avait pris place Brigida et la jeune fille. Sa présence parut fort pénible à Ourida, qui se félicita d’être séparée de lui par la femme de charge.
Il sortit le premier, quelques instants avant la fin de la messe, et, dehors, la jeune fille ne l’aperçut pas. Mais comme les deux femmes s’engageaient dans le sentier de la forêt, elles le virent qui les attendait.
Cette fois, il salua Ourida en souriant le plus aimablement du monde.
– Un temps parfait, ce matin, n’est-ce pas, Claire ?
Elle répondit froidement :
– Très beau, en effet.
Il ne parut pas se froisser de l’accueil et, ayant écarté d’un signe Brigida, qui semblait de fort mauvaise humeur, il se mit à marcher près de la jeune fille. Tout d’abord, il parla du pays, de la forêt... Puis, voyant qu’Ourida lui répondait à peine, par monosyllabes, il dit avec un sourire câlin :
– Voyons, Claire, soyez un peu plus gentille !... Je n’ai que le désir de vous être agréable, soyez-en sûre.
– En ce cas, monsieur, je vous demanderai de me faire grâce de vos amabilités. Vous devriez comprendre qu’elles ne peuvent m’être que désagréables, venant du fils de Mme de Varouze.
Lionel feignit un étonnement presque scandalisé.
– Mme de Varouze !... votre bienfaitrice !... Oh ! Claire !...
Elle riposta, sur un ton d’amère ironie :
– Ma bienfaitrice... comme vous le dites avec tant de sincérité. Croyez bien que je lui accorde toute la reconnaissance qu’elle est en droit d’attendre de moi.
Cette fois, Lionel fut un instant démonté par cet accent et ces paroles. Mais, très vite, il se reprit et dit avec le ton doucereux qui rappelait si bien celui d’Angelica :
– Vous êtes une ingrate, ma petite Claire... mais une ingrate si délicieuse que je suis prêt à excuser chez elle beaucoup de choses.
Elle ne répondit rien et hâta le pas, ce qui lui amena cette observation de Brigida :
– Eh ! pas si vite ! Mes jambes ne vont pas de ce train-là ! Tu ne pourras toujours pas dire, après ça, que tu es fatiguée par le travail que je t’ai fait faire, car sans ça tu ne trotterais pas de cette manière !
Ah ! Ourida ne songeait guère en ce moment à sa fatigue physique, si écrasante pourtant, après ces deux journées de dur labeur et de pénibles soucis !... Elle voulait, avant tout, être délivrée de l’odieuse présence de ce Lionel, tellement semblable à sa mère, et plus détestable encore, lui semblait-il.
M. d’Artillac se taisait maintenant ; mais il regardait en dessous la jeune fille avec une expression qui l’aurait effrayée si elle en avait compris la signification.
Ourida eut un soupir de soulagement quand elle se vit dans la cour du château. Au moment où elle allait s’éloigner de Lionel et de Brigida pour regagner la maison de Mahault, le jeune homme se rapprocha d’elle en disant avec son plus caressant sourire :
– Au revoir, charmante Claire. J’aurai le plaisir de causer encore avec vous, et je suis bien certain que nous finirons par nous entendre.
Avant qu’Ourida eût pu s’en défendre, il avait saisi sa main et y appuyait ses lèvres.
Elle se dégagea violemment et s’éloigna, s’enfuit plutôt, car vraiment, elle courait presque. À la porte du vieux logis, elle s’arrêta un long moment. Son cœur battait avec force, l’indignation empourprait ses joues. Mépris, colère, secret effroi d’un danger qu’elle pressentait, sans pouvoir le définir, tout cela s’agitait en son âme. D’un geste répulsif, elle frottait contre sa jupe la main qu’avaient touchée les lèvres de Lionel. Mais il fallait qu’elle se calmât un peu, qu’elle composât son visage avant de paraître devant Mlle de Francueil. Elle n’y réussit pas très vite, et encore était-il heureux pour elle que les yeux de Mlle Luce fussent très fatigués, car celle-ci n’eût pas manqué de remarquer l’altération des traits charmants, l’expression soucieuse, préoccupée du regard.
Elle s’informa :
– Brigida n’a pas été trop désagréable, ce matin ?
– Pas plus qu’à l’habitude, mademoiselle.
Puis, dans la crainte que la femme de charge parlât à Mlle Luce de la présence de Lionel, la jeune fille ajouta, essayant de raffermir sa voix :
– M. d’Artillac était avec nous en revenant... Il m’a paru aussi antipathique, aussi faux que sa mère.
– Vous a-t-il parlé ?
– Oui... et j’ai dû lui faire comprendre que ses amabilités me déplaisaient fort.
Mlle Luce tressaillit légèrement et enveloppa la jeune fille d’un regard inquiet.
– A-t-il été... insolent ?
Voyant cette anxiété, Ourida ne voulut pas l’augmenter. Elle répondit en se forçant à sourire :
– Mais non, mademoiselle... un peu trop aimable seulement, à mon avis du moins, car enfin, je suis peut-être un peu sauvage... Et puis, je vous le répète, M. d’Artillac m’a paru fort déplaisant. Il ressemble tellement à sa mère !
Mlle de Francueil soupira et ferma les yeux. Ah ! quel souci la tourmentait, quand elle songeait à l’avenir de cette enfant trop belle pour laquelle il lui serait impossible d’être une protection, puisqu’elle n’était pas libre et que Mme de Varouze pouvait la lui enlever d’un moment à l’autre !
Ainsi, par exemple, que ce Lionel s’avisât de lui faire la cour, elle ne pourrait rien pour l’en empêcher... rien, rien, si la comtesse ne jugeait pas utile de s’opposer à cette fantaisie de son fils.
Sous ses draps, la malheureuse femme se tordit les mains. Ah ! quelle torture que cette impuissance, que cet esclavage, que cette sorte de complicité à laquelle il lui était impossible de se soustraire !
Ourida et elle souffraient ainsi un tourment secret, en essayant de se dérober l’une à l’autre leur préoccupation. La jeune fille vaqua à sa besogne habituelle dans leur modeste logis, en cette matinée dominicale où Brigida avait consenti à faire trêve au travail forcé dont elle accablait depuis deux jours sa victime. Mais tandis qu’elle allait et venait, rangeant, essuyant la poussière, la jeune fille poursuivait la solution d’un problème : comment arriver à savoir si le testament du comte de Varouze existait toujours ?
La veille, tandis qu’elle travaillait au château, elle avait entendu Brigida dire à la femme du concierge :
– Il faudra que j’ouvre l’appartement du défunt comte, demain, pour que M. Lionel puisse juger des arrangements à prendre. Sans doute fera-t-il disparaître une partie des meubles, qui sont vieux et certainement pas à son goût.
La jeune fille, inquiète, avait songé aussitôt :
« Il faudrait alors que j’y aille le plus tôt possible... car si on enlevait la statue, je ne saurais peut-être pas où elle serait mise ensuite. »
Elle avait donc décidé qu’elle tâcherait de gagner, cet après-midi, l’appartement du comte par la voie des caves. L’entreprise offrait des dangers, car elle pourrait tomber sur Brigida ou sur M. d’Artillac... mais cependant, elle en présentait moins encore que les deux expéditions semblables faites autrefois par la petite Ourida, à une époque où le château était habité par plusieurs maîtres et cinq ou six domestiques, où le comte de Varouze était l’objet d’une grande surveillance de la part de sa femme et de son valet de chambre. En ce moment, personne ne logeait dans cette partie de l’habitation. Il y avait donc toutes chances pour qu’Ourida ne fût pas troublée dans son investigation.
« Il faut que je le fasse... il le faut ! se répétait la jeune fille. Comme cela, je pourrai renseigner à ce sujet le prince Falnerra, quand il me sera possible de le voir. »
Brigida ne parut pas dans la matinée. Elle vint seulement après le déjeuner, grommela en voyant Mlle Luce au lit, et ne souffla mot de Lionel. D’ailleurs, elle semblait d’humeur particulièrement revêche et jetait à Ourida des regards chargés de la plus noire malveillance.
– Demain, tu seras à cinq heures à la porte du château et tu attendras là que je vienne t’ouvrir, lui jeta-t-elle en quittant le logis.
Vers trois heures, voyant Mlle de Francueil disposée à s’assoupir, Ourida songea à mettre son projet à exécution.
– Si vous n’avez pas besoin de moi, j’irai un peu dans le parc, chère mademoiselle, dit-elle à sa compagne.
– Oui, oui, allez, mon enfant... tâchez de bien vous remettre aujourd’hui des fatigues de ces derniers jours... pour mieux affronter les fatigues de demain.
La jeune fille avait préparé un morceau de bougie et des allumettes. Elle s’en munit et gagna les caves. L’expédition lui apparaissait plus difficile qu’autrefois, quand elle n’était qu’une enfant sans expérience. Puis elle se demandait anxieusement :
« L’ouverture du couloir ne s’est-elle pas bouchée, par suite de quelque éboulement, depuis lors ? »
Non, elle existait toujours, et même un déplacement de la terre l’avait quelque peu agrandie. Ourida passa assez facilement et, sans encombre, atteignit la pièce qui servait de resserre au rez-de-chaussée du château.
Tout était silence, dans cette salle et aux alentours. Ourida, le cœur battant, monta doucement l’escalier qui conduisait au premier étage. Elle arriva au vestibule carré sur lequel ouvraient les appartements de la comtesse et du défunt comte.
Là encore, on n’entendait aucun bruit. Ourida se glissa jusqu’à la porte du fumoir. C’était le moment critique. S’il y avait quelqu’un là ?...
Elle écouta un moment. Rien ne bougeait. D’une main qui tremblait, elle tourna doucement le bouton. La porte s’ouvrit. Lentement, Ourida en écarta le battant, passa la tête dans l’entrebâillement. La pièce était déserte.
Elle entra, s’avança vers la portière, jeta un coup d’œil dans la chambre. Là, également, il n’y avait personne.
Alors elle s’avança délibérément, marcha jusqu’à la cheminée, prit entre ses mains la statue de la justice... et la renversa...
Le testament était là encore... Elle le lut... et des larmes emplirent ses yeux au souvenir du malade... du prisonnier qui avait écrit ces lignes. Pauvre oncle, quelles souffrances, quelles angoisses laissait deviner sa physionomie, à cette seconde entrevue avec la fille de son cher Gérault !
Mais elle ne devait pas s’attarder ici. Vivement, elle reposa la statue sur la cheminée, puis regagna le fumoir.
Au moment où elle y entrait, un bruit de pas et de voix se fit entendre vers le vestibule. D’un regard plein de détresse, elle chercha un refuge. Devant l’une des fenêtres retombaient les lourds rideaux de vieux brocart... Ourida se précipita de ce côté, disparut derrière l’un d’eux.
Il était temps. Sur le seuil du fumoir apparaissaient M. d’Artillac et Brigida.
– Allons, choisis là-dedans ce que tu veux garder, dit la femme de charge. Je ferai porter le reste dans une des chambres du second.
– Oh ! ici, je ne veux que ces tableaux, qui me paraissent assez bons... et ces rideaux, qui sont fort beaux.
Lionel s’approcha, tâta l’étoile superbe. Ourida crut que son cœur cessait de battre...
M. d’Artillac fit quelques pas en arrière, inspecta encore la pièce autour de lui et dit avec dédain :
– Le reste ne me plaît pas. Je ferai meubler ça en style Renaissance... quelque chose de très bien.
– Oh ! c’est que tu aimes le beau, mon petit Lionel !
– Eh ! oui... C’est pourquoi la petite Claire m’a donné si fortement dans l’œil. Quelle merveille !... C’est à rendre fou l’homme le plus raisonnable ! Aussi, ma vieille Brigida, sois sûre qu’elle sera à moi, de gré ou de force.
Brigida marmotta, d’un ton de mauvaise humeur :
– Il faudrait savoir ce que ta mère dirait de ça !
Lionel eut un rire d’ironie.
– Que veux-tu que cela lui fasse ?... Au contraire, j’entrerai peut-être ainsi dans ses vues. La jeune personne sera plus souple, quand elle comprendra que nous tenons dans nos mains sa réputation.
– À moins, au contraire, comme je te le disais hier, qu’elle ne devienne plus insupportable encore, quand elle verra que tu t’occupes d’elle et que tu fais semblant de l’aimer.
Lionel ricana légèrement.
– Faire semblant ?... Mais, Brigida, elle est bien assez délicieuse pour que je l’aime très réellement ! Quant à tes craintes, elles sont tout à fait vaines. Je me charge de mater Claire, au cas où elle aurait des velléités de révolte.
Puis, comme la femme de charge grommelait encore, il ajouta d’un ton insinuant :
– Allons, sois gentille, et aide-moi au contraire à apprivoiser cette petite. Je me porte garant que ma mère n’en sera aucunement mécontente.
– Bon, bon, nous verrons... Mais, tu sais, je me méfie de cette Claire ! Angelica aurait bien fait de suivre mon conseil... de se débarrasser d’elle, après la mort de sa mère. Il est à craindre qu’elle soit obligée d’en arriver là, un jour ou l’autre, car il n’y a que les morts qui ne parlent pas, qui ne réclament pas.
– Bah ! nous avons le temps de songer à ça... en admettant qu’il faille envisager cette extrémité. Pour le moment, Claire me plaît furieusement, voilà toute la question... et tu auras beau dire, Brigida...
La femme de charge l’interrompit d’un ton où l’indulgence luttait contre la mauvaise humeur :
– Ça te regarde, mon petit Lionel... et tu t’arrangeras avec ta mère. Viens maintenant voir la chambre d’à côté. Je ne crois pas que tu conserves grand-chose, en fait de meubles. Mais il y a d’assez belles choses, en dehors de cela... par exemple, la pendule, les deux statues qui sont sur la cheminée...
Ils entrèrent dans la pièce voisine, et la portière retomba derrière eux.
Alors Ourida se glissa hors de l’embrasure de la fenêtre, puis hors du fumoir, par la porte restée ouverte sur le vestibule. Elle s’enfuit vers l’escalier, gagna les caves du château et, de là, celles du vieux logis. Là seulement, elle s’arrêta, haletante. Et l’énergie qui l’avait soutenue jusqu’ici l’abandonnant un instant, elle s’affaissa, les jambes fléchissantes, sur le sol dur.
Elle avait écouté avec terreur l’entretien des deux misérables complices de la comtesse. Bien que, dans son inexpérience, elle ne pût comprendre toute la portée des paroles de Lionel, l’instinct de son âme délicate lui avait fait sentir là un danger terrible, plus terrible, pour elle, que celui qu’évoquait cette sinistre phrase de Brigida : « Il n’y a que les morts qui ne parlent pas, qui ne réclament pas. » Frémissante, éperdue, elle songeait : « Il ne faut pas que je reste ici... Mlle Luce ne peut pas me protéger... Je vais partir, le plus tôt possible. »
Partir ? Pour aller où ?
Dans sa détresse, un seul nom, un seul visage surgissaient : don Salvatore ! Elle ne voyait que lui qui pût la défendre, la préserver des intrigues de ses ennemis.
Il avait dit qu’il habitait en ce moment le château d’Aigueblande, près de Châtel-Sablon, à trente kilomètres d’ici. Eh bien ! elle s’enfuirait cette nuit de la Roche-Soreix, par l’ouverture qui avait permis au prince de pénétrer dans le parc ; elle s’en irait à pied, demandant sa route. Ah ! elle se traînerait plutôt, pour atteindre ce but, pour échapper à Lionel qui en cet instant représentait pour elle un ennemi bien plus effrayant que sa mère et Brigida !
Cette résolution prise, Ourida se releva, ayant recouvré toute son énergie. Le plus pénible, pour elle, était de quitter Mlle de Francueil, surtout en l’état de santé précaire qui était maintenant le sien. Mais la pauvre demoiselle ne pouvait rien pour la protéger du péril, et Ourida, l’ayant vue autrefois éluder les confidences que l’orpheline malheureuse, isolée, aurait été heureuse de lui faire, n’avait même pas aujourd’hui la pensée de lui demander conseil en cette occurrence où cependant elle en aurait eu tant besoin. Un instinct l’avertissait que Mlle Luce ne « pouvait » pas approuver son projet de fuite et que son intérêt serait même de le contrecarrer.
« Quand j’aurai ma liberté d’action, pensa la jeune fille, et aussi la part de fortune qui me revient, je m’emploierai, en même temps que je rechercherai mon petit Étienne, à délivrer cette pauvre femme de cette étrange servitude en laquelle la tient Mme de Varouze. Peut-être n’y a-t-il là qu’une question d’argent, une somme qu’elle doit à la comtesse et qu’elle est incapable de payer... »
En songeant ainsi, Ourida regagna le rez-de-chaussée de la vieille maison. Mlle de Francueil sommeillait. La jeune fille en profita aussitôt pour faire ses préparatifs de départ, bien succincts, d’ailleurs. Une grande mante pour l’envelopper, un peu de linge dans un petit panier, c’était tout ce qu’emportait du domaine de ses pères la fille de Gérault. Elle écrivit aussi à l’intention de Mlle Luce ces quelques lignes :
« Je suis obligée de partir, chère mademoiselle, car je sens que de grands dangers me menacent. Pardonnez-moi de vous quitter ainsi. Mais j’ai voulu vous épargner tout ennui à cause de moi. Toujours, je resterai reconnaissante de vos soins excellents, de tout ce que je vous dois, pour ces neuf années passées près de vous. Que Dieu me permette de vous le rendre un jour ! »
Elle ne signa point, car elle ne voulait pas mettre ce nom menteur de Claire, et Mlle Luce ne connaissait pas, ou ne « voulait » pas connaître celui d’Ourida.
Après quoi, elle fit quelques rangements pour que tout fût bien en ordre après son départ ; elle s’ingénia à préparer le nécessaire pour le lendemain, afin que Mlle Luce ne se fatiguât pas. Son cœur se serrait, des larmes montaient à ses yeux, tandis qu’elle s’occupait ainsi. Elle avait de l’affection pour cette femme dont l’apparente froideur cachait peut-être un cœur déchiré, une âme brisée par quelque mystérieuse épreuve, pour cette femme qui, seule ici, avait été bonne pour elle et lui avait donné de solides leçons intellectuelles et morales. Il lui en coûtait beaucoup de la quitter de cette manière. Mais il le fallait. Le danger était apparu à Ourida trop terrible, et trop proche, pour qu’elle pût hésiter à fuir cette demeure où elle avait déjà tant souffert.
II
Ce soir-là, profitant d’un moment d’assoupissement de Mlle Luce, Ourida put se glisser dans son lit tout habillée. Il était huit heures et demie et, à cette époque, la nuit n’était pas encore complète. La jeune fille avait eu soin de laisser largement entrebâillée la porte qui faisait communiquer la chambre avec la salle à manger. Elle avait fait de même pour la porte d’entrée. Aussi n’eût-elle aucune peine à sortir quand, au milieu de la nuit, ayant entendu Mlle Luce ronfler légèrement, elle se glissa, toute frémissante, hors de son lit. Quelques instants plus tard, elle était dans les jardins. Un mince croissant de lune lui donnait une clarté juste suffisante pour se guider. Elle gagna ainsi le parc, longea la clôture, arriva à l’endroit dont lui avait parlé le prince. Là, elle passa facilement et se trouva dans la forêt.
Pour retrouver le sentier qui, du château, descendait à Champuis, il lui fallait longer à gauche cette clôture. Cela se fit sans encombre, et, de même, elle s’engagea dans le sentier. Mais à mi-chemin, elle s’arrêta. Il y avait probablement encore plusieurs heures de nuit, – car elle n’avait pas de montre pour la fixer sur ce point, – et, pour prendre la route de Châtel-Sablon, il fallait auparavant qu’elle se renseignât sur cette direction. Or, elle ne le pouvait avant le jour, alors que les logis campagnards s’éveilleraient, que les travailleurs se rendraient aux champs. Il était donc préférable de s’arrêter dans la forêt, où elle serait mieux cachée qu’aux alentours du village.
Elle s’enfonça un peu sous bois et s’assit au pied d’un arbre. Dans cette solitude, dans le silence que troublaient seuls quelques bruissements d’insectes, quelques chutes de feuilles, la pauvre enfant frissonnait, en dépit de tout son courage. Et elle songeait : « Ô ma chère maman, toi qui me vois de là-haut, protège ta petite Ourida ! demande à Dieu, pour elle, qu’elle échappe au péril, qu’elle arrive au but. »
Les heures lui semblèrent interminables. Elle ne voulait pas céder à l’engourdissement qui la gagnait, après la fatigue des jours précédents et les émotions de cette journée. Pour s’encourager, elle tendait toute sa pensée vers don Salvatore, le refuge et le salut. Il lui semblait que, près de lui, elle n’aurait plus rien à redouter. Car, pas un instant, elle n’avait l’idée qu’il pût la mal accueillir. Toute sa confiance, tout son espoir allaient ardemment, ingénument vers ce noble étranger qui lui était apparu comme un prince de contes de fées, un Prince charmant tel que la petite solitaire de la Roche-Soreix n’en avait jamais rêvé.
Enfin l’aube parut. Ourida se remit en marche. Elle atteignit bientôt le village, mais, voulant l’éviter, elle prit une route au hasard, avec l’intention de demander son chemin dès qu’elle le pourrait.
Sur le seuil d’une ferme, une femme parut, en camisole, les cheveux emmêlés. Ourida s’approcha et demanda :
– Pourriez-vous me dire, madame, si je suis sur la route de Châtel-Sablon ?
– Châtel-Sablon ?... Je ne sais pas... Mais je vais demander à mon mari, qui connaît le pays assez loin, rapport aux foires.
Elle revint peu après et informa Ourida qu’il lui fallait continuer sur cette voie pendant un peu de temps, puis prendre une route à gauche. Ensuite, elle demanderait encore son chemin, car elle n’était pas près d’arriver, pour sûr...
En parlant ainsi, la femme considérait curieusement cette étrangère enveloppée dans sa vieille cape, chaussée de souliers très usés et qui dissimulait son visage sous un épais voile gris.
Ourida remercia et continua sa route. Dans la fraîcheur de l’aube et après le repos pris dans la forêt, elle sentait moins sa fatigue. Mais celle-ci commença de l’accabler dès que le soleil chauffa la campagne. Cependant, courageusement, elle allait... allait toujours. À midi seulement, elle s’arrêta dans un pré, au bord d’un ruisseau pour manger un morceau de pain qu’elle avait gardé, la veille au soir. C’était sa subsistance pour toute la journée.
Elle résolut de demeurer là une heure pour reprendre quelques forces. Mais quand elle se leva, elle chancelait de faiblesse et d’accablante lassitude. Le travail intensif auquel l’avait soumise Brigida, les veilles de la semaine précédente, pour achever les broderies exigées par la comtesse, le manque à peu près complet de nourriture, aujourd’hui, et cette marche à laquelle son existence de recluse ne l’avait pas habituée, tout concourait pour enlever ses dernières forces à un organisme déjà affaibli par une alimentation insuffisante, par des préoccupations morales datant de tant d’années.
Néanmoins, en se raidissant, la jeune fille se remit en marche. Le soleil, à cette heure, brûlait la route, qui s’allongeait entre de verts pâturages, au-delà desquels s’élevaient les collines couvertes de bois de hêtres. Ourida songeait, désespérément : « Je ne puis plus... je ne puis plus... » Et cependant, elle avançait toujours, en se traînant, comme une malheureuse biche qui, près d’expirer, essaye encore de mettre un peu plus de distance entre les chasseurs et elle.
Une charrette passa près de la jeune fille. Elle était conduite par un paysan d’un certain âge, près duquel se trouvait assise une femme au visage rond et rougeaud, coiffée du bonnet des paysannes d’Auvergne. Comme, à ce moment, la route commençait de monter, le cheval ralentit le pas, et Ourida se trouva à la hauteur du rustique équipage. Elle remarqua alors la physionomie ouverte et honnête de la femme qui la regardait avec quelque curiosité. Une idée lui vint aussitôt. Élevant la voix, elle demanda :
– Pardon, madame, iriez-vous par hasard du côté de Châtel-Sablon ?
– Du côté, oui... mais pas jusque-là. Nous nous arrêtons à la Volande... Qu’est-ce qu’il y aurait pour votre service, ma petite dame ?... Ce serait-il que vous voulez monter dans notre voiture pour ménager vos jambes ?
– S’il vous plaît, je vous en serais bien reconnaissante... Mes forces sont à bout...
– On ne vous refusera pas ça, bien sûr... Arrête un peu, Saturnin, que cette dame monte...
Non sans peine, Ourida, avec l’aide de la fermière, se hissa dans la charrette et s’installa sur la banquette, entre deux paniers d’œufs et de beurre. Mais à peine la voiture s’était-elle remise en marche que la jeune fille se sentit défaillir. Vivement, la fermière lui enleva son voile, lui frappa dans les mains, tout en murmurant avec une surprise admirative :
– Est-elle jolie !... Seigneur ! est-elle jolie !... Vois donc, Saturnin. Mais qu’elle est pâle ! Pauvre mignonne, ça fait pitié !
Au bout d’un moment, Ourida revint à elle et remercia d’un léger sourire la brave femme qui la considérait avec compassion.
– Je vous demande pardon, madame, de vous donner tout cet ennui...
– Bah ! qu’est-ce que c’est que ça !... Vous vous êtes sans doute trop fatiguée, ma pauvre petite !... Et comme vous avez chaud !
– Oui... et je suis très peu forte. Mais, je vous en prie, continuez... Je ne voudrais pas vous retarder...
– Oh ! quelques minutes de plus ou de moins... Allons, repars, Saturnin !
Le paysan, qui avait une figure tranquille et aussi honnête que celle de sa compagne, remit en marche son cheval. Pour abriter quelque peu du soleil la jeune fille, l’excellente fermière lui avait fait une sorte de large coiffe avec un journal. Ourida se sentait très faible, mais elle éprouvait un réconfort, un apaisement à se trouver près de ces braves gens. De plus, au bout d’un kilomètre, la route passait entre des bois, des escarpements rocheux qui répandaient une ombre fort appréciable. Quand elle se sentit un peu remise, Ourida s’informa de la distance qui lui restait à parcourir, une fois à la Volande, pour gagner Châtel-Sablon.
– Ça fera bien huit bons kilomètres, à mon avis, répondit la fermière. Est-ce que vous auriez idée d’aller jusque-là aujourd’hui ?
– Il le faut bien... Je ne puis m’arrêter en route...
La femme hocha la tête.
– Ça, ma petite demoiselle, je vous dis que vous ne pourrez pas le faire... On voit bien que vous êtes tout au bout de vos forces.
Hélas ! elle s’en rendait bien compte, pauvre Ourida ! Elle songeait avec terreur :
« Que vais-je devenir, seule, sans argent, si je ne puis continuer mon chemin ? »
La fermière, qui voyait se refléter cette angoisse sur le joli visage, dit avec sympathie :
– Écoutez, peut-être y aurait-il moyen d’arranger ça. J’ai des cousins, à la Volande... des braves gens qui seront contents de vous rendre service. Peut-être bien qu’ils connaîtront quelqu’un allant vers Châtel-Sablon et qui accepterait de vous emmener.
– Oh ! j’en serais bien heureuse !
Puis, rougissant un peu, Ourida ajouta :
– Mais je n’ai pas d’argent... pour le moment, du moins.
– Ne vous embarrassez pas de ça, ma jolie demoiselle. Ces petits services-là, on les rend avec plaisir, dans nos campagnes.
Un peu rassurée, Ourida ferma les yeux et, engourdie par la fatigue, se laissa cahoter sur la route assez mal entretenue. À la Volande, la fermière la conduisit chez sa cousine, Marie Simon, femme du forgeron de l’endroit. Celle-ci promit de s’informer si quelque habitant de Châtel-Sablon ou des proches alentours se trouvait à la Volande. En attendant, Ourida fut invitée à entrer dans une petite salle sombre et fraîche, très proprement tenue. Mme Simon proposa :
– Vous allez bien boire quelque chose, mademoiselle ? Par ce temps chaud, on a grand-soif...
Ourida refusa en rougissant de nouveau. Et pourtant, combien elle était altérée, en effet, la pauvre enfant !
Mais la fermière, qui la regardait attentivement, dit avec autorité à sa cousine :
– Si fait, Marie, donne-lui quelque chose de bon et de réconfortant... Ce qui la gêne, cette pauvre petite demoiselle, c’est qu’elle n’a pas de quoi te payer. Mais, Dieu merci, on a coutume de rendre service au prochain, dans notre famille... Et elle mangerait bien aussi quelque chose, j’en suis sûre ?
Ourida essaya de protester. Mais déjà Mme Simon avait disparu. Elle revint peu après, apportant un bol de lait, du café, du beurre.
La fermière prit alors congé de sa protégée, qui la remercia chaleureusement.
– Dites-moi votre nom ? demanda Ourida. Si, plus tard, je passais de ce côté, j’irais vous faire une petite visite.
– Mélanie Chambon, à la Grangelière... Pour sûr que je serai bien contente de vous revoir, mademoiselle !
Ourida était si accablée par la faiblesse et la fatigue qu’elle put seulement boire le lait préparé par l’obligeante Marie. Celle-ci, visiblement apitoyée par la mine de la jeune fille, l’installa dans un fauteuil de paille avec un tabouret sous les pieds, puis elle retourna à ses occupations. Mais un peu après, elle vint avertir Ourida que la Méjan, une fermière des environs de Châtel-Sablon, partirait de la Volande à cinq heures pour retourner chez elle et qu’elle acceptait d’emmener la jeune étrangère.
Après cela, dans la pièce fraîche et silencieuse, la fugitive somnola, jusqu’au moment où la femme du forgeron vint la prévenir que la fermière attendait.
En dépit des protestations de la jeune fille, Marie Simon mit dans son panier un paquet contenant deux tartines beurrées et un morceau de fromage.
– Les Méjan sont des gens honnêtes, mais très regardants, lui confia-t-elle, et il est bien possible qu’ils ne songent pas à vous offrir à souper. Alors, comme ça, vous aurez de quoi manger avant de monter jusqu’à Aigueblande.
La Méjan était une grosse femme entre deux âges, dont la mine sournoise déplut aussitôt à Ourida. Elle dévisagea curieusement la voyageuse, qui s’était à nouveau enveloppée de son voile. Et une fois en route, elle commença de la questionner, insidieusement.
Ainsi, elle allait à Aigueblande ? Un bien beau château, où le nouveau maître avait dû dépenser joliment d’argent ! Mais on le disait si riche, ce prince Falnerra ! Et il y avait un train, là-dedans !... Des domestiques, des voitures. Encore on prétendait que le prince en avait laissé une grande partie à Paris...
– Ah ! dame, c’est un grand personnage ! et un fameux beau garçon ! Hier, à l’église, il était dans le banc des anciens seigneurs d’Aigueblande... et je vous assure que toutes les femmes n’avaient d’yeux que pour lui !
Puis, avec un petit sourire entendu, la fermière ajouta :
– Mais vous le connaissez sans doute, mademoiselle ?
Froissée par l’indiscrète curiosité de cette femme, désagréablement impressionnée par ce quelque chose d’indéfinissable pour elle qui existait dans ses paroles, dans son accent, dans le regard de ses yeux narquois, Ourida répondit froidement :
– Un peu, oui, madame.
– Et comme ça, vous allez chez lui ?
– Certainement.
La brièveté de la réponse, l’air lassé de la jeune fille n’invitaient pas à continuer les questions. La Méjan se tut en couvrant la jeune fille d’un regard d’ironique malveillance.
Il fallait deux heures pour atteindre Châtel-Sablon, car la route montait et elle était en outre passablement mauvaise. La montre de la Méjan marquait plus de sept heures, quand le char à bancs s’arrêta devant les bâtiments d’une ferme qui semblait assez mal tenue.
– Vous voilà tout près de Châtel-Sablon, dit la Méjan. Tenez, on voit les premières maisons du village, derrière ces arbres... Mais vous n’avez pas besoin d’aller jusque-là. Prenez ce petit chemin, à gauche... Vous arriverez à une route, pas très large, mais assez bonne. C’est celle que le prince a fait faire l’année dernière pour arriver plus facilement à Aigueblande... Vous n’aurez qu’à monter, tout droit, et vous atteindrez le château.
Ourida descendit de voiture, remercia poliment, mais sans chaleur et s’engagea dans le chemin désigné, d’un pas chancelant.





























