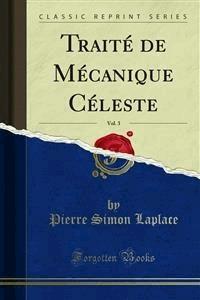Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
L’Astronomie, par la dignité de son objet et par la perfection de ses théories, est le plus beau monument de l’esprit humain, le titre le plus noble de son intelligence. Plusieurs siècles de travaux ont fait tomber le voile sur le système du monde.
Ce Précis de l’histoire de l’astronomie offre trois périodes bien distinctes, qui, se rapportant aux phénomènes, aux lois qui les régissent et aux forces dont ces lois dépendent, nous montrent la route que cette science a suivie dans ses progrès et que les autres sciences naturelles doivent suivre à son exemple. La première période embrasse les observations des astronomes antérieurs à Copernic sur les apparences des mouvements célestes, et les hypothèses qu’ils ont imaginées pour expliquer ces apparences et pour les soumettre au calcul. Dans la seconde période, Copernic déduit de ces apparences les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, et Kepler découvre les lois des mouvements planétaires. Enfin, dans la troisième période, Newton, en s’appuyant sur ces lois, s’élève au principe de la gravitation universelle ; et les géomètres, appliquant l’Analyse à ce principe, en font dériver tous les phénomènes astronomiques et les nombreuses inégalités du mouvement des planètes, des satellites et des comètes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pierre-Simon Laplace, comte Laplace, puis 1er marquis de Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge et mort le 5 mars 1827 à Paris, est un mathématicien, astronome, physicien et homme politique français.
Laplace est l'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne. Il a apporté des contributions fondamentales dans différents champs des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des probabilités. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de son temps, notamment par son affirmation du déterminisme. Il a contribué de façon décisive à l'émergence de l'astronomie mathématique, reprenant et étendant le travail de ses prédécesseurs dans son "Traité de Mécanique céleste" (1799-1825). Cet ouvrage majeur, en cinq volumes, a transformé l'approche géométrique de la mécanique développée par Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique.
En 1799, il est nommé ministre de l'Intérieur sous le Consulat. Napoléon Ier, son ancien élève en 1785 à l'âge de 16 ans pour un examen, lui confère, une fois empereur, le titre de comte d'Empire en 1808. En 1817 il est fait marquis par Louis XVIII, après la restauration des Bourbons
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Précis de l’histoire de l’Astronomie.
Précis de l’histoire de l’Astronomie
L’astronomie tient la primauté parmi les sciences : tous ceux qui ont essayé de présenter une classification philosophique de nos diverses connaissances lui ont accordé sans réserve cette suprématie que le sentiment populaire a depuis longtemps consacrée. Tandis que les autres sciences ont pour théâtre étroit la terre et ne s’occupent que des corps inorganiques ou organisés qui s’y rencontrent, l’astronomie étudie la planète dans ses rapports avec le reste de l’univers, elle nous fait pénétrer à la fois dans l’infini de l’espace et dans l’infini du temps. Notre globe n’est pour l’astronomie qu’une chétive unité dans le nombre illimité des corps célestes ; nous jetant hors des bornes de l’univers visible, elle nous permet de découvrir des mondes nouveaux par-delà ceux qui illuminent le firmament. Si la raison pure conçoit spontanément l’infini, l’astronomie est l’unique science qui puisse nous fournir des impressions capables de traduire cette grande et presque effrayante pensée. Aussi est-elle la science favorite des philosophes, qui ne se lassent point de lui emprunter des comparaisons, des arguments et des images. Par le côté pratique, elle se mêle à tous les détails de notre vie, puisqu’elle nous apprend à mesurer l’étoffe dont toutes nos actions sont faites, le temps. Qui nous fournit les notions à l’aide desquelles nous nous orientons ? Le soleil et le monde étoilé. Imaginez un instant que nous n’ayons ni nord, ni sud, ni orient, ni occident : comment la navigation sera-t-elle possible, partant le commerce, les voyages, tout ce que l’homme gagne en changeant simplement de place sur notre globe ?
L’astronomie est de plus le centre et l’âme de tout mouvement scientifique ; c’est elle qui a suscité les plus grands progrès de la physique, qui a présidé de tout temps au développement des mathématiques. Les observatoires sont ainsi les véritables temples de la science : dans ces retraites silencieuses et fermées au vulgaire se poursuit la nuit comme le jour l’éternelle étude de la nature sidérale ; des générations d’observateurs patients s’y transmettent d’âge en âge les nombres énigmatiques avec lesquels ils écrivent l’histoire du monde…
La place que tient l’astronomie parmi les objets de notre vénération est si élevée, que les astronomes nous paraissent d’habitude plus grands que les autres savants. Combien de noms, même parmi les plus illustres, ne fait point pâlir celui de Galilée ou de Newton ? De telles gloires ont en partage quelque chose de l’immobilité et de l’éternité des phénomènes sur lesquels ces grands génies se sont exercés. Pendant la ferveur de la jeunesse, celui qui étudie les sciences se figure volontiers l’astronome comme un sage, vivant loin des hommes, absorbé dans la contemplation des phénomènes célestes, sans autre passion que la recherche des vérités éternelles.
(Auguste Laugel,
L’Astronomie aux États-Unis).
Précis de l’histoire de l’astronomie.{1}
CHAPITRE I.
De l’astronomie ancienne, jusqu’à l’époque de la fondation de l’École d’Alexandrie.
Le spectacle du ciel dut fixer l’attention des premiers hommes, surtout dans les climats où la sérénité de l’air invitait à l’observation des astres. On eut besoin pour l’agriculture de distinguer les saisons et d’en connaître le retour. On ne tarda pas à s’apercevoir que le lever et le coucher des principales étoiles, au moment où elles se plongent dans les rayons solaires ou quand elles s’en dégagent, pouvaient servir à cet objet. Aussi voit-on chez presque tous les peuples ce genre d’observations remonter jusqu’aux temps dans lesquels se perd leur origine. Mais quelques remarques grossières sur le lever et sur le coucher des étoiles ne formaient point une science, et l’Astronomie n’a commencé qu’à l’époque où, les observations antérieures ayant été recueillies et comparées entre elles, et les mouvements célestes ayant été suivis avec plus de soin qu’on ne l’avait fait encore, on essaya de déterminer les lois de ces mouvements. Celui du Soleil dans un orbe incliné à l’équateur, le mouvement de la Lune, la cause de ses phases et des éclipses, la connaissance des planètes et de leurs révolutions, la sphéricité de la Terre et sa mesure ont pu être l’objet de cette antique Astronomie ; mais le peu qui nous reste de ses monuments est insuffisant pour en fixer l’époque et l’étendue. Nous pouvons seulement juger de sa haute antiquité par les périodes astronomiques qui nous sont parvenues, et qui supposent une suite d’observations d’autant plus longue que ces observations étaient plus imparfaites. Telle a été la vicissitude des choses humaines, que celui des arts qui peut seul transmettre à la postérité d’une manière durable les événements des siècles écoulés, l’imprimerie, étant d’une invention moderne, le souvenir des premiers inventeurs s’est entièrement effacé. De grands peuples ont disparu sans laisser sur leur passage des traces de leur existence. La plupart des cités les plus célèbres de l’antiquité ont péri avec leurs annales et avec la langue même que parlaient leurs habitants ; à peine reconnaît-on la place où fut Babylone. De tant de monuments des arts et de l’industrie qui décoraient ces cités et qui passaient pour les merveilles du monde, il ne reste plus qu’une tradition confuse et des débris épars dont l’origine est le plus souvent incertaine, mais dont la grandeur atteste la puissance des peuples qui ont élevé ces monuments.
Il paraît que l’Astronomie pratique des premiers temps se bornait aux observations du lever et du coucher des principales étoiles, de leurs occultations par la Lune et par les planètes, et des éclipses. On suivait la marche du Soleil au moyen des étoiles qu’effaçait la lumière des crépuscules, et par les variations des ombres méridiennes des gnomons ; on déterminait les mouvements des planètes par les étoiles dont elles s’approchaient dans leurs cours. Pour reconnaître tous ces astres et leurs mouvements divers, on partagea le ciel en constellations, et cette zone céleste nommée Zodiaque, dont le Soleil, la Lune et les planètes alors connues ne s’écartaient jamais, fut divisée dans les douze constellations suivantes :
Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, l’Écrevisse, le Lion, la Vierge ;La Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons.
On les nomma signes, parce qu’elles servaient à distinguer les saisons ; ainsi l’entrée du Soleil dans la constellation du Bélier marquait, au temps d’Hipparque, l’origine du printemps ; cet astre parcourait ensuite le Taureau, les Gémeaux, l’Écrevisse, etc. Mais le mouvement rétrograde des équinoxes changea, quoiqu’avec lenteur, la correspondance des constellations avec les saisons, et à l’époque de ce grand astronome elle était déjà fort différente de celle que l’on avait établie à l’origine du zodiaque. Cependant l’Astronomie, en se perfectionnant, ayant eu besoin de signes pour indiquer le mouvement des astres, on continua de désigner, comme Hipparque, l’origine du printemps par l’entrée du Soleil dans le Bélier. Alors on distingua les constellations des signes du zodiaque, qui ne furent plus qu’une chose fictive, propre à indiquer la marche des corps célestes. Maintenant que l’on cherche à tout ramener aux notions et aux expressions les plus simples, on commence à ne plus considérer les signes du zodiaque, et l’on marque la position des astres sur l’écliptique par leur distance à l’équinoxe du printemps.
Les noms des constellations du zodiaque ne leur ont point été donnés au hasard ; ils ont exprimé des rapports qui ont été l’objet d’un grand nombre de recherches et de systèmes. Quelques-uns de ces noms paraissent être relatifs au mouvement du Soleil : l’Écrevisse, par exemple, et le Capricorne indiquent la rétrogradation de cet astre aux solstices, et la Balance désigne l’égalité des jours et des nuits à l’équinoxe ; les autres noms semblent se rapporter à l’agriculture et au climat du peuple chez lequel le zodiaque a pris naissance. Le Capricorne ou la constellation de la Chèvre paraît mieux placée au point le plus élevé de la course du Soleil qu’à son point le plus bas. Dans cette position, qui remonte à quinze mille ans, la Balance était à l’équinoxe du printemps, et les constellations du zodiaque avaient des rapports frappants avec le climat de l’Égypte et avec son agriculture. Tous ces rapports subsisteraient encore si les constellations du zodiaque, au lieu d’avoir été nommées d’après leur lever avec le Soleil ou au commencement du jour, l’eussent été d’après leur lever à l’entrée de la nuit, si, par exemple, le lever de la Balance à ce moment eût indiqué le commencement du printemps. L’origine du zodiaque, qui ne remontrerait alors qu’à deux mille cinq cents ans avant notre ère, s’accorde beaucoup mieux que la précédente, avec le peu que nous savons, de l’antiquité des sciences et spécialement de l’Astronomie.
Les Chinois sont de tous les peuples celui dont les annales nous offrent les plus anciennes observations que l’on puisse employer dans l’Astronomie. Les premières éclipses dont elles font mention ne peuvent servir qu’à la chronologie, par la manière vague dont elles sont rapportées ; mais ces éclipses prouvent qu’à l’époque de l’empereur Yao, plus de deux mille ans avant notre ère, l’Astronomie était cultivée à la Chine comme base des cérémonies. Le calendrier et l’annonce des éclipses étaient d’importants objets pour lesquels on avait créé un tribunal de Mathématiques. On observait dès lors les ombres méridiennes du gnomon aux solstices et le passage des astres au méridien ; on mesurait le temps par des clepsydres, et l’on déterminait la position de la Lune par rapport aux étoiles dans les éclipses ; ce qui donnait les positions sidérales du Soleil et des solstices. On avait même construit des instruments propres à mesurer les distances angulaires des astres. Par la réunion de ces moyens, les Chinois avaient reconnu que la durée de l’année solaire surpasse, d’un quart de jour environ, trois cent soixante et cinq jours ; ils la faisaient commencer au solstice d’hiver. Leur année civile était lunaire, et pour la ramener à l’année solaire, ils faisaient usage de la période de dix-neuf années solaires correspondantes à deux cent trente-cinq lunaisons, période exactement la même que, plus de seize siècles après, Calippe introduisit dans le calendrier des Grecs. Leurs mois étant alternativement de vingt-neuf et de trente jours, leur année lunaire était de trois cent cinquante-quatre jours, et par conséquent plus courte de onze jours et un quart que leur année solaire ; mais, dans l’année où la somme de ces différences aurait excédé une lunaison, ils intercalaient un mois. Ils avaient partagé l’équateur en douze signes immobiles et en vingt-huit constellations, dans lesquelles ils déterminaient avec soin la position des solstices. Les Chinois avaient, au lieu du siècle, un cycle de soixante ans, et un cycle de soixante jours au lieu de la semaine ; mais ce petit cycle de sept jours, en usage dans tout l’Orient, leur était connu depuis les temps les plus reculés. La division de la circonférence fut toujours, en Chine, subordonnée à la longueur de l’année, de manière que le Soleil décrivît exactement un degré par jour ; mais les divisions du degré, du jour, des poids et de toutes les mesures linéaires étaient décimales, et cet exemple, donné depuis quatre mille ans au moins par la plus nombreuse nation de la terre, prouve que ces divisions, qui d’ailleurs offrent tant d’avantages, peuvent devenir, par l’usage, extrêmement populaires.
Les premières observations utiles à l’Astronomie sont de Tcheou-Kong dont la mémoire est encore en vénération à la Chine, comme celle de l’un des meilleurs princes qui l’aient gouvernée. Frère de Ou-Ouang, fondateur de la dynastie des Tcheou, il régit l’empire après sa mort, pendant la minorité de son neveu, depuis l’an 1104 jusqu’à l’an 1098 avant notre ère. Confucius, dans le Chou-King, le livre le plus révéré des Chinois, fait adresser par ce grand prince à son pupille les plus sages maximes du gouvernement et de la morale. Tcheou-Kong fit par lui-même et par ses astronomes un grand nombre d’observations dont trois nous sont heureusement parvenues, et précieuses par leur haute antiquité. Deux d’entre elles sont des longueurs méridiennes du gnomon, observées avec un grand soin, aux solstices d’hiver et d’été, dans la ville de Loyang ; elles donnent pour l’obliquité de l’écliptique, à cette ancienne époque, un résultat conforme à la théorie de la pesanteur universelle. L’autre observation est relative à la position du solstice d’hiver dans le ciel à la même époque. Elle s’accorde pareillement avec la théorie, autant que le comportent les moyens employés alors pour déterminer un élément aussi délicat. Cet accord remarquable ne permet pas de douter de l’authenticité de ces observations.
L’incendie des livres chinois, ordonné par l’empereur Chi Hoanti, vers l’an 213 avant notre ère, fit disparaître les vestiges des anciennes méthodes du calcul des éclipses et beaucoup d’observations intéressantes ; pour en retrouver qui puissent être utiles à l’Astronomie, il faut descendre d’environ quatre siècles depuis Tcheou-Kong, et se transporter en Chaldée. Ptolémée nous en a transmis plusieurs : les plus anciennes sont trois éclipses de Lune, observées à Babylone dans les années 719 et 720 avant notre ère, et dont il a fait usage pour déterminer les mouvements de la Lune. Sans doute Hipparque et lui n’en avaient point de plus anciennes qui fussent assez précises pour servir à ces déterminations, dont l’exactitude est en raison de l’intervalle qui sépare les observations extrêmes. Cette considération doit diminuer nos regrets de la perte des observations chaldéennes, qu’Aristote, si l’on en croit Porphyre cité par Simplicius, se fit communiquer par l’entremise de Callisthène, et qui remontaient jusqu’à dix-neuf siècles avant Alexandre. Mais les Chaldéens n’ont pu découvrir que par une longue suite d’observations la période de 6585 jours 1 31/3, pendant lesquels la Lune fait 223 révolutions à l’égard du Soleil, 239 révolutions anomalistiques, et 241 révolutions par rapport à ses nœuds. Ils ajoutaient 4 135 4/135 de la circonférence pour avoir le mouvement sidéral du Soleil dans cet intervalle, ce qui suppose l’année sidérale de 365 jours 1 41/4. Ptolémée, en rapportant cette période, l’attribue aux plus anciens mathématiciens ; mais l’astronome Geminus, contemporain de Sylla, désigne les Chaldéens comme inventeurs de cette période, et il explique la manière dont ils en ont conclu le mouvement diurne de la Lune, et la méthode par laquelle ils calculaient l’anomalie lunaire. Son témoignage ne doit laisser aucun doute, si l’on considère que le saros chaldéen, de 223 mois lunaires, qui ramène la Lune à la même position à l’égard de ses nœuds, de son périgée et du Soleil, fait partie de la période précédente. Ainsi les éclipses observées dans une période fournissaient un moyen simple de prédire celles qui devaient avoir lieu dans les périodes suivantes. Cette période et la manière ingénieuse avec laquelle ils calculaient la principale inégalité lunaire ont exigé un grand nombre d’observations comparées entre elles avec adresse : c’est le monument astronomique le plus curieux avant la fondation de l’école d’Alexandrie. Voilà ce que l’on connaît avec certitude de l’Astronomie d’un peuple que l’antiquité regarda comme le plus instruit dans la science des astres. Les opinions des Chaldéens sur le système du monde ont été très variées, comme cela devait être à l’égard d’objets que l’observation et la théorie n’avaient point encore éclairés. Cependant, quelques-uns de leurs philosophes, plus heureux que les autres ou guidés par des vues plus saines sur l’ordre et sur l’immensité de l’univers, ont pensé que les comètes étaient, ainsi que les planètes, assujetties à des mouvements réglés par des lois éternelles.
Nous avons très peu de renseignements certains sur l’Astronomie des Égyptiens. La direction exacte des faces de leurs pyramides vers les quatre points cardinaux donne une idée avantageuse de leur manière d’observer ; mais aucune de leurs observations n’est parvenue jusqu’à nous. On doit être étonné que les astronomes d’Alexandrie aient été forcés de recourir aux observations chaldéennes, soit que la mémoire des observations égyptiennes ait dès lors été perdue, soit que les Égyptiens n’aient pas voulu les communiquer, par un sentiment de jalousie qu’a pu faire naître la faveur des souverains pour l’école qu’ils avaient fondée. Avant cette époque, la réputation de leurs prêtres avait attiré les premiers philosophes de la Grèce. Thalès, Pythagore, Eudoxe et Platon allèrent puiser chez eux les connaissances dont ils enrichirent leur patrie, et il est vraisemblable que l’école de Pythagore leur fut redevable de quelques-unes des idées saines qu’elle professa sur la constitution de l’univers. Macrobe leur attribue expressément la pensée des mouvements de Mercure et de Vénus autour du Soleil. Leur année civile était de trois cent soixante-cinq jours ; elle était divisée en douze mois de trente jours, et ils ajoutaient à la fin cinq jours complémentaires ou épagomènes. Mais, suivant l’ingénieuse remarque de M. Fourier, l’observation des levers héliaques de Sirius, la plus brillante des étoiles, leur avait appris que le retour de ces levers retardait alors, chaque année, d’un quart de jour, et ils avaient fondé sur cette remarque la période sothique de 1461 ans, qui ramenait à peu près aux mêmes saisons leurs mois et leurs fêtes. Cette période s’est renouvelée dans l’an 139 de notre ère. Si elle a été précédée d’une période semblable, comme tout porte à le croire, l’origine de cette période antérieure remonterait à l’époque où l’on peut supposer avec vraisemblance que les Égyptiens ont donné des noms aux constellations du zodiaque, et où ils ont fondé leur Astronomie. Ils avaient observé que dans vingt-cinq de leurs années il y avait trois cent neuf retours de la Lune au Soleil, ce qui donne une valeur fort approchée de la longueur du mois. Enfin on voit, par ce qui nous reste de leurs zodiaques, qu’ils observaient avec soin la position des solstices dans les constellations zodiacales. Suivant Dion Cassius, la semaine est due aux Égyptiens. Cette période est fondée sur le plus ancien système d’Astronomie, qui plaçait le Soleil, la Lune et les planètes dans cet ordre de distances à la Terre, en commençant par la plus grande : Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune. Les parties successives de la série des jours divisés chacun en vingt-quatre parties étaient consacrées dans le même ordre à ces astres. Chaque jour prenait son nom de l’astre correspondant à sa première partie. La semaine se retrouve dans l’Inde parmi les Brames, et avec nos dénominations, et je me suis assuré que les jours nommés par eux et par nous de la même manière répondent aux mêmes instants physiques. Cette période, qui était en usage chez les Arabes, les Juifs, les Assyriens et dans tout l’Orient, s’est renouvelée sans interruption et toujours la même, en traversant les siècles et les révolutions des empires. Il est impossible, parmi tant de peuples divers, d’en connaître l’inventeur ; nous pouvons seulement affirmer qu’elle est le plus ancien monument des connaissances astronomiques. L’année civile des Égyptiens étant de 365 jours, il est facile de voir qu’en donnant à chaque année le nom de son premier jour, les noms de ces années seront à perpétuité ceux des jours de la semaine. C’est ainsi qu’ont dû se former ces semaines d’années, dont on voit l’usage chez les Hébreux, mais qui appartiennent évidemment à un peuple dont l’année était solaire et de 365 jours.