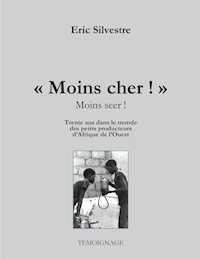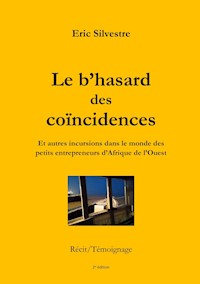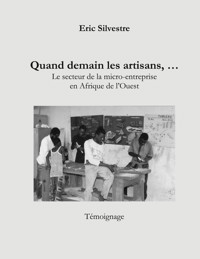
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
L'auteur, acteur atypique du monde de la Coopération et du Développement, dont le charisme repose sur la priorité donnée à l'observation, à la capitalisation des acquis et à leur partage, nous fait découvrir les stratégies et méthodologies des Projets de Développement dont il a eu la charge, pour le compte du BIT, le Bureau International du Travail. Il pose un regard critique sur quelques problématiques majeures dont la formation professionnelle, les espaces de travail, la micro finance, l'insertion des jeunes, l'apprentissage. Cet ouvrage est un témoignage intéressant et un outil pour celles et ceux qui s'engageront, demain, dans le développement, en général, et dans la promotion de la micro entreprise, en particulier. L'auteur nous livre, au fil de son récit, quelques anecdotes croustillantes sur sa vie de conseiller technique expatrié, hautes en couleur et pimentées.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Pour le BIT
▪ Historique d’une décennie d’appui au secteur informel du Mali, avec Souleymane Sarr, préface de Carlos Maldonado S INF A-6 1994 ;
▪ Pour un système intégré de formation dans le secteur artisanal : Le cas du Sénégal. Avec l’Équipe consultative multidisciplinaire pour l’Afrique sahélienne. OIT EMAS 1998.
Publications personnelles
▪ La vie improbable de Julien des Faunes, roman/récit The Book Édition, 2019, nouvelle édition, 2023
▪ Le b’hasard des coïncidences : récit/témoignage. Incursion dans le monde des micros-entrepreneurs d’Afrique de l’Ouest BOD 2022
À celles et ceux qui m’ont accompagné dans mon parcours professionnel
et sur les routes de l’expatriation :
Mes amis : Boubacar Djibo Harouna, Boubé Bagnou, Camille Virot, Christian Bourgeois,
François-Georges Barbier Wiesser, François Lecuyer, Grégoire Detœuf, Laurence Guigou,
Laurent Sawadogo, Michel Didier Laurent, Vatché Papazian, Yves Guémard.
Mes anciens collègues d’Enda : Amadou Diallo, Anne Reynebeau, Emmanuel Dione,
Fabrizio Terenzio, Huguette Lassort, Maam Laity Diouf, Youba Sokona
Mes anciens collègues du BIT : Adlen Garidi, Alexandra Da Cruz, Amani,
Ana Andrade, André Bogui, Assitan Traoré, Boubacar Amani (Ganda), Brahim ould
Ndah, Caroline Kane, Carlos Maldonado, Castro Almeida, Cheikh Badiane, Constance Lo-
pez,
Cyr Davodoun, Dame Diop, Dinastela Curado, Dieudonné Nahimana, Djibril Coulibaly,
Dramane Haidara, Evelyne Messanh, Fatim Ndiaye, Federico Barroeta, Floriane Leutzinger,
François Murangira, François Nannaba, François Ramseyer, Hamou Haïdara, Hans
Roeske, Jacques Gaude, Jean Claude Woillet, Katy Ndong, Keith Van de Ree, Lawali Ba-
bale, Luc Vandeweerd, Luigi Spinato, Marc Franck, Mohamed Ali ould Sidi, Mpenga Ka-
bundi,
Noël Diallo, Ntéba Soumano, Olivier Lompo, Oumar Coulibaly, Paolo Barcia, René Daugé,
Rachid Moussa, Roberto Pes, Sandro Mazzetti, Souleymane Sarr, Sylvain Senghor,
Les Formateurs et Maîtres formateurs GERME
et mes amis artisans et micro-entrepreneurs
Et ceux qui nous ont quittés : André Delluc, Babacar Niang, Francisco Monteiro,
Gerald Belkin, Hamadou Konaté, Jacques Bugnicourt, Marielle Silvestre, Papa Kane,
Simon Goldberg, Yakouba Coulibaly, Patrick de Lalande, Patrick Scalbert, Emmanuel Cissé
……………………………………………………………………………………..
À mes familles première et plurielle :
Ma mère centenaire, mes sœur et beau-frère,
Mes fils et filleuls,
Mes petits fils et petites filles
Mes neveux, nièces, petits neveux et nièces
Quelques repères
1. A propos des petites entreprises
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui composent la grande majorité des entreprises sénégalaises (99,8% des unités recensées en 2016), constituent un levier de lutte contre la pauvreté, un facteur de croissance économique avéré et un tremplin vers l’émergence économique. Les PME ont donc un rôle majeur à jouer dans la transformation structurelle de l’économie qui constitue l’axe 1 du Plan Sénégal Émergent (PSE) qui est la politique économique et sociale définie par les Autorités pour conduire le pays vers l’émergence à l’horizon 2035. (Ministère de l’Économie, des finances et du plan, Agence nationale de la statistique et du plan : Evaluation de la contribution des PME au Produit Intérieur Brut (PIB), à l’emploi, et au commerce extérieur)
2. Le concept de développement revêt de multiples facettes dont il est difficile de donner une définition précise. En voici quelques-unes :
- Un pays est dit développé si certains aspects de ses structures économiques et sociales affichent des niveaux satisfaisants, d’où la notion du bien-être qui mène vers une première définition du développement qui désigne le degré de satisfaction des besoins jugés prioritaires par la population. Le développement est un concept qui décrit la dynamique du changement qualitatif d’une société ; tant que ce changement s’achemine vers le mieux, la société tend à se développer, et inversement. (Économie et gestion, destiné aux étudiants)
- Lorsque le concept de développement est appliqué à une communauté humaine, il désigne alors le progrès du point de vue économique, social, culturel ou politique. (Le Dico des définitions)
3. L’aide au développement désigne une action volontaire par un acteur extérieur pour impulser le développement d’un pays tiers (en développement). Elle va généralement des pays développés vers les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, elle est internationale. Le donateur peut être constitué d’un pays ou d’une entité publique ou privée d’un pays ou d’un groupe de pays par l’intermédiaire d’une organisation internationale. L’aide peut cependant venir d’une entité interne au pays même.
4. Le Projet de développement est un cadre de mise en œuvre de l’aide au développement. Dans le langage du Système des Nations Unies (SNU), il peut être expliqué comme suit : en premier lieu, il faut qu’un Etat demande une assistance technique et financière pour un besoin précis. Il exprime un besoin et cherche le second partenaire, dans le cas présent une agence spécialisée des Nations Unies pour mobiliser des compétences techniques dans le but de renforcer l’institution concernée. Ces nouveaux apports techniques sont proposés par l’agence du SNU selon ses compétences. Le troisième partenaire est le bailleur de fonds, qui prend en charge les couts de gestion (salaires et charges salariales des compétences techniques mobilisées pour son exécution : experts internationaux ou nationaux avec des contrats annuels, ou collaborateurs extérieurs et consultants avec des contrats de courte durée) et de fonctionnement et exécution (apports matériels, équipements, documentation, fournitures, formations). Les sources de financement peuvent provenir du SNU lui-même (via le PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement, notamment), de l’Union Européenne, sous forme de subventions, ou de la Banque Mondiale, via des prêts remboursables à des taux faibles. Il y a aussi des aides financières dites bilatérales venant d’Etats donateurs, lesquels imposent parfois leur propre assistance technique, voire l’achat des intrants chez eux. Un Projet des Nations Unies est toujours d’une durée limitée, généralement moins de 5 ans. Il peut être reconduit après une évaluation tripartite effectuée par les partenaires.
Table des matières
Préface
Genèse du livre
Les thèmes du livre
Chapitre 1
Quelques principes et/ou concepts
Compétences, expérience, diplômes
Types et modes de formation
Bailleurs et Coopération
Chapitre 2
L’organisation du secteur artisanal
Les Organisations professionnelles (OP)
1 : Les statuts des OP
2 : Création et structuration des OP
3 : La formation des élus
4 : Intrusion de la démocratie dans la gestion des OP !
5 : Les échanges entre régions et pays
La Confédération des artisans d’Afrique de l’Ouest
Le concept d’industrialisation du travail
Les espaces de travail
Les zones d’activités artisanales
L’exemple de Ouagadougou
Les villages artisanaux
Les boutiques de vente dans les Villages artisanaux
Les bases d’appui BIT
Salons et/ou foires
Aspects sociologiques
Chapitre 3
Les chambres de métiers
Fédération des artisans vs Chambre de métiers au Mali
La réforme des Chambres de métiers en Mauritanie
Des Chambres de métier au Bénin ?
Chapitre 4
Le renforcement de l’apprentissage
Le film sur les apprentis
Le film sur les jeunes pêcheurs, à Nouakchott
Les documentaires réalisés pour Enda
Le renforcement de l’apprentissage
La formation dans le secteur traditionnel
Le rôle perdu des maîtres artisans
Appui aux patrons
Appui aux apprentis du Mali
Appuis aux apprentis du Burkina Faso
Le paiement des formations
Appui aux apprentis du Niger
Divers appuis aux apprentis au Sénégal
En conclusion sur la problématique de l’apprentissage
Chapitre 5
La microfinance au service des artisans
Les structures de financement des micro-entrepreneurs
Le réseau Kondo Jigima
Évolution de la microfinance
Chapitre 6
Les maîtres du feu
Les forgerons fondeurs récupérateurs
Les incidences culturelles du phénomène de castes
Les potières
Un tour de poterie au SIAO de Ouagadougou
Un potier atypique à Niamey
Chapitre 7
Politique de formation professionnelle
1 : Des formations initiales ou continues
2 : La contribution des bénéficiaires
3 : Les outils pédagogiques
4 : La durée des modules
5 : L’orientation professionnelle
6 : La mise en œuvre des modules de formation
7 : Localisation des formations
8 : Les Fonds pour la formation
9 : Des formations novatrices
10 : Les formations professionnalisantes
11 : L’approche par la demande
12 : La rénovation de l’apprentissage
Les assises nationales sur la Politique de FP
Quelques remarques à caractère sociologique sur la formation
Chapitre 8
Création et gestion d’entreprises
La méthodologie GERME
La méthodologie CLE/KAB
Le développement de GERME et CLE
1 : Sur la question du statut des formateurs CLE
2 : A propos du Plan d’affaire lors des formations CLE
3 : Concernant l’élaboration, l’impression et la traduction des manuels etdocuments
4 : La mise en place des réseaux GERME
5 : Germe niveau 1
Chapitre 9
L’insertion des jeunes
Les formation initiales professionnalisantes de Nigetech
Focus sur l’insertion au PRG (Germe) et dans le Projet ISFP
Le parcours d’insertion
Les cellules d’insertion
Le financement des entreprises créées par les jeunes
Chapitre 10
Deux Projets atypiques
L’expérience de Bamako
La Boutique d’appui de Ouagadougou : un Projet novateur
Chapitre 11
Conseillers techniques et/ou consultants
Conseiller technique
Consultant
L’angoisse du consultant dans certaines situations
Chapitre 12
Les missions
Tunisie
Haïti
Quelques autres missions
Chapitre 13
Le bout du bout, …, et au-delà
Toute dernières missions
Guinée-Bissau
Cabo verde
La der des der
Clap de fin
Bibliographie
Sigles et acronymes
Préface
Peu avant de quitter le Bureau international du travail (BIT) où il venait de passer vingt ans, et de prendre sa retraite, Eric Silvestre proposa d’effectuer un travail de capitalisation des acquis et expériences des deux décennies d’appui au développement de la micro-entreprise et à l’insertion des jeunes pendant lesquelles il s’impliqua directement, à travers les Projets du BIT dont il fut le CTP, ou en tant que consultant.
Son intention était de rédiger un mode d’emploi des stratégies retenues et appliquées lors de la mise en œuvre des appuis, au regard de certaines méthodologies spécifiques élaborées par le BIT. Pour ce faire, il prévoyait de collaborer avec quelques collègues proches, béninois, burkinabè, cap-verdiens, français, maliens, mauritaniens, nigériens, suisses, sénégalais, et de tenter d’effectuer un travail aussi exhaustif que possible.
Sa proposition fut entendue et les encouragements ne manquèrent pas mais son projet ne fut pas mis en œuvre. C’est dommage, tant il est vrai qu’un tel travail, à chaud, aurait permis de coucher sur le papier nombre de réflexions, d’analyses, de commentaires, de critiques constructives, et de pistes à développer. Toutefois, selon le vieil adage qui dit que la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié, et parce qu’Eric Silvestre fut un passionné dans son travail, je ne doute pas que le meilleur de son expérience du terrain lui reste en mémoire.
Cela nous a semblé suffisant pour lui demander, près de dix ans après son départ, de revenir sur ses vingt années au sein de notre Maison, de chercher dans ses souvenirs ceux qui l’ont le plus marqué, ceux qu’il a envie de transmettre, avec le recul, aux femmes et aux hommes qui étudient le passé récent du monde du développement, ou qui se sont engagés ou s’engageront sur ses traces.
Le présent ouvrage témoigne de cette expérience passionnante qui l’a conduit à vivre dans cinq pays où il a occupé des postes de conseiller technique et à séjourner dans une vingtaine d’autres où il a effectué des missions pour le BIT et d’autres partenaires.
Ce livre illustre également la générosité d’un praticien du développement qui a tenu à partager la somme de connaissances et d’expériences accumulées au cours de plus de deux décennies de praxis1 dans le secteur de l’artisanat et d’interactions, tant avec les institutions nationales publiques et privées en charge du développement, qu’avec les opérateurs et opératrices du secteur de la micro et petite entreprise, jeunes femmes et hommes en apprentissage, en formation professionnelle ou en quête d’insertion. Il apporte dans cet ouvrage un éclairage technique personnel sur neuf grands thèmes qui l’ont occupé et passionné pendant son parcours professionnel, et nous livre quelques éléments d’analyse des différentes problématiques en jeu qui, à nos yeux, restent d’actualité et pourront être utiles, demain, lors de la mise en œuvre des prochains Projets de développement.
Son témoignage éclaire le lecteur sur le monde méconnu de la Coopération et du Développement, dont il opère une relecture lors de ses conversations avec Guillaume, son interlocuteur, et avec divers collègues. Une relecture plus humaine que strictement technique ou politique, ponctuée par des anecdotes sur la vie de Chef de Projet et de consultant, avec ses aléas heureux ou malheureux qui constituent le quotidien de la vie dans l’univers du Développement. En Afrique de l’Ouest, beaucoup, mais aussi au Vietnam, au Rwanda, en Tunisie et en Haïti.
Ce livre permettra, je l’espère, aux jeunes qui s’engageront demain sur les chemins du Développement international en général, et du secteur de la micro-entreprise, en particulier, d’avoir à l’esprit quelques repères et idées utiles pour leur gouverne. De même qu’une meilleure appréhension de cet univers très particulier, en vue de son appropriation.
Eric Silvestre a conservé quelques réflexions ou phrases prononcées par ses interlocuteurs, jeunes et moins jeunes, ou écrites par des collègues, qui illustrent mieux que mille discours, certaines problématiques. Les unes, prononcées par de jeunes artisans ou des patrons, d’autres par des consultants, experts ou cadres du BIT.
Pour finir, c’est sans aucun doute la recommandation de Jean Claude Woillet, un collaborateur majeur du BIT fin connaisseur des arcanes de la coopération au Développement, portée dans le rapport d’évaluation du Projet de Ouagadougou dont Eric Silvestre était le responsable, qui explique le mieux sa démarche d’écriture :
« Le surcoût de l’expertise internationale doit être compensé par une production intellectuelle qui permette de capitaliser et reproduire les expériences menées. »
Cette recommandation, je l’ai constaté par la suite, l’a poussé à rédiger de nombreux documents techniques et à produire des rapports d’activités et de mission qui ont fait date, riches de commentaires sur la méthode, quand il était en poste dans des Projets du BIT.
Ses rapports, comme certains documents de Projets qu’il écrivit ou contribua à écrire, ont souvent constitué des mines d’informations, car il était généreux dans sa rédaction et n’hésitait pas à donner des indications sur la mise en œuvre à venir des activités.
C’est dire combien cette œuvre est un précieux legs aussi bien pour la génération actuelle de jeunes experts engagés dans la voie de la Coopération au Développement que pour les praticiens expérimentés et établis qui ne manqueront d’y trouver des sources d’inspiration et autres pistes fécondes de solutions aux problématiques toujours actuelles que charrie la mise en œuvre des Projets de développement.
Cette contribution élaborée avec passion et dans un réel esprit de partage illustre parfaitement la nature singulière d’un expert d’une rare compétence et d’une infinie générosité.
Cheikh Badiane (Ancien fonctionnaire international du BIT)
1 Manière générique de penser la transformation du milieu naturel et des rapports sociaux (Wikipédia).
Genèse du livre
Écrire un livre n’est pas une aventure ordinaire, et s’il en est un qui n’était pas prédisposé à le faire, c’est bien moi. Et pourtant je l’ai fait. Je me suis fait la main en rédigeant les rapports d’activités et de missions pour le BIT et d’autres organismes de Coopération. J’ai rapidement compris la vocation de mes rapports à terminer leur parcours dans les tiroirs desdites organisations, et j’ai rapidement fait le choix de les humaniser, en y glissant des éléments qui permettent de comprendre comment on s’y est pris, pourquoi ça a bien ou mal marché. Il m’est arrivé plusieurs fois de rédiger deux rapports : un premier pour les tiroirs, et un second avec des commentaires sur la méthode qui ne manquerait pas, je l’espérais, d’intéresser certains collègues. C’est donc de la rédaction de rapports d’activités ou de missions qu’est née ma modeste vocation d’écrivain, après quoi mon désir de témoigner de mes expériences professionnelles, assez atypiques, mais potentiellement utiles, a pris forme.
Le public visé dans ce livre est celui des professionnels, des étudiants, des chercheurs, et de celles et ceux qui souhaitent s’engager dans le Développement avec des idées plus claires sur les enjeux et les problématiques qui sous-tendent la coopération et le Développement, en termes de stratégies, de méthodologies, de partenariat entre les acteurs, d’attentes et de réactions des bénéficiaires. Ce, à travers la restitution d’une expérience forte et sincère.
C’est aussi celui des lecteurs que la vie outre-mer intrigue, celles et ceux qui souhaitent mieux connaître l’univers dans lequel travaillent ces drôles d’individus que l’on appelle coopérants, conseillers techniques ou consultants, dont les parcours se nourrissent d’expériences professionnelles diverses, s’enrichissent de compétences multiples, et n’en sont pas moins ponctués par des évènements improbables.
Mon propre parcours est fait d’une multitude d’emplois et ma carrière s’articule autour de deux périodes aussi distinctes que disparates. La période qui précéda mon entrée dans une vie active que je qualifierais de normale, dura vingt ans.
C’est celle du soixantedisard en rupture avec un milieu socioculturel pesant, soucieux de justice sociale, intéressé par la découverte des autres. Un héritier de 68 qui, après avoir fait des études d’ingénieur, décida de partir en Afrique puis, à son retour en France, de s’installer à la campagne comme menuisier.
Vingt années à l’affût des hasards et des coïncidences2 que j’ai saisis, pour, au bout du compte, me construire un parcours assez improbable mais qui m’a permis d’acquérir des compétences dont je me suis servi par la suite dans les postes que j’ai occupés. Guillaume, mon interlocuteur dans ce livre, comprit dès nos premières discussions que ces décennies 70 et 80 furent riches d’activités aussi passionnantes que variées, ce, dans des domaines parfois assez éloignés de mes compétences premières (le bâtiment). J’ai travaillé dans les secteurs privé et associatif, j’y ai gagné ma vie de façon très irrégulière, avec des périodes confortables et d’autres de vaches maigres, voire de chômage.
Je les ai mises à profit pour effectuer des reconversions professionnelles. J’ai traversé quatre fois le Sahara et y ai réalisé un film, j’ai exercé différents métiers, dans le bâtiment, au Cameroun et en Mauritanie, puis dans la décoration et la capture d’animaux sauvages, au Cameroun, la menuiserie, la restauration de maisons anciennes, l’animation de stages, la cuisine, le management et la production d’artistes, la photographie, l’audiovisuel. À ce titre, j’ai réalisé plusieurs documentaires, dont un premier qui m’ouvrit les yeux sur le monde de l’apprentissage, et un dernier, sur la microfinance. Au bout du compte, il s’avéra que les expériences vécues et les compétences acquises pendant cette période constituèrent le terreau de ma carrière professionnelle à venir.
Ce n’est qu’à 40 ans que j’ai commencé à travailler comme tout le monde, avec des journées de huit heures, des congés payés, une protection sociale en bonne et due forme, et au bout du compte, une retraite décente. L’évènement majeur qui marqua la rupture entre ces deux époques fut mon entrée dans le Système des Nations Unies, au BIT, où je devins Conseiller technique principal d’un Projet.
Mon expérience tend à démontrer qu’être conseiller technique dans le secteur du Développement n’est pas un métier en soi, dans lequel on entre au sortir d’études supérieures, mais plus par le biais des compétences acquises sur le terrain. Mes choix de postes furent pour beaucoup, je l’ai dit, le fruit de hasards et de coïncidences. Des choix opérés consciemment, tant du point de vue des emplois qui me furent proposés que des pays où je dû séjourner. Pour le plaisir, toujours, et souvent du fait de mes bonnes relations avec les personnes que j’allais retrouver dans le travail. J’ai refusé des postes lucratifs que je ne sentais pas, malgré le confort qu’ils m’auraient apporté.
J’ai fait un jour le choix de partir dans un pays où je n’avais plus de raison d’aller, tant il était situé au fin fond du Sahel. La logique, à cette époque, était plutôt de commencer par ce type de pays, lointain et enclavé, et de terminer par le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. J’y suis parti par intérêt financier, je l’avoue, en quête des points de retraite qui me manquaient, mais pour finir, ce fut ma plus belle aventure professionnelle et de vie d’expatrié.
Mon parcours dans le Système des Nations Unies fut quelque peu hors normes, on le comprendra à la lecture de ce livre. J’y fus, tant du point de vue de ma personnalité que de ma démarche, un fonctionnaire atypique. Mais apprécié, semble-t-il, au point de m’être vu confier plusieurs postes de Chef de Projet et des dizaines de missions de consultant, même après mon départ à la retraite, bien qu’ayant démissionné de mon dernier poste.
Je suis resté fidèle à l’esprit de ma démarche. J’ai toujours eu pour principe de me baser sur l’observation et l’analyse du terrain, et sur les expériences intéressantes acquises ailleurs, dans des contextes similaires, qui restent à contextualiser et à adapter à la réalité des pays concernés, plutôt que sur les idées préconçues et les stratégies importées. J’ai toujours cherché à adopter des approches pertinentes qui permettent de procéder en connaissance de cause, au plus près des réalités, sans se fonder sur des a priori et des solutions copiées-collées. Mieux valait, à mes yeux, scruter le milieu dans lequel j’allais évoluer, écouter les gens, leur parler, observer leurs modes et méthodes de travail, comprendre comment ça marche et, le cas échéant, pourquoi ça ne marche pas. J’ai essayé de mener des actions fondées sur ces préalables, quitte à sortir des chemins tracés et à opter pour des stratégies novatrices.
J’établis volontiers un parallèle entre les parcours d’insertion des jeunes en quête d’emploi et nos parcours professionnels d’acteurs du Développement que nous déroulons au fil des étapes de notre vie, de nos expériences et de nos acquis de terrain.
Les responsables locaux des pays où l’on travaille revendiquent souvent des différences et spécificités vis-à-vis des pays voisins, alors que cela n’est pas toujours vrai. À bien y regarder, les études menées en amont des Projets montrent que les comportements des individus au sein de groupes sociaux similaires sont globalement assez proches d’un pays à l’autre. Il faut procéder par étapes, aller à la rencontre des petits producteurs, mettre les pieds dans la boue, accepter de boire un thé ensemble ou manger sur la natte, se frotter aux atmosphères chaudes et parfois un peu grasses, prendre le temps, ne pas se presser, attendre, laisser venir les petites phrases qui donnent les clefs. Il faut transformer son expérience en éléments de compétence, jusqu’à disposer d’une compétence plurielle qui confère à notre propre individualité son originalité, sa force, et sa capacité à apporter des plus-values aux postes que l’on occupe. La valeur d’un Chef de Projet ou d’un consultant relève beaucoup plus de ses acquis du terrain que des diplômes reçus dans les écoles.
Il est un autre élément de compétence à prendre en compte chez le futur conseiller technique, et plus encore le Chef de Projet : son savoir être, sa capacité à travailler avec ses homologues, à croiser ses connaissances avec les leurs, à faire preuve d’abnégation, à puiser dans les compétences de l’autre celles qui peuvent le renforcer. Il y va de sa vie professionnelle, de sa réussite, et plus encore de l’efficacité du Projet dont il a la charge, et des synergies développées entre partenaires.
Le livre que vous avez entre les mains, contrairement au précédent, laisse de côté les aventures de la vie d’expatrié et se concentre sur le champ d’intervention du conseiller technique, non sans rapporter quelques anecdotes liées aux aléas du métier, car, on a trop tendance à l’oublier : être consultant n’est pas un long fleuve tranquille.
J’avais dans l’idée, au sortir de mes vingt années de BIT, d’effectuer une capitalisation des acquis et expériences, au regard des stratégies et méthodologies, mais les promesses reçues n’ont pas été suivies de faits. C’est donc dans ce livre que, dix ans plus tard, je m’attaque à l’exercice. J’essaie de restituer ce qui me reste en tête, et dans le cœur, de ce que j’ai vécu, tant du point de vue du travail que des imprévus qui en ponctuent le quotidien. Je fais cette capitalisation partielle et tardive pour celles et ceux qui partiront demain et pensent que l’expérience de leurs prédécesseurs peut leur être utile, que leurs réussites, échecs et erreurs comptent, qu’il n’est pas d’action aujourd’hui qui ne peut faire l’économie de celles qui ont été menées précédemment. J’ai oublié beaucoup de choses, le lecteur peut l’imaginer, mais il en reste assez pour permettre à ce livre de jouer le rôle à lui imparti.
J’ai moi-même profité de l’expérience de mes prédécesseurs, et, on le verra, de quelques phrases clefs, essentielles à mes yeux, qui en disent plus que bien des discours. J’ai donné la priorité à l’observation du terrain, en privilégiant les relations Sud Sud. J’ai cherché, autant que faire se put, à croiser les expériences, échanger les documents pédagogiques, faire se rencontrer les acteurs, micros-entrepreneurs, artisans, mais aussi mes collègues conseillers techniques, chefs de Projets, agents des directions techniques concernées.
Je me suis battu pour rassembler autour d’un même Projet conjoint plusieurs Agences du Système des Nations Unies, non sans difficulté, ni sans prendre des coups inattendus ! Mais le jeu en valait la chandelle.
J’espère que ce livre ira dans le même sens.
Guillaume y sera mon principal interlocuteur. C’est un jeune architecte que je pourrais avoir rencontré à Pushkar dans une librairie, à l’occasion d’un voyage en Inde3. Le but de nos discussions est de rendre compte de mon parcours professionnel dans le monde du Développement, en général, et dans celui des petits producteurs, en particulier, on l’aura compris, et d’en montrer l’impact sur le Développement.
Eric Silvestre
2 Titre du deuxième livre de l’auteur : Le B’hasard des coïncidences. BOD 2022
3 C’est tout au moins comme cela qu’il est présenté dans mon livre : « La vie improbable de Julien des Faunes ». The Book Edition, Nouvelle édition, 2023
Les thèmes du livre
Tout ce qui suit est le fruit de trente et quelques années dans le monde du Développement, en général, et de la petite entreprise, en particulier. Principalement en Afrique de l’Ouest. Ce livre est d’une certaine façon le fruit d’un carambolage entre des idées et des expériences, des savoirs et des savoir-faire, des théories et des pratiques, et, pour entrer pleinement dans le sujet, des Projets de développement et des Documents de projet, des Coopération bilatérales et multilatérales, des organisation internationales et non gouvernementales (ONG), des rapports d’activité et de mission, l’élaboration et l’exécution de Projets, des pays et des continents, l’emploi salarié et l’auto-emploi, la vie professionnelle et celle d’expatrié, des diplômes et l’expérience de terrain. Des hasards et des coïncidence aussi. Le long d’un parcours professionnel qu’aucun plan de carrière n’a jamais sous-tendu.
Pour faciliter la lecture de ce livre, je propose de commencer par une sous table des matières avec la liste des neuf thèmes qui en constituent l’ossature centrale, et par-là, neuf portes d’entrée, selon l’intérêt que le lecteur porte à chacun d’entre eux.
Thème 1 : L’organisation du secteur artisanal
37
Thème 2 : Les espaces de travail
66
Thème 3 : Les chambres de métiers
81
Thème 4 : Le renforcement de l’apprentissage
93
Thème 5 : La micro finance au service des artisans
132
Thème 6 : Les maîtres du feu
143
Thème 7 : Politique de formation professionnelle
155
Thème 8 : Création et gestion d’entreprises
188
Thème 9 : L’insertion des jeunes
197
Plus quelques principes, en introduction, trois sujets liés aux Projets, au travail de conseiller ou consultant, et aux missions, et pour finir, un diagnostic médical sur ma sortie du Système, et un clap de fin.
« L’intelligence n’est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on fait quand on ne sait pas » (Jean Piaget). Cette citation que propose Etienne Klein dans son livre « Courts circuits4 » apporte de l’eau à mon moulin au moment d’écrire que l’intérêt du témoignage réside non pas dans la seule abstraction, voire dans la description théorique ou scientifique des différentes thématiques, sujettes à des interprétations diverses, voire contestables, mais dans ce qui a été fait sur le terrain, avec les moyens du bord, sans certitudes, avec une liberté d’action que n’ont pas tous les acteurs du développement, du fait de leurs hiérarchies parfois rigides ou tatillonnes. Aussi m’a-t-il semblé intéressant et nécessaire, pour ne pas me cantonner dans la seule abstraction, d’évoquer tout ce qui est entré en jeu dans le traitement de ces thématiques : les stratégies d’appui, les méthodologies, les actions menées et les conditions de leur mise en œuvre, les contextes des pays et Projets dans lesquels je travaillais, les attentes et les attitudes des bénéficiaires, les expériences des pays voisins, la personnalité des individus au sein du machin5, ou en d’autres termes les chefs de Projets du SNU.
Si des résultats sont indiqués, ils ne sont ni chiffrés ni quantifiés, car mon idée, on l’aura comprise, est plus d’apporter quelques éclairages sur la méthode que de produire un rapport exhaustif sur vingt et quelques années consacrées au secteur de la micro-entreprise.
Les acteurs du carambolage
Ils sont nombreux et il n’est pas utile de tous les citer ici vu que le lecteur les retrouvera entre les lignes du texte qui suit. Il s’agit notamment :
Des postes que j’ai occupés
: chef de chantier, réalisateur, chef de projet.
Des entreprises
(Grands travaux de l’Est et Sétuba au Cameroun, Somaco TP en Mauritanie) ;
ONGs (
Enda) ;
organisations privées ou internationales
(BIT, FAO, PNUD, Coopération française, Grand-Duché de Luxembourg, Lux Development, AFD),
avec lesquelles ou dans lesquelles j’ai travaillé.
Des Projets de développement :
Projet BIT/SNS
, au Mali (financé par la Coopération suisse) ;
Projet d’appui aux petits producteurs et productrices de Ouagadougou
(
Boutique d’appui)
au Burkina Faso, financé par la KFW allemande ;
Projet NIGETECH
, au Niger, financé par l’Union Européenne ;
Programme Régional GERME BIT
, financé par la Suède ;
Programme ISFP
, au Sénégal, financé par le Grand-Duché de Luxembourg.
Les missions de consultation
que j’ai effectuées dans une vingtaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, au Rwanda, en Tunisie et à Haïti.
Il s’agit également de :
Celles et ceux (
collègues du BIT, de l’ONUDI, d’Enda, du PNUD, chefs de Projets, consultants, artisans et bénéficiaires des Projets) ;
Quelques propos et petites phrases
qui comptent.
Donc carambolage, certes, mais géré !
4 Gallimard 2024
5 Allusion faite par le Général de Gaulle sur l’ONU
Chapitre 1 Quelques principes et/ou concepts
J’ai oscillé, lors de l’écriture des deux précédents ouvrages, entre fiction et récit, mais cette fois, il n’est question que de rendre compte d’un parcours professionnel et d’un engagement auprès des artisans et petits entrepreneurs que je ne désignerai plus comme acteurs du secteur informel, mais du Développement et, de fait, de la croissance de leurs pays. Notamment quand ils sortent des centres de formation professionnelle ou des lycées techniques, comptent parmi l’élite de la jeunesse et constituent le fer de lance du sursaut économique.
- Vous répondez souvent par une pirouette à certaines de mes questions ou réflexions en disant, le sourire aux lèvres, « Moins cher ! » S’étonne Guillaume. Qu’entendez-vous par là ?
- C’est le cœur du problème. Dans le milieu de la micro-entreprise, la tendance est toujours à tirer le prix vers le bas, donc à acheter moins cher, pour le client, et, par obligation, à vendre moins cher, pour le producteur, donc à fabriquer moins bien.
- En quoi cela constitue-t-il un problème, demande Guillaume ?
- Tu as raison de poser cette question. On pourrait ne pas y voir d’ambiguïté, de menace pour le secteur, ou bien dire que c’est la même chose partout ! Pourtant c’est un vrai problème.
Pour la micro-entreprise, cet état de fait engendre une succession de dommages, non pas collatéraux, mais directs. En tirant le prix vers le bas, le client oblige l’artisan à tirer la qualité vers le bas, et la spirale négative s’enclenche.
Vous avez dit émergence
En écho aux politiques actuelles qui prônent la croissance accélérée et l’émergence du pays, cette situation du moins cher tire l’économie vers le bas, vers la stagnation, la survie. Elle doit être combattue.
- Mais d’ailleurs, peut-on programmer l’émergence, demande Guillaume ?
- Bonne question, en effet. Pour te dire le fond de ma pensée, je pense que non. Elle se constate mais ne se programme pas. Toutes les politiques économiques sont censées conduire les pays vers la croissance et l’émergence, mais tous n’y vont pas ! Quand l’un d’eux y parvient, alors le monde se réjouit et on parle alors de pays émergent.
La question est de savoir ce qui a été fait pour que le pays se trouve en situation d’émergence : Qu’est-ce qui a changé ? Qui a changé de comportement, et qui a fait quoi ? Quand les producteurs et les consommateurs ne s’inscrivent pas dans une spirale ascendante, dans une dynamique de développement palpable, le secteur s’informalise et stagne. On retrouve cette dynamique négative dans bien des situations, et elle se traduit par une absence d’éthique dans la démarche commerciale des vendeurs, de propreté, d’hygiène, de qualité.
Tout cela pour rester moins cher et satisfaire le client qui veut dépenser moins.
L’émergence se bâtira sur la défense de la qualité des produits, et de leur prix, sur des changements de comportement, sur le respect de l’autre, sur le refus de l’informel dangereux (le Diola6 les taxis pourris). Et pourquoi pas sur la pose de compteurs dans les taxis !
Un chemin vers l’émergence
En interdisant la vente des produits comestibles (légumes, poissons, notamment) par terre, à la merci des éclaboussures et de tout ce que l’on peut imaginer de sale, et en obligeant les vendeurs à les présenter sur des tables, dans les marchés et à des places matérialisées, voire dans des boutiques ou des kiosques, les maires s’inscriraient dans une politique résolument orientée sur le développement et l’émergence, à travers une démarche écologique, protectrice de l’environnement et de la santé de leurs électeurs.
Les vendeurs et leurs clients s’inscriraient dans une dynamique de développement avec à la clef, une bonne gestion de leurs activités, un souci d’hygiène et de qualité des produits proposés aux clients, du travail et des revenus pour les menuisiers qui fabriqueront les tables. Quant aux clients obligés de payer les fruits et légumes un peu plus cher, ils devront travailler un peu plus pour gagner plus, ce qui boostera la croissance économique !
Compétences, expérience, diplômes
- A vous écouter, dit Guillaume, on peut dire que c’est votre expérience de vie et de terrain qui a le plus compté dans la construction de votre profil et dans le choix de votre personne par le BIT.
- Tout à fait. Nous aurons des occasions de parler du mécanisme d’entrée dans la vie active par la bande, pourrais-je dire, ou par le terrain, en d’autres termes. Ce qui fut mon cas, je l’avoue. Il est clair que je n’ai pas construit mon parcours professionnel sur un diplôme, même si j’en avais un en poche, de l’ESTP7. Je suis d’ailleurs assez réservé sur la portée de certains diplômes, au regard des compétences annoncées dans leur titre.
J’ai un bon exemple pour illustrer ce point de vue. Au Cameroun, un chef d’entreprise m’a proposé un poste, arguant du fait que mon diplôme me désignait comme l’homme de la situation pour diriger un chantier de bâtiment. En fait il avait tout faux et son attitude illustre bien la fascination qu’exercent les diplômes. Il était persuadé que je maîtrisais les compétences de l’ensemble des matières couvertes par mon diplôme, alors que, comme certains étudiants, j’avais fait l’impasse sur les matières qui ne m’intéressaient pas, notamment la résistance des matériaux et le béton armé. Le directeur aurait été surpris, si j’avais accepté sa proposition, de constater que j’aurais été incapable de faire le moindre calcul de béton armé !
- Cet exemple, répond Guillaume, illustre bien l’ambiguïté de la formation diplômante, notamment quand il y a de nombreuses matières au programme.
Le diplôme est accordé au vu de la moyenne obtenue à l’examen et ne garantit pas, comme vous le démontrez, la maîtrise de l’ensemble des compétences citées dans l’énoncé du diplôme, et attendues des
futurs employeurs. Les plus affutés demandent ce que nous avons fait et savons faire, plus que nos diplômes papier.
- Cela dit, je ne conteste pas pour autant la validité des diplômes et des compétences acquises de façon générale, notamment dans les matières que l’on peut qualifier d’exactes. Quand il s’agit de Développement, c’est plus complexe, et je ne vois pas quelle école peut donner les compétences qu’il faut pour intervenir sur le terrain autrement que sur la base d’idées théoriques, généralistes, voire préconçues, qui relèvent souvent du copié-collé et génèrent des situations décalées lors de la mise en œuvre des actions, au regard des réalités du terrain.
Types et modes de formation
- On connaît les types et modes de formation élémentaires, dit alors Guillaume : la formation initiale, pour celles et ceux qui n’ont aucun acquis, et la formation continue, ou permanente, pour celles et ceux qui travaillent et peuvent compléter leurs compétences ou en acquérir de nouvelles, notamment dans le cadre d’une reconversion. Il serait bien, demande Guillaume, d’évoquer à titre préalable, les deux types de formation qui renvoient plus spécifiquement au concept de compétences : la formation diplômante, et l’approche par les compétences.
- C’est une bonne idée, en effet, qui permettra d’éclairer notre lanterne. Essayons d’en faire un bref parallèle simple.
La formation diplômante est vieille comme le monde, ou tout au moins, comme les systèmes de formation professionnelle.
Elle valide, ou invalide, à l’issue d’un contrôle, examen écrit ou pratique, une formation globale contenant, dans la grande majorité des cas, plusieurs matières ou unités de valeur.
Si la note obtenue est supérieure à la moyenne, on a le diplôme ! Il est censé certifier que le titulaire maîtrise l’ensemble des compétences liées aux thèmes de la formation. Rien n’est moins sûr !
L’approche par les compétences vise quant à elle à garantir la maîtrise de toutes les compétences liées à un métier, un poste de travail ou un travail précis. Lors des formations par compétences, chaque module est dispensé selon une méthode pédagogique, avec un objectif visé, une démarche pour y arriver, et un mécanisme de contrôle d’acquisition/maîtrise de chaque compétence attendue. Elle fait l’objet généralement d’une validation desdites compétences qui donne lieu, le plus souvent, à un Certificat d’aptitude, plus qu’un diplôme.
- Est-ce que ces nuances sont bien maîtrisées par les acteurs de la formation professionnelle, demande Guillaume ?
- Oui et non. Disons qu’elle embrouille certains et en amène certains à prendre l’approche par compétences pour ce qu’elle n’est pas.
Contrairement à ce que certains pensent, en effet, il s’agit des mêmes compétences dans les deux approches, qui vont permettre de réaliser tel ou tel travail. C’est juste une façon de mettre l’accent sur chacune d’elles et de s’assurer que les bénéficiaires les maîtrisent.
Lors d’un séminaire sur l’approche par compétence, à Dakar, je me suis trouvé assis, lors du déjeuner, à côté d’une dame qui venait de faire une présentation en séance plénière sur le sujet, pour son ministère. Une présentation qui fit douter certains participants de sa bonne connaissance de la problématique en jeu. La preuve en est qu’elle me laissa entendre, au cours d’une discussion, que selon elle, on ne parlait pas des mêmes compétences que dans la formation diplômante !
Beaucoup ont appréhendé l’approche par les compétences, adoptée ces dernières années dans différents pays et considérée comme une révolution dans le SFP8