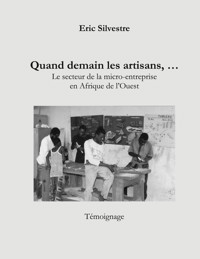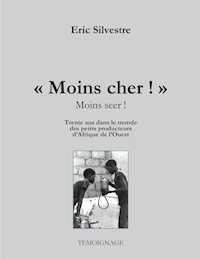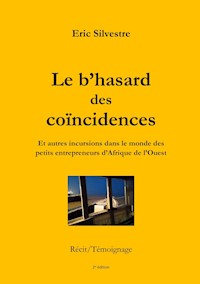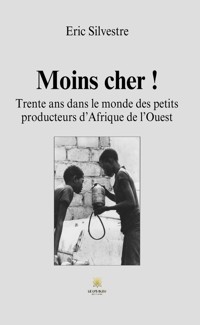
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
L’auteur, acteur atypique du monde de la coopération et du développement, dont le charisme repose sur la priorité donnée à l’observation, la capitalisation des acquis et leur partage, nous introduit au cœur des stratégies des Projets du BIT – Bureau international du travail – dont il a eu la charge. Il pose également un regard critique sur quelques problématiques majeures.
Cet ouvrage est un témoignage intéressant et un outil pour celles et ceux qui s’y engageront. La part de récit qui saupoudre ces lignes nous montre à quel point la vie d’expatrié, par ailleurs, ne manque ni de couleurs, ni d’émotions, ni de piment.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Eric Silvestre vit entre le Sénégal et la France. Il a passé plus de quarante ans en Afrique, en poste dans six pays et dans plus de vingt-cinq autres pour des missions. Après deux premiers ouvrages riches et vivants relatant son parcours de vie et de travail, ce troisième est conçu comme une capitalisation de trente années dans la promotion de la micro-entreprise et l’insertion des jeunes où il a acquis une expertise reconnue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eric Silvestre
Moins cher !
Trente ans dans le monde des petits producteurs d’Afrique de l’Ouest
Essai
© Lys Bleu Éditions – Eric Silvestre
ISBN : 979-10-377-9505-2
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Pour le BIT
Le cas du Sénégal, avec l’Équipe consultative multidisciplinaire pour l’Afrique sahélienne. OIT EMAS 1998.
Publications personnelles
Incursion dans le monde des micros-entrepreneurs d’Afrique de l’Ouest, récit/témoignage illustré (BoD 2021) ;
Incursion dans le monde des micros-entrepreneurs d’Afrique de l’Ouest, récit/témoignage (BoD 2022).
À celles et ceux qui m’ont accompagné dans mon parcours
professionnel et sur les routes de l’expatriation
Mes amis et collègues : Boubacar Djibo Harouna, Brahim ould Ndah, Camille Virot, Cyr Davodoun, Dame Diop, Emmanuel Cissé,
François-Georges Barbier Wiesser, François Lecuyer,
François Nannaba, François Ramseyer, Grégoire Detoeuf, Hamou Haïdara, Jacques Gaude, Jean Claude Woillet,
Laurence Guigou, Laurent Sawadogo, Michel Didier Laurent, Souleymane Sarr, Vatché Papazian, Yves Guémard
Mes collègues à Enda : Amadou Diallo, Anne Reynebeau, Emmanuel Dione, Fabrizio Terenzio, Huguette Lassort,
Maam Laity Diouf, Youba Sokona
Au BIT : Adlen Garidi, Alexandra Da Cruz, Amani, Ana Andrade,
André Bogui, Assitan Traoré, Boubacar Amani (Ganda), Carlos Maldonado, Caroline Kane, Castro Almeida, Cheikh Badiane, Constance Lopez, Dinastela Curado, Dieudonné Nahimana,
Djibril Coulibaly, Dramane Haidara, Evelyne Messanh, Fatim Ndiaye, Federico Barroeta, Floriane Leutzinger,
François Murangira, Hans Roeske, Katy Ndong,
Keith Van de Ree, Lawali Babale, Luc Vandeweerd,
Luigi Spinato, Marc Franck, Mohamed Ali ould Sidi,
Mpenga Kabundi, Noël Diallo, Ntéba Soumano,
Oumar Coulibaly, Paolo Barcia, René Daugé, Rachid Moussa, Roberto Pes, Sandro Mazzetti, Sylvain Senghor,
et tous les Formateurs et Maîtres formateurs GERME
À mes amis artisans et micro-entrepreneurs :
Abdoulaye de Niamey, Baba Diawara, Djiby Mbaye,
Landing Sané, Moussa Ndiaye, Olivier Lompo,
À mes familles première et plurielle, ma mère centenaire, mes sœur, beau-frère, neveux, nièces, petits neveux et nièces, mes fils, filleuls, petits fils et petites filles,
et tant d’autres
À celles et ceux qui ont compté dans mon parcours,
et nous ont quittés :
Mon père Marcel Silvestre, ma sœur Marielle, mon cousin Hervé.
Mes ami(e)s : Anne Jean-Bart, Daniel Ramet, Hervé Dubreil, Hussein Bahsoun, Patrick Scalbert, Pierre Martel, René Esmieu, Rose Michaud, Serge Devic, Tommy Diallo, Seydina Insa Wade
Oumar Ly, Demba Assane Sy, Ibrahima Sy, Grand père, Cissé
Mes collègues : André Deluc, Babacar Niang,
Francisco Monteiro, Hamadou Konaté,
Papa Kane, Simon Goldberg, Yakouba Coulibaly.
À Patrick de Lalande
qui vient de nous quitter
Mon ami, mon frère,
collègue si proche pendant nos années de travail
au Burkina Faso.
Genèse du livre
Écrire un livre n’est pas une aventure ordinaire, et s’il en est un qui n’était pas prédisposé à le faire, c’est bien moi. Et pourtant je l’ai fait. Trois fois.
Je me suis fait la main en rédigeant les rapports d’activités et de missions pour le BIT et des organisations internationales. J’ai assez rapidement compris leur vocation à terminer leurs parcours dans les tiroirs desdites organisations, et j’ai tout aussi rapidement fait le choix de leur humanisation, d’y glisser des histoires vraies qui permettent de comprendre comment on s’y est pris, pourquoi ça a bien ou mal marché.
Il m’est arrivé plusieurs fois d’en rédiger deux : un premier, qui allait sans doute terminer sa route dans les tiroirs, et un second, avec des commentaires sur la méthode. Bien des seconds n’ont pas manqué d’intéresser des collègues et consultants. Je me souviens des agents du Pnud de Guinée-Bissau qui m’ont dit qu’en expliquant les choses comme je le faisais, je livrais trop de clefs aux futurs exécutants sur les conditions de mise en œuvre du futur Projet, et que mieux valait les garder sous le coude pour les distiller plus tard, lors de son exécution.
C’est donc dans la rédaction de rapports d’activités ou de missions qu’est née ma modeste vocation d’écrivain, et que mon désir de témoigner de mes expériences professionnelles et personnelles, assez atypiques, il est vrai, mais peut-être utiles, a pris forme.
L’ouvrage que vous avez entre les mains, avec son drôle de titre, est le troisième d’une série de livres qui constituent un tout dont je me propose de vous tracer ici la genèse.
Le public auquel j’ai souhaité m’adresser dans le premier livre est celui de mes petits-enfants, « noirs et de couleur », à qui j’avais envie de raconter quel personnage est leur grand-père (blanc, on l’aura deviné) et de les sensibiliser sur sa culture et l’histoire de son pays, qui est un peu devenu le leur, en plus de leurs pays d’origine. Pour finir, je les ai abandonnés au bord du sentier1 et j’ai destiné l’ouvrage à un public friand d’aventures exotiques, on verra comment un peu plus loin.
Le public visé dans le deuxième livre est celui des lecteurs que la vie d’expatrié intrigue. Celles et ceux qui souhaitent mieux connaître l’univers dans lequel travaillent ces drôles d’individus que l’on appelle selon le cas, coopérants, conseillers techniques ou consultants ; qui reviennent d’Afrique, dans mon cas, avec des histoires de vie abracadabrantes, et parfois des loukoums dans les valises. Et au-delà de leurs univers professionnels, leur quotidien, avec, on le sait, nombre d’histoires abracadabrantes à leur actif.
Le public visé dans le troisième livre est celui des lecteurs que je qualifierai de professionnels, qui souhaitent avoir des idées plus claires sur les enjeux et les problématiques qui sous-tendent la coopération et le Développement : les stratégies, les méthodologies. Et ce, de façon directe, crue, moins spectaculaires que celles que dans la presse. Des lecteurs qui souhaitent peut-être s’engager dans le Développement. Disons qu’il s’agit d’une version hard, ou un peu plus hard, que le second.
Trois publics différents, trois livres, la chose paraît pliée, après coup. Mais dans la durée, cela n’a pas été simple.
Pour le premier livre, intitulé « La vie improbable de Julien des Faunes », j’avais opté pour le récit, avant de basculer dans la fiction, après qu’un ami m’ait donné l’idée de faire naître mon personnage dans un grenier. Après deux années de gamberge, la naissance de Julien des Faunes2 était imaginée, et de fait, le livre a effectivement changé de public et basculé dans la fiction. En se faisant conduire dans une librairie de Pushkar, au Rajasthan, pour une rencontre improbable entre un jeune architecte thésard en vacances et le personnage central du livre, le deuxième public y a trouvé son compte. Il termine sa route dans un petit village des Alpes-de-Haute-Provence pour une fin improbable, après des passages en Afrique centrale et sur le Nil.
Mon idée de raconter des histoires de vies est restée intacte, et je leur ai même donné parfois une dimension pédagogique. Le lecteur a notamment échappé au titre : « Comment utiliser correctement une serpillière pour laver le sol sans déplacer la saleté d’un côté à l’autre ». La part de récit reste importante mais au bout du compte, le livre bascule dans la fiction et n’est plus adapté à un public d’enfants !
Pour le projet de second livre, j’ai souhaité dépersonnaliser le récit et le centrer sur mon expérience professionnelle, en l’occurrence mes vingt années passées dans le développement, en général, et dans le monde de la microentreprise, en particulier. En majeure partie au BIT, le Bureau International du Travail. Mais l’envie de parler du quotidien improbable a fait de la résistance au point qu’au terme de l’écriture du manuscrit, il y avait deux histoires parallèles : l’une qui, malgré mon idée première, donnait une place importante à la vie d’expatrié, l’autre, à connotation plus technique, conçue comme un témoignage sur mes activités au sein du BIT. Chacune d’elles ciblait, force m’était de le constater, deux publics différents.
Le premier qui pouvait avoir lu le tome 1 et attendait la suite, le second qui s’intéresserait plus à la dimension technique, à l’expérience professionnelle, au témoignage sur le monde du Développement.
Deux parties distinctes avec à la clef, deux publics distincts, qui risquent de s’ennuyer à la lecture de l’une des moitiés du livre !
Il me fallait trancher.
C’est ce que j’ai fait en décidant de couper le manuscrit en deux et d’en reprendre l’écriture pour en faire deux livres distincts.
De ce fait, ce qui est devenu mon second livre, intitulé « Le B’hasard des coïncidences » (on verra pourquoi) a vu le jour. Un livre sous forme de récit, avec sa part de vie d’expatrié, donc, riche de ses surprises, de ses incongruités, de ses bonheurs furtifs et de ses drames, aussi, avec une part de vie professionnelle, sans trop entrer dans le détail, mais avec de quoi permettre aux lecteurs de comprendre comment ça se passe. Ce livre est ressenti par certains lecteurs comme une ode à la quête d’emplois et de compétences, pour les jeunes, une incitation à accepter les emplois qui s’offrent à eux, dans l’idée d’enrichir et d’élargir leur champ de compétences, jusqu’à trouver le bon emploi, ou de créer son auto-emploi. Celui qui permet à chacun d’entre nous de se sentir bien dans le poste qui lui est confié. Ou qu’il s’est confié. Nos parcours d’insertion gagnent à se nourrir d’expériences professionnelles diverses et à s’enrichir de compétences multiples et variées.
Mon propre parcours professionnel est fait d’une multitude d’emplois et ma carrière de deux périodes aussi distinctes que disparates. L’une que je qualifie de soixante-disarde3, qui a duré une vingtaine d’années, et l’autre, plus sérieuse, qui a duré vingt années de plus.
Quarante années à l’affût des hasards et des coïncidences que j’ai saisis, pour, au bout du compte, me construire un parcours d’insertion assez improbable qui m’a permis d’acquérir des compétences dont je me suis souvent servi, après coup, pour valoriser ce parcours. De ces faits, j’ai intitulé ce second livre : « Le b’hasard des coïncidences », qui constitue le tome 2 de la vie de Julien des Faunes, dont j’ai une nouvelle fois endossé le costume.
Le manuscrit recomposé a donné lieu, on l’aura compris, à un troisième livre qui laisse de côté les aventures de la vie d’expatrié et se concentre sur le champ d’intervention du conseiller technique et du consultant. Non sans raconter quelques anecdotes sulfureuses liées aux aléas du métier, car, on a trop tendance à l’oublier, être consultant dans le Sud n’est pas un long fleuve tranquille. Dans ce troisième livre que vous avez en main, je laisse de côté le costume de Julien des Faunes, que j’ai porté dans mes deux premiers ouvrages. Le titre, « Moins cher » (ou « Moins seer », en wolof), renvoie, sous forme de clin d’œil, à une triste réalité du secteur de la micro-entreprise et du quotidien de la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest, l’incontournable volonté de toujours vouloir faire ou payer moins cher.
Je reviendrai plus loin sur mon idée, au sortir de mes vingt années de BIT, d’effectuer une capitalisation des acquis et expériences, au regard des stratégies et méthodologies. Cela me paraissait très important pour la suite, mais cela n’a pas été possible, malheureusement, et c’est donc dans ce livre, dix ans plus tard, que je m’attaque à l’exercice.
J’essaie de restituer ce qui me reste en tête, et dans le cœur, de ce que j’ai vécu, tant du point de vue du travail effectué, que des imprévus qui en ponctuent le quotidien, étant acquis qu’à des milliers de kilomètres de chez soi, des imprévus prennent parfois des proportions surréalistes.
Je fais cette capitalisation pour celles et ceux qui partiront demain et pensent que l’expérience de leurs prédécesseurs peut leur être utile, que leurs réussites, échecs et erreurs comptent, qu’il n’est pas d’action aujourd’hui qui ne peut faire l’économie de celles qui ont été menées précédemment.
J’ai oublié beaucoup de choses, le lecteur peut l’imaginer, mais il en reste assez, et si je devais raconter dans le détail tout ce qui me reste en tête, il faudrait plusieurs tomes !
J’ai moi-même tiré parti de l’expérience de mes prédécesseurs, et, le lecteur le verra, de quelques phrases clefs, quelques phrases essentielles, à mes yeux, qui en disent plus que bien des discours. J’ai donné la priorité à l’observation du terrain, en privilégiant les relations Sud Sud. J’ai cherché autant que faire s’est pu, à croiser les expériences, échanger les documents pédagogiques, faire se rencontrer les acteurs, micros-entrepreneurs, artisans, mais aussi mes collègues conseillers techniques, chefs de Projets, agents des directions techniques concernées. J’ai bénéficié, à ce titre, de la ferme volonté de certains collègues et non moins amis pour aller dans ce sens.
Je me suis même battu pour rassembler autour d’un même Projet conjoint plusieurs Agences du Système des Nations Unies. Non sans difficulté ni sans prendre des coups inattendus ! Mais le jeu en valait la chandelle et ça a en partie marché.
J’espère que ce livre ira dans le même sens.
Eric Silvestre
Préface
Peu avant de quitter le Bureau international du travail (BIT) où il venait de passer vingt ans, et de prendre sa retraite, Eric Silvestre proposa d’effectuer un travail de capitalisation des acquis et expériences des deux décennies d’appui au développement de la micro-entreprise et à l’insertion des jeunes pendant lesquelles il s’impliqua directement à travers les Projets du BIT dont il fut le CTP ou conseiller technique, et réalisa de nombreuses missions.
Son intention était de rédiger un mode d’emploi des stratégies retenues et appliquées lors de la mise en œuvre des appuis, au regard de certaines méthodologies spécifiques élaborées par le BIT. Pour ce faire, il prévoyait de collaborer avec quelques collègues proches, béninois, burkinabè, cap-verdiens, français, maliens, mauritaniens, nigériens, suisses, sénégalais, et de tenter de faire un travail aussi exhaustif que possible.
Sa proposition fut entendue et les encouragements ne manquèrent pas mais son projet ne fut pas mis en œuvre. C’est dommage, tant il est vrai qu’un tel travail, à chaud, aurait permis de coucher sur le papier nombre de réflexions, d’analyses, de commentaires, de critiques constructives, et de pistes à développer.
Toutefois, selon le vieil adage qui dit que la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié, et parce qu’Eric Silvestre fut un passionné dans son travail, je ne doute pas que le meilleur de son expérience du terrain lui reste en mémoire.
Cela nous a semblé suffisant pour lui demander, près de dix ans après son départ, de revenir sur ses vingt années au sein de notre Maison, de chercher dans ses souvenirs ceux qui l’ont le plus marqué, ce qu’il a envie de transmettre, avec le recul, à celles et ceux qui étudient le passé récent de l’univers du développement, ou qui se sont engagés ou s’engageront sur ses traces.
Le présent ouvrage témoigne de cette expérience passionnante qui l’a conduit à vivre dans cinq pays où il a occupé des postes de conseiller technique, et à séjourner dans une vingtaine d’autres où il a effectué des missions, tant pour le BIT que pour quelques partenaires.
Ce livre illustre également la générosité d’un praticien du développement qui a tenu à partager la somme de connaissances et d’expériences accumulées au cours de plus de deux décennies de praxis4 dans le secteur de l’artisanat et d’interactions, tant avec les institutions nationales publiques et privées en charge du développement qu’avec les opérateurs et opératrices du secteur de la micro et petite entreprise, jeunes femmes et jeunes hommes en apprentissage, en formation professionnelle ou en quête d’insertion.
Il apporte dans cet ouvrage un éclairage technique personnel sur cinq grands thèmes qui l’ont occupé et passionné pendant son parcours professionnel, et nous livre quelques éléments d’analyse des différentes problématiques en jeu qui, à nos yeux, restent d’actualité et pourront être utiles, demain, lors de la mise en œuvre des prochains Projets de développement.
Son témoignage éclaire le lecteur sur le monde méconnu de la Coopération et du Développement, dont il opère une relecture lors de ses conversations avec Guillaume, son interlocuteur, et avec différents partenaires. Une relecture plus humaine que strictement technique ou politique, ponctuée par des anecdotes sur la vie de Chef de Projet, d’expatrié, de consultant, avec ses aléas heureux ou malheureux, qui constituent le quotidien de sa vie dans l’univers du Développement. En Afrique de l’Ouest, beaucoup, mais aussi au Vietnam, au Rwanda, en Tunisie et en Haïti.
Ce livre permettra, je l’espère, aux jeunes qui s’engageront demain sur les chemins du Développement international en général, et du secteur de la micro-entreprise, en particulier, d’avoir à l’esprit quelques repères et idées utiles pour leur gouverne. De même qu’une meilleure appréhension de cet univers très particulier, en vue de son appropriation.
Eric Silvestre a conservé quelques réflexions ou phrases prononcées par ses interlocuteurs, jeunes et moins jeunes, ou écrites par des collègues, qui illustrent mieux que mille discours, certaines problématiques. Certaines, prononcées par des jeunes artisans, comme cet apprenti mécanicien de Dakar qui parle de son ami et dit :
— Celui-là il peut démonter, mais il ne peut pas remonter.
Ou ce patron mécanicien qui dit de l’apprentissage :
— Nous qui sommes leurs patrons, nous leur apprenons la pratique seulement, car nous-mêmes nous n’avons appris que la pratique. La théorie ils peuvent l’apprendre à l’école.
Ou encore cette phrase clé prononcée par le Directeur de la formation permanente :
— À secteur informel il faut des réponses informelles.
Pour finir, c’est sans aucun doute la recommandation de Jean Claude Woillet, autre illustre collaborateur du BIT et fin connaisseur des arcanes de la coopération au développement, portée dans le rapport d’évaluation du Projet de Ouagadougou dont Eric Silvestre était le responsable, qui explique le mieux sa démarche d’écriture :
— Le surcoût de l’expertise internationale doit être compensé par une production intellectuelle qui permette de capitaliser et reproduire les expériences menées.
Cette dernière réflexion, je l’ai constaté par la suite, l’a poussé à rédiger de très nombreux documents techniques et à produire des rapports d’activités et rapports de mission qui ont fait date, riches de commentaires sur la méthode, quand il était en poste dans des Projets du BIT. Ses rapports, comme certains documents de Projets qu’il écrivit ou contribua à écrire, ont souvent constitué des mines d’informations, car il était généreux dans sa rédaction et n’hésitait pas à donner des indications sur la mise en œuvre des activités. Ce que certains collègues lui reprochaient parfois, disant que mieux valait les garder sous le coude pour le temps de l’exécution ! Est-il nécessaire d’ajouter que c’est sans nul doute cette recommandation qui l’a poussé à écrire ce livre ?
C’est dire combien cette œuvre est un précieux legs aussi bien pour la génération actuelle de jeunes experts engagés dans la voie de la Coopération au Développement que pour les praticiens expérimentés et établis qui ne manqueront d’y trouver des sources d’inspiration et autres pistes fécondes de solutions aux problématiques toujours actuelles que charrie la mise en œuvre des Projets de développement.
Cette contribution élaborée avec passion et dans un réel esprit de partage illustre parfaitement la nature singulière d’un expert d’une rare compétence et d’une infinie générosité.
Son témoignage est aussi celui d’une vie d’expatrié et de grand voyageur, marquée par des aventures aussi improbables que cocasses, dues, tant aux aléas de son implication sur le terrain qu’à ses escapades dans les pays où il a vécu et voyagé. Il nous livre à cette occasion quelques anecdotes croustillantes, utiles et, parfois, pimentées.
Cheikh Badiane
Spécialiste Senior du développement des entreprises
et de la création d’emploi
(Bureau international du travail)
Préambule
Nous, qui sommes leurs patrons,
Nous leur apprenons la pratique seulement,
Car nous-mêmes, nous n’avons appris que la pratique.
La théorie, ils peuvent l’apprendre à l’école.
Un patron de garage à Rebeus, Dakar
Ces propos recueillis lors du tournage d’un film sur l’apprentissage sonnent comme la clef de la problématique de la modernisation de l’apprentissage dans le secteur artisanal utilitaire moderne. Et ils nous renvoient directement à l’histoire de la formation professionnelle aux siècles passés.
Guillaume sera dans ce livre mon principal interlocuteur. C’est un jeune architecte que je pourrais avoir rencontré à Pushkar dans une librairie, à l’occasion d’un voyage en Inde, en 2016. Il y aurait achevé un voyage d’études sur l’incidence de quelques architectures spécifiques sur la vie des gens qui en occupent des maisons représentatives. Le but de nos discussions, cette fois, est de rendre compte, non plus des aventures de mon clone romanesque, Julien des Faunes, mais des vingt et quelques années de mon parcours professionnel dans le monde du Développement, en général, et dans celui de la micro-entreprise, en particulier, la plupart du temps au sein du BIT.
Nous aborderons ensemble cinq grandes problématiques du monde de l’artisanat et de la micro-entreprise, dont la première, consacrée à leur organisation, constitue d’une certaine façon, le chapeau de l’ensemble de ces thématiques.
Les autres peuvent en être considérées comme des déclinaisons dont l’importance, toutefois, justifie, dans les Projets de Développement et dans le présent ouvrage, une prise en compte spécifique.
Chaque thème fera l’objet d’un préalable destiné à en situer la problématique au vu des actions que j’ai menées et dont je rends compte dans cet ouvrage. Avec le recul du temps. Et du retraité que je suis devenu !
La période qui précéda mon entrée dans une vie active que je qualifierais de normale, politiquement correcte, voire sérieuse, est celle du soixantedisard (héritier de 68), qui fit le choix de partir vivre à la campagne et d’y devenir menuisier, après avoir fait des études d’ingénieur, en rupture avec un milieu socioculturel pesant, soucieux de justice sociale, intéressé par l’éco-construction, la découverte de l’autre, des autres. Lequel, pour finir, est parti non pas en Inde, comme la grande majorité de mes amis, mais en Afrique, pour un premier séjour de trois ans qui changea le cours de ma vie. J’en revins par l’Est, la vallée du Nil le Soudan et l’Égypte, et je me suis installé en Haute Provence. Comme menuisier.
Guillaume comprit, dès nos premières discussions, que les décennies 70 et 80 furent riches d’activités aussi passionnantes que variées, et ce, dans des domaines parfois assez éloignés de mes compétences premières (le bâtiment). J’ai travaillé dans les secteurs privé et associatif, j’y ai gagné ma vie de façon très irrégulière, avec des périodes confortables et d’autres de vaches maigres, voire de chômage. Je les ai mises à profit pour effectuer des reconversions professionnelles. J’ai traversé quatre fois le Sahara et y ai réalisé quelques films, j’ai exercé différents métiers, dans le bâtiment, d’abord (diplôme de l’ESTP5 en poche), au Cameroun et en Mauritanie, puis dans la décoration et la capture d’animaux sauvages, la menuiserie, la restauration de maisons anciennes, l’animation de stages, la cuisine, le management et la production d’artistes musiciens, la photographie, l’audiovisuel.
À ce titre, j’ai réalisé plusieurs documentaires, le premier, qui m’ouvrit les yeux sur le monde de l’apprentissage, et le dernier, qui m’ouvrit les yeux sur la microfinance. Au bout du compte, il s’avéra que les expériences vécues et les compétences acquises pendant cette période un peu dissolue constituèrent le terreau de ma carrière professionnelle à venir.
Ce n’est qu’à quarante ans que j’ai commencé à travailler comme tout le monde, à des postes bien définis, avec des journées de travail de huit ou dix heures, des congés payés, une protection sociale en bonne et due forme, et au bout du compte, par le biais d’un hasard que je n’attendais plus, une retraite décente. L’évènement majeur qui marqua la rupture entre ces deux époques fut mon entrée dans le Système des Nations Unies, au BIT, où je devins d’emblée conseiller technique principal d’un Projet au Mali, et fonctionnaire, avec des contrats à durée limitée, d’un an, selon la mauvaise habitude du Système. Mais des contrats renouvelables chaque année, qui le seront une quinzaine de fois. Merci quand même !
Être conseiller technique dans le secteur du Développement n’est pas un métier en soi. On y vient plus par le biais de l’expérience et des compétences acquises sur le terrain que par le charme exercé par des diplômes acquis à l’Université ou dans des écoles supérieures sur les employeurs dudit secteur.
Mes choix de postes furent pour beaucoup, on le verra, le fruit de hasards et de coïncidences, opérés consciemment, tant du point de vue des missions qui me seraient confiées, que des pays où je devrais séjourner.
Pour le plaisir, toujours, et souvent du fait de mes bonnes relations avec les gens que j’allais retrouver dans le travail. J’ai refusé des postes lucratifs que je ne sentais pas, malgré le confort qu’ils m’auraient apporté, dont un au Niger, sur lequel je reviendrai. J’ai fait une fois le choix de partir dans un pays où je n’avais plus de raison d’aller, tant il était situé au fin fond du Sahel. J’y suis parti par intérêt financier, je l’avoue, en quête des points de retraite qui me manquaient, mais pour finir, ce fut ma plus belle aventure professionnelle et de vie d’expatrié.
Mon parcours dans le Système des Nations Unies fut quelque peu hors normes, on le comprendra à la lecture de ce livre, à commencer par mon entrée, qui surprit nombre de mes amis. J’y fus de toute évidence un fonctionnaire atypique, tant du point de vue de ma personnalité que de ma démarche. J’y ai fait mon chemin et j’y ai été, semble-t-il, apprécié, au point de m’être vu confier quatre postes de Chef de Projet, un de conseiller technique, et des dizaines de missions de consultant, même après mon départ à la retraite.
Je suis resté fidèle à l’esprit de ma démarche, et j’ai toujours eu pour principe de me baser sur l’observation et l’analyse du terrain, plutôt que sur les idées préconçues, les statistiques, les cas de figure et les stratégies importés : une approche pertinente qui permet de procéder en connaissance de cause au plus près des réalités et sans se fonder sur des a priori et des solutions copiées-collées, fussent-ils le fruit d’expériences intéressantes, mais acquises ailleurs dans des contextes parfois similaires. Des expériences qui restent à contextualiser et à adapter à la réalité des pays concernés. Mieux valait, à mes yeux, scruter le milieu dans lequel j’allais évoluer, écouter les gens, parler avec eux, observer leurs modes et méthodes de travail, comprendre comment ça marche et, le cas échéant, pourquoi ça ne marche pas, puis essayer de mener des actions croisées, fondées sur ces préalables, quitte à sortir des chemins tracés et à opter pour des stratégies novatrices.
J’établis volontiers un parallèle entre les parcours d’insertion des jeunes en quête d’emploi et les parcours professionnels des acteurs du Développement.
En montrant comment chacun se construit au fil des étapes de sa vie, de ses expériences et acquis du terrain. Voire de lectures de revues techniques, mais pas que ! Ni pas trop. « J’ai travaillé des années durant avec une personne qui photocopiait des centaines de documents chaque jour, qu’elle stockait chez elle. Et devait lire, mais à quelle fin, je ne saurais le dire ? Toujours est-il que je l’ai entendue tenir des propos sur l’artisanat qui n’avaient pour dire vrai guère de lien avec la réalité du terrain. Une réalité assez méconnue, il est vrai, des théoriciens et consultants en costumes qui hésitent à entrer dans les ghettos et autres zones d’activités artisanales assez poussiéreuses et enfumées. Notamment chez les forgerons fondeurs. En tout état de cause, ses prises de position renvoyaient à une approche très théorique du secteur concerné. »
Avant de déterminer une stratégie et de mettre en œuvre des appuis, il est nécessaire et utile de prendre son temps, de bien observer les contextes dans lesquels les bénéficiaires évoluent, de s’informer de leurs réactions dans des situations semblables à celles dans lesquelles d’autres se sont trouvés, pour mieux comprendre les comportements, les différences, les similitudes. Les responsables locaux des pays où l’on travaille revendiquent souvent des différences et spécificités vis-à-vis des pays voisins, alors que cela n’est pas toujours vrai. À bien y regarder, les études menées en amont des Projets montrent que les comportements des individus au sein de groupes sociaux similaires sont globalement (voire statistiquement) assez proches d’un pays à l’autre. Il faut procéder par étapes, aller à la rencontre des petits producteurs, mettre les pieds dans la boue, ou le sable, accepter de boire un thé ensemble, voire de manger sur la natte, de se frotter aux atmosphères chaudes et parfois un peu grasses, prendre le temps, ne pas être pressé, attendre, laisser venir les petites phrases qui donnent les clefs.
Il faut ensuite transformer son expérience en éléments de compétence, jusqu’à disposer d’une compétence plurielle qui confère à notre propre personnalité son originalité, sa force, et sa capacité à apporter des plus-values. La valeur d’un Chef de Projet ou d’un consultant relève beaucoup plus de ses acquis du terrain que des diplômes reçus dans les écoles.
Il est un autre élément de compétence à prendre en compte chez le futur conseiller technique, et plus encore Chef de Projet : son savoir être, pour parler technique, ou sa capacité à travailler avec ses homologues, à croiser ses connaissances avec les leurs, à faire preuve d’abnégation, à puiser dans la compétence de l’autre ce qui peut le renforcer.
Il y va de sa vie professionnelle, de sa réussite, et plus encore de l’efficacité du Projet dont il a la charge, et des synergies développées entre les Projets partenaires.
Chapitre 1
Trois problématiques majeures
Guillaume et moi avons beaucoup travaillé à l’écriture des deux précédents ouvrages, qui oscillaient entre fiction et récit, mais cette fois, il n’est question, je l’ai dit, que de rendre compte d’un parcours professionnel et d’un engagement auprès des artisans et petits entrepreneurs, que je ne désignerai plus comme des acteurs du secteur informel, dans lequel je n’ai plus envie aujourd’hui de les ranger. Notamment quand ils sont en formation dans des centres de formation professionnelle ou des lycées techniques et que l’on peut dire qu’ils comptent parmi l’élite de la jeunesse et constituent le fer de lance du sursaut économique de demain.
— Pourquoi ce titre étrange, « Moins cher », s’étonne Guillaume ? Qu’entendez-vous par là ?
— Parce que c’est le cœur du problème. Dans le milieu de la micro-entreprise, la tendance est toujours à tirer le prix vers le bas, donc d’acheter moins cher, pour le client, et, par obligation, de vendre moins cher, donc de fabriquer moins bien pour le producteur.
— En quoi cela constitue-t-il un problème, demande Guillaume ?
— Tu as raison de poser cette question. On pourrait ne pas y voir d’ambiguïté, de menace pour le secteur, ou bien dire que c’est la même chose partout ! Pourtant c’est un vrai problème. Tellement vrai, d’ailleurs, que même Auchan Sénégal en a fait sa devise : Moins cher tout le temps.
— Pour Auchan, dit Guillaume, on peut y voir l’exception qui confirme la règle, car bizarrement, cette grande surface semble avoir un effet positif sur le marché local, d’après certains Sénégalais.
Notamment sur les vendeuses de légumes dans les marchés, dont nombre de clients commencent à bouder les fruits et légumes qui sont vendus à même le sol. Alors qu’à Auchan, ils sont présentés sur des étals propres, et ne sont pas plus chers.
— Pour la micro-entreprise, cet état de fait engendre une succession de dommages, non pas collatéraux, mais directs, raison pour laquelle j’ai choisi cette expression comme titre de ce livre : « Moins cher », en français, « Moins cher », en wolof (du Sénégal).
En tirant le prix vers le bas, le client oblige l’artisan à tirer la qualité vers le bas, et la spirale négative s’enclenche. En écho aux politiques actuelles qui prônent la croissance accélérée et l’émergence du pays, cette situation du moins cher tire l’économie vers le bas, vers la stagnation, la survie.
— Mais d’ailleurs, s’inquiète Guillaume, peut-on programmer l’émergence ?
— Bonne question, en effet. Pour te dire le fond de ma pensée, je pense que non. Elle se constate mais ne se programme pas. Toutes les économies sont censées aller vers la croissance et l’émergence, mais la plupart d’entre elles n’y vont pas ! Quand l’une d’elles y parvient, alors le monde s’étonne et qualifie le pays d’émergent.
La question est de savoir ce qui a été fait pour que le pays se trouve en situation d’émergence ? Qu’est-ce qui a changé ? Qui a changé de comportement, et qui a fait quoi ? Quand les producteurs et les consommateurs ne s’inscrivent pas dans une spirale ascendante, dans une dynamique de développement palpable, le secteur s’informalise et stagne.
On retrouve cette dynamique négative dans bien des situations, et elle se traduit par une absence d’éthique dans la démarche commerciale des vendeurs, de propreté, d’hygiène, de qualité. Tout cela pour rester moins cher et satisfaire le client qui veut dépenser moins.
En obligeant les femmes à vendre sur des tables, dans les marchés, les boutiques, les kiosques, les places matérialisées, les maires s’inscriraient dans une politique résolument émergente, écologique, protectrice de l’environnement et de la santé de leurs électeurs. Les vendeuses et leurs clients s’inscriraient dans une dynamique de développement dont ils enclencheraient le processus, avec à la clef, une bonne gestion de leurs activités par les femmes, la qualité des produits pour les clients, du travail et des revenus pour les menuisiers qui fabriqueront les présentoirs et tables. Et comme effet collatéral, les clients obligés de payer les fruits et légumes un peu plus cher seraient obligés de travailler un peu plus, et en retour seraient payés un peu mieux, ce qui ne ferait pas de mal à la croissance de l’économie !
— Si je comprends bien, dit Guillaume, c’est votre expérience de vie et de terrain qui a le plus compté dans la construction de votre profil et dans le choix de votre personne par le BIT.
— Tout à fait. Nous aurons diverses occasions de parler du mécanisme d’entrée dans la vie active par la bande, pourrait-on dire, ou par le terrain. Ce qui fut mon cas, je l’avoue. Il est clair que je n’ai pas construit mon parcours professionnel sur un diplôme, même si j’en avais un en poche, de l’ESTP. Je suis d’ailleurs assez réservé sur la portée de certains diplômes, au vu des compétences sous-entendues dans leur énoncé. J’ai un bon exemple pour illustrer ce point de vue. Au Cameroun, un chef d’entreprise m’a proposé un poste, arguant du fait que mon diplôme me désignait comme l’homme de la situation pour diriger un chantier de bâtiment. En fait il avait tout faux et son attitude illustre bien la fascination qu’exercent les diplômes.
Il était persuadé que je maîtrisais les compétences de l’ensemble des matières couvertes par mon diplôme de l’ESTP, alors que, comme pas mal de mes collègues étudiants, j’avais fait l’impasse sur les matières qui ne m’intéressaient pas, notamment la résistance des matériaux et le béton armé.
Le directeur aurait été surpris, si j’avais accepté sa proposition, de constater que j’étais incapable de faire le moindre calcul de béton armé !
— Cet exemple, répond Guillaume, illustre bien l’ambiguïté de la formation diplômante, notamment quand il y a de nombreuses matières au programme. Le diplôme est accordé au vu de la moyenne obtenue à l’examen et ne garantit pas, comme vous le démontrez, la maîtrise de l’ensemble des compétences citées dans l’énoncé du diplôme.
— Cela est vrai pour certains diplômes, car je ne conteste nullement la validité des compétences acquises et validées par des diplômes dans l’économie, la médecine, l’architecture, l’agronomie ou la finance.