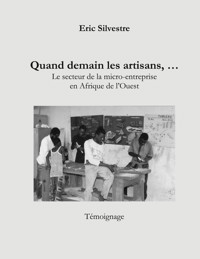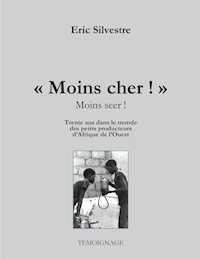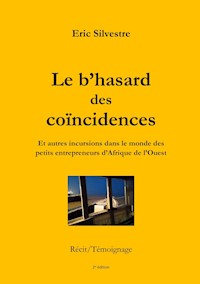
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Julien des Faunes
- Sprache: Französisch
L'auteur endosse de nouveau le costume de Julien des Faunes et confie à Guillaume (le jeune architecte prétendument rencontré à Pushkar, en Inde) le soin de détricoter son parcours de vie qu'il qualifie de "B'hasard des coïncidences" : des années 70/80, débridées, aux années 95/2015, plus sérieuses. Le narrateur jongle avec les éléments qui ponctuèrent la vie de l'auteur, de conseiller technique et consultant dans le monde du Développement et des petits entrepreneurs, en Afrique de l'Ouest, et au-delà, en même temps que d'expatrié. Des vies nourries de rencontres, d'amitiés et d'évènements improbables. (Voir : La vie improbable de Julien des Faunes. The Book Edition, 2019)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
La vie improbable de Julien des FaunesRoman The Book Edition – 2019
Le b’hasard des coïncidencesRécit BOD 1ère édition 2021
…..
Livres en chantier
Moins seer ! (Moins cher !)Vingt ans auprès des artisans et micro-entrepreneurs Témoignage
Banon : La folle épopée des années 70Ouvrage collectif à tirage limité
Recueil de nouvelles insolitesNouvelles
2e édition corrigée et amendée Mai 2022
A mes collègues et amis qui m’ont accompagné dans mon parcours professionnel et sur les routes de l’expatriation
Abel Ndong, Aïssa Dione, André Deluc, Boubacar Djibo Harouna, Dominique Gros, Boubé Bagnou, Boris Kokou, Camille Virot, Chantal, Martial et Emile Berthier, Emmanuel Cissé, Emmanuel Dione, Fabrizio Terenzio, François et Aimée Lecuyer, François Nannaba, Gilles, Sergine, Florence, Grégoire, Swan et Tom Scalabre, Gerald Belkin, Huguette Lassort, Idrissa Diop, Laurent Sawadogo, Michel Didier Laurent, Nadjirou Sall, Madeleine Devès Senghor, Mauro Petroni, Oumar Sow, Pierre Brasset, Patrick de Lalande, Michèle Scalbert, Seydina Insa Wade, Souleymane Sarr, Vatché Papazian, Vincent Roca, Yves et Aissata Guémard
A Enda : Amadou Diallo, Huguette Lassort, Jacques Bugnicourt, M Laity Diouf, Youba Sokona,
Dans les Projets BIT : Ana Andrade, André Bogui, Assitan Traoré, Brahim ould Ndah, Carlos Maldonado, Cheikh Badiane, Cyr Davodoun, Dame Diop, Dinastela Curado, Dieudonné Nahimana, Djibril Coulibaly, Dramane Haidara, Federico Barroeta, François et Franka Ramseyer, Hamou Haïdara, Hans Roeske, Jacques Gaude, Jean Claude Woillet, Keith Van de Ree, Luigi Spinato, Mohamed Ali ould Sidi, Noël Diallo, Ntéba Soumano, René Daugé, Roberto Pes, Sandro Mazzetti, Roberto Pes et tous les Formateurs et Maîtres formateurs GERME
A mes amis artisans et micro-entrepreneurs : Abdoulaye, Baba Diawara, Boubacar Djibo Harouna, Djiby Mbaye, El Hadj Seydou Tall, Moussa Ndiaye, Racine Tine, Racine Diop, Olivier Lompo, et tant d’autres
A ma mère, centenaire, qui ne pourra pas me lire. A mes familles première et élargie : sœur, beau-frère, nièces, neveux, fils, filleuls et petits-enfants, dont les deux petits Éric, devenus petits Julien le temps d’un livre
A celles et ceux qui nous ont quittés trop vite : Patrick Scalbert, ami d’enfance et frère, présent dans mes deux livres, Hussein Bahsoun, rencontré en Mauritanie et retrouvé au Sénégal. Mon père Marcel Silvestre, ma sœur Marielle, mon cousin Hervé. Anne Jean-Bart et Rose Michaud. Daniel Ramet, Hervé Dubreil, Pierre Martel, René Esmieu, Serge Devic, Tommy Diallo, Seydina Insa Wade Mes amis de Podor, Oumar Ly, Demba Assane Sy, Ibrahima Sy, Grand père Mes jeunes amis : César de Lalande, Papis, Ali de Bamako, Doudou le griot, Ousseynou. Mes collègues : Hamadou Konaté, Babacar Niang, Francisco Monteiro, Yakouba Coulibaly, Simon Goldberg.
Table des matières
Préface
Chapitre 1 : Le b’hasard des coïncidences
Chapitre 2 : Vous avez dit soixantedisard !
La parenthèse mauritanienne
La parenthèse cinéma
Le 1
er
film : les apprentis mécaniciens
Le 2
e
film : les jeunes pêcheurs
Le 3
e
film ! une journée de trois enfants
La parenthèse Enda
Vincent Roca
Seydina Insa Wade
Christian Rist
Les enfants de la rue
Les traversées du désert
Chapitre 3 : Début de normalité
Chapitre 4 : Le Mali
Les maîtres du feu
Les potières
Les forgerons fondeurs récupérateurs
Chapitre 5 : 1
ère
mission de consultant
Chapitre 6 : Le Burkina Faso
Chapitre 7 : Parcours de consultant
Chapitre 8 : Le Niger
Aléa de la vie de consultant
Chapitre 9 : Voyage éclair au Vietnam
Chapitre 10 : Le Sénégal
Chapitre 11 : Les dernières missions
Guinée Bissau : it’s not a pizza !
La cerise sur le gâteau : le Cabo verde
La der des ders
Chapitre 12 : La retraite, pour de vrai
Anne Jean-Bart
Clap de fin
Supplément pour la route : Histoires de terre
Bibliographie
Préface
« Hier soir, j’ai fait un rêve, Je me suis réveillé, et le rêve m’a montré la voie. J’ai rêvé qu’on peut avoir le même père, la même mère, la même éducation dans la même maison, mais que chacun a sa voie. »Seydina Insa Wade (Gent)
Avant d’avoir une fin, les histoires ont une suite. Ce n’est pas un proverbe, ni un dicton, juste un constat. C’est aussi un argument pour justifier l’écriture d’un second ouvrage après un premier. Ceci, par contre, est une lapalissade, diront certains !
Le présent ouvrage constitue la suite de La vie improbable de Julien des Faunes, un roman/récit qui nous a laissés dans un village de Haute Provence en 1975. Ce Tome 2 commence dans les années 70/80, après les changements sociaux, culturels et politiques des années 60, ponctuées par le phénomène hippy et Timothy Leary, en Amérique, mai 68, en Europe, quelques livres culte, de Jack Kerouac, HD Thoreau, Aldous Huxley, Carlos Cas-taneda, Herman Hesse, et en France, Michel Lancelot, et la route, vers l’Inde, l’Afrique ou la campagne. Sans oublier la musique, de Jefferson Airplane à Gérard Manset, via les Beatles et Ravi Shankar.
« Il suffit d’écouter la musique des années 70 pour comprendre à quel point ces années ont été belles », dit David Crosby à la fin du documentaire intitulé « Laurel canyon », diffusé par Arte fin 2020.
Après ces deux décennies de vie de soixantedisard, l’histoire se poursuivra avec les années 90/2015, qui, pour Julien des Faunes, seront plus sérieuses. Toujours improbables, et ponctuées par des hasards et des coïncidences.
« Tout ou presque, dans ce livre, est récit, donc exact », tient à préciser l’auteur. Contrairement au livre précédent, où la part de fiction occupait une certaine place. Ici, elle est totalement absente. Ou presque. Ce B’hasard des coïncidences est une sorte de Samaritaine où l’on trouve de tout, des moutons, des conseillers techniques, une table qui double une voiture, des esclaves, des vodkas orange corsées, un tonton macoute en furie, de la bière de mil, un bébé emmené en voyage d’étude, un système de financement abracadabrant, des musiciens, des comédiens, des maisons en terre, ...
Et à travers les innombrables évocations du monde de la micro-entreprise, de l’apprentissage, du micro-crédit, de l’organisation du secteur artisanal, de l’insertion des jeunes et de la formation professionnelle, on trouve surtout une invitation à l’aventure professionnelle, à l’expatriation, à la saisie des opportunités qui s’offrent à toutes celles et ceux qui souhaitent travailler, acquérir des compétences, enrichir leur CV, s’essayer dans différents métiers, sans craindre l’échec mais au contraire, dans l’idée que c’est comme cela que l’on se construit un profil professionnel. Tout est mis en scène et en ordre par Guillaume, le jeune architecte que Julien des Faunes dit avoir rencontré dans une librairie de Pushkar. Avec quelques coups de mains des petits enfants de l’auteur, les petits Julien, qui ne manquent pas les occasions de tirer les vers du nez de leur improbable grand-père.
Chapitre 1 : Le b’hasard des coïncidences
« Vivre est la chose la plus rare, la plupart des gens se contentent d’exister »Oscar Wilde
- Avant d’en venir à notre nouveau projet, demande Guillaume, j’aimerais vous demander une faveur.
- Je t’en prie, Guillaume, à quoi penses-tu exactement ?
- J’aimerais vous appeler Julien, si cela ne vous dérange pas, ça serait plus simple !
- Ça ne me dérange pas du tout, au contraire ! D’ailleurs, à la lecture de ton livre, j’ai trouvé qu’il y avait trop de Julien des Faunes dans le texte. Tu aurais pu sauter le pas plus tôt !
- Ok. Venons-en maintenant à notre projet de tome 2, si vous le voulez bien, dit Guillaume. Nous avons du pain sur la planche, avec plus de quarante ans de vie à décrypter !
- Je vois qu’il y a ici deux jeunes garçons qui trépignent d’impatience et ont, semble-t-il, une question au bout des lèvres depuis quelques minutes.
Ce sont les deux petits Julien. Leur grand-père se tourne vers eux et les invite à entrer dans la conversation.
- Papy Julien, dit l’un d’eux, nous avons une question à te poser. Tu es notre grand-père mais comment se fait-il que tu sois blanc et que nous soyons noirs ?
- C’est une bonne question, et je sens qu’elle vous tarabuste depuis pas mal de temps !
- Elle nous quoi, papy, demande l’un des enfants ?
- Elle vous tarabuste. C’est un mot bizarre, en effet, cher à Boby Lapointe, un chanteur français des années 60 qui aimait jouer avec les mots. Tarabuster veut dire tourmenter, torturer. La réponse à votre question est liée à une série de hasards et de coïncidences sur lesquels je reviendrai de temps en temps. Mais d’ailleurs, est-ce que vous connaissez le sens de ces mots un peu compliqués ?
- Bien sûr, papy. Le hasard est une chose qui arrive au moment où l’on ne s’y attend pas, répond un des enfants.
- Les coïncidences sont des choses qui arrivent en même temps, dit l’autre.
- Vous êtes brillants mes biquets ! Vous verrez que ma vie s’est construite au gré de hasards et de coïncidences, en effet, et que cela est également valable pour mon travail. Sans compter le fait d’avoir des petits-enfants noirs : vous. Vous savez, ce sont ces hasards et coïncidences qui m’ont donné des occasions de changer de travail, de statuts et de pays, et aussi de croiser les routes de vos papas que j’ai adoptés ou qui sont devenus mes filleuls.
- Mais vous, par contre, vous n’êtes pas le fruit d’un hasard ou d’une coïncidence. Vous êtes les fils de mes fils et filleuls, tout beaux et bien vivants : mes petits-fils donc. Noirs, il est vrai, mais là n’est pas le problème. C’est une situation à laquelle on ne peut rien changer. Alors pourquoi s’en inquiéter ? C’est comme ça. Si problème il y a, c’est plus lié au fait que vous êtes à cheval entre deux cultures, celle de vos parents africains, et la mienne, car vous avez maintenant des ancêtres noirs et des ancêtres blancs !
- Tu parles de Muti, demande l’un des petits Julien ?
- Oui. Votre arrière-grand-mère. Cette affaire de double culture est beaucoup plus complexe que nos couleurs de peaux respectives. Nous en reparlerons tranquillement. Depuis que j’ai adopté vos papas, mes ancêtres sont un peu devenus les vôtres, et à travers eux, vous pourrez comprendre certaines choses sur la société et la culture françaises.
- Sur les gaulois, demande l’un des enfants ?
- Mais non, pas sur les gaulois, leur histoire est beaucoup plus vieille que celle de ma famille ! Moi je vous parle de mes ancêtres proches, mon père, mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, à propos de qui je vous raconterai quelques petites histoires.
- On ne les a pas connus, s’exclame un des petits Julien !
- Non, bien sûr. Moi non plus, d’ailleurs. Si vous connaissez un peu leur histoire, vous comprendrez un peu mieux la mienne, et celle de votre deuxième pays, la France. C’est important de connaître l’histoire et la culture de son pays d’adoption.
- Waouh, s’exclament les enfants ! Ça va faire du taf pour nous souvenir de tout ce que tu vas nous raconter.
- Oui, mais ça sera passionnant. Vous en saurez deux fois plus que vos copains et copines.
- Mon papa m’a dit que mon arrière-grand-père était tirailleur sénégalais, et qu’il a travaillé comme cuisinier pendant la guerre, en France. Puis au Sénégal, à son retour.
- C’est vrai. Et bien parlons-en, justement. Tu connais le métier de ton papa ?
- Oui, il est chef cuisinier, répond son petit-fils.
- Et alors, qu’est-ce que tu en conclues ? Ne penses-tu pas qu’il y a un lien entre l’histoire de ton père et celle de son grand-père ! Quand j’ai commencé à m’occuper de ton papa, j’ai compris qu’il aimait cuisiner, je m’en suis étonné, mais quand il m’a parlé de ce grand-père cuisinier, j’ai compris qu’il avait des gènes de cuisinier ! Tu comprends que son choix de devenir cuisinier est très certainement lié à l’histoire de son grand-père.
- C’est vrai papy, je n’y avais pas pensé, répond le petit Julien. Mon papa m’a parlé du vieux qui lui demandait de préparer des bonnes soupes ! Maintenant je comprends pourquoi. C’était un connaisseur !
- Vous voyez que là-aussi, c’est une affaire de double culture. C’est une chance d’être entre deux cultures, une belle opportunité pour comprendre le monde. Mais en même temps, c’est du travail en perspective !
La vie de Julien évoquée dans ce livre commence, on l’a dit, en 1975, après une première tranche de vie en Afrique centrale. La deuxième tranche nous amènera en 1990, puis suivront deux décennies, de son entrée au BIT, en 1990, à sa retraite, en 2010. Et même un peu plus loin, en 2015. Les hasards et les coïncidences se chargeront de poser sur sa route des balises qui l’amèneront à séjourner et voyager dans de nombreux pays, à occuper des postes inattendus, à rencontrer des personnes avec lesquelles il fera équipe et conservera des liens d’amitié tenaces. Sans compter celles qui l’amèneront à créer cette famille plurielle qui étonne ses petits-enfants.
Chapitre 2 : Vous avez dit soixantedisard !
Les années 70/80 furent pour Julien celles du grand ménage. Il vécut cette période de façon totalement décousue, passant d’un job à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une période faste à une de vaches maigres, au fil des hasards et des coïncidences, on le sait. Ces années commencent à l’achat de la maison de Banon en Haute Provence par Julien et ses cousins Sergine et Gilles.
- La maison que nous avons achetée est immense !
- Pour y avoir séjourné plusieurs semaines lors de nos premiers entretiens, dit Guillaume, je ne peux que confirmer.
- Nos amis nous ont traités de fous quand ils ont vu ces deux maisons de quatre niveaux chacune, avec plus de huit cents mètres carrés habitables ! Il est vrai qu’il fallait être un peu fous pour acheter un truc pareil. »
- Vous l’avez restaurée vous-mêmes, dit Guillaume ?
- Oui. Par la force des choses. Nous avions tout juste de quoi l’acheter et étions loin d’avoir les moyens de payer une entreprise pour le faire. Nous avons emprunté 25 000 francs et attaqué les travaux dès notre arrivée.
Julien a une belle histoire à raconter à propos de leur première nuit dans la maison. « Vers deux heures du matin, deux gendarmes se sont présentés devant la porte d’entrée avec un énorme berger allemand. Piba, notre chien, qui était derrière la porte, s’est mis à hurler aussi fort que l’autre et tout leur brouhahas nous a réveillés.
« Nous dormions au deuxième étage, dans la seule pièce habitable. Je me suis penché à la fenêtre et je leur ai demandé ce qu’ils voulaient. -De quel droit dormez-vous dans cette maison - m’ont-ils demandé ? Du droit du propriétaire, ai-je répondu. Ce qui les calmés. »
- Ils avaient le droit de vous réveiller en pleine nuit, demande Guillaume ?
- Je ne pense pas, mais ils venaient de monter une traque qui avait foiré et du coup ils étaient sur le qui-vive car ils ne voulaient pas se planter une seconde fois.
La maison avait été squattée plusieurs fois par des trafiquants d’herbe, et ils venaient d’organiser quelques jours plus tôt une descente du genre commando, avec encerclement du vieux village, talkie-walkie, et toute l’armada. Mais ils firent chou blanc, car les supposés hippies avaient fui juste avant ! Il fallait qu’ils se rattrapent, raison pour laquelle ils ne laissèrent pas aux nouveaux venus le temps de disparaître avant de les interpeller. Sauf que les deux cousins étaient dans leur droit.
Le lendemain, têtes quasiment rasées pour cause de connexion avec le centre tibétain d’Aix en Provence, ils rendirent visite au chef de la gendarmerie pour décliner leurs identités. Ce dernier en profita pour leur faire une description apocalyptique de la situation des jeunes de l’époque, cheveux longs, mal rasés, fumeurs de chanvre indien, et tutti quanti.
Puis il leur demanda leurs cartes d’identité pour noter leurs noms. A la vue des photos et des cheveux de ses interlocuteurs, le chef des gendarmes faillit tomber à la renverse ! Il comprit à cet instant qu’il avait tout faux !
Les années qui suivirent furent le théâtre d’évènements passablement improbables, entre les travaux, les stages, les rencontres, les spectacles, et d’autres de tous ordres.
« Les banonais, nous avait dit le maire à notre arrivée, vous attendent à deux virages : d’abord la réfection du toit, et ensuite de passer l’hiver dans la maison. Ce que nous avons fait, avec, en plus, un bébé d’un an dans la maison. Quant aux toits, nous avons refait intégralement celui de la maison de droite, puis la partie écroulée de celle de gauche. »
La vie dans l’hôtel-Dieu était spartiate et dans l’air du temps. Nous ne mangions quasiment pas de viande, mais plutôt des céréales, de la gaude, une farine de maïs grillé très prisée par les maghrébins, du riz complet, bien sûr, et il nous arrivait même de cuire notre pain ou de faire nos propres fromages avec du lait que nous achetions au village. L’aménagement d’une salle de douche avec de l’eau chaude et la présence du téléphone nous faisait passer, aux yeux des babas du coin, pour des bourgeois. Chacun son truc ! Certains d’entre eux ne se faisaient pas prier pour venir prendre des douches chez nous, ou passer des coups fil ! C’était la grande époque du jazz rock, et la salle de musique que nous avons aménagée dans l’une des grandes pièces du deuxième étage, fonctionnait à fond. Il y faisait un froid de canard, mais enveloppés dans des couvertures chaudes nous y étions bien. Pas mal enfumés, souvent, la tête un peu dans les nuages, parfois, mais bon, ça nous donnait des idées.
La maison côté Nord était immense et ses nouveaux propriétaires s’installèrent au seul niveau habitable, le premier étage, qui est aussi le rez-de-jardin.
Les étages supérieurs étaient à ce moment-là des passoires battus par les vents et la pluie, aussi leur restauration fut elle rapidement engagée.
Quand Julien et son cousin n’étaient pas sur les machines à bois, ils étaient sur le toit, ou dans les étages. Tout le monde mit la main à la pâte, les parents des uns et des autres, les amis, les cousins. Sans compter un jeune architecte qui se présenta un jour et leur reprocha d’occuper sa maison qu’il prétendit avoir achetée ! Il est vrai qu’elle trônait au-dessus de la maison de son enfance et qu’il en rêvait depuis toujours. Il avait envoyé une lettre à la propriétaire avec une offre d’achat ambiguë qu’elle ne retint pas. Heureusement pour Julien et ses cousins !
D’autres candidats y avaient pensé mais s’étaient présentés trop tôt, quand les deux maisons n’avaient pas de propriétaire officiel et ne pouvaient être achetées. La faute à une association à qui la bonne sœur défroquée qui avait acheté et transformé la maison en colonie de vacances pour jeunes filles de bonnes familles, l’avait cédée, avant de quitter le village. Tout rentra dans l’ordre quand son frère prit les choses en mains, organisa une assemblée générale de ladite association qui restitua la maison à sa propriétaire officielle, puis il la mit en vente. Julien et ses cousins arrivèrent au bon moment.
Ils baptisèrent Maison des sœurs la bâtisse côté Sud, au regard de son histoire. Elle avait hébergé un four banal, un atelier d’artisan et l’hôpital public de Banon pendant deux siècles, aux 17e et 18e. Une longue histoire chargée de douleurs, de naissances et de morts, de blessures, d’épidémies. De saignées et de lavements, si l’on s’en réfère à la médecine de l’époque.
Certains visiteurs quelque peu médiums en ont ressenti les vibrations dans les murs. Vers 1830, l’hôpital fut transféré dans la maison d’en face, réaménagée pour la circonstance, et baptisé hôtel-Dieu car géré par des religieuses qui habitèrent donc en face : la Maison des sœurs !
On parle aujourd’hui d’ancien hôtel-Dieu pour désigner l’ensemble de ces deux bâtisses. La menuiserie fut installée dans la Maison des sœurs, dans ce qui fut autrefois l’hôpital. Les deux comparses s’y chauffèrent pendant leur premier hiver avec un poêle à sciure archaïque qui leur explosa deux ou trois fois à la figure, risquant de mettre le feu à l’atelier. Dans la menuiserie, ils fabriquèrent des jouets, des carrioles à roulettes, appelées dirigeables, des poussettes, des camions, et des objets en bois qu’ils vendaient sur les marchés ou dans les boutiques spécialisées. Dans les expositions ils se présentaient comme « phrères artisans », en référence au Grand jeu1, le mouvement créé par René Daumal et ses copains lycéens à l’époque surréaliste. Janine Levy, une amie pédiatre du Revest des Brousses, leur donna l’idée de fabriquer les jouets éducatifs dont elle préconisait l’utilisation par les crèches dans son livre « L’éveil du tout petit2 ». Aussi créèrent-ils des chariots de marche dont ils vendirent des exemplaires préfabriqués à des établissements spécialisés où des jeunes handicapés en assuraient la finition.
Jean, un ami de Julien, ancien instituteur Freinet au Cameroun, écologiste avant l’heure devenu apiculteur, vint passer quelques jours à Banon pour fabriquer des ruches.
Son passé politique au PSU leur permit d’alimenter de chaudes discussions sur la vie des deux menuisiers fraîchement installés. Il les étonna quand il leur dit : « Si vous travaillez comme vous le faites en ce moment, vous gagnerez tout juste de quoi bouffer. Si vous voulez gagner de l’argent, il faut créer et vendre vos idées. » Cette phrase laissa des traces dans leurs têtes. De même qu’une autre, prononcée par un vieux menuisier qui vendait tout son matériel avant de partir à la retraite. Venus le voir pour acheter quelques outils, ils abordèrent la question des machines-outils, très utiles et performantes, selon le vieil homme, mais extrêmement dangereuses. Pour bien se faire comprendre, le vieil homme leva la main droite, trois doigts tendus vers le haut : « Vous savez, les menuisiers ils ont tous cinq enfants » leur dit -il !
- Waouh, s’exclame Guillaume, un conseil comme celui-là, ça ne vous laisse pas sans réaction ! En témoigne d’ailleurs l’émotion que je perçois dans votre voix.
Pendant l’été 76, ils se rendirent au Castellet avec des amis pour un concert rock qui sentait bon Woodstock ou l’Ile de Wight. Ils y virent et écoutèrent quelques grands musiciens de l’époque, dont Weather report, Joe Coker, John Mac Laughlin et Shakti, Larry Coryell. Le lendemain à l’aube, ils furent l’objet d’une scène surréaliste. Ils s’arrêtèrent dans un bar sur la place centrale du Castellet, tôt le matin, et au moment où le serveur leur apporta les cafés, il leur manquait de quoi en payer un. « Ce n’est pas grave », dit le serveur, avant de partir avec la tasse qu’il versa ostensiblement dans la fontaine !
- Non, s’exclame Guillaume, quel enfoiré !
- Tu peux le dire !
- C’est loin des gens dont vous m’avez parlé un jour, qui vous offrirent des petits déjeuners dans un bar d’Amougies, en Belgique. Et prirent soin de quitter la salle avant que le garçon ne vous les apporte, par discrétion. Là aussi vous aviez assisté à un grand festival, si mes souvenirs sont bons.
- Un superbe festival !
Lors des changements de scènes, la cabine technique passait les titres du dernier album des Beatles, Abbey Road. L’un des meilleurs. C’était comme s’ils étaient là.
A la fin de l’hiver 76, moins d’un an après leur installation à Banon, un évènement improbable vint changer leurs plans. Serge D., le responsable d’un centre artisanal3, rencontré par hasard, leur proposa de transformer l’hôtel-Dieu en annexe dudit centre et d’héberger les stagiaires photo et danse.
Un hasard de plus qui leur tombait dessus et qu’ils saisirent ! Le crédit jeunes entrepreneurs qu’ils venaient de contracter au Crédit agricole pour développer leur activité de menuiserie fut englouti dans l’aménagement de quatre chambres, un labo et une salle de danse. Trois mois plus tard, ils recevaient leurs premiers clients.
A ce propos, dit Julien, il faut que je te raconte comment s’est passée leur installation ! « Nous avions laissé deux amis à la maison avec mission de fabriquer les lits et de les faire. Tout était sur place, les traverses, les planches, un marteau et des pointes, les matelas, les draps et les oreillers. Il leur suffisait de clouer les planches sur les traverses, de poser les matelas dessus, et de faire les lits.
Ce soir-là, nous avons donné à l’expression faire son lit, un sens nouveau. Nous étions descendus au Centre pour accueillir les clients et les ramener à la maison. Quand nous avons voulu leur proposer de monter à l’hôtel-Dieu, après le dîner, on nous a dit qu’ils y étaient déjà partis. Nous avons sauté dans la voiture et sommes rentrés à la maison où nous les avons trouvés debout dans les chambres, éberlués.
- Les lits n’étaient pas faits, demande Guillaume ?
- Non, et je peux te dire que ça faisait désordre. Les clients étaient abasourdis !
- J’imagine la scène, dit Guillaume.
- Nous leur avons dit de ne pas se faire de souci et que nous allions faire leurs lits. En deux temps, trois mouvements, ils furent faits, montés, cloués, équipés de matelas et draps !
L’aventure dura douze ans, élargie à d’autres disciplines : jonglage, vidéo, cinéma, théâtre, pantomime, maquillage, comédien clown, et photojournalisme, avec Gamma Formation. Sans oublier les marionnettes géantes, dont l’aventure commença par une rencontre aussi improbable, une nouvelle fois, que décisive. Julien croisa par hasard, sur la place du village, Nadia, Jean Pierre, Blaise et Guillaume Arlaud, une famille de saltimbanques dont les parents travaillaient avec le Théâtre du Loup, à Genève, et avaient côtoyé le Bread and Puppet. Ils voyageaient entre Italie et France en jouant gratuitement sur les places publiques un spectacle tout en nuances, beau et romantique, une parodie de cirque dont les animaux étaient en carton, les couteaux en bois, les haltères en papier mâché, les ours gentils.
Julien les invita à l’ancien hôtel-Dieu, ils y jouèrent leur spectacle, puis ils décidèrent d’un commun accord d’organiser un atelier de marionnettes géantes l’année suivante. Les stages se succédèrent pendant six ans, avec chaque fois un thème nouveau, la mer, le feu, les poissons, les oiseaux, les moutons, toujours liés à la nature, jamais de personnages de carnaval, de BD ou de feuilletons télévisuels.
Les stagiaires fabriquaient les marionnettes géantes qui firent les grandes heures des fêtes du vieux village de Banon pendant six ans. Certains stagiaires rentrèrent chez eux avec leurs propres marionnettes fabriquées pendant leurs dix jours de travail en atelier. Les plus grandes, restées à Banon, font l’objet d’une installation qui fascine les visiteurs.
Quand il ne s’occupait pas des stages, Julien était sur les routes ou au Sénégal. Il ne fit jamais un travail désagréable dans le seul but de gagner de l’argent. Cela lui valut de vivre des périodes fastes autant que de vaches maigres, sans pour autant en être perturbé. Il ne le savait pas, mais nombre d’expériences qu’il allait vivre pendant cette décennie lui seraient très utiles lors des deux suivantes, dans des contextes totalement différents.
La parenthèse mauritanienne
Pour améliorer la capacité de production de l’atelier de menuiserie, Julien décida de repartir quelques mois dans une entreprise de travaux publics à l’étranger. Il chercha d’abord en Algérie, interpellé par un encart publicitaire de l’ETT (Entreprise des Travaux Touristiques) dans le mensuel Afrique Asie.
Cette entreprise travaillait avec l’architecte français Fernand Pouillon, qui intéressait beaucoup Julien. Il écrivit au directeur de l’entreprise qui l’invita à Alger et lui proposa d’emblée un poste sur le chantier de construction d’un hôtel à In Salah, une ville du Sud où Julien n’avait pas envie de s’enterrer avec son épouse, tout juste arrivée de Pologne ! Il préféra une offre de travail en Mauritanie.
- Encore un hasard, dit Guillaume ! C’est dommage que vous vous soyez privé d’un travail avec Pouillon dont vous me parlez aujourd’hui encore avec passion. Je connais bien ce qu’il a construit à Marseille sur le vieux port, les résidences en Algérie pour l’administration française, et les complexes touristiques pour le gouvernement algérien, entre 67 et 82.
- C’est vrai, dis-je, avec une pointe de nostalgie. Je le regrette, car en 1977 il était à l’apogée de son parcours algérien, et j’aurais pu devenir son élève ! Pour finir je suis parti à l’aventure dans les sables mauritaniens.
…..
La Mauritanie est un pays désertique dont la zone urbanisée se limitait alors à deux villes, Nouakchott et Nouad-hibou, situées l’une et l’autre sur la façade atlantique. Cette côte très poissonneuse faisait le bonheur des pêcheurs artisanaux de Nouakchott, majoritairement sénégalais, et des entreprises de pêche de Nouadhibou. Des entreprises étrangères y décimaient déjà la faune halieutique, avec leurs navires usines, le plus souvent sans accords de pêche avec le gouvernement mauritanien. La situation s’est améliorée depuis, mais le contrôle en haute mer est difficile et coûteux !
Le pays était en guerre avec le Front Polisario4 à la fin des années 70, pour des raisons liées à l’occupation du Sahara occidental que le gouvernement espagnol venait de quitter sans avoir pris soin d’en préparer la relève de gouvernance par ses occupants.
La ville de Nouakchott fut construite dans les années 60 à l’aube de l’indépendance pour doter le pays d’une capitale digne du nom. En lieu et place de Saint-Louis du Sénégal, dont la partie Nord de la langue de Barbarie, au-delà du deuxième pont, appartenait à la Mauritanie, qui y avait installé ses bâtiments administratifs. La ville est séparée de la mer par la sepcra, une zone inondable en cas de fortes crues du fleuve Sénégal, pourtant situé 200 kilomètres au Sud. Les autorités considéraient à juste titre, dans les années 70, que ladite sepcra n’était pas constructible, aussi la ville était-elle séparée des dunes qui longent la plage par un espace vide de trois ou quatre kilomètres. A cette époque, la capitale comptait six arrondissements dont le Ksar, le village d’origine, et la lisière Nord s’arrêtait à l’ambassade d’Espagne, aujourd’hui noyée dans les quartiers périphériques.
En Mauritanie, l’européen est appelé toubab, et le maure (blanc) beïdane. Mais contrairement au Sénégal, le mot toubab n’y signifie pas blanc, mais étranger. Ce sont les européens qui sont vus comme les étrangers, les blancs sont les maures, qui n’aiment pas beaucoup les noirs qu’ils appellent captifs. Si certains travailleurs noirs jouissaient malgré tout, sur le chantier, d’une certaine considération, celle-ci n’était due qu’à leurs capacités techniques et à leur utilité.
Julien avait été recruté par l’une des deux grandes entreprises de bâtiment de Nouakchott, la SOMACO TP, qui appartenait à un homme d’affaires mauritanien. La direction technique était assurée par un ingénieur français, et les deux chantiers de l’époque étaient dirigés par des jeunes européens. Celui dont Julien avait la responsabilité concernait l’extension de l’hôpital national. Il comptait environ deux cents ouvriers et ce, dans un contexte un peu particulier, lié au fait que les prédécesseurs de Julien avaient tous démissionné ou quitté le chantier et l’entreprise, parfois sans prévenir. L’un d’eux se rendit à Dakar et laissa sa voiture au parking de l’aéroport, avec un papier sous le pare-brise indiquant le nom du propriétaire !
Julien vécut deux ans en Mauritanie où tout marchait de travers, selon lui, et sa première impression en entrant sur le chantier le sidéra. Il s’inquiéta de ne pas voir de gravier et on lui répondit : « Mais si, c’est ça », en désignant un tas de coquillages ! Il comprit qu’en l’absence de pierres à concasser dans la région, on utilisait des coquillages.
Fossilisés, il est vrai, donc très durs, mais il y avait de quoi surprendre le jeune technicien qu’il était. Les ouvriers du chantier étaient soit mauritaniens, maures (blancs ou noirs5) ou noirs, soit sénégalais, immigrés. Ces derniers palliaient l’absence de compétences professionnelles dans le pays. La bonne marche des travaux reposait sur les épaules de quatre chefs de chantier sénégalais, compétents et expérimentés.
Ils bénéficiaient du statut d’expatriés propre aux personnes qui viennent d’un pays étranger, et percevaient à ce titre des primes de logement et un voyage aller-retour au Sénégal. Mais c’étaient bien les seuls avantages dont ils pouvaient se réjouir car leur situation sur le chantier restait totalement aléatoire.
Les délais d’exécution des travaux étaient serrés et l’entreprise risquait de payer des indemnités s’ils n’étaient pas respectés, aussi Julien a-t-il maintes fois poussé les chefs de chantier à travailler dur pour tenir les délais. Il leur promit, pour les motiver, de défendre leur cause, à la fin du mois, pour qu’ils soient récompensés. Mais ils ne reçurent jamais un ouguiya (monnaie locale) de plus. Les gratifications étaient basées sur l’appartenance au clan du patron ou à une certaine ethnie. De toute évidence, pas celle des noirs. « Ça me foutait le moral dans les chaussettes, dit Julien, avec le recul, je me dis que les chefs de chantier savaient très bien qu’ils n’auraient rien du patron, et ils devaient me trouver bien naïf quand je leur disais qu’ils seraient augmentés. »
Le patron demanda un jour à Julien de faire un travail pour un de ses amis qui avait une maison sur la dune. Il profita de la présence du bulldozer dans la zone pour faire faire le terrassement demandé, mais le lendemain, son patron le convoqua dans son bureau et lui reprocha violemment d’avoir profité de cette occasion pour se faire valoir et d’avoir gaspillé l’argent du chantier. Julien essaya de se justifier en lui rappelant qu’il n’avait fait que répondre à sa demande et ne comprenait pas cette vindicte à son égard, d’autant que le chantier marchait beaucoup mieux que du temps de ses prédécesseurs.
Il insista sur le fait qu’il se démerdait pour tenir le rythme et rester dans les délais impartis et s’entendit répondre par son patron : « Si tu te démerdes comme tu dis, c’est parce que je te paie, le reste je m’en fous ! »
Un ami français qui gérait la pharmacie de l’hôpital lui demanda un jour de l’aider à détruire plusieurs centaines de kilos de médicaments qu’il avait reçus mais qui étaient périmés et devenus dangereux. Julien mobilisa des manœuvres armés de brouettes pour les sortir et les verser dans un grand trou creusé pour la circonstance, puis ils brulèrent tout. Pendant l’opération certains d’entre eux s’emparèrent de quantités de médicaments et rentrèrent chez eux les bras chargés sans se soucier de ce que Julien tenta de leur expliquer quant à leur dangerosité !
On l’appela un jour dans la maternité pour voir des siamois collés par la tête qui venaient de naître ! La vue des deux enfants le bouleversa ! Les médecins lui dirent le surlendemain qu’ils avaient réussi à les séparer, mais que seul l’un d’eux avait survécu. Julien construisit quatre maisons pour les médecins, l’une d’elles fut occupée dès sa finition par un chirurgien libanais6 qui devint rapidement son ami. Celui-ci faisait une pause à une certaine heure de la matinée pour boire un café turc chez lui, aussi Julien s’arrangeait-il pour être de ce côté du chantier à ce moment, et devint accroc au café turc. « Il m’a raconté qu’il lui arrivait de trouver de la crasse dans les plis du ventre de certaines femmes qu’on lui amenait en salle d’opération. Et pire, il y trouva des vers ! On dit que les maures ne se lavent pas beaucoup, mais à ce point ! »
Il faut dire que l’obésité des femmes constitue en Mauritanie un critère d’appréciation de leur beauté par les hommes. Nombre de petites filles sont gavées dans leur enfance pour devenir grosses. Julien assista lui-même, sous une tente en plein désert, au gavage d’une petite fille qu’une vieille femme forçait à boire du zrig, le lait de chamelle coupé d’eau. Elle avait calé une longue baguette de bois entre les doigts de pieds de la petite, et quand celle-ci arrêtait de boire, la vieille faisait pression sur la baguette avec son pied, provoquant une forte douleur dans celui de la petite qui geignait et se remettait à boire !
La plage, à cette époque, était belle, surtout en amont et en aval du site des pêcheurs. Par la suite elle devint une décharge publique ! Chaque soir ou presque, Julien faisait les trois ou quatre kilomètres qui séparaient la ville de la mer pour s’y rendre avec sa femme et des amis. Il y avait, derrière la dune, sur l’immense plage, des centaines de pirogues de pêcheurs, sénégalais pour la plupart, ou mauritaniens noirs d’origine sénégalaise. A cette époque, les maures mangeaient très peu de poisson ! Autant dire qu’ils ne savaient pas pêcher non plus ! C’étaient, et ce sont toujours, de grands mangeurs de viande ! Et pas n’importe quels morceaux, notamment en matière de pattes de moutons, quand ils font des méchouis. C’est la sècheresse des années 70, et plus tard le départ des sénégalais à l’occasion d’une grave crise entre les deux pays, qui les amenèrent à se tourner vers la mer, à manger du poisson et à le pêcher. De même qu’à pratiquer certains métiers de l’artisanat moderne qu’ils n’exerçaient pas auparavant.
…..
Le chantier faisait l’objet d’un suivi rigoureux par les contrôleurs techniques du bailleur de fonds et du ministère, aussi les chefs de chantier faisaient-ils leur possible pour que le béton soit de bonne qualité. Mais il y avait des limites à la qualité du travail, main d’œuvre et conditions de travail obligent ! Cela posa des problèmes lors des visites de chantier où des défauts furent constatés par le contrôleur allemand, notamment la qualité des carrelages que l’on teste en tapant du talon sur le sol. Si cela fait tic tic, c’est bon, toc toc, c’est mauvais ! Ça signifie que la chape n’adhère pas à la dalle et que le carrelage ne tiendra pas longtemps ! Inquiet de la réaction du contrôleur assez sévère, Julien se demanda comment lui faire comprendre que son collègue et lui étaient de bonne foi quand ils lui disaient qu’il ne leur était vraiment pas possible d’obtenir un meilleur résultat de la part des ouvriers.
Lequel collègue, américain francophone et ancien séminariste, lui expliqua que s’ils arrivaient à établir une relation de confiance avec le contrôleur, celui-ci les comprendrait mieux et leur ferait plus confiance. Pour ce faire, sachant que c’était un amateur de ping-pong, Julien organisa un tournoi entre eux et leur plan fonctionna car le contrôleur devint beaucoup plus compréhensif et conciliant !
Le chantier faisait appel à des entreprises de sous-traitance pour certains travaux secondaires de carrelage, peinture ou vitrerie.
« J’étais surpris par la présence d’adolescents dans ces petites entreprises artisanales, et j’ai appris qu’il s’agissait d’apprentis. Lesquels, je ne le savais pas à ce moment-là, seraient quelques années plus tard, au centre de mon travail. »
Le directeur technique commanda un jour du marbre de Carrare pour un immeuble dont deux collègues français de Julien supervisaient la construction. Il demanda au fournisseur italien de mettre quelques bons produits culinaires dans l’une des caisses. A leur arrivée, ils cherchèrent celle qui contenait les provisions et l’ouvrirent pour récupérer les salamis, tomates pelées et autres bons produits italiens. Dans la situation qui était la leur à l’époque, en Mauritanie, c’était Byzance ! Le seul problème c’est que le gardien inféodé au patron les ayant vus faire leur micmac, lui raconta tout. Le lendemain, ledit patron s’en inquiéta auprès du directeur technique français qui fut un peu honteux de se faire traiter comme un vulgaire voleur de billes. Pour finir le patron rigola et lui dit : « Vous les toubabs, vraiment, vous aimez trop manger ! »
Julien fit plusieurs vols en avion avec un ami français, dont un au-dessus de la plage, avec des piqués face à la rive pour faire des photos, et un autre au Cap Timiris, sur le banc d’Argun, à près de cent kilomètres au Nord de la capitale. C’est là que les pêcheurs appelés Imeraguens pêchent les mulets en se faisant aider par les dauphins. Quand ils en aperçoivent des bancs, un homme joue du tam-tam sur la dune pour appeler les dauphins qui, en se rapprochant de la rive, rabattent les mulets que les hommes attrapent à la main en entrant dans la mer. Ensuite les femmes en extraient les œufs pour préparer la fameuse poutargue, le caviar mauritanien.
Un ami suisse donna à Julien une petite cabane en béton qu’il avait construite sur la dune. Il la répara entièrement dans l’idée d’y passer des week-ends avec son épouse pour profiter des couchers et levers de soleil sur la plage.
La cabane était juste finie quand il y eut un vent de sable d’une telle épaisseur, que cela provoqua une éclipse totale de soleil. En quelques minutes, l’obscurité s’empara de la ville. Le sable contenu dans les nuages filtrait la lumière qui ne revint que progressivement, d’abord rouge, puis jaune, comme dans une boîte de nuit. La population s’affola, les gens coururent de partout au point qu’une personne se noya dans une petite mare. Julien et son épouse firent un tour à la plage en fin d’après-midi pour voir à quoi elle ressemblait après ce terrible vent de sable. Elle était recouverte d’une fine poussière rouge et l’on pouvait voir les traces de pas des gens qui avaient fui la tempête pour se réfugier là où il leur semblait possible de s’abriter. C’est dans leur petite cabane que nombre d’entre eux se réfugièrent après en avoir fracassé portes et fenêtres ! Ecœurés, Julien et sa femme n’y remirent jamais les pieds.
Quelques années plus tard, dans un hôtel à Agadez, Julien raconta cette histoire à un ami qui se souvint qu’il avait vécu cet évènement dans le Sud marocain exactement à la même époque. Le même vent, le même sable. Etonnant hasard !
Peu avant le départ de Julien, un député invita le staff de l’entreprise à passer un week-end chez lui dans le désert, au Sud de Nouakchott. Julien y partit avec l’épouse du directeur. Ils furent reçus royalement par le député et sa femme sous une grande tente, passèrent des heures à boire le thé, allongés sur des matelas posés à même le sol sur de superbes nattes tressées de cuir et de paille, à discuter des conditions de vie dans cette région isolée.