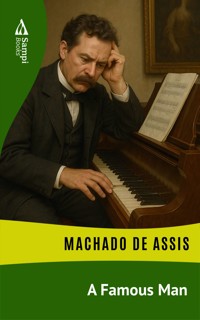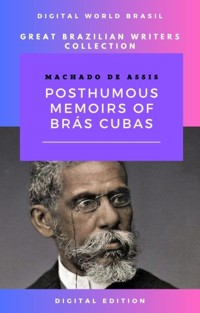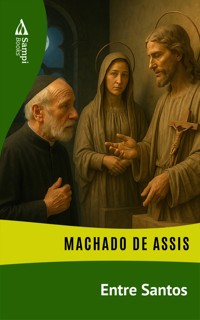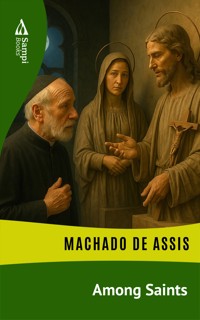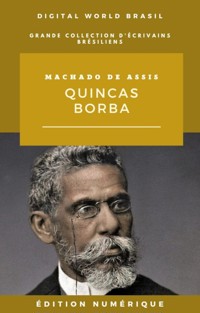
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Digital World
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Collection de grands écrivains brésiliens
- Sprache: Französisch
Publié en 1891, Quincas Borba est l'un des chefs-d'œuvre du réalisme brésilien et peut-être la critique la plus acerbe de Machado de Assis sur la nature humaine et les illusions du progrès. Poursuivant l'univers psychologique initié dans les Mémoires posthumes de Brás Cubas, le roman explore les contradictions morales et sociales du XIXe siècle, mettant en scène des personnages qui, plus que simplement vivre, philosophent et s'extasient sur la vie. Au cœur de l'intrigue se trouve Rubião, héritier de la fortune et des idées de son ami excentrique Quincas Borba, créateur de la célèbre et ironique devise : « Au vainqueur, les pommes de terre ». Naïf et idéaliste, Rubião s'installe à Rio de Janeiro, emportant avec lui l'argent et la philosophie de son mentor, mais finit par se retrouver empêtré dans la vanité, l'ambition et l'hypocrisie de la société bourgeoise. Entre la séduction de Sofia et l'opportunisme de Palha, le protagoniste se perd dans les illusions et les désillusions, jusqu'à ce que son esprit, fragile et poétique, cède au délire et à la folie. Machado de Assis, avec sa prose élégante et incisive, construit une satire raffinée du pouvoir, de la morale et de la folie. Dans Quincas Borba, rire et tragédie fusionnent : la philosophie absurde de l'« humanisme » – brillante parodie des doctrines scientifiques et optimistes de son époque – se révèle une métaphore cruelle de la condition humaine. L'homme, prisonnier de la quête de gloire et de richesse, est dépeint comme un être qui se détruit sans cesse, croyant toujours en sa propre rationalité. Cette édition numérique revue et adaptée respecte le style d'époque de Machado tout en offrant fluidité et clarté au lecteur contemporain. Idéale pour les étudiants, les chercheurs et les amateurs de littérature, cette version met le classique à portée de main, préservant sa valeur esthétique et philosophique, tout en offrant une expérience de lecture accessible et moderne. Quincas Borba est plus qu'un roman sur la folie et l'héritage : c'est un miroir de la vanité humaine, un traité sur l'illusion de la victoire, et une œuvre qui perdure grâce à son ironie et son actualité. Achetez dès maintenant l'édition numérique de Quincas Borba et plongez dans le génie de Machado de Assis, maître absolu de l'ironie et de l'âme brésilienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiche technique
Quincas Borba
2025© – Digital World. Tous droits réservés.
E-ISBN: 9790702577351
ATTENTION:
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être utilisée ou reproduite, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de l'éditeur ou du détenteur des droits d'auteur.
Direction éditoriale
Fabrício D. Marchesan
Créateurs de contenu
Pline Guimarães
Élisabeth Morsegai
Ligne Torquato
Sheila Calazans
Lincoln LT Baptista
Rébeca Montserrat
Erica Dias
Révision
Raquel Salazar
Conception de la couverture
Monde numérique
PAO
Monde numérique
À propos de l'éditeur
Digital World est une start-up spécialisée dans la production de contenu numérique aux formats EPUB, MOBI et PDF. Notre équipe de chercheurs pluridisciplinaires possède une expérience dans divers domaines. Depuis plus de six ans, nous créons du contenu de qualité pour encourager l'auto-apprentissage, en proposant des ouvrages de genres variés pour tous les âges et tous les besoins, tant personnels que professionnels. Comptez sur nous pour vous accompagner dans votre développement personnel grâce à nos livres numériques et audio.
Dans notre petit coin du cyberespace, nous croyons au pouvoir de l'éducation et du développement personnel. Nous avons à cœur de vous aider à développer votre esprit, à explorer de nouvelles voies et à découvrir votre potentiel infini.
Notre mission est de vous offrir une expérience unique, riche en découvertes et en développement personnel. Parcourez notre sélection d'ebooks, couvrant tous les domaines, de la sagesse ancestrale aux dernières découvertes scientifiques. Explorez des produits numériques qui vous aideront à révéler votre véritable moi et à libérer votre potentiel intérieur.
Chez Digital World, nous valorisons l'apprentissage et le développement personnel. Nous sommes là pour vous accompagner, vous motiver et vous donner les moyens de devenir la meilleure version de vous-même. Rejoignez-nous dans cette quête passionnante de connaissance et de découverte de soi.
Laissez-nous être le phare qui vous guidera vers un monde de possibilités et de développement personnel. Nous sommes impatients de vous accompagner dans votre parcours et de vous aider à réaliser vos rêves.
Avec nous, votre potentiel est illimité et votre avenir est prometteur. Embarquons ensemble pour ce voyage!
À propos de ce livre électronique
Texte source:
Publié à l'origine en feuilletons, de 1886 à 1891, dans A Estação.
Publié en volume par Garnier, Rio de Janeiro, la même année 1891, avec des différences substantielles par rapport aux publications en série.
Ce que nous avons ici est précisément l’édition du livre.
Par Digital World Brasil
PROLOGUE DE LA 3E ÉDITION
La deuxième édition de ce livre fut achevée plus rapidement que la première. Le voici sous sa troisième forme, sans autre modification que la correction de quelques erreurs typographiques, si peu nombreuses que, si elles étaient conservées, elles n'en obscurciraient pas le sens.
Un ami et collègue distingué insiste pour que ce livre soit suivi d'un autre. « Avec les Mémoires posthumes de Brás Cubas, dont celui-ci est issu, vous créerez une trilogie, et la Sofia de Quincas Borba occupera exclusivement la troisième partie. » J'ai un temps pensé que c'était possible, mais en relisant ces pages, je conclus autrement. Sofia est ici dans son intégralité. La continuer serait la répéter, et le répéter serait un péché. Je crois que c'est ainsi que j'ai été marqué avec ce livre et d'autres que j'ai composés au fil du temps, dans le silence de ma vie. Des voix généreuses et fortes m'ont alors défendu; je les ai déjà remerciées en privé; maintenant, je le fais cordialement et publiquement.
1889.
M. de A.
CHAPITRE UN
Rubião contemplait la crique – il était huit heures du matin. Quiconque le voyait, les pouces enfoncés dans le cordon de sa robe de chambre, à la fenêtre d'une grande maison de Botafogo, aurait cru admirer cette étendue d'eau calme; mais, en vérité, je vous le dis, il pensait à autre chose. Il comparait le passé au présent. Qu'était-il il y a un an? Un enseignant. Qu'est-il aujourd'hui? Un capitaliste. Il se regarde, regarde ses pantoufles (des pantoufles de Tunis, offerts par un ami récent, Cristiano Palha), la maison, le jardin, la crique, les collines et le ciel; et tout, des pantoufles au ciel, partage le même sentiment de propriété.
« Voyez comme Dieu écrit droit avec des lignes tordues », pense-t-il. « Si Sœur Piedade avait épousé Quincas Borba, cela ne m'aurait donné qu'un espoir secondaire. Elle ne s'est pas mariée; ils sont morts tous les deux, et voilà que tout est avec moi; alors, ce qui semblait être un malheur… »
CHAPITRE II
Quel gouffre entre l'esprit et le cœur! L'esprit de l'ancien professeur, agacé par cette pensée, se retourna, cherchant un autre sujet, un canot qui passait; son cœur, cependant, continuait de battre de joie. Que lui importent le canot ou le canoéiste, que les yeux de Rubião suivent de près? Lui, son cœur, ne cesse de répéter que, puisque Sœur Piedade a dû mourir, il a bien fait qu'elle ne se soit pas mariée; un fils ou une fille aurait pu naître… — Beau canot! — C'est mieux ainsi! — Comme il obéit bien aux rames de l'homme! — La vérité, c'est qu'ils sont au Paradis!
CHAPITRE III
Un serviteur apporta le café. Rubião prit la tasse et, tout en y versant du sucre, jeta un coup d'œil furtif au plateau, en argent ciselé. L'argent et l'or étaient ses métaux préférés; il détestait le bronze, mais son ami Palha lui expliqua que c'était une denrée précieuse, d'où la présence de deux personnages dans le salon, un Méphistophélès et un Faust. S'il devait choisir, il choisirait le plateau: un chef-d'œuvre d'argenterie, finement travaillé et fini. Le serviteur attendait, tendu et sérieux. Il était espagnol; et ce ne fut pas sans résistance que Rubião l'accepta des mains de Cristiano. Il avait beau lui répéter qu'il était habitué à son Minas Gerais natal et qu'il ne voulait pas de langues étrangères à la maison, son ami Palha insista, démontrant la nécessité de domestiques blancs. Rubião cede à regret. Son bonne page, qu'il voulait placer dans le salon comme un morceau de province, ne put même pas le laisser dans la cuisine, où régnait en maître un Français, Jean. Il fut dégradé à d'autres services.
« Quincas Borba est-il très impatient? » demanda Rubião en prenant une dernière gorgée de café et en jetant un dernier coup d'œil au plateau.
—Il me semble que oui.
— Je le laisserai partir.
Il ne s'éloigna pas; il resta là un moment, à contempler les meubles. Voyant les petites gravures anglaises accrochées au mur au-dessus des deux bronzes, Rubião pensa à la belle Sofia, l'épouse de Palha. Il fit quelques pas et s'assit sur le pouf au centre de la pièce, regardant au loin…
C'est elle qui m'a recommandé ces deux tableaux, alors que nous étions toutes les trois en train de chercher des choses à acheter. Elle était si jolie! Mais ce que j'aime le plus chez elle, ce sont ses épaules, que j'ai vues au bal du colonel. Quelles épaules! On dirait de la cire; si lisses, si blanches! Ses bras aussi; oh! Ses bras! Comme ils sont bien dessinés!
Rubião soupira, croisa les jambes et tapota ses genoux avec les pompons de sa robe de chambre. Il sentait qu'il n'était pas entièrement heureux, mais il sentait aussi qu'il n'était pas loin du bonheur complet. Il reconstitua mentalement ces manières, ces regards, ces mouvements qui n'avaient aucune explication, si ce n'est qu'elle l'aimait, et qu'elle l'aimait profondément.
Il n’était pas vieux; il allait avoir quarante et un ans; et, à proprement parler, il paraissait plus jeune.
Cette observation s'accompagna d'un geste; il passa la main sur son menton, rasé quotidiennement, ce qu'il ne faisait pas auparavant, par économie et par souci inutile. Un simple professeur! Il portait des favoris (il se laissa plus tard pousser une barbe fournie) – si doux que c'était un plaisir d'y passer les doigts… Et ainsi se souvint-il de leur première rencontre, à la gare de Vassouras, où Sofia et son mari montèrent dans le train, dans le même wagon que lui qui descendait de Minas; c'est là qu'il rencontra ce regard neuf, qui semblait faire écho à l'exhortation du prophète: Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il n'avait aucune idée appropriée à l'invitation, il est vrai; il venait avec l'héritage en tête, le testament, l'inventaire, des choses qu'il faut d'abord expliquer pour comprendre le présent et l'avenir. Laissons Rubião dans la salle Botafogo, tapotant les glands de sa robe de chambre sur ses genoux, et prenant soin de la belle Sofia. Viens avec moi, lecteur; on le verra, des mois avant, au chevet de Quincas Borba.
CHAPITRE IV
Ce Quincas Borba, si vous m'avez fait la faveur de lire les Mémoires posthumes de Bras Cubas, est ce même naufragé qui y apparaît, mendiant, héritier inattendu et inventeur d'une philosophie. Le voici maintenant à Barbacena.
Dès son arrivée, il tomba amoureux d'une veuve, une femme de condition modeste et de revenus modestes; mais elle était si timide que les soupirs de son amante s'éteignirent. Elle s'appelait Maria da Piedade. Son frère, aujourd'hui Rubião, fit tout son possible pour les marier. Piedade résista; une pleurésie la prit.
C'est ce bref moment d'idylle qui lia les deux hommes. Rubião savait-il que notre Quincas Borba recelait en lui cette petite part de folie qu'un médecin croyait avoir trouvée? Certainement pas; il le considérait comme un homme étrange. Il est certain, en revanche, que cette petite part ne quitta jamais l'esprit de Quincas Borba, ni avant ni après la maladie qui le consuma lentement. Quincas Borba avait eu de la famille là-bas, décédée en 1867; le dernier était l'oncle qui le laissa en héritage. Rubião reste le seul ami du philosophe. Il dirigea alors une école de garçons, qu'il ferma pour soigner le malade. Avant de devenir enseignant, il avait prêté son concours à plusieurs entreprises, qui finirent par faire faillite.
Il a occupé le poste d'infirmier pendant plus de cinq mois, presque six. Le dévouement de Rubião était authentique; patient, souriant et polyvalent, il écoutait les prescriptions du médecin, administrait les médicaments à l'heure convenue et accompagnait le patient en promenade, n'oubliant rien, ni les tâches ménagères, ni les journaux, dès son arrivée à la Cour ou à Ouro Preto.
— Tu vas bien, Rubião, soupira Quincas Borba.
— Quel exploit! Comme si tu étais méchant!
Le médecin pensait ostensiblement que la maladie de Quincas Borba allait lentement s'atténuer. Un jour, notre Rubião, accompagnant le médecin jusqu'à la porte d'entrée, l'interrogea sur l'état réel de son ami. On lui répondit qu'il était perdu, complètement perdu; mais il fallait le réconforter. Pourquoi rendre sa mort plus douloureuse avec cette certitude?
« Non, pas du tout », interrompit Rubião. Pour lui, mourir est une chose facile. Vous n'avez jamais lu un livre qu'il a écrit il y a des années, sur une question de philosophie…
— Non; mais la philosophie est une chose, et mourir vraiment en est une autre; adieu.
CHAPITRE V
Rubião trouva un rival pour le cœur de Quincas Borba: un beau chien de taille moyenne, couleur plomb, tacheté de noir. Quincas Borba l'emmenait partout; ils dormaient dans la même chambre. Le matin, c'était le chien qui réveillait son maître, grimpant sur le lit, où ils échangeaient leurs premiers saluts. L'une des extravagances du maître fut de lui donner son propre nom; mais il expliquait cela pour deux raisons: l'une doctrinale, l'autre personnelle.
— Puisque l’Humanité, selon ma doctrine, est le principe de la vie et réside partout, elle existe aussi dans le chien, et le chien peut ainsi recevoir un nom humain, qu’il soit chrétien ou musulman...
« Mais pourquoi ne l'as-tu pas appelé Bernardo plus tôt? » demanda Rubião, pensant à un rival politique local.
— C'est précisément pour ça. Si je meurs avant, comme je m'y attends, je survivrai au nom de mon bon chien. Tu ris, n'est-ce pas?
Rubião a fait un geste négatif.
« Eh bien, tu devrais rire, ma chère. Car l'immortalité est mon lot, ou ma dot, ou quel que soit le nom. Je vivrai à jamais dans mon grand livre. Ceux qui ne savent pas lire, cependant, appelleront le chien Quincas Borba, et… »
Le chien, entendant son nom, courut vers le lit. Quincas Borba, ému, le regarda:
— Mon pauvre ami! Mon bon ami! Mon seul ami!
— Unique?
« Pardonnez-moi, vous aussi, je le sais, et je vous remercie infiniment; mais on pardonne tout à un malade. Peut-être que je commence à délirer. Laissez-moi me regarder dans le miroir. »
Rubião lui tendit le miroir. Le patient contempla quelques secondes le visage maigre, le regard fiévreux avec lequel il découvrait les abords de la mort, vers lesquels il marchait lentement mais sûrement. Puis, avec un pâle sourire ironique:
—Tout ce qui est dehors correspond à ce que je ressens au fond de moi; je vais mourir, mon cher Rubião… Ne gesticule pas, je vais mourir. Et qu'est-ce que mourir, pour que tu sois si étonné?
— Je sais, je sais que tu as des philosophies... Mais parlons du dîner; qu'est-ce que ce sera aujourd'hui?
Quincas Borba était assis sur le lit, laissant pendre ses jambes, leur extraordinaire minceur visible à l'extérieur de son pantalon.
—Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu? demanda Rubião.
« Rien », répondit le malade en souriant. « Des philosophies! Comme vous me dites ça avec dédain! Répétez-le, allez, je veux l'entendre à nouveau. Des philosophies! »
—Mais ce n’est pas par dédain… Car ai-je la capacité de dédaigner les philosophies?
Je dis juste que vous pouvez croire que la mort ne vaut rien, car vous aurez des raisons, des principes...
Quincas Borba chercha ses pantoufles; Rubião les lui apporta; il les enfila et commença à marcher pour se dégourdir les jambes. Il caressa le chien et alluma une cigarette.
Rubião voulait qu'il s'enveloppe chaudement et lui apporta un frac, un gilet, une robe de chambre et une cape – à son choix. Quincas Borba les repoussa d'un geste de la main. Son regard avait changé; ses yeux, tournés vers l'intérieur, révélaient son esprit tandis qu'il réfléchissait. Après plusieurs pas, il s'arrêta quelques secondes devant Rubião.
CHAPITRE VI
— Pour comprendre ce que sont la mort et la vie, il me suffit de vous raconter comment ma grand-mère est morte.
— Comment c'était?
— Asseyez-vous.
Rubião obéit, montrant le plus grand intérêt possible sur son visage, tandis que Quincas Borba continuait à marcher.
« C'était à Rio de Janeiro », commença-t-il, « devant la chapelle impériale, alors royale, un jour de grande fête. Ma grand-mère partit, traversa le cimetière pour se rendre à la remise qui l'attendait sur la place du Paço. Les gens étaient comme des fourmis. Ils voulaient voir les grandes dames monter dans leurs riches carrosses. Au moment où ma grand-mère quittait le cimetière pour se rendre à la remise, un peu plus loin, l'une des bêtes d'une calèche fut surprise; la bête s'emballa, l'autre suivit. Ce fut la confusion, le tumulte, ma grand-mère tomba, et les mules et la calèche la renversèrent. »
Elle a été portée dans ses bras jusqu'à une pharmacie de la rue Direita, un hémorragique est arrivé, mais il était trop tard; sa tête était fissurée, une jambe et une épaule étaient cassées, elle était couverte de sang; elle est décédée quelques minutes plus tard.
—C’était vraiment une honte, dit Rubião.
— Non.
— Non?
Écoutez la suite. Voici comment cela s'est passé. Le propriétaire de la voiture était dans le cimetière, et il avait faim, très faim, car il était tard, et il avait déjeuné tôt et légèrement.
De là, il pouvait faire signe au cocher; il fouettait les mules pour aller chercher son maître. La voiture rencontra un obstacle au milieu de la route et le renversa; cet obstacle, c'était ma grand-mère. Le premier acte de cette série d'actes était un mouvement d'instinct de conservation: Humanitas avait faim. Si, au lieu de ma grand-mère, il s'était agi d'un rat ou d'un chien, il est vrai que ma grand-mère ne serait pas morte, mais le fait restait le même: Humanitas a besoin de manger. Si, au lieu d'un rat ou d'un chien, s'était agi d'un poète, Byron ou Gonçalves Dias, la situation aurait été différente, fournissant matière à de nombreuses nécrologies; mais l'essentiel demeurait. L'univers ne s'est pas encore arrêté faute de quelques poèmes morts s'épanouissant dans la tête d'un homme illustre ou obscur; mais Humanitas (et c'est important, surtout), Humanitas a besoin de manger.
Rubião écoutait, le cœur dans les yeux, sincèrement désireux de comprendre; mais il ne comprenait pas la nécessité que son ami attribuait à la mort de sa grand-mère. Le cocher, malgré son arrivée tardive, ne mourait sûrement pas de faim, tandis que la bonne dame était bel et bien morte, et pour toujours. Il lui expliqua ses doutes du mieux qu'il put, et finit par demander:
— Et qu’est-ce que c’est que cette Humanitas?
« L'humanitas est le principe. Mais non, je ne dis rien. Tu es incapable de comprendre cela, mon cher Rubião; parlons d'autre chose. »
— Dis-le toujours.
Quincas Borba, qui n’avait pas arrêté de marcher, s’arrêta quelques instants.
— Veux-tu être mon disciple?
— Je veux.
Eh bien, tu comprendras peu à peu ma philosophie; le jour où tu la saisiras pleinement, ah! Ce jour-là, tu connaîtras le plus grand plaisir de la vie, car il n’y a pas de vin aussi enivrant que la vérité. Crois-moi, l’Humanisme est l’aboutissement de toutes choses; et moi, qui l’ai formulé, je suis le plus grand homme du monde. Regarde, vois-tu comme mon cher Quincas Borba me regarde? Ce n’est pas lui, c’est Humanitas…
—Mais de quelle Humanitas s’agit-il?
— L'humanitas est le principe. Il existe, en toute chose, une substance cachée et identique, un principe unique, universel, éternel, commun, indivisible et indestructible – ou, pour reprendre le langage du grand Camões:
Une vérité qui marche dans les choses, qui vit dans le visible et l’invisible.
Car cette substance ou vérité, ce principe indestructible est l’Humanitas.
Je l'appelle ainsi parce qu'il résume l'univers, et l'univers, c'est l'homme. Vous comprenez?
— Peu; mais quand même, comment se fait-il que la mort de ta grand-mère...
— Il n'y a pas de mort. La rencontre de deux expansions, ou l'expansion de deux formes, peut déterminer la suppression de l'une d'elles; mais, à proprement parler, il n'y a pas de mort, il y a vie, car la suppression de l'une est la condition de la survie de l'autre, et la destruction n'affecte pas le principe universel et commun. De là le caractère conservateur et bénéfique de la guerre. Imaginez un champ de pommes de terre et deux tribus affamées. Les pommes de terre ne suffisent qu'à nourrir l'une des tribus, qui acquiert ainsi la force de traverser la montagne et d'atteindre l'autre versant, où les pommes de terre abondent; mais si les deux tribus se partagent pacifiquement les pommes de terre du champ, elles n'obtiennent pas suffisamment de nourriture et meurent de faim. La paix, dans ce cas, est destruction; la guerre, préservation. Une tribu extermine l'autre et ramasse le butin. De là la joie de la victoire, les hymnes, les acclamations, les récompenses publiques et tous les autres effets des actions guerrières. Si la guerre n'était pas cela, de telles manifestations n'auraient jamais lieu, pour la simple raison que l'homme ne célèbre et n'aime que ce qui lui est agréable ou avantageux, et pour la raison rationnelle que nul ne canonise une action qui le détruit virtuellement. Au vaincu, la haine ou la compassion; au vainqueur, les pommes de terre.
—Mais l’opinion des exterminés?
— Il n'y a pas d'extermination. Le phénomène disparaît; la substance reste la même. N'avez-vous jamais vu de l'eau bouillir? Il faut se rappeler que des bulles se forment et disparaissent continuellement, et que tout reste dans la même eau. Les individus sont ces bulles transitoires.
— Eh bien, l’avis de la bulle...
—Bubble n'a pas d'opinion. Apparemment, y a-t-il quelque chose de plus affligeant qu'une de ces terribles pestes qui ravagent un point du globe? Et pourtant, ce prétendu mal est un bienfait, non seulement parce qu'il élimine les organismes faibles et incapables de résistance, mais parce qu'il donne lieu à l'observation, à la découverte du remède. L'hygiène est le fruit d'une pourriture séculaire; nous la devons à des millions de personnes corrompues et infectées. Rien ne se perd, tout se gagne. Je le répète, les bulles restent dans l'eau. Voyez-vous ce livre? C'est Don Quichotte. Si je détruis mon exemplaire, je ne supprime pas l'œuvre qui demeure éternelle dans les exemplaires survivants et dans les éditions suivantes. Éternelle et belle, magnifiquement éternelle, comme ce monde divin et supradivin.
CHAPITRE VII
Quincas Borba se tut, épuisé, et s'assit, essoufflé. Rubião vint à son secours, lui apportant de l'eau et le priant de s'allonger et de se reposer; mais le malade, au bout de quelques minutes, répondit que ce n'était rien. Il avait perdu l'habitude de faire des discours, voilà tout. Et, écartant Rubião pour qu'il puisse lui faire face sans effort, il se lança dans une brillante description du monde et de ses merveilles.
Il mêlait ses propres idées à celles des autres, des images de toutes sortes, idylliques, épiques, à tel point que Rubião se demandait comment un homme qui allait mourir dans quelques jours pouvait gérer de telles choses avec autant de courage.
—Viens te reposer un peu.
Quincas Borba réfléchit.
— Non, je vais me promener.
— Pas maintenant, tu es trop fatigué.
— Quoi! C'est fini.
Il se leva et posa ses mains sur les épaules de Rubião d'une manière paternelle.
— Es-tu mon ami?
— Quelle question!
— Dire.
—Autant ou plus que cet animal, répondit Rubião, dans un élan de tendresse.
Quincas Borba lui serra la main.
— Bien.
CHAPITRE VIII
Le lendemain, Quincas Borba se réveilla avec la résolution de se rendre à Rio de Janeiro. Il reviendrait dans un mois et avait des affaires à régler. Rubião fut stupéfait. Et la maladie? Et le médecin? Le patient répondit que le médecin était un charlatan et que la maladie avait besoin de se changer les idées, tout comme la santé. Maladie et santé étaient deux graines d'un même fruit, deux états d'Humanité.
« Je m'en vais pour une affaire personnelle », conclut le malade, « et j'ai un plan si sublime que même vous ne pourrez pas le comprendre. Pardonnez-moi d'être si franc, mais je préfère l'être avec vous qu'avec qui que ce soit d'autre. »
Rubião espérait que ce projet lui échapperait avec le temps, comme tant d'autres; mais il se trompait. Il ajouta qu'en vérité, le patient semblait aller mieux; il ne se couchait pas, il sortait, il écrivait. Au bout d'une semaine, il fit venir le notaire.
—Notaire? répéta son ami.
— Oui, je veux enregistrer mon testament. Ou devrions-nous y aller tous les deux…
Ils partirent tous les trois, car le chien ne laissait pas son maître partir sans l'accompagner. Quincas Borba déposa le testament, avec toutes les formalités du jour, et rentra chez lui tranquillement. Rubião sentit son cœur battre violemment.
—Il est clair que je ne te laisserai pas aller seul au tribunal, dit-il à son ami.
« Non, ce n'est pas nécessaire. De plus, Quincas Borba ne part pas, et je ne le confierai à personne d'autre qu'à toi. Je laisse la maison telle qu'elle est. Je reviens dans un mois. »
Je pars demain; je ne veux pas qu'il se rende compte de mon départ. Prends soin de lui, Rubião.
— Oui je le fais.
— Vraiment?
— Par cette lumière qui m'éclaire. Suis-je donc un enfant?
— Donnez-lui du lait aux heures appropriées, tous ses repas habituels et ses bains; et quand vous le promenez, veillez à ce qu'il ne s'enfuie pas. Non, le mieux, c'est qu'il ne sorte pas… qu'il ne sorte pas…
— Vas-y doucement.
Quincas Borba pleurait pour l'autre Quincas Borba. Il ne voulait pas le voir partir. Il pleurait sincèrement; des larmes de folie ou d'affection, quelles qu'elles fussent, il les laissait derrière lui dans la belle terre du Minas Gerais, comme la sueur finale d'une âme sombre sur le point de sombrer dans l'abîme.
CHAPITRE IX
Quelques heures plus tard, Rubião eut une horrible pensée. Il était probable qu'il avait lui-même incité son ami à faire le voyage, afin de le tuer plus rapidement et de s'emparer de l'héritage, si celui-ci était effectivement prévu dans le testament. Il éprouva des remords. Pourquoi n'avait-il pas utilisé toute sa force pour le retenir? Il vit le cadavre de Quincas Borba, pâle, hideux, le fixant d'un regard vengeur; il résolut, si l'issue fatale se produisait pendant le voyage, de renoncer à l'héritage.
De son côté, le chien reniflait, gémissait, cherchait à s'échapper; il ne dormait pas tranquillement et se levait souvent la nuit, faisait les cent pas dans la maison et retournait dans son coin. Le matin, Rubião l'appelait pour aller se coucher, et le chien venait tout joyeux; il imaginait que c'était son propre maître; il s'apercevait plus tard que ce n'était pas le cas, mais il acceptait les caresses et lui en donnait d'autres, comme si Rubião devait donner les siennes à son ami, ou l'y amener.
De plus, il s'était attaché à elle, et pour lui, elle était le pont qui le reliait à son existence antérieure. Il ne mangea pas les premiers jours. Sa soif étant moins supportable, Rubião réussit à lui faire boire du lait; ce fut son unique nourriture pendant un certain temps. Plus tard, il passait ses heures silencieuses, triste, recroquevillé sur lui-même, ou bien le corps allongé et la tête dans les mains.
Lorsque le médecin revint, il fut étonné de la témérité du malade; on aurait dû l'empêcher de partir; la mort était certaine.
— Droite?
— Tôt ou tard. As-tu pris ce chien?
« Non, monsieur, il est avec moi; il m'a demandé de m'occuper de lui, et il a pleuré, et il a pleuré sans fin. C'est vrai », dit Rubião, défendant le malade, « le chien mérite l'affection de son maître: il est comme un être humain. »
Le docteur ôta son large chapeau de paille pour fixer le ruban adhésif; puis il sourit.
Des gens? À quoi ressemblaient-ils alors? insista Rubião, puis il expliqua: ce n'étaient pas des gens comme les autres, mais ils avaient des sentiments, et même du jugement. Écoute, j'allais te dire quelque chose…
— Non, mon gars, non; bientôt, bientôt; je vais voir un homme atteint d'érysipèle… Si des lettres de lui arrivent, et qu'elles ne sont pas confidentielles, je veux les voir, tu m'entends? Et mes salutations au chien, conclut-il en partant.
Certains se moquèrent de Rubião et de sa tâche unique: surveiller un chien plutôt que le chien lui-même. Les rires fusèrent et les surnoms pleuvèrent. Que manigançait le professeur? Un gardien de chiens!
Rubião craignait l'opinion publique. Il lui semblait ridicule; il évitait le regard des étrangers, regardait l'animal avec dégoût, se livrait au diable et renonçait à la vie. N'avait-il pas espéré un héritage, si modeste fût-il… Impossible pour lui de ne pas laisser un souvenir.
CHAPITRE X
Sept semaines plus tard, cette lettre arriva à Barbacena, datée de Rio de Janeiro, entièrement écrite de la main de Quincas Borba:
« Mon cher monsieur et ami,
Mon silence a dû vous paraître étrange. Je ne vous ai pas écrit pour des raisons personnelles, etc. Je reviendrai bientôt, mais je veux vous dire quelque chose de privé, de très privé.
Qui suis-je, Rubião? Je suis Saint Augustin. Je sais que tu souriras, car tu es ignorant, Rubião; notre intimité me permettrait de dire un mot plus direct, mais je vais faire cette concession, qui est la dernière. Ignorant!
Écoute, ignorant. Je suis Saint Augustin; j’ai découvert cela avant-hier: écoute et tais-toi. Tout coïncide dans nos vies. Le saint et moi passons une partie de notre temps dans les plaisirs et l’hérésie, car je considère tout ce qui ne relève pas de ma doctrine de l’Humanité comme une hérésie; nous avons tous deux volé, lui, enfant, des poires à Carthage, et moi, jeune homme, une montre à mon ami Bras Cubas. Nos mères étaient pieuses et chastes. Quoi qu’il en soit, il pensait, comme moi, que tout ce qui existe est bon, et il le démontre au chapitre XVI du livre VII des Confessions, à cette différence près que, pour lui, le mal est une déviation de la volonté, une illusion typique d’un siècle arriéré, une concession à l’erreur, puisque le mal n’existe même pas et que seule la première affirmation est vraie; tout est bon.omnia bona, et au revoir.
Adieu, ignorant. Ne raconte à personne ce que je viens de te confier, sinon tu seras indiscret. Tais-toi, sois discret et sois reconnaissant d'avoir la chance d'avoir un grand homme comme moi comme ami, même si tu ne me comprends pas. Tu me comprendras.
Dès mon retour à Barbacena, je vous donnerai, en termes clairs et simples, à la portée d'un âne, la véritable idée du grand homme. Adieu; mes salutations à mon pauvre Quincas Borba. N'oubliez pas de lui donner du lait; du lait et des bains; au revoir, au revoir… Cordialement.
QUINCAS BORBA”
Rubião tenait à peine le papier entre ses doigts. Au bout de quelques secondes, il comprit qu'il s'agissait peut-être d'une blague de son ami et relut la lettre; mais la deuxième lecture confirma sa première impression. Aucun doute: il était fou. Pauvre Quincas Borba!
Ainsi, les bizarreries, les changements fréquents d’humeur, les impulsions sans motif, la tendresse disproportionnée, n’étaient rien d’autre que des signes avant-coureurs de la ruine totale du cerveau.
Il était mourant avant de mourir. Si bien! Si heureux! Il avait ses impertinences, c'est vrai; mais la maladie les expliquait. Rubião s'essuya les yeux, humides d'émotion.
Puis vint la pensée de l’héritage possible, et cela le bouleversa encore plus, car cela lui montra quel bon ami il allait perdre.
Il voulait relire la lettre, lentement cette fois, analyser les mots, les décortiquer, pour en discerner le sens et découvrir s'il s'agissait vraiment d'une plaisanterie philosophique. Cette façon de le décomposer en plaisantant lui était familière; mais la suite confirma ses soupçons de catastrophe. Vers la fin, il s'arrêta net. Se pouvait-il que, la maladie mentale du testateur étant prouvée, le testament soit nul et non avenu, et les indices perdus? Rubião se sentit pris de vertige. Il tenait encore la lettre ouverte dans ses mains lorsqu'il vit apparaître le médecin, venu signaler le patient; le maître de poste lui avait annoncé qu'une lettre était arrivée. Était-ce celle-là?
— C'est ça, mais...
— Avez-vous des communications confidentielles?...
— Précisément, c'est une communication confidentielle, très confidentielle; une affaire personnelle. Pardon?
Sur ce, Rubião rangea la lettre dans sa poche; le médecin partit et il prit une grande inspiration. Il avait échappé au danger de publier un document aussi grave, qui aurait pu prouver l'état mental de Quincas Borba. Quelques minutes plus tard, il le regretta; il aurait dû remettre la lettre; il éprouva des remords et envisagea de l'envoyer chez le médecin. Il appela un esclave; lorsque l'esclave arriva, il avait déjà changé d'avis; il jugea cela imprudent; le patient reviendrait bientôt – dans quelques jours – s'enquérirait de la lettre, l'accuserait d'indiscrétion, de délation… Remords faciles, de courte durée.
« Je ne veux rien », dit-il à l'esclave. Et une fois de plus, il pensa à l'héritage. Il calcula le chiffre. Moins de dix mille, non. Il achèterait un terrain, une maison, cultiverait ceci ou cela, ou extrairait de l'or. Le pire serait que ce soit moins, cinq mille…
Cinq? Ce n'était pas grand-chose; mais après tout, ce ne serait peut-être pas plus. Cinq, même si c'était le cas, c'était un arrangement mineur, et mieux que rien. Cinq mille… Ce serait pire si le testament était nul et non avenu. Eh bien, cinq mille!
CHAPITRE XI
Au début de la semaine suivante, recevant les journaux de la Cour (toujours signés par Quincas Borba), Rubião lut cette nouvelle dans l'un d'eux:
M. Joaquim Borba dos Santos est décédé hier, après avoir enduré sa maladie avec une philosophie singulière. C'était un homme d'une grande érudition, et il s'est épuisé à lutter contre ce pessimisme terne et terne qui nous atteindra un jour; c'est la maladie du siècle. Ses derniers mots furent que la douleur était une illusion, et que Pangloss n'était pas aussi stupide que Voltaire l'avait inculqué… Il délirait déjà. Il laisse derrière lui de nombreux biens. Son testament est à Barbacena.
CHAPITRE XII
— Tu viens de souffrir! Soupira Rubião.
Puis, en lisant les nouvelles, il vit qu'elles parlaient d'un homme qu'il tenait en haute estime et respect, à qui on attribuait une lutte philosophique. Il n'y avait aucune allusion à la démence. Au contraire, la fin affirmait qu'il délirait depuis une heure, conséquence de sa maladie. Heureusement! Rubião relut la lettre, et l'hypothèse de la moquerie lui parut à nouveau plausible. Il reconnut qu'il était drôle; il avait certainement envie de le taquiner; il alla voir saint Augustin, comme il serait allé voir saint Ambroise ou saint Hilaire, et écrivit une lettre énigmatique pour le dérouter, jusqu'à ce qu'il rit à nouveau de la supercherie.
Pauvre ami! Il était en bonne santé – en bonne santé et mort. Oui, il ne souffrait plus du tout. En voyant le chien, il soupira:
—Pauvre Quincas Borba! Si seulement il pouvait savoir que tu étais mort…
Alors je peux:
— Maintenant que l'obligation est terminée, je vais la donner à la camarade Angélica.
CHAPITRE XIII
La nouvelle se répandit dans toute la ville; le vicaire, le pharmacien et le médecin partirent tous vérifier la véracité de la nouvelle. Le maître de poste, qui l'avait lue dans les pages, apporta personnellement à Rubião une lettre qui lui avait été remise dans la valise; elle pouvait provenir du défunt, bien que l'écriture de l'enveloppe fût différente.
« Alors, l'homme s'est enfin déboîté? » demanda-t-il, tandis que Rubião ouvrait la lettre, se précipitait vers la signature et lisait: Brás Cubas. C'était une simple note:
Mon pauvre ami Quincas Borba est décédé hier chez moi, où il se trouvait depuis quelque temps, dépenaillé et sordide, des suites de sa maladie. Avant de mourir, il m'a prié de lui écrire pour lui annoncer cette nouvelle et de lui adresser de vifs remerciements, et que le reste serait réglé selon les usages de la cour.
Les remerciements firent pâlir le professeur, mais les usages de la cour lui redonnèrent courage. Rubião ferma la lettre sans rien dire; l'agent parla de choses et d'autres, puis s'en alla. Rubião ordonna à un esclave d'apporter le chien en cadeau à la camarade Angélica, lui disant que, puisqu'elle aimait les animaux, il en existait un autre; de bien le traiter, car il y était habitué; enfin, que le nom du chien était le même que celui de son défunt propriétaire, Quincas Borba.
CHAPITRE XIV
À l'ouverture du testament, Rubião a failli tomber à la renverse. On devine pourquoi.
Il fut désigné comme l'unique héritier du testateur. Non pas cinq, ni dix, ni vingt mille, mais tout, le capital entier, les biens spécifiés, les maisons de la Cour, dont une à Barbacena, les esclaves, les polices d'assurance, les actions de la Banque du Brésil et d'autres institutions, les bijoux, la monnaie, les livres: tout passa finalement entre les mains de Rubião, sans détournement, sans legs à quiconque, sans aumônes ni dettes. Le testament ne contenait qu'une seule condition: que l'héritier garde son pauvre chien, Quincas Borba, un nom qu'il lui avait donné en raison de sa grande affection pour lui. Il exigeait que Rubião le traite comme s'il était le testateur lui-même, n'épargnant rien pour son bien, le protégeant de la maladie, de la fuite, du vol ou de la mort que quiconque pourrait lui infliger par malveillance; enfin, qu'il prenne soin de lui comme s'il n'était pas un chien, mais un être humain. De plus, il imposa la condition qu'à la mort du chien, il lui donnerait une sépulture décente dans son propre terrain, qu'il couvrirait de fleurs et de plantes odorantes; et qu'il déterrerait aussi les os dudit chien, quand le moment serait venu, et les recueillerait dans une urne de bois précieux pour les déposer dans le lieu le plus honorable de la maison.
CHAPITRE XV
Telle était la clause. Rubião la trouva naturelle, puisqu'il n'avait en tête que de s'occuper de l'héritage. Il avait eu un indice, et la totalité de ses biens avait été retirée de son testament. Il n'arrivait pas à y croire; il dut se laisser serrer par leurs mains – par la force des félicitations – pour ne pas croire à un mensonge.
—Oui, monsieur, écrivez un mot, dit le propriétaire de la pharmacie qui avait donné son médicament à Quincas Borba.
Un héritier, c'était déjà beaucoup; mais universel… Ce mot fit gonfler les joues de l'héritage. Héritier de tout, pas une seule cuillerée de moins. Et combien cela représenterait-il? se demandait-il. Maisons, polices d'assurance, actions, esclaves, vêtements, porcelaine, quelques tableaux, qu'il aurait à la Cour, car c'était un homme de grand goût et qui traitait les questions artistiques avec une grande connaissance. Et les livres? Il devait en avoir beaucoup; il en citait beaucoup. Mais comment tout cela allait-il? Cent mille? Peut-être deux cents. C'était possible; trois cents, même; rien d'étonnant. Trois cent mille! Trois cents! Et Rubião avait envie de danser dans la rue. Puis il se calmerait; deux cents, ou cent, étaient un rêve que Dieu Notre Seigneur lui avait donné, mais un long rêve, sans fin.
Le souvenir du chien parvint à s'immiscer dans le tourbillon de pensées qui traversait l'esprit de notre homme. Rubião trouvait cette clause naturelle, mais inutile, car lui et le chien étaient deux amis, et rien n'était plus approprié qu'être ensemble, pour se souvenir de leur troisième ami, celui qu'ils avaient perdu, l'auteur de leur bonheur. Il y avait sans doute quelques particularités dans cette clause, une histoire d'urne, et il ne savait quoi d'autre; mais tout s'accomplirait, même si le ciel lui tombait dessus… Non, avec l'aide de Dieu, corrigea-t-il. Bon chien! Excellent chien!
Rubião n'oublia jamais qu'il avait souvent tenté de s'enrichir grâce à des entreprises disparues. À l'époque, il se considérait comme un misérable, un rustre, alors qu'en vérité, « il vaut mieux aider Dieu que se lever tôt ». Devenir riche n'était pas impossible, alors il l'était.
« Impossible, quoi? » s'exclama-t-il d'une voix forte. « Il est impossible que Dieu pèche. Dieu tient toujours ses promesses. »
Il continua ainsi, arpentant les rues de la ville, sans guide, sans plan, le sang battant. Soudain, une question sérieuse se posa: allait-il vivre à Rio de Janeiro ou rester à Barbacena? Il ressentit le besoin irrésistible de rester, de briller là où il faisait sombre, de casser la châtaigne à ceux qui l’avaient jusque-là ignoré, et surtout à ceux qui s’étaient moqués de l’amitié de Quincas Borba. Mais, peu après, l’image de Rio de Janeiro, qu’il connaissait, avec ses charmes, son agitation, ses théâtres omniprésents, ses belles jeunes femmes « habillées à la française », lui revint en mémoire. Il décida que c’était mieux; il pouvait retourner dans sa ville natale encore et encore.
CHAPITRE XVI
— Quincas Borba! Quincas Borba! Hé! Quincas Borba! cria-t-il en entrant dans la maison.
Pas de chien. Ce n'est qu'alors qu'il se souvint de l'avoir envoyé à son amie Angélica. Il courut chez elle, qui était loin. En chemin, toutes sortes d'idées désagréables lui vinrent, certaines extraordinaires. L'une d'elles était que le chien s'était enfui. Une autre idée extraordinaire était qu'un ennemi, au courant de la clause et du cadeau, irait chez son amie, volerait le chien et le cacherait ou le tuerait. En l'occurrence, l'héritage… Un nuage passa sur ses yeux; puis il commença à y voir plus clair.
« Je ne connais rien à la justice », pensa-t-il, « mais il semble que je n'y sois pour rien. La clause suppose que le chien est vivant ou à la maison; mais s'il s'enfuit ou meurt, il n'est pas nécessaire d'inventer un chien; par conséquent, l'intention principale… Mais mes ennemis sont capables de tromperies. Si la clause n'est pas respectée… »
Là, le front et le dos des mains de notre ami s'humidifièrent. Un autre nuage obscurcit ses yeux. Et son cœur battait fort, fort. La clause commençait à lui paraître extravagante. Rubião s'occupait des saints, promettant des messes, dix messes… Mais il y avait la maison de son ami. Rubião pressa le pas; il vit quelqu'un; était-ce elle? Oui, c'était elle, appuyée contre la porte et riant.
—Quelle figure tu fais, mon ami? À moitié étourdi, jetant les bras partout.
CHAPITRE XVII
— Mon cher, le chien? demanda Rubião, indifférent, mais pâle.
—Entrez et asseyez-vous, répondit-elle. Quel chien?
« Quel chien? » Le visage de Rubião pâlit. « Celui que je t'ai envoyé. Tu ne te souviens pas que je t'ai envoyé un chien pour rester ici quelques jours, pour te reposer, pour voir si… bref, un vrai chien de compagnie. Il n'est pas à moi. Il est venu… Mais tu ne te souviens pas? »
« Ah! Ne me parlez pas de cet animal! » répondit-elle d'un ton précipité.
Elle était petite, tremblante au moindre signe, et quand elle tombait amoureuse, les veines de son cou gonflaient. Elle lui répéta de ne pas parler de l'animal.
—Mais qu’est-ce qu’il t’a fait, ma chère?
—Qu'est-ce que tu m'as fait? Que me ferait ce pauvre animal? Il ne mange rien, il ne boit pas, il pleure comme un être humain et il se promène avec un seul œil crevé, essayant de s'échapper.
Rubião prit une grande inspiration. Elle continua de lui raconter les tracas du chien; lui, anxieux, voulait le voir.
Il est là-bas, dans le grand enclos; il est seul pour que les autres ne viennent pas le chercher. Mais son ami vient-il le chercher? Ce n'est pas ce qu'ils ont dit.
Il me semblait entendre que c'était pour moi, que c'était donné.
« Je t'en donnerais cinq ou six si je pouvais », répondit Rubião. « Je ne peux pas te donner celle-là; je ne suis qu'un fiduciaire. Mais ne t'inquiète pas, je te promets un fils. Crois-moi, le message est mal passé. »
Rubião marchait; sa marraine, au lieu de le guider, le suivait. Le chien était là, dans l'enclos, avec sa gamelle de nourriture à portée de main. Chiens et oiseaux sautaient de tous côtés; d'un côté, un poulailler, plus loin, des cochons; encore plus loin, une vache somnolait, deux poules à ses pieds, se picorant le ventre pour en extraire des tiques.
—Regarde mon paon! dit la marraine.
Mais Rubião avait les yeux fixés sur Quincas Borba, qui reniflait avec impatience et se jetait sur lui dès qu'un garçon ouvrait la porte de l'enclos. C'était une scène de délire; le chien répondait aux caresses de Rubião en aboyant, en sautant et en lui baisant les mains.
— Mon Dieu! Quelle amitié!
« Tu ne peux pas imaginer, ma chère. Au revoir, je te promets un fils. »
CHAPITRE XVIII
Rubião et le chien, entrant dans la maison, perçurent et entendirent la personne et les voix de leur défunt ami. Tandis que le chien reniflait partout, Rubião s'assit dans le fauteuil où il se trouvait lorsque Quincas Borba avait décrit la mort de sa grand-mère avec des explications scientifiques. Sa mémoire reconstitua, bien que confuse et effilochée, les arguments du philosophe. Pour la première fois, il médita pleinement sur l'allégorie des tribus affamées et en comprit la conclusion: « Au vainqueur, les pommes de terre! » Il entendit distinctement la voix rauque du défunt expliquer la situation des tribus, la lutte et ses raisons, l'extermination de l'une et la victoire de l'autre, et murmura doucement:
— Au vainqueur, les pommes de terre!
Tellement simple! Tellement clair! Il regarda son jean usé et sa fichue brouette et réalisa que jusqu'à récemment, il avait été, pour ainsi dire, un exterminé, une masse informe; mais maintenant, non, il était un vainqueur. Aucun doute; les pommes de terre étaient faites pour la tribu qui élimine l'autre, afin de traverser la montagne et d'atteindre les pommes de terre de l'autre côté. Précisément son cas. Il descendait de Barbacena pour déraciner et manger les pommes de terre de la capitale. Il devait être dur et impitoyable; il était puissant et fort. Et se relevant brusquement, excité, il leva les bras en s'exclamant:
— Au vainqueur, les pommes de terre!
Il appréciait la formule; il la trouvait ingénieuse, complète et éloquente, ainsi que vraie et profonde. Il concevait les pommes de terre sous leurs différentes formes, les classait selon leur saveur, leur apparence et leur valeur nutritionnelle, et se régalait du festin de la vie.
Il était temps d'en finir avec les pauvres racines sèches qui ne faisaient que tromper l'estomac, la triste nourriture de longues années; voici l'abondante, la solide, la perpétuelle, à manger jusqu'à la mort, et à mourir sous des couvre-lits de soie, mieux que des haillons. Et il revint à l'affirmation d'être dur et implacable, et à la formule de l'allégorie. Il composa même de mémoire une chevalière à son usage, avec cette devise: AU VICTOR, LES POMMES DE TERRE.
Il oublia le motif du sceau, mais la formule resta gravée dans l'esprit de Rubião pendant quelques jours: « Au vainqueur, les pommes de terre! » Il ne l'aurait pas comprise avant le testament; au contraire, nous avons vu qu'il la trouvait obscure et inexpliquée. Il est tellement vrai que le paysage dépend du point de vue, et que la meilleure façon d'apprécier le fouet est de tenir le manche en main.
CHAPITRE XIX
N'oublions pas de mentionner que Rubião prit l'initiative d'ordonner une messe pour l'âme du défunt, même s'il savait ou pressentait qu'il n'était pas catholique. Quincas Borba ne débita pas d'absurdités à propos des prêtres, ni ne discrédita les doctrines catholiques; il ne parla pas non plus de l'Église ni de ses serviteurs. D'autre part, la vénération de l'Humanité rendit l'héritier méfiant quant à la religion du testateur. Il ordonna néanmoins que la messe soit célébrée, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un acte de volonté du défunt, mais d'une prière des vivants; il estimait en outre que ce serait un scandale dans la ville s'il, désigné héritier par le défunt, n'offrait pas à son protecteur les suffrages qui ne sont pas refusés aux plus misérables et aux plus avares de ce monde.
Si certains ont arrêté de venir pour éviter d'être témoins de la gloire de Rubião, beaucoup d'autres — et pas parmi la populace — ont été ceux qui ont vu le véritable remords de l'ancien professeur de garçons.
CHAPITRE XX
Une fois les préparatifs de l'héritage réglés, Rubião s'organisa pour venir à Rio de Janeiro, où il s'installerait dès que tout serait terminé. Il y avait du travail à faire dans les deux villes, mais les choses promettaient d'avancer rapidement.
CHAPITRE XXI
À la gare de Vassouras, Sofia et son mari, Cristiano de Almeida e Palha, montèrent dans le train. Lui, un beau jeune homme de trente-deux ans, et elle, entre vingt-sept et vingt-huit ans. Ils s'assirent sur les deux bancs en face de chez Rubião, disposèrent les petits paniers et les paquets de souvenirs qu'ils avaient rapportés de Vassouras, où ils avaient passé une semaine; boutonnèrent leurs manteaux et échangèrent quelques mots à voix basse.
Alors que le train reprenait sa route, Palha remarqua Rubião, dont le visage, parmi tant de personnes fronçant les sourcils ou agacées, était le seul à afficher un visage calme et satisfait. Cristiano fut le premier à engager la conversation, lui disant que les voyages en train étaient très fatigants, ce à quoi Rubião répondit que oui; pour quelqu'un habitué aux voyages à dos d'âne, ajouta-t-il, le train était fatigant et peu agréable; cependant, on ne pouvait nier que c'était un progrès…
— Certainement, acquiesça Palha. Les progrès sont grands.
— Vous êtes agriculteur?
— Non, monsieur.
— Vous habitez en ville?
— De Vassouras? Non, nous sommes venus ici pour passer une semaine. En fait, j'habite à la Cour.
Je ne serais pas fait pour être agriculteur, même si je pense que c'est un poste bon et honorable.
De l'agriculture, ils passèrent à l'élevage, à l'esclavage et à la politique. Cristiano Palha maudit le gouvernement pour avoir introduit un mot sur la propriété servile dans le discours du Trône; mais, à sa grande surprise, Rubião ignora son indignation. Le gouvernement prévoyait de vendre les esclaves que le testateur lui avait léguées, à l'exception d'un page; s'il perdait quelque chose, le reste de l'héritage compenserait la perte. De plus, le discours du Trône, qu'il avait également lu, imposait le respect des biens actuels. Que lui importait de futurs esclaves s'il ne les rachetait pas? La page serait libérée dès qu'il entrerait en possession des biens. Palha changea de sujet et passa à la politique, aux Chambres, à la guerre du Paraguay – autant de sujets généraux auxquels Rubião prêtait plus ou moins attention. Sofia se contenta d'écouter; elle bougea seulement ses yeux, qu'elle savait beaux, fixant tantôt son mari, tantôt son interlocuteur.
« Tu vas rester à la Cour ou retourner à Barbacena? » demanda Palha après vingt minutes de conversation.
« Je veux rester, et je le ferai », répondit Rubião. « J'en ai assez de la province; je veux profiter de la vie. J'irai peut-être même en Europe, mais je ne sais pas encore. »
Les yeux de Palha s'illuminèrent instantanément.
—Vous avez tout à fait raison, je ferais la même chose si je le pouvais; pour l’instant, je ne peux pas.
Vous y êtes probablement déjà allé?
—Je n'y suis jamais allé. C'est pourquoi j'avais quelques idées en quittant Barbacena; alors, au revoir!
Il faut qu'on se débarrasse de cette morrinha. Je ne sais pas encore quand ça viendra, mais je le ferai…
Tu as raison. On dit qu'il y a beaucoup de choses splendides là-bas; ce n'est pas étonnant, ils sont plus vieux que nous; mais nous y arriverons; et il y a des domaines où nous sommes à leur niveau, voire supérieurs. Notre Cour… je ne dirais pas qu'elle peut rivaliser avec Paris ou Londres, mais elle est magnifique, tu verras…
— Je l'ai vu.
— Déjà?
— Il y a de nombreuses années.
—Tu trouveras ça mieux; tu as fait de rapides progrès. Ensuite, quand tu iras en Europe…
« Es-tu déjà allée en Europe? » interrompit Rubião en s’adressant à Sofia.
— Non, monsieur.
« J'ai oublié de te présenter ma femme », répondit Cristiano. Rubião s'inclina respectueusement et, se tournant vers son mari, lui dit en souriant:
—Mais tu ne me présentes pas à moi?
Palha sourit aussi; il comprit qu'aucun d'eux ne connaissait le nom de l'autre, et il s'empressa de dire le sien.
— Cristiano de Almeida et Palha.