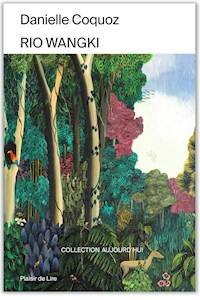
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plaisir de Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
1986, Danielle et Andrée se trouvent au Nicaragua, envoyées par le CICR dans une région reculée, territoire des indiens Miskitos, dont la population a été expulsée. Une guerre civile sévit dans le pays. Elles mettent sur pied une mission : aider les Miskitos à retourner sur leurs terres ancestrales.
Ce récit retrace avec vivacité et humour l’épopée folle de deux femmes sur un fleuve, au milieu de la jungle, traversant les zones de combats, faisant face avec bravoure et simplicité à des conditions de vie éprouvantes et rocambolesques.
Une page d’histoire qui nous emmène hors du quotidien et qui se lit comme un roman d’aventures.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À la mémoire de gianni, le Boss
AVANT-PROPOS
Ce texte est le récit de ma mémoire.
Pendant un quart de siècle j’ai travaillé sous l’emblème du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), participant à l’engagement humanitaire de cette institution au sein des conflits armés.
En 1986, je fus envoyée en mission sur la côte atlantique nord du Nicaragua en compagnie d’une infirmière, Andrée, dans le but de venir en aide à la population indienne Miskito victime de la guerre civile qui déchirait le pays depuis plusieurs années. Cet épisode de mon parcours humanitaire occupe une place de choix dans mon esprit et dans mon cœur.
Le délégué du CICR est un passant, dans tous les sens du terme. Il entre dans une situation généralement tragique et chaotique, puis il en sort, un an ou deux plus tard. Il passe le relais et poursuit sa route. Ce qui, hier, lui tenait à cœur à s’en ronger les sangs devient, dès demain, l’affaire des autres. Sa contribution personnelle s’évapore au sein de l’effort collectif, il ne parvient pas à en faire le bilan. En outre, si les succès de l’action pour laquelle il s’est engagé se révèlent parfois éphémères, il arrive au contraire que les échecs renferment une graine qui fera fleurir autre chose, plus tard, sans lui. L’action humanitaire en situation de guerre est un révélateur brutal et grossissant de la précarité et de l’incertain des entreprises humaines.
Les années ont passé. Au fil du temps, le désir de faire le récit de cette aventure chez les Miskitos a poussé en moi comme les anneaux d’un tronc à croissance lente. Un processus souterrain de distillation, de zoom, d’oubli également a façonné ma mémoire pendant près de trente ans.
Restait à trouver le fil de l’écriture. J’ai décidé de me fier à l’intuition de raconter à la première personne tout ce dont je me souvenais et seulement ce dont je me souvenais. Je n’ai pas cherché à consulter les archives du CICR. Ma démarche est strictement personnelle, aux antipodes d’un travail de recherche.
Pour ce qui est de l’histoire et des traditions du peuple Miskito, ma mémoire a dû être rafraîchie par quelques lectures. Il en va de même pour certains épisodes de la guerre civile du Nicaragua. Sans surprise, les clivages idéologiques propres à ce conflit du temps de la guerre froide perdurent dans nombre d’écrits, éclairant les événements sous des jours différents. Cependant, nul ne conteste plus depuis longtemps le fait que les Indiens miskitos du Rio Wangki furent chassés de leurs terres en 1981 et qu’ils connurent le malheur de l’exil ou de l’internement.
Afin que la narration s’ordonne de façon cohérente pour le lecteur, il m’a fallu en recomposer partiellement la trajectoire. Ce travail d’harmonisation ne change pas le fait que tout est vrai, du point de vue de mes souvenirs.
Rio Wangki est le nom indigène du fleuve frontière entre le Nicaragua et le Honduras, appelé officiellement Rio Coco. Dans le texte, j’ai souhaité le nommer par son nom miskito, le Wangki.
En cours d’écriture, quantité de souvenirs endormis ont été réveillés et ont repris les couleurs de la vie.
Il s’agit bien du récit de ma mémoire.
CARTE DU NICARAGUA Carte : Vidiani-maps. (Les noms de Puerto Cabezas, Waspam, Rio Coco (Wangki) et Cabo de Gracias a Dios ont été agrandis par mes soins)
Carte approximative du trajet des expéditions sur le Rio Coco (Wangki)
RIO ABAJO
C’est une entrée en scène grandeur nature. Nous descendons le cours sinueux du fleuve depuis des heures, boucle après boucle. L’eau, la végétation, le ciel se liguent pour nous bluffer, nous en mettre plein la vue.
Depuis la pirogue, le fleuve tempétueux prend une largeur d’Amazone. Une herse compacte d’arbres, de lianes et de plantes immenses obturent les rives. Autour de nous, un enchevêtrement de végétation brisée dévale le courant, mettant nos bateaux au défi d’éviter troncs et branches, d’autant plus dangereux que l’on n’en perçoit que la partie émergée, à la manière des icebergs.
Et nous, fétus de paille, coquilles de noix cramponnées au dos de ce dragon bouillonnant ! Pour le moment ma joie est libérée, toute peur dissipée.
Perchés sur la cime des arbres, les oiseaux du fleuve offrent au soleil leurs ailes déployées, saluant notre passage de toute leur envergure, haie d’honneur sous le ciel blanc. Certains s’envolent par bandes, leurs cris percent le vrombissement des moteurs hors-bord.
Il faut le voir Cornelio, à la barre du Zodiac ! C’est lui qui ouvre la voie et, depuis ma pirogue, j’admire sa précision : rien ne lui échappe, pas plus les courants et les brusques remous que les arbres à la dérive, une anticipation millimétrée. Les assistants calent leurs manœuvres sur la sienne. En plus, il se paie le luxe d’arborer un air nonchalant, quasiment ennuyé. Humphrey bogart dans African Queen.
Mon cerveau s’agite en zigzag : où allons-nous bien pouvoir faire halte pour la nuit, aucune ouverture n’ayant encore été perceptible dans l’épais rideau de la jungle ; des populations sont-elles de retour le long des berges ? Je commence à avoir un petit creux, je ne peux même pas parler à Andrée qui est dans le Zodiac. Pas bon ça, il faudra que nous naviguions ensemble à l’avenir, en parler à Cornelio. Cette navigation est fabuleuse mais je commence à avoir mal aux fesses et des débuts de crampes aux jambes, affreusement coincée par tout le matériel. Normal, c’est le premier jour, on améliorera les choses au fur et à mesure. Il ne faudrait peut-être pas oublier pourquoi nous sommes là, bien que l’expérience présente se suffise amplement à elle-même. Exploratrice sur le Rio Wangki, ha ! Pas l’ombre d’une autre embarcation depuis le départ, pas le moindre soldat, pas trace du plus petit guérillero, aucune femme, homme ou enfant. Pourquoi n’y a-t-il aucun signe de vie humaine, la jungle est-elle donc si complètement vorace ? Oh, attention, Cornelio nous fait signe, il dirige le Zodiac vers la rive !
Il ne s’agit que d’une petite pause. Les bateaux sont amarrés à des arbres, les hommes sautent à terre et dégagent un petit coin à la machette pour que nous puissions dérouiller nos jambes. On avale un léger casse-croûte de pain et de fromage, on se soulage en vitesse dans un fourré qui inspire tout sauf confiance, et retour sur le fleuve. Cette fois je m’installe aussi sur le Zodiac.
– Cornelio, on ne voit pas âme qui vive, qu’en penses-tu ?
– Plus bas, peut-être.
Quel bavard, ce Cornelio.
Une courbe du fleuve, puis une autre. Soudain, deux silhouettes agitent les bras sur la rive. Les bateaux se rapprochent, les deux hommes font signe de nous préparer à accoster, juste un peu plus bas. Ce sont des civils.
L’ENVOYÉ
Par un beau jour d’avril, l’Envoyé avait frappé à la porte de notre maison de Puerto Cabezas. Il s’était présenté comme un Indien miskito du Rio Wangki désireux de s’entretenir avec nous et nous l’avions immédiatement invité à entrer. C’était un homme jeune d’une maigreur impressionnante. Il posa son sac à dos avec un soupir de soulagement en s’asseyant dans notre petite antichambre. Cela faisait des jours qu’il marchait, nous expliqua-t-il, et il était grandement soulagé de nous trouver à Puerto Cabezas, ayant craint que nous ne soyons déjà reparties. Il s’exprimait avec le langage et les façons de quelqu’un de bien éduqué, un étudiant sans doute. Il absorba en silence le café et les biscuits posés devant lui. C’était un beau garçon à l’air calme et assuré, malgré son évidente fatigue. Assis tranquillement en face de nous, il déclara que la nouvelle de notre installation à Puerto Cabezas, parvenue aux oreilles des Miskitos, suscitait de l’espoir. C’était la raison de sa visite.
L’Envoyé se présenta comme un émissaire, dépêché par un groupe d’Anciens des communautés du Rio Wangki pour nous informer de la situation du peuple Miskito et pour solliciter l’aide du CICR.
La guerre civile au Nicaragua opposait depuis 1979 le gouvernement sandiniste révolutionnaire à l’opposition armée contre-révolutionnaire, la Contra, dans un schéma typique de la guerre froide. Bientôt, le scandale du Contragate révélerait toute l’ampleur du soutien des États-Unis à la Contra. Quant aux Soviétiques et aux Cubains, s’ils se montraient plus discrets ils n’en étaient pas moins partie prenante auprès des Sandinistes. Je rentrais d’Angola et d’Éthiopie et là-bas la visibilité des grands « parrains » était inversée, Cubains et Soviétiques participaient ouvertement au conflit. En Europe, les gens de gauche regardaient les Sandinistes avec l’œil de Chimène, ultime espoir d’une révolution tropicale marxiste à visage humain. Cet espoir provoquait certains troubles oculaires. À l’autre bord, la droite criait au feu communiste. Pour ce camp-là, la misère d’un peuple et l’oppression qu’il avait longuement subie semblaient n’avoir d’autre réalité que celle de la propagande des « rouges ».
J’avais été envoyée par le Comité International de la Croix-Rouge – CICR – dans cette région de la côte atlantique nord du Nicaragua au début du printemps 1986, basée dans le chef-lieu de la région, Puerto Cabezas, pour une durée d’un an. Nous serions deux pour donner corps à cette mission, Andrée l’infirmière, et moi qui porterais le titre de cheffe de bureau, dont le parfum de routine administrative m’avait fait sourire. J’y pressentais un décalage cocasse avec la réalité. Je ne fus pas déçue.
Et quelle était ma mission dans cet endroit dont je n’avais jamais entendu parler, ce Puerto-machin ? « Tu verras bien », m’avaient dit mes chefs. « On sait qu’il y a eu des déplacements de population parmi les Indiens miskitos sur le Rio Wangki, il doit y avoir de gros besoins, va voir, débrouille-toi ! »
L’année précédente, deux collègues avaient été basés à Puerto Cabezas pendant quelques mois, mais l’accès au fleuve n’était pas encore d’actualité.
Le Rio Wangki était un fleuve frontière qui reliait le nord du Nicaragua au Honduras sur plus de 700 km, bordé en bonne partie d’épaisses forêts tropicales. Un lieu de bout du monde. Le peuple Miskito du Nicaragua, traditionnellement méfiant envers les autorités hispanophones du pays, s’était tourné vers la Contra après une période d’expectative, suite à la victoire de la révolution sandiniste. Le Rio Wangki, le long duquel vivaient de toute éternité de nombreuses communautés Miskitos, avait été le théâtre d’affrontements violents entre l’armée et la nouvelle guérilla Miskito, encadrée par la Contra. En décembre 1981, les forces gouvernementales, déterminées à ne pas laisser s’amplifier ce front ennemi supplémentaire, avaient débarqué en force dans la zone et détruit tous les villages.
Voilà en résumé les informations dont nous disposions.
La visite de l’Envoyé était particulièrement bienvenue car il nous manquait des informations de première main sur la situation des Indiens miskitos du Rio Wangki. Cela faisait plusieurs semaines que nous étions installées à Puerto Cabezas, occupées à prendre nos marques, à nouer des contacts, à constituer une petite équipe, à acquérir du matériel en état de marche, à batailler pour obtenir des autorisations de déplacement.
L’Envoyé commença son récit. Une partie des familles du Rio Wangki avaient pu s’enfuir de l’autre côté du fleuve, au Honduras, lors de ce jour funeste de décembre 1981 où toutes les rives du côté nicaraguayen avaient été vidées de leurs habitants en une fulgurante opération militaire. La plupart se trouvaient depuis plusieurs années dans le camp de réfugiés de Mocoron, sur le territoire de la Moskitia hondurienne. Ceux qui n’avaient pas pu fuir, la majorité, avaient été éloignés du fleuve par la force et regroupés dans des camps, en un lieu nommé Tasba Pri. Après plus de quatre ans, la jungle avait repris ses droits sur les berges du fleuve. Cependant, tous les habitants voulaient retourner chez eux et nulle part ailleurs, les Miskitos étaient « les gens du fleuve », leurs enfants apprenaient à nager avant de faire leurs premiers pas sur la terre ferme. Pouvions-nous mettre notre influence au service de leur retour puis faciliter leur réinstallation ? Ils avaient tout perdu dans l’exode. Sitôt connue, la présence du CICR le long du Rio Wangki encouragerait les réfugiés Miskitos au Honduras à se mettre en route. Certaines familles avaient déjà traversé le fleuve, préférant un total dénuement et l’absence de sécurité à un prolongement de l’attente dans les camps de réfugiés. Officiellement, la population avait été autorisée à retourner sur le fleuve depuis plusieurs mois, mais bien peu s’y risquaient. La confiance faisant défaut, l’aide et la caution d’une institution réputée comme le CICR pourraient faire une grande différence.
L’Envoyé nous parla pendant des heures, très concrètement. Ses explications recoupaient et complétaient les informations que nous possédions de façon fragmentaire. À l’évidence, c’était un type crédible.
Cette rencontre clarifia la direction que devait prendre notre action et aiguillonna notre désir de nous rendre sur le fleuve.
Le CICR était déjà en négociation pour obtenir l’autorisation de se rendre sur le Rio Wangki, mais les affaires traînaient et l’attente s’éternisait.
Nous fûmes aidés par l’évolution du conflit. En mai, une rencontre des présidents d’Amérique centrale à Esquipulas, au Guatemala, officialisa un processus de négociation, sous la houlette du président costaricien Oscar Arias. Dans ce nouveau contexte il était opportun pour le gouvernement du Nicaragua de montrer quelques signes de souplesse. Et puis, le sort des Miskitos commençait à filtrer à l’étranger, y compris auprès des milieux qui soutenaient les autorités sandinistes, via quelques articles de presse. Début de questions gênantes, mauvaise image en perspective.
Près de trois mois d’insistance auprès des autorités furent nécessaires, tant à Managua qu’à Puerto Cabezas, pour pouvoir enfin nous rendre sur le Rio Wangki. Je passais des jours à tenter d’attraper le commandant militaire de la région. La plupart du temps il ne me recevait pas. Il était parti, il était absent, me disaient ses subordonnés que je tentais de sensibiliser à notre cause. Je regardais le chauffeur laver tranquillement le véhicule du commandant. Ma ligne d’action était simple : ne pas me décourager et faire un siège régulier, courtois et obstiné.
Pourquoi n’allions-nous pas directement sur le fleuve, sans nous embarrasser d’autorisations officielles ? Une zone de guerre est un endroit dangereux en tous temps, mais particulièrement si l’on s’y aventure au nez et à la barbe des belligérants. De plus, la coutume du CICR est d’agir en transparence afin que sa neutralité d’action soit crédible et, autant que possible, reconnue par tous les acteurs du conflit.
Un beau jour, ô joie, l’autorisation de descendre le fleuve nous fut octroyée par le puissant ministre de l’Intérieur à Managua, avec l’accord de l’armée. Les retours de population seraient observés attentivement, tout problème signifierait le retour à la fermeture. À nous d’interpréter.
WASPAM, LE FLEUVE DÉSERTÉ
Il y a une vraie rage dans ses yeux, du mépris aussi.
– Pour les belles paroles, vous êtes tous des champions, mais pour les actes, il n’y a plus personne !
Je la comprends, la hargne de ce jeune Miskito. Je réponds simplement :
– Ne vous énervez pas, revenez demain matin et vous verrez !
Il explose :
– Ça fait combien d’années qu’on nous berce de promesses :
« On ne va pas tarder à descendre le fleuve, on va venir vous aider et patati et patata », du vent oui, et vous, vous osez me dire que vous descendrez le fleuve demain, tiens, vous avez la palme du culot, et en plus vous êtes des femmes !
Il tourne le dos et disparaît.
Bon, ne nous dispersons pas et, d’abord, réjouissons-nous d’avoir réussi à amener notre camion jusqu’ici, à Waspam, le vieux ford perclus de rhumatismes qui nous a fait la grâce de ne pas s’embourber sur la piste en venant de Puerto Cabezas. Hormis le volant qui pèse trois tonnes, il n’est pas trop difficile à conduire.
Waspam est un village tombé en catalepsie depuis des années mais qui était, avant le conflit, le point d’accès pour le transport fluvial des personnes et des marchandises sur le Rio Wangki, situé au beau milieu du parcours du fleuve dont les rives, six cents kilomètres en amont et en aval, ont été peuplées depuis des siècles par les communautés des Indiens miskitos. Aujourd’hui, seule la piste Puerto Cabezas-Waspam permet d’accéder au fleuve par véhicule.
Aujourd’hui à Waspam une population clairsemée cultive ce qu’elle peut – haricots rouges et légumes – et élève des cochons noirs qui fouinent et grognent entre les maisons. Que sont devenus les anciens trafics, qui avaient doté Waspam d’une aura sulfureuse ? Dans cette zone isolée et frontalière avec le Honduras, la contrebande assurait des gains à tout un monde, en temps de paix. Mais depuis quatre ans il semblerait que plus rien ne circule sur ses eaux boueuses, à l’exception de rares patrouilles militaires et peut-être de quelques canots furtifs, qui de nuit glisseraient sur le fleuve comme des fantômes.
De l’embarcadère, il reste une mauvaise jetée de bois, branlante et édentée, un squelette effrité. Mieux vaut l’oublier. Un talus de plusieurs mètres de haut protège la berge de la violence des crues. Désormais, on accède au fleuve par une volée de marches creusées dans la terre et calées par des planches, envahies par la boue et horriblement glissantes. C’est par là qu’il faudra charger les bateaux.
Nulles plages à Waspam, mais des toboggans terreux au sommet desquels il est conseillé de ne pas perdre l’équilibre lorsqu’on s’approche pour admirer le fleuve.
À côté de ce patelin, Puerto Cabezas prend soudain des allures de pimpante bourgade helvétique. Ce que j’ignore encore, c’est que lorsque nous arpenterons le fleuve, Waspam à son tour se parera dans mon imagination des douceurs de la civilisation et du confort !
Pour l’heure, nous organisons notre logistique sur place, non seulement pour ce séjour mais pour tous ceux à venir. Pour l’apéro, mieux vaut compter sur ses propres ressources. Tout notre petit stock de bières précieuses tient dans le sac isotherme qui ne garde le froid qu’un jour ou deux. Quant au restaurant, c’est la cuisine de Doña Cristina, une dame du village qui élève seule une nombreuse progéniture et trouve avec nous l’occasion de mettre un peu de beurre dans le gallo pinto1, qui nous servira de cantine. En guise d’hôtel, nous dressons notre tente à côté d’un bâtiment d’une seule pièce qui abrite notre barda et dont la porte en fer se verrouille au cadenas. Cette cambuse nous servira de bureau, d’entrepôt, de salle de réunion et de salle de bains. Pas d’eau courante, bien entendu, mais avec un seau et un gobelet, nous devrions pouvoir maintenir une hygiène minimale, à l’abri des regards.
Pas de toilettes non plus dans notre dispositif, mais les commodités de Doña Cristina feront l’affaire, une guérite en planches équipée d’un banc troué. Comme dans le mazot de mes grands-parents, dans les vignes en Valais, lorsque j’étais môme.
Doña Christina, nous l’aimons déjà. Sa maison est située juste derrière notre petit entrepôt et elle nous a souhaité la bienvenue dès le premier matin de notre arrivée. Dès le premier brin de causette, nous avons été attirées par son amabilité spontanée, loin des regards furtifs et des visages impénétrables que nous croisons parfois à Waspam. Bientôt, elle nous a proposé ses services de cuisinière. Il n’a pas fallu de longues palabres pour se mettre d’accord en toute confiance. Nous voilà désormais attablées deux fois par jour dans l’appentis recouvert de plaques de tôle et ouvert sur deux côtés qui lui sert de cuisine et de salle à manger.
Ce midi, nous la regardons alimenter le feu sous ses casseroles sans quitter des yeux son petit dernier qui crapahute à toute vitesse en s’agrippant aux bancs et aux pieds de la table, emporté par la joie d’expérimenter la position verticale. Deux fillettes entre cinq et sept ans font mine de se bagarrer à coups de petits pieds nus dans le hamac délavé suspendu dans un coin.
Les traits tirés de Doña Christina, ses cheveux ternes et cassants racontent une fatigue incrustée en elle de longue date, un surmenage qu’elle s’oblige à ignorer pour accomplir l’interminable labeur nécessaire à l’entretien de sa famille, jour après jour. Seuls ses yeux échappent à l’usure, ses yeux au regard vif et doux.
Ayant rempli nos assiettes de son ragoût de légumes odorant, elle accepte de faire une petite pause et en profite pour nous interroger sur notre mission, notre pays et nos familles. Pourquoi diable sommes-nous venues jusqu’ici, si loin de chez nous, qu’est-ce qui nous a poussées à partir ainsi à l’autre bout du monde ? Elle écoute nos explications sur l’engagement humanitaire, le désir de courir le monde et de se frotter à l’histoire de notre époque avec une expression qui oscille entre ébahissement et pitié. Finalement elle nous sourit en hochant la tête, préférant, semble-t-il, s’abstenir de juger des femmes qui mènent une vie aussi incompréhensible. Andrée et moi percevons parfaitement ce que nos explications ont d’incongru aux oreilles de Doña Christina. Qu’est-ce que c’est que cette histoire de choisir sa vie ? Comme si on avait le choix ! Entre nos vies et la sienne il y a comme une faille intersidérale. Alors, comment se fait-il que nous nous sentions si tranquilles, si confortables ensemble ? En vérité, il suffit que nous soyons assises les trois dans sa cuisine à bavarder tranquillement pour que le sentiment de camaraderie s’impose comme une évidence. Elle n’a pourtant pas l’habitude de parler d’elle-même, mais oui, elle a cinq enfants, l’aînée commence à l’aider, il y a les champs de maïs et de haricots à cultiver, le potager et puis tout le reste. Elle utilise les formules consacrées que l’on entend un peu partout à la campagne : « ici la vie est ainsi faite » « pauvres nous sommes, pauvres nous restons » « on se débrouille avec l’aide de Dieu ».
Doña Christina, solide comme une liane du fleuve, est une de ces innombrables héroïnes anonymes qui font tenir le pays debout, malgré la pénurie de tout, malgré le marathon sans fin des tâches ingrates et épuisantes, en dépit de la solitude à laquelle l’inconstance légendaire de leurs hommes condamnent les femmes de ce pays. Difficile d’imaginer un avenir qui ne soit pas la lugubre répétition du présent. Et pourtant elles s’accrochent et luttent pied à pied pour leurs enfants, pour les parents qui vieillissent, chaque jour que Dieu fait.
L’habitude de s’asseoir dans la cuisine rudimentaire de Doña Christina est prise en un rien de temps. Elle nous accueille toujours avec bienveillance et, de notre côté, nous la divertissons volontiers avec des anecdotes sur nos mésaventures. On ne saurait rêver d’un meilleur point d’ancrage à Waspam.
Plusieurs jours sont nécessaires pour organiser la première expédition sur le fleuve, celle qui devrait nous permettre d’entrer en contact avec la population, s’il y en a, d’obtenir une image des besoins prioritaires et de tester également la sécurité de la zone. Dans quelle mesure le conflit est-il actif ? La nouvelle de notre arrivée imminente sur le fleuve a-t-elle bien été relayée auprès des unités locales de la guérilla, la Kissan, à travers ses unités au Honduras ? Je ne peux m’empêcher d’avoir des doutes, tant l’impression est forte d’être égarée ici au fin fond de nulle part. Je me rassure avec la certitude que notre présence à Waspam ne passe pas inaperçue, tous ces préparatifs… Reste à espérer que les nouvelles circulent sur le fleuve d’une façon ou d’une autre. Pour le moment, pas question de poser des questions délicates, nous sommes en zone gouvernementale, dans une position précaire, ignorant complètement qui joue à quoi dans ce drôle de village. Les regards sur nous sont curieux mais opaques.
Il y a un autre sujet qui perturbe légèrement mon sommeil. C’est le fleuve. Et tout ce qu’il y a autour.
À Waspam, la jungle envahit in petto chaque pouce de terrain qui n’est pas farouchement défendu à coups de houe et de machette. Pire qu’une horde de brigands qui guette la tombée de la nuit pour lancer sa razzia sur la ville. La jungle se moque des horloges et des calendriers, elle marche avec la foudre et les éclairs, avec toute l’eau du ciel qui chasse le soleil brûlant. Lorsque nous aurons quitté la très relative urbanité de Waspam, quel pandémonium végétal nous attend, quel fichu monstre vert ?
Je contemple sur le fleuve les arbres entiers qui en dévalent le cours. Des arbres entiers, oui, leurs racines comme chevelure de Méduse et toute la ramée, branches, brindilles et feuillage. Ce ne sont pas des troncs coupés, œuvre humaine et raisonnable, ce sont de grands arbres arrachés aux berges par la puissance de l’eau. Notre petit Zodiac, là-dessus ?
D’un fleuve large et abondant, on dit qu’il est majestueux. Le Rio Wangki est super-majestueux. J’interroge Cornelio, notre guide fraîchement engagé : « Comment ça va se passer la navigation sur le fleuve, là, tellement…, avec le Zodiac et la pirogue ? » Il a un petit rire à bouche fermée, coule vers moi un regard oblique et ne dit rien.
À crapahuter des jours dans la glèbe de Waspam, je me fais l’effet de Kathleen Turner dans À la poursuite du diamant vert. Sans doute vous souvenez-vous, lorsqu’elle traîne sa valise sur la méchante piste boueuse, les chevilles tordues dans des escarpins pointus, à chercher la ville de Cartagena, et Michael Douglas, excédé, qui soudain lui attrape ses escarpins et en sectionne les talons d’un bon coup de machette. Malgré mes bottes en caoutchouc, je me vois mal assortie à cet environnement de chercheur d’or. Je suis une citadine, moi, je ne fais pas de sport et je fume des tas de cigarettes.
Enfin, le matin fatidique est arrivé. Cornelio dirige la manœuvre de chargement des deux embarcations. Bien qu’il ne s’agisse que d’une expédition de reconnaissance, pas question de s’aventurer avec le seul Zodiac dans une zone de guerre coupée du monde depuis des années. Outre notre équipement, de la nourriture suffisante pour deux à trois semaines, nous embarquons dans la pirogue du matériel de première nécessité destiné à d’éventuelles populations revenues le long du fleuve.
Tout Waspam est rassemblé au sommet des talus surplombant le fleuve. Les mamans, les gamins qui courent partout, les hommes un peu en retrait. Nous créons l’événement, c’est le moins que l’on puisse dire. Le chargement dure une partie de la matinée, il faut que tout soit parfaitement équilibré. Andrée, ma collègue infirmière, participe à la manœuvre et s’assure que son coffre de matériel médical est correctement arrimé. Elle a prévu de proposer des consultations le long du fleuve, afin de juger de l’état sanitaire des gens, adultes et enfants.
Avec Andrée, nous avons déjà travaillé ensemble en Angola, sur deux sortes de désastres : la grave dénutrition des populations du Planalto en raison de la guerre civile et les mutilations causées par les innombrables mines antipersonnelles. Nous ne prévoyons rien d’aussi tragique ici, mais en réalité nous ignorons tout de la situation sur le plan médical, y a-t-il seulement quelque agent de santé avec un minimum de matériel ?
Andrée est sage-femme et infirmière. Elle espère qu’une ou deux dames auront la bonté de faire coïncider leur accouchement avec notre passage. C’est une pro chevronnée, une de ces infirmières spécialistes des situations d’urgence dans le tiers-monde, qui ont eu à affronter seules des pathologies aiguës qui effraieraient bien des médecins de nos pays. Elle peut compter sur sa solide expérience, et un flair clinique épatant.
C’est une belle femme, Andrée, à l’élégance svelte, une brune au regard vif et aux traits harmonieux, une battante volontaire, pleine d’humour et dotée d’un sens de l’observation très fin. Elle dégage une énergie hors du commun et c’est vrai que rien ne l’arrête lorsqu’elle est lancée. Il faut la côtoyer un certain temps pour percevoir ses écorchures souterraines. La chance que j’ai de l’avoir pour coéquipière dans cette mission ne sera jamais démentie.
Cornelio et ses trois assistants achèvent les préparatifs. Nos deux moteurs hors-bord ont été nettoyés et graissés : celui de 48 chevaux est installé sur la pirogue, le 24 chevaux suffira pour le Zodiac.
Ça y est, tout est prêt. Les drapeaux du CICR fixés à l’arrière des deux bateaux sont déroulés. Ils se déploient sous la brise. Cornelio, Andrée et un assistant s’installent sur le Zodiac, les deux autres dans la pirogue où je vais les rejoindre. Soudain, la conscience de vivre un moment unique me foudroie. La prestance insolite de cette expédition en devenir, son extrême précarité aussi me chavirent le cœur d’allégresse et d’effroi. La foule est compacte sur le terre-plein. C’est à moi de donner le signal du départ. Je grimpe dans la pirogue, agite la main vers Cornelio et les moteurs démarrent aussitôt. La première secousse suffit à m’envoyer les quatre fers en l’air au fond du bateau. Éclats de rire dans la foule.
C’est toujours pareil avec la réalité, dès qu’on s’envole un peu, elle vous plaque au sol aussi sec.
1Le gallo pinto (coq multicolore) est la base de l’alimentation des nicaraguayens : riz et haricots rouges, présents dans tous les menus. À Cuba, ce plat est appelé Morro y Christiano.
LE FANTÔME D’UNE GUERRE
« Mesdames, c’est une date historique dans l’histoire du peuple miskito, nous ne l’oublierons jamais, car aujourd’hui vous nous ramenez au monde ! »
La déclaration est si intensément solennelle, si inattendue aussi, que les larmes me montent aux yeux. Andrée est saisie par la même émotion. Les hommes secouent la tête, ils regardent leurs mains. Un long silence permet à tous les anges du fleuve de passer. Quelque chose se noue à ce moment-là, cette simple phrase m’engage auprès des Miskitos comme une sorte de pacte et je l’accepte.
L’homme qui a parlé est un Ancien, entouré de quatre autres. Ils sont vêtus de quasi guenilles et chacun porte un chapeau de cuir, la version miskito du chapeau de cow-boy, je présume. Nous sommes installés sous une espèce d’abri recouvert de palmes. Un petit groupe de femmes se tient derrière les hommes, les plus âgées tirent sur de petites pipes rudimentaires qui ne semblent pas contenir grand-chose.
Débarquées hier après-midi, suite au signal des deux hommes sur la rive, nous avons pris pied dans une clairière grossièrement défrichée, où se dressent trois esquisses de maisons sur pilotis. Les premières familles revenues au bercail ! L’accueil a été enthousiaste.
– Nous nous sommes cachés lorsque nous avons entendu les moteurs au loin, craignant que ce soit l’armée, mais lorsque nous avons vu les drapeaux du CICR, nous avons couru vous faire signe !
– Et comment connaissez-vous le drapeau du CICR ?
Les hommes m’ont regardée, étonnés.
– Évidemment que nous le connaissons !
Miracle universel de la Croix-Rouge. Les hommes vont essayer de rassembler plusieurs Anciens des communautés qui souhaitent effectuer leur réinstallation au plus vite, cela prendra un jour ou deux pour aller les avertir et les ramener, est-ce que nous pouvons attendre ?
Pas de problème, nous avons de la nourriture et des tentes. Je demande naïvement :
– Comment faites-vous pour circuler dans cette jungle impénétrable ?
Un sourire en guise de réponse.
Nous avons donc attendu que les Anciens se regroupent. Le petit périmètre défriché se trouve à l’emplacement de l’ancien village. Je remarque avec étonnement qu’il semble n’y en avoir aucune trace.
– En effet, me répond un des hommes, tout a été détruit, maisons, école, église, tout. Il faut repartir de zéro, c’est l’église que nous allons reconstruire en premier !
Andrée a profité de l’attente pour se faire une première idée de l’état de santé des quelques familles présentes, une vingtaine de personnes, avec les enfants. Pas de malnutrition, des affections courantes qu’elle peut soigner facilement, ouf.
Les femmes nous ont fait les honneurs de leur embryon de logis où tout manque, à commencer par des réserves de nourriture. Nous leur avons donné du riz, des haricots rouges et de l’huile, un petit coup de main en attendant de recueillir assez d’informations pour définir un programme d’assistance.
J’avais bandé mon énergie comme un arc en quittant Waspam, prête à un effort sans relâche. Ma foi, cette pause inattendue m’apprend dès le début que le rythme et le tempo de nos expéditions sur le Rio Wangki seront dictés par une multitude d’aléas imprévisibles, bien plus que par la planification, rassurante peut-être, mais illusoire. En réalité, ce temps disponible est une chance, il permet de faire connaissance avec les familles présentes.
Nous voici installées sur le plancher d’une des cabanes, entourées des femmes. Certaines s’expriment assez bien en espagnol, d’autres pas. Esteban nous a rejoint, il se révèle un interprète plein de gentillesse, s’appliquant à faciliter la conversation.
C’est le monde à l’envers ! Ce sont les femmes qui nous bombardent de questions : qui sommes-nous, d’où venons-nous, pourquoi avons-nous laissé nos familles, où sont nos maris, combien avons-nous d’enfants ? Questions classiques entendues tant de fois dans les régions où l’horizon des femmes dépasse difficilement les limites du foyer. L’annonce de notre absence de postérité provoque un jaillissement de commentaires navrés. La voix éraillée d’une des femmes plus âgées tranche la question :
– Elles auront leurs bébés lorsqu’elles seront rentrées de chez nous !
Voilà qui est dit. Nous rions et une maman pose son petit sur mes genoux. Le bambin me regarde de tous ses yeux et se met à hurler. Sa mère s’empresse de le reprendre et, berçant l’enfant énergiquement, elle nous le présente avec une fierté presque cérémonieuse :
– Son nom est Eliseo, c’est ici au bord du fleuve qu’il va grandir !
– On dirait qu’il a vu la LIWA MAIRIN, s’écrie une des femmes en désignant le petit qui peine à se calmer.
Esteban explique :
– La Liwa Mairin est un esprit des eaux très puissant, moitié poisson et moitié femme, qui provoque naufrages et noyades. Elle est présente dans tous les éléments aquatiques, les fleuves, la mer, les lacs.
– Attention, ajoute une des aînées, si elle tombe amoureuse d’un homme elle devient jalouse et le noie pour lui prendre son âme.
– Alors nous autres les femmes nous ne risquons rien ?
– Mais si, la Liwa peut aussi être du genre masculin et s’attaquer aux femmes.
Je me tourne vers Esteban :
– Est-ce que ces dames ne sont pas de religion morave ?
Il traduit la question d’un air malicieux. Exclamations :
– Bien sûr que si, l’église morave est notre église à nous les Miskitos, nous vénérons notre Seigneur Jésus-Christ.
Pas de contradiction.
Bientôt, les femmes ne dissimulent plus leur angoisse et leur amertume, elles crient qu’elles sont réduites à une inaction terrible.
– Toute notre vie, nous nous sommes occupées de notre potager, du champ de maïs et puis de la maison et des bambins. Maintenant, regardez, nous sommes sans ressources, nos mains sont mortes, oui mortes, nous sommes réduites à voir nos enfants souffrir de la faim. Quel mal avons-nous bien pu faire pour en arriver là ?
Elles ne me demandent pas ce que nous pourrons faire pour eux. Elles savent que pour traiter de ce sujet vital, il faut que les Anciens soient réunis.
J’écoute le grondement du fleuve. Liwa Mairin, s’il te plaît, ne nous regarde pas, repose-toi dans les cavités profondes du Wangki, retiens tes éclaireurs, les poissons qui surgissent en surface par milliers pour engloutir les piroguiers.
– Esteban, est-ce qu’il y a beaucoup d’autres esprits ?
– Bien sûr, il y a ceux de la forêt, ceux des animaux, du vent et tant d’autres. Mais par-dessus tout est WAN AISA, le grand esprit dans le Cosmos.
Nous nous taisons. Et puis, je ne peux m’empêcher d’interroger :
– D’où viennent les choses, d’où vient le fleuve ?





























