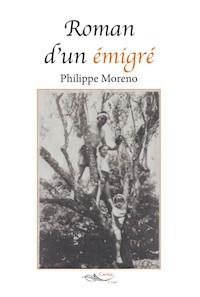
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quel tourbillon que cette vie d’un Espagnol genevois, placée sous le signe de l’exil pour fuir le franquisme, l’installation dans le sud-ouest de la France puis à Paris, avant l’arrivée à Genève, à l’âge de treize ans.
Que de péripéties pour ce jeune Espagnol, qui s’engage avec passion dans une carrière d’architecte, tente un retour à Madrid pour y ouvrir un bureau, mais c’est finalement en tant que professeur à l’Ecole d’architecture de Genève qu’il s’engage. Il y développe son penchant pour l’architecture climatique et l’écologie, au moment où peu y voient un intérêt.
C’est enfin loin de Genève, à Alep, en Syrie, qu’il va créer, sept ans avant les terribles événements qui l’anéantiront, une faculté d’architecture dans laquelle il mettra en œuvre ses programmes audacieux, aux côtés d’étudiants enthousiastes. La structure perdurera quelques années, avant de finir en poussière, à l’image de la ville tout entière. L’auteur de ce parcours est surtout le fils de ce père, qui va le marquer de son empreinte de façon permanente.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1934 à Madrid, Philippe Moreno, avec sa famille, fuira les rigueurs du franquisme et gagnera la France puis Genève. C’est dans cette ville qu’il suivra des études d’architecte. Attaché à l’Espagne, il y retournera en 1966 pour y fonder un atelier et y réaliser différentes constructions. Il reviendra ensuite s’installer à Genève, où il ouvrira un nouveau bureau et deviendra, en 1968, professeur à l’école d’architecture. En 2003, alors qu’il dirige une résidence pour étudiants à Genève, il est invité à créer une structure universitaire à Alep, en Syrie, destinée à former des étudiants en architecture.
Il vit aujourd’hui dans le Nord Vaudois.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Moreno
Roman d’un émigré
Espagne – France – Genève – Alep
À Marie-France, mon épouse, pour sa participation active et son si précieux soutien.
Préface
Le premier
Eh oui, Philippe, tu es partout et toujours le premier.
Architecte nommé professeur d’université dans les années 60, ton enseignement innovant bouscule toutes les traditions conventionnelles de l’époque.
Première en Europe
Tu utilises les premiers logiciels informatiques créés au monde, appliqués à la création de projets et de dessins d’architecture. Tablette graphique contre planche à dessin classique. L’avenir a prouvé ta juste vision.
Le premier… encore
Les années 80 : Premier à éveiller et à développer la sensibilité écologique appliquée au monde de l’architecture. Nouvelles technologies, nouveau matériel de construction. Tu réalises un immeuble selon ces nouveaux critères de construction. Construction entièrement filmée, documents destinés à l’enseignement, cours et conférences en Suisse et en Europe.
Le premier… toujours
Recherches scientifiques. État fédéral, école polytechnique, universités. Les économies d’énergie dans le monde de la construction, revues scientifiques.
Le premier… suite
Architecte réalisateur de films (Séquences Urbaines, 1970).
Réalisation de plusieurs documents vidéographiques destinés à l’enseignement en Europe et au Moyen-Orient notamment.
Le premier… enfin
Eh oui, Philippe, les richesses et la noblesse des origines qui t’accompagnent, le long de ce parcours sans cesse innovant, font qu’à l’avenir tu seras sans cesse toujours le premier…
Allez, mon pianiste, joue !
Aimé Jolliet, réalisateur vidéo
Paris
Le ta-ca-ta-ca-ta du train finira bien par m’endormir, à demi couché sur les bagages dans le couloir et malgré l’incessant passage de voyageurs qui les enjambent avec difficulté. Ma mère, assise dans le compartiment avec Jésùs, mon frère cadet, les surveille sans en avoir l’air, car elle ne veut surtout pas qu’on sache que le gros tas de paquets avec la cage et les deux lapins encore vivants, nous appartiennent. La situation ne manque pas d’attirer les commentaires des voyageurs, vu la peine qu’ils ont à passer et les protestations fusent : « Mais à qui sont tous ces paquets, nom de Dieu ? »
Ma mère ne bronche pas et surtout ne me regarde pas. J’ai dix ans et suis chargé de surveiller la cargaison. Gêné, je fais semblant de rien. Ma mère a toujours été anxieuse du lendemain et, en 1945, juste après la fin de la guerre et en partance pour Paris où nous devons rejoindre le père de famille, les provisions que nous traînons depuis notre départ de Montaigu-du-Quercy, ne seront pas de trop. Un sac de pommes de terre, un autre de haricots blancs, deux lapins, des œufs – arriveront-ils entiers ? – deux ou trois grosses miches de pain, ça va être drôle à l’arrivée…
La nuit précédente nous avons dormi à Montauban, chez des amis français connus lors de notre arrivée en France, juste après la sortie de papa du camp de Septfonds. Ils nous ont hébergés cette fois avec la même générosité qu’ils nous avaient aidés en 1940. Le mari est architecte et je me souviendrai toujours des « bleus » qui sortaient du tirage, ces plans reproduits à l’époque sur du papier bleu et à l’odeur caractéristique. Plus tard, j’y repenserai, lorsque je serai devenu architecte et tirerai mes propres plans, bien que ne s’en dégagera pas la même odeur. En partant, maman leur a remis quelques provisions en remerciement, elles ont été très appréciées car c’est encore une période de tickets de rationnement.
L’été précédent j’avais commencé à travailler dans une ferme de Montaigu. Tous les jours, très tôt, je partais garder les vaches. En arrivant à la ferme, j’avais droit au petit déjeuner campagnard et à un casse-croûte pour midi, puis il me fallait amener les vaches au pré et les surveiller avec le chien, lequel d’ailleurs faisait le travail tout seul. J’en profitais pour lire, ma passion déjà, parfois aussi pour dormir à l’ombre. Le soir je ramenais les vaches à l’étable, puis j’avais droit au souper, quelques provisions pour la famille et puis il me fallait rentrer, trois bons quarts d’heure de chemin à travers champs. Mais j’aimais ça et de toute façon je n’avais pas le choix.
Mais, à présent, le train trace sa route sur les rails bruyants et la cheminée de la locomotive crache une fumée noire, qui s’infiltre à l’intérieur en apportant une odeur âcre qui irrite la gorge et fait tousser. Pas moyen donc de dormir avec tout ça. Mon petit frère, Jésùs, six ans, dort pourtant, appuyé sur notre mère qui, angoissée par la surveillance des bagages et, enceinte, craint surtout les malaises qui la prennent souvent. Même pendant la guerre d’Espagne et presque à la fin, nos parents n’ont pas craint de faire un enfant et, à présent, à peine l’autre guerre terminée, la deuxième, d’en mettre en route un autre. Encore que s’ils avaient su tout ce qui allait arriver, peut-être auraient-ils tout fait pour éviter cette épreuve. C’est vrai qu’à Montaigu il s’est passé beaucoup de choses et à Aurignac aussi. Aurignac c’est après Montauban, puis Bordeaux, c’est après Porbou et Porbou après Caldetas, petite ville de la Costa Brava au bord de la mer. Nous y avons vécu avec maman et ma grand-mère maternelle. Nous y sommes venus en 1937 lorsque mon père a été envoyé à l’école militaire de Barcelone, où le gouvernement formait en urgence et en quelques mois des officiers, pour compenser la perte de presque tous les gradés de carrière, en grande majorité affiliés aux insurgés, les « nationaux ». Ainsi Felipe, mon père, engagé volontaire du côté des fidèles à la République, est devenu « un Rouge », c’est en effet ainsi que les appelaient les insurgés, car pour eux tous les républicains étaient communistes, donc rouges…
Mais revenons au voyage de la petite famille vers Paris, en 1945, lorsqu’elle va rejoindre Felipe, le Rouge, qui vient d’être engagé par le gouvernement en exil de la République espagnole dans le cadre des tâches consulaires. En effet, mon père, étudiant en droit et journaliste dans les années trente à Madrid, s’était présenté au concours pour la nomination de deux sténographes parlementaires et, étant sorti premier ex aequo parmi plus de 5 000 concurrents, était devenu fonctionnaire au Parlement. Peu après le « pronunciamiento », coup d’État de juillet 1936, le gouvernement et le parlement de la République, face au danger de siège de Madrid, avaient été transférés à Valence, ville restée à l’intérieur de la zone républicaine et moins menacée que Madrid. Mais très vite, gêné de rester à l’arrière et à l’abri, Felipe se fit porter volontaire pour combattre et fut donc envoyé en formation à Barcelone. À présent, exilé en France après avoir vécu six mois en camp de concentration à Septfonds près des Pyrénées, et avoir passé la durée de la deuxième guerre mondiale dans la région de Bordeaux et du Quercy, travaillant dans pas mal d’emplois bien éloignés de ses qualifications, il est recruté par le consulat représentant la République espagnole en exil, à Paris. Il faudra sans doute revenir sur cette période du début de l’exil, peut-être même sur les circonstances exactes de cet exil aussi bien pour Felipe, mon père, que pour ma mère Maria-Jésùs, et moi, Philippe.
Enfin, après une longue nuit de voyage, entrecoupée d’arrêts, de ralentissements, de nouveaux départs, le train finit par arriver à la gare d’Austerlitz à Paris. Dans le wagon, mon frère Jésùs, Maria-Jésùs ma mère enceinte et moi, laissons sortir tous les voyageurs avant d’oser nous occuper des bagages, étalés dans le couloir et sauvagement saccagés par l’empressement des voyageurs à s’extraire du train. Les pommes de terre et les haricots sont à moitié sortis des sacs déchirés, un des lapins est mort, pas mal d’œufs sont cassés, dont le contenu a eu le temps de sécher, et quelques miches de pain qui ont disparu. C’est vrai que la guerre vient de finir et que la faim représente le problème principal de la population.
Sur le quai, nous attend mon père, accompagné d’un vieil ami espagnol, Cancela. Ils se précipitent en nous voyant débarquer épuisés, hagards, traînant les colis à moitié éventrés. Après les embrassades, nous nous empressons de quitter la gare, tant bien que mal, pour rejoindre le studio dans lequel Cancela et son ami Felipe vivent depuis quelques mois. Il s’agit de camper cette nuit, quant à Cancela il ira dormir chez d’autres réfugiés pour laisser la place à la petite famille.
Ce n’est pas la première fois que nous allons dormir dans des conditions précaires. À Caldetas, sur la Costa Brava, de 1937 à 1939, avec ma mère et ma grand-mère maternelle, nous avons vécu sans chauffage ni confort dans une cabane à bateau qu’une famille nous avait prêtée, au bord même de la mer. Mon père suivait les cours de l’école d’officiers, puis il partit participer à la guerre dans l’état-major de l’armée républicaine. Pendant cette période, ma mère lui apportait régulièrement à manger car mon père a toujours été pénible, puisqu’il ne se nourrissait que d’œufs, de viande et de quelques fruits. Son salaire de fonctionnaire nous permit de subsister pendant toute la durée de la guerre d’Espagne, lui-même vivant grâce à son statut de militaire.
Pendant ce séjour à Caldetas, ma mère, lorsqu’elle allait en train voir son mari à Barcelone, subit à plusieurs reprises le bombardement, l’aviation fasciste attaquant les convois, qu’ils soient militaires ou pas, mais elle eut la chance de toujours échapper au pire. Un jour pourtant, dans leur cabane, alors que la grand-mère était aux toilettes au fond du jardin, une bombe tomba tout près et tout le monde crut que les latrines avaient été pulvérisées. Ils assistèrent pourtant avec effroi et médusés à la sortie de l’abuela, environnée de fumée, choquée mais indemne.
Mais nous sommes le lendemain de l’arrivée de la famille à Paris, à l’automne 1945. Mon père a trouvé un logement dans un petit bungalow de la banlieue parisienne, à Trembley-les-Gonesses, à trois quarts d’heure de train de la capitale. Le quartier s’appelle le Vert-Galant, nom donné à ce lieu en l’honneur d’Henri IV, roi de France, qui y possédait un pied-à-terre… Tout notre monde prend donc le train à la gare du Nord, par une belle journée ensoleillée et se retrouve devant un pavillon au milieu d’un petit jardin arborisé. L’endroit est charmant en comparaison avec les derniers logements habités par la famille depuis sa sortie d’Espagne, sans parler de la cabane à bateaux de Caldetas. À Bordeaux, tout d’abord, où ma mère enceinte et moi, sommes recueillis par l’oncle Raphaël, célibataire encore, ancien officier de marine dont le bateau, surpris dans un port de l’Atlantique investi par les insurgés, est parti en catastrophe pour éviter sa capture par la marine franquiste. Il faut cependant préciser qu’au moment du coup d’État, le franquisme n’existait pas en tant que tel, puisque le général Franco n’avait pas encore été désigné chef de l’État par les insurgés nationalistes. Il s’agit donc ici d’une simplification historique pour rendre le récit plus clair. À Bordeaux donc, passage Moreau, ruelle de la vieille ville, logement insalubre dans lequel naît le 28 juillet 1939, Jésùs, le fils cadet de Felipe et de Maria-Jésùs. Lors de la naissance de mon frère, mon père était encore à Septfonds où il passa en tout six mois, mais eut finalement la chance d’en sortir grâce à l’attestation du gouvernement espagnol en exil, lui assurant un subside mensuel en sa qualité d’ancien fonctionnaire et d’officier supérieur. Dès son arrivée à Bordeaux, mon père trouva à loger sa famille, d’abord au Quatre-Pavillons, quartier périphérique, puis au centre, à la rue Leyteire où nous restâmes jusqu’en 1942, date à laquelle les bombardements alliés devinrent insupportables, une bombe ayant même détruit en partie notre immeuble pendant que nous étions réfugiés dans un abri public. De ces événements, j’ai gardé pour ma part une telle hantise que je n’ai jamais pu par la suite supporter les feux d’artifice à cause du bruit des pétards. Ces scènes de guerre m’ont laissé, malgré ma jeunesse – j’avais six ans – deux souvenirs indélébiles : celui des heures passées pendant les bombardements des alliés dans les abris souterrains et une scène terrible dans notre logement que nous n’avions pas eu le temps de quitter lors d’une alerte. Mon père, couché sur le lit conjugal, ma mère assise sur une chaise et les deux enfants pelotonnés contre nos parents, tous nous serrant les uns contre les autres : le fracas des bombes, les éclairs des impacts, les lueurs d’incendie, tout contribuait à nous terroriser. Le lit vibrait et je crus tout d’abord que le souffle des bombes en était responsable, mais je m’aperçus avec effroi que c’était mon père qui tremblait, lui qui venait pourtant de vivre trois ans de guerre civile dont une grande partie sur le front… Il était sorti d’Espagne parmi les derniers avec les restes de sa division, quittant la région de Valence, dernière zone républicaine mais encerclée, et réussit à passer en France en bateau, de Valence à Port-Bou, avec les derniers survivants.
C’est à Bordeaux, à cinq ans, que j’ai commencé ma scolarité et je n’ai parlé jusque-là que l’espagnol. Mais j’apprends vite, surtout la lecture. Ce sera la passion de ma vie, la lecture. Mon père me ramène des journaux pour enfants qu’il récupère on ne sait où : Bibi Fricotin, les Pieds Nickelés, Tom Mix vont devenir mes héros, auprès de qui mes progrès vont être spectaculaires. Il n’y a pas de jouets, mais j’ai vite compris que je peux fabriquer des personnages avec du papier ou du carton et je dessine surtout des chevaux, des vaches et des soldats, que je découpe et fais tenir debout en pliant la partie inférieure laissée volontairement plus longue. Je m’inspire des bandes dessinées et des jouets que j’examine dans les vitrines des magasins spécialisés. À partir de l’année 1941, je croise sur le chemin de l’école des soldats allemands qui nous offrent du chocolat que nous n’osons pas refuser. Un jour, posté à la fenêtre de l’appartement, moi qui aime regarder la rue, je vois un cheval s’écrouler sur le pavé et j’assiste à sa mise à mort, car l’animal, en tombant, s’est cassé une jambe. Je vis cet événement comme un drame que j’associerai dorénavant à la mort, comprenant ce qu’elle a d’inéluctable et de définitif. C’est ainsi que les premières années de l’émigration seront pour moi, malgré ma jeunesse, le fondement de valeurs que je vais conserver toute ma vie, quoique je n’en sois pas conscient à ce moment-là. Les souvenirs en resteront précis et m’accompagneront tout au long de mon existence. Même l’évocation de la faim me permettra, durant toute ma vie, de ressentir ma culpabilité d’Européen chaque fois que je verrai des enfants la connaître, en Afrique noire, au Maghreb, ou au Moyen-Orient. À Bordeaux, elle s’est concrétisée dans mon souvenir, en me revoyant lécher sur mon index mouillé, les miettes de pain que mon frère laisse sur la table et que je récupère…
On comprend ici qu’il est impossible de raconter une vie dans un strict ordre chronologique. Les souvenirs sautent les dates et passent d’un événement à un autre sans autre logique que ce que la pensée suggère à l’instant, faisant fi de la cohérence, de la géographie et de toute autre considération. Suivons donc ce chemin aléatoire et revenons à présent à cette charmante maisonnette du Vert-Galant, qui va être le cadre d’un drame qui bouleversera la vie de la famille.
On s’y installe avec plaisir, nous les enfants adorons jouer dans le jardin, nous avons à présent onze et six ans. Je fréquente l’école communale où, grâce à ma passion de la lecture, j’obtiens très vite les meilleures notes en français. J’ai appris rapidement à lire dès mon entrée à l’école maternelle à Bordeaux, grâce aussi à mon père qui réussit à me trouver des bandes dessinées et me les commente. Au Vert-Galant, il me ramène régulièrement, d’une bibliothèque publique parisienne, les livres de Jules Verne, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Paul Féval, de même que Dickens avec « Olivier Twist » et « Sans Famille » d’Hector Malot. De plus, depuis que nous sommes arrivés à Paris, mon grand-père paternel m’envoie régulièrement des petits fascicules contenant les « Episodios nacionales », écrits par Perez Galdòs, grand écrivain espagnol, ami de mon grand-père. Il s’agit d’une chronique, qui s’étale sur une cinquantaine d’années, commençant par l’invasion de l’Espagne par Napoléon Bonaparte, et publiée dans une édition bon marché qui se vend par abonnement.
À cette époque, mon père travaille au Consulat espagnol de la République en exil et il est également speaker à la radio espagnole républicaine. Il s’agit là de donner des nouvelles aux exilés, mais aussi à l’intention des Espagnols restés au pays, pour contrer la désinformation franquiste.
Le 8 mai 1946 naissent, à la surprise de mes parents, deux magnifiques petites jumelles, prénommées Marguerite (du nom de ma grand-mère maternelle) et Maria-Jésùs, comme ma mère. Oui, il faut expliquer ici les coutumes espagnoles concernant les prénoms des enfants : le premier fils reçoit en principe le nom du père, la première fille celle de la grand-mère maternelle ou de la mère. Ensuite, on prend les prénoms des grands-pères, grands-mères, etc… Après ma naissance, ma mère souhaitait accoucher d’une fille qu’elle aurait appelée comme elle, Maria-Jésùs. Il se trouve que c’est un garçon qui naît. Frustrée, ma mère l’a alors appelé Jésùs-Maria, prénom masculin très usité en Espagne à cette époque, puis les deux suivantes, en l’occurrence les jumelles : la première, Marguerite, comme la grand-mère maternelle et la seconde, comme ma mère, Maria-Jésùs ! Mon prénom de Felipe fut francisé dès l’école maternelle à Bordeaux, je devins donc Philippe, mais dans la famille et depuis ma plus petite enfance, un surnom me fut donné, qui m’a suivi toute ma vie. Il provenait de ma propre difficulté à prononcer mon prénom, lequel, déformé, devint… « Pipin » et cela se prononce pipiin, en accentuant le dernier i et non pipain.
Quoi qu’il en soit, tout n’est pas rose au Vert-Galant. En effet, si la maison – composée de deux pièces, la cuisine et la chambre en plus de son jardin – est agréable, elle est tout de même exiguë pour un couple avec quatre enfants et l’intimité y est pratiquement impossible, tant pour les parents que pour les jeux des enfants ou les devoirs d’école. Mais il y a plus grave : elle est infestée de rats, non pas des souris mais des rats, des rats des villes, comme ceux de La peste, livre d’Albert Camus que mon père me rapportera bien plus tard et qui engendrera chez moi à la fois une passion pour cet auteur, mais aussi le début d’une conscience alimentée depuis l’enfance par mon père. Grâce à des exposés à l’occasion de nos promenades au cours desquelles il me racontera l’histoire d’Espagne, il en profitera pour y insérer des explications politiques et sociales. Malgré mon jeune âge, l’enfant que je suis se nourrit de ces conversations et je comprends les enjeux essentiels que je ne cesserai d’approfondir par la suite, constituant ma conscience politique et me donnant le goût de l’analyse critique que j’exercerai par la suite systématiquement.
Le combat contre les rats devient prioritaire : d’abord l’acquisition d’un chat, ensuite la fermeture systématique de tous les interstices entre la terre – il n’y a pas de cave – et le plancher avec des morceaux de verre censés empêcher les rats d’entrer dans les parties habitables. Cette bataille ne va pas sans mal : mon père se blesse assez gravement la main en manipulant les morceaux de verre. Malgré tout il n’y a pas de miracle : le chat est vite terrorisé, car il faut dire que les rats sont aussi gros que lui et le verre ne les empêche pas de passer. Ils arrivent donc toujours à trouver un espace. Pendant la nuit, ce n’est pas rare de les sentir trotter dans l’obscurité et fouiller les réserves de nourriture, pourtant emballées et mises sur les étagères ou sur la table de la cuisine. Même les armoires ne les empêchent pas de se les approprier. C’est d’autant plus hallucinant que les rats ne les consomment pas sur place et il est fréquent qu’au matin nous trouvions des colonnes de pommes de terre ou de pâtes montrant le chemin de la sortie… ou plutôt de l’entrée de leur territoire.
C’est à Trembley-les-Gonesses que je fais ma deuxième expérience de natation, car la première ce fut dans la piscine municipale de Montauban, alors que j’étais âgé d’à peine cinq ans. Mon oncle Paco, – diminutif de Francisco –, frère de mon père, m’avait emmené nager et m’avait lancé dans l’eau puis avait sauté pour me récupérer. J’avais bu la tasse mais n’avais pas gardé de cette aventure la peur de l’eau, puisque je devais devenir plus tard, à l’âge de treize ans, un excellent nageur, jouant même au waterpolo. Mon père avait réussi à faire libérer ce frère cadet du camp de concentration d’Argelès et l’avait pris avec lui à Montauban, avant de partir pour Bordeaux. Nous reviendrons plus tard sur le destin de Paco qui resta en France jusqu’à sa mort à la fin des années 1980. Mais nous en sommes à ma deuxième expérience dans l’eau. C’est à Trembley, dans un canal de l’Ourcq, la rivière qui traverse la région, que mon père et moi sommes partis nous baigner. Et mon père trouve aussi, comme Paco, qu’il faut brusquer un peu les choses et une fois dans une eau profonde d’à peine un mètre, il me prend dans ses bras et me fait faire une pirouette dans l’eau, la tête la première. Malgré la tasse avalée, je m’en remettrai et n’en garderai que le souvenir de mon père heureux de jouer avec son fils.
Les rats du Vert-Galant n’ont toutefois pas fini d’en faire voir à notre famille. Une nuit, alors que les jumelles sont nées il y a quelques mois seulement, nous sommes réveillés en sursaut par des cris d’enfant. Mon père se précipite, allume la lumière, nous sommes assis avec mon frère dans notre petit lit, hébétés. Ma mère hurle, l’une des jumelles, Margarita, est couverte de sang. Elle a été mordue au visage, peut-être ailleurs encore. Après l’avoir prise dans ses bras, ma mère crie qu’il faut un médecin, mon père veut aller le chercher, car il n’y a évidemment pas de téléphone à la maison, mais préférant rester avec sa femme qui panique, il me demande d’y aller à sa place. Je sais où habite le docteur car j’y ai accompagné ma mère enceinte. Il faut aller à l’autre bout du village, c’est assez loin et on est au milieu de la nuit, mais peu importe, je me souviendrai toute ma vie de ce trajet que j’ai fait en pleurant et je vois encore le docteur, ouvrant sa porte en robe de chambre, et n’hésitant pas à prendre sa mallette et à me suivre tout en m’interrogeant. Ce drame, dont mes parents ont souffert toute leur vie et dont la conséquence a été terrible puisque la pauvre enfant est morte après quelques semaines pendant lesquelles il avait semblé qu’elle allait guérir, ce drame donc, ma mère en a attribué la responsabilité à son mari qui, selon elle, n’avait pas su protéger sa famille contre les attaques de ces maudits animaux. Pendant cette épreuve, deux circonstances singulières méritent d’être rapportées : lors de l’aggravation de l’état de l’enfant, le médecin désarmé conseilla de l’emmener à l’hôpital le plus proche. Et là, à la réception, mes parents étant des émigrés, il fallut d’abord passer du temps à remplir un grand nombre de formulaires pour satisfaire aux démarches administratives, alors même que la petite fille délirait et manifestement se mourait. Ce fut mon père qui finalement s’insurgea violemment contre cette perte d’un temps précieux et alerta un médecin qui passait dans le couloir, le forçant à s’occuper en urgence de l’enfant. Malheureusement, après deux journées à l’hôpital et malgré quelques semaines ensuite au cours desquelles elle parut guérir, Margarita, âgée de moins d’un an, décéda, empoisonnée par les morsures. Et c’est là qu’intervient l’autre circonstance, celle-ci non pas dramatique, mais étonnante. Quelques jours après le décès, sa sœur jumelle, Maria-Jésùs, montra les mêmes symptômes d’empoisonnement, alors qu’elle n’avait pas été mordue…, mais, aussitôt soignée, échappa au pire, guérissant en quelques jours !
La famille cherche à présent un logement à Paris afin de fuir cette maison maudite. Mais en attendant cet hypothétique déménagement, si pour moi l’école représente le lieu où je peux exercer mon goût pour la lecture et accéder aux bons points, du moins en français, c’est aussi le lieu de jeux et de batailles, notamment celles pour défendre mon frère Jésùs dont le prénom lui vaut les moqueries et les insultes des gamins. Et cela se passe surtout dans la rue, à la sortie et souvent à l’aide de boules de charbon que l’on trouve après la livraison des charbonniers. Dans ces combats, nous sommes parfois assistés par un de mes amis, plus âgé et lui-même fils de charbonnier. Un jour, voulant m’apprendre une figure de gymnastique qu’il a vu faire on ne sait où, le même copain me vaudra une fracture de la clavicule…
Le jardin de notre maison est souvent le lieu de rencontre avec quelques copains et nous pouvons ainsi rester entre nous sans que Jésùs ait à subir de sarcasmes. C’est là qu’un jour pour jouer aux cow-boys, je ramène un pistolet acheté dans un magasin de jouets tout proche. J’effectue cet achat avec quelques sous dérobés à ma mère, ce qui me vaudra une première humiliation et surtout une leçon que je n’oublierai jamais. En effet, ne pouvant expliquer d’où sort ce jouet, j’avoue mon geste à mon père et me vois obligé de ramener l’objet au patron du magasin, rendant ainsi mon acte public.
Au Vert-Galant, le cinéma du dimanche après-midi est devenu le meilleur moment de la semaine, tant pour ma mère qui, adolescente, adorait déjà le septième art, mais aussi pour mon père et les garçons car il s’agit toujours de deux films, en général un western américain et ensuite un long-métrage français, parfois un film muet de Charlot ou de Buster Keaton, accompagné par la musique d’un pianiste dans la salle. Cela change du cinéma de Montaigu-du-Quercy, une fois par mois à la belle saison, car il avait lieu en plein air et j’y allais seul, la famille n’ayant pas les moyens de payer les billets d’entrée. Avec mes copains d’école, nous nous arrangions pour voir le film gratuitement, mais à l’envers, derrière l’écran, ce qui nous obligeait à une gymnastique cérébrale pour lire les légendes car il s’agissait de films muets et sous-titrés. Tom Mix, Zorro, les films de cape et d’épée avec Douglas Fairbanks étaient le plus souvent à l’affiche.
Le jour du déménagement pour Paris arrive enfin, mon père ayant trouvé en plein centre de la capitale, sur le boulevard Bonne-Nouvelle, au numéro 31, deux petites chambres de bonne, au huitième étage, sans ascenseur et sans confort. Tout juste un évier avec un robinet d’eau froide dans l’une des pièces et un w.-c. à la turque dans le couloir. Ce superbe appartement fut immédiatement baptisé la « guardilla », mot qui, en espagnol, signifie « mansarde ». Il avait quand même quelques qualités : commode pour papa qui se rendait au travail en utilisant la station de métro située pratiquement devant la porte de l’immeuble et, surtout, parce que depuis le couloir du huitième étage, on pouvait monter sur le toit et jouir d’une magnifique vue sur Paris et sur de somptueux couchers de soleil. Mais, toute médaille ayant un corollaire bien pesant, la guardilla devint aussi mon cauchemar car je me vis confier la tâche d’aller régulièrement à la cave remplir le seau de charbon destiné au poêle familial : huit étages à descendre et à remonter, mais cette fois avec le seau plein. De plus, la plupart du temps c’est le soir qu’il fallait se charger de cette besogne et la traversée de la cave, mal éclairée, lugubre, était pour moi un cauchemar, surtout depuis que j’avais vu le film « L’assassin habite au 21 », avec Noël Roquevert, dont une scène montrait une cave avec le sol rayé, traces qui menaient au cadavre traîné par l’assassin.
À cette époque, la vie à Paris, pour un enfant de douze ans, pouvait être agréable malgré les privations avec les cartes de rationnement encore en vigueur et le faible revenu des parents. Vivant sur les grands boulevards, le spectacle y était permanent : les étalages, les forains qui se disputent les trottoirs, les cinémas étalant les photos de films, tout cela me distrayait quand il m’arrivait de devoir promener la poussette avec ma petite sœur. Le chemin de l’école également, par la rue Poissonnière, la traversée de Réaumur et d’une partie des Halles, le passage qui menait à l’école Etienne Marcel, tout ce parcours constituait un terrain de jeux, car j’y retrouvais les copains quotidiennement et nous y partagions jeux, rigolades et courses échevelées dans les passages couverts. Le directeur de l’école était un véritable dictateur, hurlant en permanence, donnant des ordres à coups de sifflet, mettant pratiquement les enfants au pas pour entrer dans les classes. Il avait même une petite moustache – on rappelle que c’était juste après la guerre… –, mais nous étions trop jeunes pour l’identifier à ce sanglant personnage. Ce n’est que plus tard, notamment lorsque parut le film de Charlie Chaplin, « Le dictateur », que nous fîmes le rapprochement.
Ce fut à Paris aussi que je fis mon entrée chez les éclaireurs. Mon père en avait fait l’expérience étant adolescent et il m’encouragea à faire partie d’une troupe, ce que j’acceptai bien volontiers. Les éclaireurs de France étaient une organisation laïque, à la différence des scouts qui étaient catholiques. Mon père étant athée convaincu, cela allait de soi de m’inscrire chez les éclaireurs. Au sujet de la religion, je n’avais pas été baptisé lors de ma naissance en Espagne, contre l’avis de ma mère, alors catholique pratiquante. Dès notre arrivée à Bordeaux, avant la libération de mon père, ma mère profita de me faire baptiser en même temps que mon nouveau-né de frère, ce qui ne perturba pas outre mesure mon père revenu du camp, au point que, toujours athée convaincu, il accepta que je suive les cours de catéchisme à Montaigu-du-Quercy et que je devienne enfant de chœur. Mon père était même devenu très ami avec le curé, car c’était le seul intellectuel de la petite ville et ils s’amusaient tous deux à argumenter longuement, à propos des événements politiques et de l’existence de Dieu.
Revenons aux éclaireurs. La troupe « Saint-Exupéry », dans laquelle je fus incorporé, jouissait d’un local dans le quartier et organisait des camps, notamment celui qui eut lieu en Normandie, où je fus baptisé – à nouveau – et où je reçus le totem de « Léopard laborieux ». L’été suivant, le camp se déroula en Vendée, au bord de la mer, et la troupe fut sélectionnée pour participer au Jamboree – grande réunion mondiale organisée tous les quatre ans –, qui était organisé cette année-là en France. Lors de cette grande réunion d’éclaireurs venus du monde entier, la troupe qui me fascina le plus venait de Suisse, ce devait être prémonitoire, et elle était composée d’éclaireurs qui se vantaient de faire des camps de ski, en montagne, ce qui me parut fascinant. Je ne savais bien sûr pas encore que nous allions bientôt vivre en Suisse et que j’y apprendrais à skier. Mais nous sommes encore à Paris et il me faut raconter ici une aventure, survenue lors d’une visite en famille au zoo de Vincennes, au cours de laquelle, juché sur un rocher, je tendis un quignon de pain à un éléphant. Je reçus alors un léger coup de trompe sur le nez, ce qui me fit perdre l’équilibre et me valut une déformation de la cloison nasale, qui me condamna désormais à ne plus respirer que par la bouche.
Compte tenu de son vécu en qualité de journaliste et sténographe parlementaire avant la guerre, puis de militaire haut gradé, mon père a d’excellentes relations avec toute l’émigration espagnole. C’est ce qui explique qu’il n’a eu aucune difficulté à trouver du travail, une fois la guerre mondiale terminée. Ce ne fut évidemment pas le cas à sa sortie du camp de concentration. Pendant quelque temps, et c’est principalement ce qui lui permit d’en sortir, il bénéficia d’un subside du gouvernement espagnol en exil, au titre de son activité de militaire et surtout de son grade de commandant de division pendant la guerre d’Espagne.
Arrivé à Bordeaux, il chercha immédiatement du travail, mais malgré de nombreuses démarches, sans connaissance du pays ni de la langue, cela lui fut très difficile et aidé par un compatriote, San Vicente, il finit par travailler pour la base des sous-marins italiens à Bordeaux. Quelle ironie, n’est-ce pas ? Être embauché par une nation qui avait contribué à la défaite de l’armée républicaine, il fallait bien y être obligé pour nourrir sa famille… Le camarade qui l’avait présenté à la base l’avait prévenu que les Italiens cherchaient désespérément des ouvriers soudeurs pour la réparation des sous-marins et, comme mon père n’avait jamais tenu un chalumeau de sa vie, son ami le rassura, s’engageant à l’aider dans son apprentissage avec l’aide des autres ouvriers, la plupart également espagnols émigrés. Et en effet, doué apparemment pour ce métier manuel mais non violent, mon père parvint à donner le change rapidement et devint un excellent soudeur. Le travail s’effectuait de nuit, car les sous-marins étaient en patrouille toute la journée en défense de la côte française et dans des actions d’attaque des convois alliés. Les bombardements autour de la base étaient fréquents et cela ajoutait du stress à un labeur déjà difficile et pénible physiquement. C’est en rentrant à l’aube d’une de ces nuits de travail que mon père rencontra, dans une rue déserte, un homme poussant une charrette couverte d’une bâche, qui le héla avec un accent qui lui fit reconnaître immédiatement un compatriote. Ils s’arrêtèrent pour discuter et mon père, lui demandant ce qu’il transportait, s’entendit répondre qu’il s’agissait d’un chargement de pousse-pieds – percebes en espagnol – qu’il avait cueillis lui-même et tenté sans succès de vendre, les Français ne connaissant pas ce fruit de mer, pourtant considéré par les Espagnols comme le plus succulent des produits de l’océan. Et c’est ainsi que, ce jour-là, alors que la disette était de mise – nous sommes en 1941 –, la petite famille d’émigrés, avec l’oncle Raphaël et quelques copains espagnols, firent un banquet de pousse-pieds qui ne leur avait pas coûté un sou, le compatriote pêcheur leur ayant fait cadeau de sa récolte, désespéré de n’avoir pas pu trouver preneur. Il en profita également en se joignant à la joyeuse compagnie.
Mais nous sommes sur le point de quitter Paris. Paris où j’ai appris à monter sur une bicyclette, où j’ai pu voir un film d’adultes avec mon père – Gilda avec Rita Hayworth –, où je suis allé aussi à des réunions de républicains espagnols en exil, qui dissertent sur les chances de voir l’Espagne de Franco redevenir démocratique grâce à l’intervention des Nations Unies, lesquelles, contrairement à leurs attentes, vont finalement admettre l’Espagne en leur sein. Paris, où je dois me faire enlever les amygdales et où je me retrouve opéré par un boucher, médecin militaire espagnol qui ne connaît pas l’anesthésie et me les arrache à vif. Paris, où je vais recevoir mon certificat d’études et où mes expériences d’éclaireur – Léopard laborieux, ne l’oublions pas –, vont encore me servir, notamment dans mon avenir proche en Suisse, car j’y intégrerai une troupe de scouts et servirai même la messe à Russin, dans une église de la campagne genevoise, les enfants de chœur l’ayant désertée. Oui, en Suisse, suite à un enchaînement de circonstances qu’il vaut la peine de raconter.
Mais, auparavant, il faut aussi parler de mon petit frère Jésùs. Lequel est un sacré petit diable, excité, turbulent et très sensible aux moqueries, auxquelles il réagit par de véritables crises, tapant son interlocuteur à tort et à travers, avec les mains, mais aussi à coups de pied, lesquels sont chaussés de galoches. Il est donc nerveux et il vient de survivre à une terrible pneumonie qui l’a laissé exsangue et très affaibli. À la suite de quoi nos parents, profitant des offres de la Croix-Rouge qui propose aux enfants sortant de maladie des séjours à l’étranger, décident d’envoyer Jésùs en Norvège, dont le climat est paraît-il favorable pour accélérer sa guérison. Il s’agit d’un séjour de deux mois en été, dans une famille qui vit près d’Oslo, au bord de la mer. Cela n’enchante guère l’enfant, qui a tout juste huit ans et rechigne à être éloigné de ses parents. Avant son départ, le père de famille, qui s’est proposé dans différents organismes internationaux pour un engagement en tant que traducteur de l’anglais ou du français vers l’espagnol, reçoit un appel d’un de ses amis, espagnol lui aussi, en poste aux Nations Unies, lui proposant un contrat de traducteur dans la section espagnole de l’Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.), dont le siège est à Genève. Intéressé, mon père se rend au rendez-vous dès le lendemain, impatient d’en apprendre davantage. En chemin, il croise par hasard deux de ses amis émigrés, dont Cancela, celui avec qui il a vécu à ses débuts à Paris. Au moment où ils se croisent et à l’étonnement de mon père, après un bref salut, les deux gaillards, apparemment pressés, le quittent sans presque s’arrêter. Perplexe, mon père continue son chemin et parvient au siège des Nations Unies, où il retrouve son contact. Celui-ci se déclare surpris de le voir, alors même qu’ils ont rendez-vous. Il lui apprend qu’il vient de donner le poste qu’il lui a proposé à Cancela qui sort de là et qui l’a informé que mon père ne s’y intéressait finalement pas. Celui-ci s’insurge, explique qu’il n’en a pas été question, qu’il vient de rencontrer Cancela qui ne lui a rien dit et qu’il ne comprend pas ce qui se passe. Son ami, outré par l’attitude de Cancela, comprend que ce dernier a dû apprendre, par une indiscrétion, la possibilité offerte à mon père. Il a eu le culot, pour ne pas dire pire, de le devancer en mentant. Le fonctionnaire des Nations Unies décide alors de ne pas en rester là et il octroie le poste à mon père, se chargeant d’informer Cancela de sa décision, avec les commentaires qui s’imposent. Il précise cependant à mon père que ce poste est à court terme, c’est-à-dire pour deux mois, cependant renouvelable, bien que le renouvellement ne soit pas garanti car il dépend de la situation internationale. Il a tout de même de bonnes chances de continuer par périodes de deux mois. Mon père répond immédiatement qu’il est prêt à prendre le risque de quitter son travail actuel, sans garantie de le retrouver en cas de non-renouvellement à Genève. Son ami lui fait donc signer un contrat et déchire celui de Cancela. C’est ainsi que le départ de la famille vers la Suisse tient au hasard du temps qu’il a fallu à mon père pour arriver à son rendez-vous, car y serait-il parvenu quelques heures plus tard, l’annulation du contrat de Cancela aurait été vraisemblablement impossible, et la suite des aventures de la famille aurait évidemment pris une toute autre direction.
Ce n’est pas le seul changement important auquel la famille a dû faire face. Après son départ d’Espagne, une fois arrivé à Bordeaux en 1940, mon père avait réussi à obtenir un visa pour le Venezuela, pays vers lequel beaucoup de réfugiés espagnols cherchaient à émigrer. Nous avions même nos billets pour la traversée en bateau et nous prîmes donc le train à destination de Marseille, ville d’embarquement. Malheureusement (ou pas ?), alors que nous étions déjà dans le train, l’Allemagne ayant proclamé la suppression d’une partie de la zone libre, nous ne pûmes franchir la frontière entre les deux zones et fûmes obligés de rebrousser chemin. Un changement de destinée qui modifia évidemment le cours de notre vie et nous allions ainsi nous retrouver en Suisse, alors que nous aurions dû débarquer à Caracas.
Quoi qu’il en soit, ma mère n’est pas trop enchantée des perspectives de départ. D’abord, elle a toujours été réfractaire au changement, par crainte de tomber dans une situation pire. Ensuite, perdre un travail sûr à Paris pour accepter un contrat de deux mois dans un pays inconnu, constitue un sacré risque, à quoi son mari rétorque que son emploi actuel n’est pas garanti non plus et qu’il se propose de partir tout seul dans un premier temps puis, si le contrat est reconduit et que les perspectives à plus long terme laissent espérer d’autres prolongements, à ce moment-là seulement, il les fera venir elle et les enfants. Cela rassure ma mère, qui accepte donc de prendre le risque. Cela leur laisse le temps de mieux préparer le déménagement et n’oublions pas que Jésùs, le cadet, doit encore partir pour la Norvège.
Peut-être est-ce le moment de faire une diversion et de raconter les circonstances dans lesquelles mes parents se sont rencontrés. Après son service militaire effectué à Tétouan, ville du Maroc encore espagnole à l’époque, mon père, étudiant en droit et journaliste pigiste à Madrid, se vit offrir un poste dans un journal de Badajoz, en Extrémadure. Il s’y rendit et, par son enthousiasme, son énergie et sa capacité de travail, il devint non seulement l’adjoint du rédacteur en chef, mais aussi la coqueluche d’une partie de la ville, conquise par sa gaieté et sa sympathie. Il fut ainsi chargé d’effectuer le reportage de l’élection de miss Extremadura, qui devait avoir lieu à Badajoz, capitale de la province. Fasciné par la jeune fille qui fut élue et qui reçut la couronne, il ne manqua pas de lui faire la cour, après l’avoir interviewée. À cette époque de l’Espagne dite catholique et dont les mœurs étaient à peu près celles du XIXe siècle, il n’était pas question pour deux amoureux – car ma mère ne fut pas insensible au charme du journaliste – de sortir ensemble seuls. Leurs rencontres se bornaient à des promenades accompagnées d’une tante de Maria-Jésùs et à quelques conversations en cachette, elle dans une pièce au rez-de-chaussée de son domicile, lui dans la rue, le front appuyé à la grille de la fenêtre, laquelle laissait les traces des barreaux sur son visage.
La famille de Maria-Jésùs faisait partie de la bourgeoisie aisée de la ville. Née à Caceres, dans la même province, Maria-Jésùs vivait à présent à Badajoz – qui devait malheureusement devenir célèbre à cause du massacre qu’y effectuèrent les nationalistes rebelles, lors de la prise de la ville en 1936 –, car son père y avait ouvert un restaurant devenu le lieu de rencontre des classes moyenne et supérieure de la ville. La famille vivait donc dans un confort d’un certain niveau, avec bonnes et aides ménagères, de nombreux enfants, allant tous à l’école, ce qui n’était pas le cas de tous les jeunes en Espagne, laquelle comptait à l’époque plus de quarante pour cent d’analphabètes. Dix enfants, cela mérite quelques commentaires. Deux d’un premier mariage du père, prénommé également Felipe (dont on comprend aisément ici qu’il sera mon grand-père) et huit de son deuxième mariage. Deux d’entre eux, Antonio et Emilio, moururent pendant la guerre civile dans deux camps différents, un autre, Fernando, fut pris à quinze ans comme mascotte d’un régiment rebelle qu’il fut forcé de suivre pendant toute la durée de la guerre. Dix enfants, dont seulement trois femmes. Dans l’ordre de naissance : du premier mariage, Luis et Carmen, puis Raphaël, Maria-Jésùs, Antonio, Emilio, Fernando, Felipe, Alonso et Margarita. Entre la naissance du premier et de la dernière, vingt-trois ans d’écart. Antonio décéda de maladie dans une tranchée, Emilio au combat, d’une balle perdue… Quoi qu’il en fût, Felipe et Maria-Jésùs s’aimèrent et se marièrent en 1933, donnant naissance l’année suivante à Pipin, à Madrid, puis en 1939 à Jésùs à Bordeaux et, enfin, en 1946 aux jumelles à Paris.
Genève
En ce printemps 1948, mon père part donc seul pour Genève où il élit domicile à « La Cloche », une pension de famille presque au bord du lac Léman et toute proche de son lieu de travail à l’U.I.T., au Palais Wilson. Après quelques semaines, son contrat étant prolongé pour six mois, il demande à sa femme de le rejoindre avec les enfants. Il a trouvé un logement meublé pour l’été, quai Charles-Page, au bord de l’Arve, affluent du Rhône et rivière qui descend depuis le glacier du Mont-Blanc. Ma mère organise le déménagement qui n’est pas très compliqué, vu la maigreur de nos biens et dans la mesure où nous n’aurons pas besoin de notre pauvre mobilier, puisque nous logerons dans un appartement meublé. Il faut attendre cependant que les enfants terminent leur année scolaire et, à fin juin, nous voilà partis pour la Suisse, sans savoir que ce sera là notre dernière migration.
Après les privations de ces dernières années, la Suisse ressemble à un eldorado : comparé au pain de maïs du temps de l’après-guerre, le pain est miraculeusement blanc, les enfants goûtent le chocolat au lait, friandise inconnue jusque-là et, comparée à Paris, la ville de Genève, avec son lac, ses airs de cité provinciale, sa circulation automobile encore modeste, ville que l’on peut donc parcourir sans danger à bicyclette, est un vrai paradis. Les enfants se font tout de suite des amis dans le quartier, principalement moi qui suis assez grand pour pouvoir entrer et sortir à ma guise, d’autant plus qu’il n’y a aucun danger à cet âge et en ces temps. La plaine de Plainpalais, tout près de notre domicile, offre un espace idéal de liberté et de jeux, ainsi que le bois de la Bâtie ou les rives de l’Arve. Et ne parlons pas du lac et des bains des Pâquis où, dès le mois de mai, on peut se baigner gratuitement et apprendre à nager. C’est justement ce à quoi je me consacre en ce début d’été et mes progrès sont rapides. Après quelques semaines de cours tous les matins, c’est fait, car il faut savoir nager pour ne pas se ridiculiser. En effet, les Suisses, apparemment et pour cause, savent nager depuis leur plus tendre enfance et skier, mais ça, ce n’est pas encore le moment pour moi. Pour l’instant, j’en suis encore aux jeux et déjà aux premiers émois avec les filles, notamment envers une jeune adolescente qui habite dans le même immeuble, à l’entrée voisine – on dit une allée, en Suisse. Elle s’appelle Michelle et les adolescents que nous sommes se plaisent. Je suis toutefois trop timide pour oser me déclarer, malgré mon expérience déjà ancienne d’un premier émoi. C’était à Montaigu-du-Quercy où, dans la maison d’en face, vivait une jeune fille de quatorze ans, plus âgée que moi, (je n’avais alors que onze ans), qui me troublait, mais à laquelle je n’avais finalement jamais fait aucune avance et, bien sûr, elle non plus. Nous verrons plus tard que Michelle, elle, saura se déclarer et prendra donc les devants. Nous n’en sommes pas là. Car il faut bien parler d’école, malgré le fait que nous soyons en été.
En effet, j’ai mon certificat d’études mais cela n’existe pas en Suisse et il va falloir se renseigner sur la façon de se raccorder au système local. Nous prenons donc rendez-vous avec le directeur du collège classique, un ancien chef de la police genevoise (!) et, patatras, le ciel nous tombe sur la tête. Pour entrer au collège classique à mon âge, je dois avoir déjà étudié durant trois ans l’allemand et le latin. L’allemand, en France après la guerre, ne s’enseignait pas et pour cause. Pourquoi maintenant le latin ? Parce que j’envisageais, poussé par mon père, de faire des études universitaires. Mon père, lui, aurait voulu être médecin, mais son père à lui, modeste huissier à la chambre des députés, le convainquit de faire des études de droit, estimant qu’un avocat avait plus de chances de trouver des débouchés et surtout parce que les études étaient plus courtes, donc moins coûteuses. Un peu frustré par son passé, mon père m’influença et je croyais donc ainsi désirer être médecin. Pour accéder à la faculté de médecine, il fallait à l’époque avoir étudié le latin. Le directeur du collège Calvin, où l’écrivain Jorge Semprun étudiera aussi – nous verrons plus tard pourquoi il est ici question de celui qui devait devenir ministre de la Culture de l’Espagne démocratique –, le directeur donc trouva la formule, assez compliquée à vrai dire, qui pouvait me permettre de passer mon bac en section latine, en perdant le moins de temps possible. Il existait un collège dit Moderne, destiné aux élèves ayant fini l’école primaire et qui se dirigeaient vers un apprentissage. Dans ce collège on enseigne bien l’allemand, mais pas le latin. Je devrais donc m’y inscrire, suivre les cours qui durent deux ans et, pendant ce temps, prendre des leçons privées de latin pour rattraper les trois années manquantes ! Sacré programme, pratiquement impossible à respecter selon le directeur du Collège classique. Eh bien, sans hésiter un seul instant, ne doutant de rien, probablement sans nous rendre compte de la difficulté du programme, mon père et moi nous engageons dans cette voie. Enfin, surtout moi, car mon père ne sachant ni l’allemand, ni le latin, ne peut certainement pas m’aider dans cette course d’obstacles.
Dès le début du mois de juillet, mon frère Jésùs doit partir pour la Norvège et notre mère décide de l’accompagner à Paris d’où est prévu le départ. C’est un petit drame et cela se comprend, car partir seul à neuf ans vers un pays lointain, vivre deux mois dans une famille inconnue qui parle une langue inconnue… Enfin, pour ce qui me concerne, bien que j’aimais beaucoup mon frère, je me sens soulagé car Jésùs est un enfant pénible, colérique et turbulent, ce qui rend nos rapports souvent tendus. L’été passe pour moi à toute vitesse avec la nouvelle bande de copains, la natation et le confort des nouvelles conditions de vie. Dès la rentrée scolaire, je me rends au Collège Moderne en tram, grande nouveauté aussi pour moi. Je commence en parallèle les cours particuliers d’allemand, une fois par semaine et de latin, trois fois. Ajouté au travail du collège, la tâche est lourde, mais j’ai toujours été un enfant obéissant et responsable, bien que très farceur et même assez indiscipliné par certains côtés, ce qui n’est pas forcément contradictoire. Réfractaire surtout à l’ordre disciplinaire imposé par l’école, ce que je resterai jusqu’à la fin de mes études.
Au Collège Moderne, après quelques jours, au vu de mon joyeux caractère et malgré ma timidité, je me fais quelques copains dont certains vont devenir des amis, deux d’entre eux même des amis pour la vie. L’un s’appelle Raymond, l’autre Jean-Pierre. Jean-Pierre est le fils unique d’un ouvrier travaillant dans une grande usine de matériel électrique, Raymond est le fils d’un émigré italien qui tient un bistrot à la périphérie de Genève, Chêne-Bourg, tout proche de la frontière française. Raymond a une demi-sœur, née d’un premier mariage de son père. Tous deux, Jean-Pierre et Raymond, sont au Collège Moderne par manque de moyens de leurs parents, qui ne peuvent songer à leur laisser continuer des études, bien qu’ils soient bons élèves. Ils deviennent mes amis mais séparément, c’est-à-dire que nous ne formons pas un groupe de trois, mais bien deux groupes de deux, et j’alterne donc les contacts en dehors de l’école, surtout à cause de la jalousie de Raymond. Il s’agit bien sûr d’une jalousie amicale qui ne crée aucun conflit. Les activités de ces deux groupes sont d’ailleurs bien distinctes, sportives avec Jean-Pierre, intellectuelles et farceuses avec Raymond. Aucun de nous trois ne s’intéresse pour l’instant sérieusement aux filles, mais cela ne va pas tarder.
La vie de ma famille est à présent bien organisée. Jésùs est rentré de Norvège, bronzé et en pleine forme, fier de son expérience et d’avoir voyagé seul. À la fin du bail de l’appartement du quai Charles-Page, mon père nous a trouvé un logement dans la vieille ville, à la rue du Perron ou « degrés du Perron », appelée ainsi car il s’agit d’une rue montante vers la Cathédrale, mais en escalier. Ce logement présente toutefois un inconvénient majeur : pas beaucoup de confort, ce qui marque une régression par rapport au quai Charles-Page et surtout, surtout, il y a des rats qui circulent dans l’immeuble. Cela, la famille n’en veut plus et l’acharnement de mon père à trouver une autre solution aboutit rapidement à un résultat : un appartement tout près de là, donc en plein centre, avec confort et apparemment sans rats ! Ce logement va devenir notre cadre de vie pendant plus de vingt ans, pour certains d’entre nous en tous les cas. Deux chambres à coucher, un salon, une belle cuisine ensoleillée et une salle de bains, eau chaude et chauffage central, c’est le paradis. Les enfants iront à pied à l’école, même moi car, entre-temps, le Collège Moderne a déménagé à la rue d’Italie, qui est tout près du nouveau domicile. On est à trois minutes du bord du lac, le Jardin Anglais pour les promenades, tous les commerces à proximité, le paradis quoi !
De six mois en six mois, le contrat de travail de mon père nous assure peu à peu la tranquillité quant à l’avenir. Genève est de plus en plus internationale, les organisations de plus en plus nombreuses, l’U.I.T., notamment, prend de plus en plus d’importance, les moyens de télécommunication, radio principalement, devenant primordiaux dans les relations internationales. En 1949, je vais avoir quinze ans et, cet été-là, la famille décide de partir en congé, car les vacances sont devenues une réalité inconnue auparavant. Des vacances donc, mais à Bordeaux chez l’oncle Raphaël, celui-là même chez qui nous nous sommes réfugiés en arrivant en France en 1939. À l’époque, la frontière, nous la passâmes à pied, près de « La Junquera », ma mère et moi (j’avais cinq ans), et quand on dit ma mère et moi, n’oublions pas qu’il y avait un troisième personnage, le futur Jésùs encore dans le ventre de sa maman. Nous passâmes la frontière à Puigcerda le 25 janvier 1939, traversâmes « Bourg Madame » et arrivâmes à Carresse, un village français du Béarn. Nous y fûmes accueillis par les autorités qui nous logèrent et, c’est un grand mot, à la Mairie où, le soir venu, je faillis m’électrocuter en enfilant un doigt dans une prise électrique. Le lendemain, devant l’affluence des émigrés et alerté par le maire, lui-même dépassé par le flot de réfugiés, le consul d’Espagne se mit en devoir de déterminer qui pourrait continuer son voyage et qui devrait être dirigé vers un camp de concentration.
Bien sûr, il ne s’agit pas ici de camps comparables à ceux qui allaient plus tard devenir célèbres pendant la deuxième guerre mondiale. Il n’en reste pas moins que, si l’on ne tuait pas, beaucoup de réfugiés mouraient à cause des conditions d’hygiène, des carences alimentaires et parfois des mauvais traitements infligés par les gendarmes français. À Argelès, les réfugiés vivaient à l’air libre été comme hiver et décédaient par centaines. À Septfonds, où mon père passa six mois, ils étaient parqués dans de grandes cabanes rectangulaires en bois, dont l’un des grands côtés n’avait pas de façade. Ils étaient donc exposés aux intempéries, aussi bien le vent que la pluie, la chaleur et le froid, et, périodiquement les gendarmes passaient faire une inspection qui consistait à démolir le peu d’installations que les réfugiés avaient réussi à construire, sous prétexte de vérifier qu’ils n’avaient rien caché de dangereux. Qu’auraient-ils pu posséder qui n’eût été confisqué à leur arrivée au camp et qu’auraient-ils pu obtenir de qui, enfermés et entourés de barbelés gardés par des gendarmes ?
Quoi qu’il en soit, ma mère et moi – et mon futur frère – réussîmes à obtenir l’autorisation de continuer le voyage, contre la garantie financière du dernier bijou en notre possession, un collier de famille donné par la grand-mère maternelle, et une lettre de l’oncle Raphaël attestant qu’il nous attendait à Bordeaux. Ironie de l’histoire, ce même bijou de grande valeur, honnêtement rendu plus tard par le consul lorsqu’il reçut l’attestation de notre résidence en France, fut volé en Suisse dans le coffre-fort de la famille plus de trente ans plus tard par un cambrioleur et remboursé par l’assurance vol pour une valeur d’environ trente mille francs suisses, somme énorme à l’époque. La réalité de la valeur de l’objet fut attestée par un orfèvre, grâce à la présentation d’une photo de ma mère portant le bijou.
Revenons à l’été 1950 et aux vacances à Bordeaux. J’ai donc quinze ans, Jésùs onze et la petite Maria-Jésùs quatre. À Bordeaux il y a également Paco, le frère cadet de mon père. Pendant la guerre d’Espagne, il s’était engagé dans la garde civile républicaine, mais son rôle n’y avait pas été très clair, il faut donc se contenter de dire qu’il fit la guerre aux côtés des républicains et termina prisonnier à Argelès, d’où son frère réussit à le faire sortir. Passionné de mécanique automobile, il trouva d’abord du travail dans une petite fabrique de lames de scies à ruban, dans laquelle il réussit à faire engager son frère Felipe qui, avec son cerveau d’intellectuel, inventa un système plus performant de fabrication, ce qui lui valut de la part du patron, dont le patronyme était Nicouloz, une éternelle reconnaissance. Après Bordeaux, où un accident de travail lui valut la perte du majeur de la main droite, Paco préféra partir à la campagne, près de Montaigu-du-Quercy, et s’engagea comme bûcheron dans une ferme gérée par une femme seule, dont le mari était décédé. Il y fit venir Felipe, mon père, qui en avait assez de travailler dans les sous-marins italiens. Felipe n’avait rien d’un bûcheron. Il commença brillamment par abattre avec beaucoup de peine un arbre marqué, parce qu’il fallait justement l’épargner. En fait il préférait se promener dans la forêt en rêvassant. Le groupe de bûcherons commandés par Paco avait pour tâche de produire du charbon de bois. Pour ce faire, ils entassaient d’énormes tas de bois sur lesquels ils plaquaient, en les entourant complètement, une épaisse couche de terre glaise, constituant ainsi un énorme four à bois, avec quelques ouvertures en partie basse et un trou au sommet pour assurer la combustion. Après avoir allumé le feu, ils le surveillaient nuit et jour pendant au moins une semaine entière mais, malgré leur soin, le résultat était souvent aléatoire, le charbon de bois finissant carbonisé ou pas assez brûlé, ce qui occasionnait pas mal de pertes. C’est là que mon père, une fois de plus, se révéla utile et compensa ainsi sa faiblesse manuelle, en cherchant une meilleure solution. Grâce à son ancien patron, Nicouloz, il réussit à trouver et faire venir de Bordeaux, avec l’accord de la patronne, un four métallique en pièces détachées qui leur facilita le travail car il ne nécessitait pas de surveillance et assurait le résultat final.
Rappelons qu’à l’époque, les véhicules automobiles fonctionnaient au gazogène, fabriqué avec du charbon de bois, à cause des restrictions dues à l’occupation allemande, l’essence étant devenue introuvable puisque réservée aux Allemands, sans parler des besoins en combustible pour le chauffage des habitations. Nous habitions à ce moment-là à Aurignac, bourg minuscule en pleine campagne. La petite ville de Montaigu étant à sept ou huit kilomètres, accessible pour nous seulement à bicyclette, le ravitaillement provenait de la ferme de la patronne – légumes, lait, charcuterie parfois et surtout les œufs, source principale de protéines – que mon père se chargeait de ramener à la maison en rentrant du travail. Les œufs arrivaient rarement au complet car mon père, pour qui c’était une friandise, en gobait en route une bonne partie.
Aurignac restera pour moi, malgré la précarité et le manque de confort, un souvenir précieux et inoubliable. Mon père tous les jours à la maison après le travail, les jeux avec mon petit frère pas encore insupportable, notamment le jeu d’imitation des vaches consistant à marcher à quatre pattes et cul nu en faisant ses besoins, la vision du père cultivant, non pas des légumes mais une plante bien plus importante, le tabac… Et surtout Safaud, un chien berger, mais quel chien ! Il suivait mon père comme son ombre au point qu’il fallait l’enfermer quand il s’absentait. Mon père, qui avait fini par en avoir assez de jouer au bûcheron, trouva enfin un travail de soudeur à Moissac, à trente kilomètres d’Aurignac. Il s’y rendait à bicyclette le lundi matin très tôt et revenait le samedi pour passer le week-end en famille. Un fameux lundi, le chien réussit à s’échapper et poursuivit mon père qui ne s’en rendit compte que lorsque le chien le rattrapa après une dizaine de kilomètres, les pattes en sang. Il nous fallut malheureusement nous en séparer et avec quelles difficultés, lorsque nous déménageâmes pour Montaigu. Mais grâce à Safaud, j’eus ma première leçon de vie à Aurignac lorsque, nous promenant avec mon père dans le hameau, le chien se précipita vers une chienne en chaleur et lui grimpa sur le dos, malgré les hurlements des deux maîtres. Il resta accroché en gémissant, les deux animaux, penauds, se retrouvant cul contre cul, tirant chacun de leur côté sans parvenir à se libérer. J’eus droit, ce jour-là, je venais d’avoir huit ans, à toute l’explication concernant les abeilles, les chiens, les chats, les humains, la petite graine du papa dans la maman et, finalement, le mystère de la procréation. Mais, comme j’avais déjà vu ma mère enceinte de mon frère, il semble que je compris assez vite et me le tint pour dit, que si je ne voulais pas me retrouver coincé comme Safaud, il me faudrait être plus prudent que le chien.





























