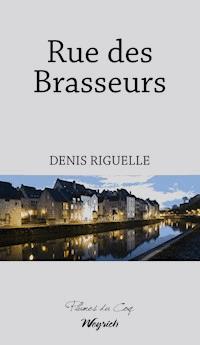
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mais que se passe-t-il dans la rue des Brasseurs, lieu de convergence de personnages
plus captivants les uns que les autres ?
Franz Racine est professeur à Namur. Un matin, il renverse une jeune fille en robe rouge… Sans conséquences, semble-t-il. Son voisin d’en face, Marc Barbot, le soupçonne d’avoir des comportements pervers et le surveille de sa fenêtre. Ce veuf solitaire est hanté par l’image du Dieu de son enfance et s’affirme de plus en plus en redresseur de torts. Racine, lui, est hanté par un amour passé et ses fantômes qu’il tente d’oublier dans la pratique du saut en longueur et dans la contemplation de la Namourette voguant sur les eaux namuroises... Une autre vie, à l’ombre de la Citadelle, est-elle encore possible ? Le destin finira par donner rendez-vous à tout ce beau monde rue des Brasseurs.
Un vrai thriller aux drôles de faux-semblants dans la ville où règne l’académie du mensonge...
EXTRAIT
Lola Valérie court. Son père vient de la déposer tout en haut de la Citadelle.
"Je ne peux pas plus loin, je suis pressé."
Elle risque d'être en retard, mais elle ne semble en avoir cure. Elle court, Lola Valérie, et sa course n'est pas celle d'une athlète entraînée, mais d'une femme prudente : une chute, lors d'un de ses premiers jours d'entrée en fonction, ce ne serait pas...
Son regard n'est que va-et-vient : ses yeux sont attentifs aux inégalités du terrain et cherchent au travers des arbres à apercevoir les toits de Namur. Ce n'est pas chose aisée. La végétation est encore drue dans cet automne qui commence : les feuilles ont du regret à quitter l'asile des branches. Alors que Lola vient de ralentir sur une petite portion de cailloux semblables à du ballast, une trouée apparaît. La jeune fille se rend compte qu'elle est déjà loin dans sa descente. Presque à l'horizontale, elle fixe l'arrière des habitations de la rue des Brasseurs : fenêtres closes ou béantes sur la Sambre. Penché à l'une d'elles, un homme se détache faiblement.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Un peu comme un jeu (théâtre) in : Démocratie mosaïque : 16 scènes inédites à lire et à jouer, Carnières, Lansman, 1998.
L’entretien (théâtre) in : Petites scènes pour la démocratie 5, Carnières, Lansman, 2003.
Du côté d’elles (recueil de nouvelles), Louvain-la-Neuve, Quadrature, 2012.
À mes enfants, Mathilde, Sarah et William.
Raconter ne consiste pas à reproduire la réalité, mais à mentir sur la réalité.
Dominique Fernandez
1
Lola Valérie court. Son père vient de la déposer tout en haut de la Citadelle.
« Je ne peux pas plus loin, je suis pressé. »
Elle risque d’être en retard, mais elle ne semble en avoir cure. Elle court, Lola Valérie, et sa course n’est pas celle d’une athlète entraînée, mais d’une femme prudente : une chute, lors d’un de ses premiers jours d’entrée en fonction, ce ne serait pas…
Son regard n’est que va-et-vient : ses yeux sont attentifs aux inégalités du terrain et cherchent au travers des arbres à apercevoir les toits de Namur. Ce n’est pas chose aisée. La végétation est encore drue dans cet automne qui commence : les feuilles ont du regret à quitter l’asile des branches. Alors que Lola vient de ralentir sur une petite portion de cailloux semblables à du ballast, une trouée apparaît. La jeune fille se rend compte qu’elle est déjà loin dans sa descente. Presque à l’horizontale, elle fixe l’arrière des habitations de la rue des Brasseurs : fenêtres closes ou béantes sur la Sambre. Penché à l’une d’elles, un homme se détache faiblement.
Que Franz Racine se penche à la fenêtre n’a rien d’exceptionnel, au contraire, cela tient de la routine : celle d’ouvrir la fenêtre, de contempler le dehors pour tenter d’apercevoir la Citadelle derrière les marronniers en fleur ; celle de se pencher sur la rivière pour découvrir que la Sambre est bien conforme à ce qu’on lui a décrit : un « noir lacet d’une sidérurgie moribonde ». Il s’est douché, s’est levé, a déjeuné et maintenant, avant de quitter son logement, il vient refermer la fenêtre qu’il avait laissée ouverte pour aérer sa chambre.
Les matins où l’automne arrive, où il échange les camaïeux de verts pour les rousseurs des feuilles, Franz emprunte systématiquement le même chemin. Au sortir de son appartement, rue des Brasseurs, sur les trois cents mètres qui le séparent des bords de la rivière, il slalome littéralement d’un côté du trottoir à l’autre, aberration de la rénovation urbaine ou véritable piège à automobilistes – Ah ! vous avez voulu que l’on refasse la rue, et à l’ancienne en plus, avec pavés et configuration d’origine, vous allez en baver, pas question de pousser le moteur, d’exciter les cylindres, d’injecter violemment le carburant, non, prudence –, Franz ne peut trancher. À peine jette-t-il à l’immeuble d’en face, au store écarté par la main fébrile de Marc Barbot qui, surpris, rage déjà que Racine ait pu le surprendre, à peine y jette-t-il un regard, Franz qui ne se doute de rien, Franz qui ignore tout en ces matins d’automne.
Lola Valérie porte un pantalon rouge, une veste blanche sur un pull de la même couleur. Une barrette peine à maintenir ses cheveux châtains qui pendent, lâches, sur sa nuque.
La municipalité de Namur exige de tout habitant une carte de riverain, carton jaunasse, inspirée peutêtre par un ex-arbitre de football devenu conseiller communal, à exhiber visiblement, l’adverbe est précis dans la circulaire envoyée aux Namurois, à l’avant du véhicule. Bizarrement, ici, le rédacteur, ou le comité de rédaction, a laissé le texte dans le flou. Franz s’est déjà laissé aller à imaginer une dizaine de personnes passant une nuit faite de sandwiches, de cigarettes fumées à la dérobée, de coups de téléphone et d’échanges de textos rageurs – Vous n’avez pas encore fini ? Presque, chérie, tu peux aller dormir. Pour une carte de riverain, il vous faut sept heures ? La politique, chérie, je ne cesse de te le répéter. Politique ? Dis-moi comment elle s’appelle ta pétasse ! – : une nuit de fatigue inquiétante pour décider de la mouture finale du document. Le texte, donc, ne précise pas clairement ce qu’on entend par avant du véhicule... Arabelle, une collègue, six ans qu’elle a acheté un appartement à La Plante, précise : « Je l’ai collée sur le parebrise. » Franz a choisi la vitre latérale du passager. Certes, cela obstrue la vision latérale droite, mais à part sur l’autoroute – hop, par sécurité, un coup d’œil rapide dans la petite glace – quand a-t-on l’usage du rétroviseur droit ?
Lola Valérie s’est arrêtée. Sa jambe droite est pliée et son pied repose sur un des bancs en bois qui jalonnent aléatoirement l’avenue. Le bas de son pantalon rouge est relevé : la jeune fille cherche à savoir d’où vient la brusque démangeaison qui l’irrite à la cheville. Une piqûre de guêpe ? Improbable, pense-t-elle, elles doivent être abruties en cettesaison. Un moustique, alors ? Non, la douleur ne serait pas si forte. Elle crache un peu de salive sur le bout de ses doigts, étend ce piètre liniment sur l’inflammation, puis pour reprendre sa descente, elle opte pour les lacets de la route, renonçant à un raccourci boueux.
Ces matins d’automne, Franz Racine longe donc brièvement la Sambre dans une position de surplomb qui lui plaît, une vue plongeante sur l’eau noire, dernière Namourette qui fend les flots, Santa Maria de pacotille, pilotée par un bien triste Christophe Colomb qui sait qu’avec la saison va se terminer son travail, qu’alors, oui, il faudra bien se résigner à retourner au CPAS, alors que lui, durant l’été, avait été le fringant capitaine de ce frêle esquif touristique, rêve d’un échevin, un autre, pas l’ex-arbitre, un romantique, celui à qui les beaux-parents fortunés avaient payé un voyage de noces à Venise et qui ne s’était jamais remis des vaporettos, projet qu’il avait porté à bout de bras – vous m’entendez, six ans de législature et j’y suis arrivé, pas étonnant que j’aie été réélu.
Et Franz franchit le pont, attend le vert du signal tricolore, place ses pas sur le passage zébré, hésite, dans une réminiscence de l’enfance, à ne pas poser un de ses pieds sur un espace dépourvu d’une grande bande blanche, gravit quelques escaliers, jette un regard douloureux au monument aux morts – de quelle guerre ? Première, seconde ? –, aperçoit sa voiture, humide encore de la nuit et se fait la réflexion qu’il n’a pas fait l’amour depuis longtemps.
Elle est distraite, Lola Valérie, parce qu’elle pense à ce qu’elle va devoir expliquer à son nouvel auditoire. Doit-elle être explicite, entrer dans les détails, faire preuve d’érudition au risque de pédanterie, ou au contraire rester simple, considérer qu’ils en savent autant qu’elle, sous-entendre plutôt qu’alourdir ?
Elle replace une mèche de cheveux derrière son oreille gauche, plonge la main dans son sac pour consulter la montre qu’elle ne porte pas d’habitude parce que le métal irrite son poignet, et constate qu’il faut vraiment qu’elle se dépêche.
C’est peut-être parce qu’il a du mal à s’extraire de son emplacement de parking – foutue vignette jaune, sale endroit, tout compte fait, que la vitre passager –, qu’il doit s’y reprendre à trois fois, qu’il démarre en trombe, qu’il accroche la jeune fille au pantalon rouge qui, un bref instant plus tard, une fois Franz extirpé de son véhicule, s’excuse :
« Non, c’est moi, en retard, un cours important, j’aurais dû être attentive, écoutez, han, han, j’ai couru, j’ahane, regardez, rien, même sur mon pantalon on ne voit pas de trace… la chute ? un réflexe, je vous assure, d’accord, je veux bien accepter votre numéro de téléphone, vous êtes gentil, je, vous comprenez, mon cours. »
Et elle s’en est déjà allée.
Tout à coup, il ne s’agit plus d’un matin d’automne où l’on échange les camaïeux de verts pour les rousseurs des feuilles, mais du matin d’automne où il a accroché une jeune fille vêtue d’un pantalon rouge accidentellement. La route, film muet, ne laisse aucune image dans son cerveau. Son véhicule pénètre de lui-même dans le parking de l’école.
Franz se réveille : « Merde ! comme d’habitude, pas de place. »
Une larme perle au bas de l’œil droit de Lola Valérie : « Que vais-je devenir dans la vie, se demande-t-elle, si je suis incapable d’aligner trois phrases ? »
2
Marc Barbot projette littéralement son corps en arrière tandis que les lattes du store qu’il vient d’écarter de deux doigts reviennent en place en une vibration inaudible. Il peste. Pas une injure, non, un palsambleu suranné, dont l’éructation lui fait tout de même du bien : Espérons qu’il ne m’a pas repéré, ce serait trop bête. Jusqu’à présent, je suis sûr qu’il ne se doute de rien, je dois être plus prudent, mieux réveillé en fait, une stupidité d’arrêter le café à soixante-sept ans ; si mon corps a tenu jusqu’ici, il n’y a pas de raison qu’il me lâche maintenant. Il s’en veut donc. Pourtant, le téléobjectif Sigma APO 800 mm, un truc de fou, de paparazzi en fait, lui avait dit le vendeur au téléphone – « J’ai travaillé pour Voici, vous savez, j’en ai shooté des vedettes avec cela, je vous assure. » –, bien stable sur son pied, était pourtant idéalement placé, comme à son habitude, en embuscade à la petite fenêtre de sa salle de bains. Quel avait été ce réflexe stupide d’écarter le store ! Il se sent las tout à coup : et s’il vieillissait, si tout cela n’avait aucun sens ?
Alors, Marc Barbot sort et marche, et de la promenade émerge la réflexion. C’est une habitude qui remonte à l’enfance. Ses jambes sont les deux trames d’un tissu, sa pensée, la navette. Auparavant, le plus souvent, naissaient des motifs parfois surprenants, pourtant toujours compréhensibles. Aujourd’hui, ceux-ci sont plus abstraits ; parfois, il n’y relève plus rien d’intelligible. Cela le taraude, l’oblige à revenir au point de rupture. Comme souvent, il bute contre le jalon que constitue la mort de Madeleine ; il a conscience que tout a basculé à ce moment : comment pourrait-il en être autrement ?
La traversée de Namur a été déambulation, flânerie. Il aime la ville, ses trottoirs surprenants, la vie tapie qui sourd sous l’apparente apathie. Avec la chaussée de Waterloo, son allure a dû se réguler, le pas se faire plus court pour que la respiration reste aisée. Le cœur garde un rythme régulier, la pensée pas. Elle le ramène en arrière, remonte le temps et l’aiguille se fige sur une soirée de décembre 1989 qu’il se remémore d’une voix sourde qui pousse quelques personnes à se retourner sur son passage tandis qu’il dépasse la maison Mucha :
« Je suis dans le jardin des Jeanmart. Madeleine a voulu qu’on se rende chez eux, malgré son état. J’étais énervé avant de partir : à plus de huit mois de grossesse, était-ce raisonnable ? J’avais même osé lui rappeler que l’accouchement de sa sœur ne s’était pas déroulé sans mal. Cela l’avait un peu énervée. Alors, elle m’avait avoué qu’elle se sentait une grosse vache cloîtrée dans une étable, qu’une petite soirée de détente lui ferait du bien, que je ne me fasse pas de souci.
« Les Jeanmart habitent le Limbourg, pour moi, Tongres, ce n’est pas tout près et puis les Jeanmart, après un louable effort, vont passer toute la seconde partie de soirée à parler en flamand. C’est peutêtre pour cela que je me retrouve dans le jardin à contempler la nuit. J’aperçois alors une lueur dans ce ciel, je médite à la coïncidence : ma femme sur le point d’accoucher, une étoile qui brille anormalement bien au-dessus de moi. Cela m’amuse un instant, je n’ose y voir un signe. Pourtant, le premier enfant, celui auquel on croit, celui dont on sera, par-dessus tout, toujours le plus fier, est sur le point de voir le jour. Madeleine perd les eaux cette nuitlà, une demi-heure à peine après que nous avons regagné notre logis. Jean voit le jour un peu avant midi, c’est un enfant vigoureux dont je suis fier.
« Le soir même, alors que Madeleine m’a demandé que je la laisse seule, m’assurant que tout irait bien, qu’elle a surtout besoin de repos, je m’effondre dans le divan devant la télévision. Le présentateur revient sur ce qu’on appelle déjà une « vague d’ovnis sur la Belgique » et précise que le soir de la veille a été riche en apparitions. Un instant, je reste à quia : ces étranges lueurs dans le ciel que j’ai observées alors que j’étais seul dans le jardin des Jeanmart, aurais-je, moi aussi… Je rejette immédiatement l’idée, tout cela n’a pas de sens. Le réel est réel ; la science-fiction porte bien son nom : fiction ! Ce ne sont que coïncidences. À cette époque, j’en suis sûr. Aujourd’hui, je me pose des questions. Qu’ai-je vraiment vu ? Quel crédit peut-on accorder à ce que l’on observe ? Était-ce une chimère ou une étoile ? »
3
Arabelle accueille Franz, lorsqu’il entre dans le bureau de l’économe, en lui tendant une tasse de café, un gobelet en plastique en fait. Elle tente son habituel quandamènerastutapropreta… qu’elle ne finit pas lorsqu’elle aperçoit le visage défait de Franz : Mal dormi ? La noria, peste-t-il, cette foutue idée de tournante de voitures, ça va me rendre fou, plus de places dans le parking, j’ai dû me garer au plateau : cinq cents mètres de marche, cinquante de dénivelé. Je me demandais l’autre jour d’où lui venait cette idée. À mon avis, c’est à cause du terme tournante, ça doit lui manquer, ou l’exciter ; elle n’est pas là ? Réunion à l’extérieur, répond laconiquement Arabelle. Tant mieux, finit Franz, on va respirer aujourd’hui. Dimitri éclate de rire dans son dos, l’embrasse et lance un dernier lazzi sur le dos d’Ano, la directrice, un fil de fer, une asperge, un roseau qui plie et ne rompt jamais. Une maigreur à faire mal. Des os qui se dévoilent, saillent sous la peau. Une déficience pondérale qui lui a valu son surnom : Ano. Dimitri juge que ce n’est pas normal d’être comme ça : elle a dû vivre un traumatisme terrible dans l’enfance, une histoire sordide, au minimum un viol, et à plusieurs – une tournante, glisse Franz – ; mais Dimitri continue : cela vient peut-être de son père, un pervers qui lui a fait des trucs qu’on ne peut même pas imaginer, ou encore d’une adolescence misérable, à Marcinelle, tu vois, à l’ombre des terrils, et que je t’oblige à ramasser des morceaux de charbon pour chauffer un baraquement insalubre… Alors, elle travaille pour s’en sortir – « Mon milieu, je le hais, je vais réussir, ne dépendre de personne ! » –, elle y met toute son énergie, y brûle toutes ses graisses… Franz n’écoute plus, qui sait qu’elle habite Mauchamp, le village où ils travaillent, le village de son école, cette école où on l’a soudain catapultée directrice : tant de formations suivies, une telle énergie, voilà notre sauveuse, celle par qui l’établissement va renaître ! On a vu cela.
Arabelle est irritée. Un énervement diffus, comme toujours, qui ne fait que s’amplifier lorsqu’elle constate la présence de la voiture de Franz à côté de la sienne. Le plateau, la marche, la noria : du pipeau. Arabelle est excédée par les continuelles remarques dépréciatives, l’« énergie négative » aime-t-elle à la nommer, qui suintent continuellement dans l’école. Ces vannes incessantes, ces griefs larvés envers Ano, la dépréciation condescendante de certains élèves, elle ne les supporte plus. Après un rapide regard circulaire à 360 degrés dans le parking, elle donne un léger coup de la pointe de sa botte dans le pneu avant droit du véhicule de Franz : geste infantile trahissant son agacement, elle en est parfaitement consciente. Elle cherche à jauger Franz : « Pourquoi cette arrogance désinvolte, cette fragilité forte, ce désarroi étouffé… ? » parodie-t-elle Shakespeare en souvenir de son bref passage sur les planches. Encore une chose qu’elle aimerait refaire, le théâtre. Ses pensées s’égarent sans que cela lui permette de mieux éclairer la personnalité de son collègue.
La portière de sa voiture résiste un peu : un accrochage malheureux lors d’une tentative de parking maladroite. Il avait fallu une semaine pour qu’Olivier, son mari, s’en rende compte : « Tu as accroché la portière conducteur ? Tu ne m’as rien dit ? » Non, elle n’avait rien dit, Arabelle la naïve, l’honnête, la sincère. Elle n’avait pas osé dans ce qu’elle considère encore maintenant comme un réflexe stupide de femme. Elle s’y reprend donc à deux fois pour ouvrir son véhicule et se dit que cette fois, elle n’échappera pas au passage par la case « garage », au paiement de la facture salée qui en découlera, alors que cet argent lui serait bien utile pour des projets plus plaisants.
Elle pose son sac sur le siège passager tandis que son esprit reste accroché à la portière et à travers elle à cette omission : a-t-elle déjà menti à son mari ? Rarement, des broutilles, et maintenant… Après le pneu de la voiture de Franz, c’est le volant de son véhicule qui morfle : elle le frappe des deux poings, elle crie presque « Foutue culpabilité ! » Et lorsqu’elle relève les yeux, Dimitri la fixe interloqué. Elle secoue les bras dans un geste tentant de signifier « Ce n’est rien, ne t’en fais pas… » Pourtant, ce n’est pas rien pour Arabelle. Elle aurait dû ouvrir la fenêtre de sa voiture, apostropher Dimitri : « Ne t’en fais pas, ce n’est qu’un mensonge ! » Un mensonge simple, énoncé en une phrase bien ponctuée à son mari : « Olivier, le jeudi, j’ai cours tout l’après-midi ; si tu savais reprendre Macha à la garderie après l’école… » Pourtant, sur la grille de son horaire, maculée des pavés bleus qui signalent ses heures de cours, la plage du jeudi après-midi est vierge.
En voyant l’arrière de la Dacia de Dimitri sortir de l’école, elle se demande ce qu’il en penserait ; elle le verrait bien ironiser avec Franz sur le bovarysme de leur collègue, glissant rapidement sur le graveleux du type de calèche qu’elle utilise pour s’envoyer en l’air, s’inquiétant de l’issue tragique de l’histoire… Ils se tromperaient totalement : Arabelle veut simplement jouir de ce jeudi après-midi pour être seule, sans sa fille, sans son mari, pour avoir un moment rien qu’à elle.
Une sculpture en creux dans la fresque de sa vie.
4
Marc Barbot s’est ressaisi. Ah ! une marche roborative : dilatation des vaisseaux pulmonaires, afflux sanguin, connexion des synapses. Il consulte sa montre : trente-huit minutes pour rejoindre le cimetière de Belgrade. Dans les temps, pas mal ! Et cela grimpe en plus. Il se renfrogne néanmoins : pas un lieu de balade si agréable, en fait, que cette longue chaussée à flot continu de voitures. Il pense qu’il pourrait rechercher un autre itinéraire plus champêtre, la semaine prochaine, peut-être.
Marc Barbot apprécie l’ordonnancement du cimetière, le quadrillage alphanumérique des allées : rangée B, emplacement 7 ; rangée D, emplacement 22… Madeleine est inhumée au F66. Une place libre, trouvée sans coup férir, alors qu’on lui avait dit… L’ordonnateur des pompes funèbres lui avait lancé un rapide : « Vous avez une préférence ?
— On peut en avoir ?
— Parfois certains n’apprécient pas d’être trop loin de l’entrée, ou trop près aussi d’ailleurs. »
Barbot n’en avait cure, alors l’homme avait poussé son avantage, rapidement, simplement, dans un naturel acquis à la suite d’une longue pratique : « Tiens, le F66 est libre, bien situé, ça vous va ? Signez là. »
C’était Antoine, le fils cadet, qui évidemment tout de suite avait décillé son père : F66, papa, F, sixième lettre de l’alphabet, 666, tu vois ? Et Antoine de partir de son rire discret. Barbot, pourtant, avait joué l’inquiet : « Tu sais bien que je ne crois pas à tout cela, reconnais tout de même que… »
— Papa, qui mieux que moi est placé pour t’assurer que le Très-Haut n’a rien à faire de tout cela.
Pourtant, plus tard, Marc Barbot verrait dans cette numérologie un signe parmi les nombreux qui lui avaient échappé ; le monde avait commencé à perdre sa stabilité avec cette étoile dans la vague des ovnis et, après, tout en avait découlé.
Il s’était retrouvé seul avec Madeleine quasi du jour au lendemain. L’entrée au séminaire d’Antoine était prévue de longue date, pas le départ de Jean, l’aîné, pour Singapour : « Papa, maman, imaginez-vous, une opportunité extraordinaire ! Voilà une semaine qu’on m’a fait la proposition, mais je voulais être sûr avant de vous en parler. Maintenant, je suis décidé. Un avancement, un salaire confortable aussi. Il semblerait même que j’ai le profil idéal pour la place… C’est loin, mais avec l’informatique, on pourra communiquer. Il existe même des sites gratuits pour se voir et se parler ! Il suffit d’une petite caméra. Je vous montrerai. » Marc avait bien pensé un instant récriminer face à ce qu’il jugeait comme une argumentation quasi adolescente, tout en sachant depuis longtemps qu’un jour il devrait laisser voler de ses propres ailes son fils ingénieur qu’on avait décrété, dès l’enfance, si brillant.
Alors Madeleine et lui avaient noyé leur mélancolie dans des projets d’aménagement de la maison : récupérer une chambre afin d’en faire un nouveau bureau pour Marc, aménager l’ancien en atelier de poterie pour Madeleine.
Le voyage programmé en Israël depuis plus d’une décennie eut enfin lieu.





























