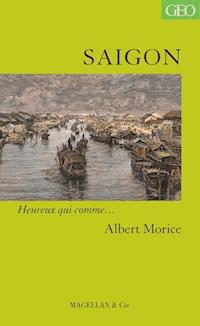
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme...
- Sprache: Französisch
À Saigon il y a beaucoup de serpents, de fourmis et de margouillats à collectionner. Sans compter les habitants de la Cochinchine que le jeune médecin passionné de zoologie voudrait bien mettre dans sa ménagerie.
Un récit décalé en pleine conquête coloniale.
Texte intégral publié dans Le Tour du Monde en 1875.
Découvrez la Cochinchine au 19ème à travers les yeux d'un colon français !
EXTRAIT
Peu de jours après notre arrivée à Hatien, le 29janvier, j’eus l’occasion d’assister à la fête du Têt ou Jour de l’an annamite. Les pratiques du culte de Bouddha et le culte des mânes des ancêtres, la crainte du diable, ou Maqui, et les bruyantes manifestations de la joie populaire s’entremêlent singulièrement pendant la célébration de cette fête. Elle dure au moins sept jours, mais les riches la prolongent plus longtemps; mon domestique me quitta, comme font à ce moment tous les indigènes au service des Européens, et je dus aller demander au fort l’hospitalité des officiers qui avaient le bonheur d’avoir un soldat pour cuisinier.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Albert Morice (1848-1877), jeune médecin affecté en Cochinchine, se découvre une passion pour la faune et la flore de la colonie, où il devient naturaliste et anthropologue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heureux qui comme…
Collection conçue et produite par Marc Wiltzen partenariat avec le magazine GÉO
MON AÏEUL EN COCHINCHINE
présenté par Michel Morice
Y aurait-il du vrai dans ces propos de sa mère ? « Il veut être médecin, écrit-elle, parce qu’il n’ose pas avouer à son père qu’il voudrait n’être rien du tout, c’est-à-dire vivre sans travailler ; mais il voudrait étudier la médecine à Lyon, non pas pour ne pas nous quitter, mais pour être plus libre, bien qu’il se plaigne sans cesse qu’on ne lui laisse point de liberté. » La crise est résolue par le parrain d’Albert, M. Bonnand, qui, à l’insu du père, prend en charge le montant des inscriptions de l’année en médecine civile. Mais, en juillet 1868, Albert Morice échoue de nouveau à l’examen de Strasbourg. Il exige de continuer à Lyon et cette fois le père paie les inscriptions, la mère les livres et Strasbourg passe aux oubliettes. En novembre 1869, il se fait offrir un remplaçant pour le service militaire. Mais survient la guerre de 1870 et le jeune homme doit servir quelques mois comme lieutenant-médecin avant de terminer ses certificats à Paris en 1871.
À travers ses écrits, il me semble déceler en lui le don du dilettante qui, sans aller jusqu’au bout de ce qu’il entreprend, sait attirer favorablement l’attention sur ses acquis, s’épargne des efforts fastidieux et change de cap selon ses désirs. Je ne sais si un ultime accrochage avec ses parents au sujet du financement de ses études l’a décidé, mais il sollicite un poste de médecin auxiliaire de la marine en faisant valoir, outre ses diplômes (baccalauréats et deux ans d’internat de médecine à Lyon), « qu’un changement de fortune l’oblige à abandonner sa vocation de chercheur ».
Sa candidature acceptée, il est affecté à Toulon le 26 janvier 1872 et embarque sur le Iéna qui y est ancré. Immédiatement, il sollicite d’être envoyé en Cochinchine. Transféré sur le Creuse, il part de Toulon le 20 mai pour arriver à Saigon le 7 juillet 1872. Affecté à l’hôpital à terre, il sera envoyé à plusieurs reprises en tournée d’inspection médicale dans le reste de la colonie. À la mi-janvier 1873, il rejoint Gocong pour trois semaines. Puis, de mars à juin inclus, il réside à Hatien d’où il part passer un mois comme médecin vaccinateur sur l’île de Phu Quoc, où quinze pour cent de la population a succombé à la variole dans les mois précédents (« j’eus le bonheur d’opérer avec du bon vaccin »). Il est alors bien placé pour observer une épidémie de dengue qui commence en mai 1873, s’étend sur tout le sud de l’Indochine en n’épargnant aucune nationalité, avant de s’éteindre en novembre. C’est cette fièvre éruptive (fièvre rouge) très peu mortelle mais très débilitante qui lui donne son sujet de thèse. Fin 1873, toute la marine est consignée et au secret à cause des événements en cours au Tonkin où Francis Garnier mène une expédition pour aider aux projets commerciaux de Dupuis avec la Chine. Puis, de février à juillet 1874, Albert se retrouve à Tay-Ninh (Paix de l’Occident) où la petite épidémie de choléra de juin n’atteint qu’un matelot annamite, qui en meurt cependant. Après ces quelques deux ans de Cochinchine, il est réembarqué le 20 septembre 1874 sur le Sarthe qui le dépose en France, déjà malade, le 4 novembre. Ce congé normal de trois mois, insuffisant pour soigner une kératite de l’œil droit (maladie qui peut laisser de larges taches opaques sur la cornée), une diarrhée de Cochinchine (sorte d’entérite souvent mortelle chez les Européens) et de l’anémie, est prolongé d’autant.
Il en profite, après accord hiérarchique, pour faire de nombreuses conférences, publier les observations diverses qu’il a faites et passer son doctorat en médecine. En fin de congé, il est affecté à Toulon, tantôt sur la Provençale, tantôt à terre. Il y réussit un concours de médecin auxiliaire de seconde classe en août 1875 et est promu « médecin entretenu de deuxième classe » le 20 novembre. Ayant essayé sans succès de se faire transférer aux Affaires indigènes, il repart pour Saigon le 19 janvier 1876 où il est à nouveau affecté à l’hôpital à terre, cette fois comme prévôt de salle, puis envoyé à nouveau en poste. Son agenda pendant l’année et demie de ce second séjour présente des incohérences : les sources le voient soit attaché au nouveau consulat de France à Quinonh, sur la côte sud d’Annam, soit de nouveau à Tay-Ninh, à l’ouest de Saigon, avec des détails contradictoires.
Outre la poursuite de ses observations sur les vies et mœurs des autochtones, des Européens et des animaux, il collecte des éléments de ruines d’un temple de l’ancien Champa (État de culture hindouiste à l’origine, qui occupait le centre du Vietnam entre le IIe et le XVIIe siècle) qu’il destine au musée de Lyon. Ses supérieurs le jugent « digne, studieux, discipliné, très doux… » mais lui reprochent à la longue ses curiosités extra-professionnelles : « Se repose de ses travaux professionnels en étudiant avec fruit la zoologie… » ; « néglige peut-être un peu les études professionnelles pour se livrer à la zoologie… » ; « les médecins de la marine ne viennent pas en Cochinchine pour faire des collections et j’apprécie fort peu ceux qui considèrent comme secondaires les devoirs qui leur sont imposés… » Bref, il commence vraiment à agacer le vice-amiral quand, ajoutant au délabrement devenu chronique de ses intestins et à ses problèmes de vision, il est rattrapé par la tuberculose dont il a dû être atteint déjà enfant. Après avoir à nouveau essayé sans succès d’être transféré aux Affaires indigènes, il demande le 7 juillet 1877 son affectation à Cherbourg après la fin de son séjour prévue pour le 20 janvier suivant. Mais, rapatrié sanitaire d’urgence quelques semaines plus tard, il meurt à Toulon le 19 octobre 1877, moins d’un mois après son arrivée en France.
Mise à part la médaille de bronze que la faculté de médecine de Paris lui aurait décernée pour sa thèse de doctorat soutenue le 25 juin 1875, la seule autre distinction que je lui connaisse est la Médaille commémorative accordée à l’Exposition universelle de 1878 au titre de l’anthropologie. Une lettre du 7 décembre 1881 le somme de venir la retirer sous peine d’annulation – trop tard !
Quoique sa sœur nous dise qu’il est souvent amoureux, il n’a ni compagne ni descendance connues. Pourtant, chercheur et expérimentateur, il dit des métis français/annamites : « Les enfants… sont fort gentils ; le nez… ; les yeux… ; le teint… Il y aurait peut-être là un moyen de colonisation qui, bien dirigé, pourrait avoir d’heureuses conséquences » ! Il observe par ailleurs qu’en Cochinchine « la sécrétion du sperme paraît activée, soit à cause de l’inaction forcée qu’impose le climat et de la position horizontale que l’on garde près de douze heures sur vingt-quatre, soit à cause de la trop grande ardeur avec laquelle on recherche les distractions génésiques, et de la facilité que l’on a à les satisfaire. »
Au physique, n’ayant pas de photo, on ne peut que s’en remettre à la description que fait de lui un de ses amis vers 1869 : « Don Quichotte et Méphistophélès : on pourrait le caricaturer sous ces deux formes. Mais au moral c’est surtout don Quichotte. La dignité, qu’il porte dans les traits de son visage et de ses vêtements, ne l’abandonne jamais ; c’est plein de majesté qu’il s’en va combattre les moulins à vent, et qu’il s’indigne des rires du Sancho Pansa qui l’escorte. »
***
Publié dans Le Tour du Monde en 1875, le Voyage en Cochinchine d’Albert Morice relate son périple de juillet 1872 à septembre 1874. Le jeune homme arrive à Saigon le 7 juillet 1872, âgé de vingt-trois ans, après une traversée de quarante-cinq jours. Il séjourne pendant trois mois à Saigon, d’où il fait des excursions à l’hôpital de Choquan avec des collègues médecins, puis à Cholon (quartier chinois, situé jadis à l’écart de la ville), avant de commencer un périple de sept mois de « pérégrinations à travers l’Indochine », marquées par des captures de serpents, pour lesquels il a une tendresse particulière. Car le jeune médecin se rêve zoologue et néglige la médecine au profit de sa passion pour les reptiles et les coléoptères.
Bientôt, écrit-il, « grâce à la riche faune de cette partie de la Cochinchine, je parvins à transformer ma case en une véritable ménagerie. » Collectionneur acharné, il surcharge les musées d’Histoire naturelle de Lyon et de Paris d’insectes et d’autres animaux. Cette collection vivante donne lieu à un inventaire extraordinaire et peu scientifique : une macaque, des « genres de cerfs », un singe multicolore, un petit singe « enfant gâté », une civette pour le Jardin des Plantes, des serpents d’eau, un mini crocodile, des tortues d’eau douce, des cigognes, un jeune ours des cocotiers qui sera transporté en France, des pangolins, un chat à queue recourbée… Passons sur l’inventaire des araignées et des fourmis qui ne manquera pas de séduire l’amateur d’exotisme.
La zoologie offre cependant d’excellentes occasions de rencontrer les indigènes et, inversement, l’hospitalité réservée aux indigènes lui permet de peaufiner sa collection : « Grâce au bon accueil que je leur fais, ma case est décidément devenue le rendez-vous de tous les chasseurs du pays ; ils prennent la douce habitude de venir y boire le matin, en revenant du marché, leur verre d’absinthe ou leur tasse de thé. Cette sorte de cour plénière que je tiens m’apprend beaucoup à connaître ces races, leurs mœurs et leurs langues, et j’ai habitué tous ces braves gens à m’apporter des reptiles, des mammifères, etc. » Clichés et racisme se mêlent alors sans surprise dans l’esprit de l’ethnologue improvisé qui ne manque pas de cette ironie condescendante si commune à l’époque. Il observe l’indigène avec une telle distance qu’on se demande s’il le prend vraiment pour un être humain. Du reste, le style naturaliste hérité du XVIIIe siècle dont il s’inspire pour décrire les mœurs a été tourné en dérision au XXe siècle par Henri Michaux dans Un Barbare en Asie (1933) et dans Ailleurs (1948) qui parodie des propos comme : « Lorsqu’on chasse, dit-on, il est prudent d’avoir un indigène avec soi ; si le tigre vous rencontre ; il préférera l’indigène. » Aujourd’hui, ce regard soulève toujours la question : qui est le plus barbare de celui qui est décrit ou de celui qui décrit ?
Véritable dilettante à l’âme de collectionneur, Albert Morice passe pour avoir découvert l’art cham. En 1876, au cours d’une de ses tournées dans le centre du Vietnam, il rapporte une collection d’une quarantaine de sculptures en grès qui ont fait partie de la décoration des kalan, les grandes tours de brique des sanctuaires cham du Binh Dinh (ancien royaume du Champa, du IIe siècle à la fin du XVIIe siècle), pillés et abandonnés depuis l’invasion des Vietnamiens en 1471. L’art cham est alors inconnu en France. Morice envoie une partie de sa collection en deux cargaisons séparées. L’une d’elles, consistant en vingt-deux caisses adressées au museum d’Histoire naturelle de Lyon, se perd dans le naufrage du vapeur Meï-Kong des Messageries maritimes, à quelques milles au sud du cap Guardafui, le 17 juin 1877. Les Somalis pillent la cargaison du Meï-Kong mais épargnent la cave à liqueurs et les sculptures de pierre. Le GRASP, sous l’égide de l’Autorité du Nord-Est de la République de Somalie, organisait en 1995 une expédition de recherche et de fouilles durant laquelle, en deux mois, la quasi-totalité des sculptures et des fragments fut récupérée et ramenée en Europe. On a reconnu depuis l’importance de la collection du docteur Morice dans la connaissance des styles vietnamiens et ouvert de nouvelles perspectives de recherches.
Ce riche récit, d’un jeune homme qui a payé de sa vie sa passion et sa curiosité pour l’ailleurs, illustre le Saigon colonial et les paysages de la Cochinchine avec humanité.
Texte intégral publié dans Le Tour du monde en 1875
SAIGON
I
Arrivée à Saigon. Les sampans. Les malabars. Achat d’un salaco. Débarquement par les coolies. Le panca.Effets du climat. Les mendiants annamites.
Il était neuf heures et demie du matin, lorsque, le 6 juillet 1872, le transport de l’État la Creuse arrêta son hélice et jeta son ancre en rade de Saigon. L’immense vapeur fut immédiatement entouré de sampans, petites barques annamites qui rappellent les gondoles vénitiennes, avec leur roufle placé au milieu et leurs rameurs qui nagent debout. Presque aussitôt, une foule d’officiers et de négociants inonda le pont et la dunette. Pour moi, qui savais n’avoir là aucun visage ami à chercher, je contemplai le paysage en attendant l’heure de descendre à terre.
Le ciel était semé d’énormes nuages à bords cuivrés entre lesquels passaient les brûlants rayons d’un soleil plus implacable encore que celui de Singapour ; le fleuve était en ce point si large et si majestueusement ample qu’il méritait bien ce nom de rade que l’on s’accorde à lui donner. Une foule d’embarcations de tous ordres, à rames, à voile, à vapeur, se pressaient sur les bords ; quelques bateaux de commerce, dont deux anglais, chauffaient en ce moment, et, dans le lointain, j’apercevais le Fleurus, vaisseau stationnaire d’où se tirent les coups de canon quotidiens qui annoncent le commencement, le milieu et la fin du jour.
Quant aux rives, celle de droite était couverte de fort petites cases en torchis et en paillote, qui pour la plupart trempaient à moitié dans le Donaï; sur la gauche s’étalait Saigon (et non pas Saïgon, comme on s’obstine encore à l’appeler en France). Le grand Cosmopolitan Hotel ou Maison Vantaï montrait avec orgueil, sur les bords mêmes du quai, sa large façade à trois étages ; les tamariniers de la rue Catinat et des diverses artères de la ville dressaient leurs larges têtes verdoyantes régulièrement échelonnées ; et ces voitures nombreuses, mais peu confortables, qu’on appelle malabars, attendaient les proies multiples qui allaient leur être livrées.
Vers onze heures, je pus descendre, laissant mes bagages prendre avec ceux de l’État le chemin des docks de la Marine, et je touchai enfin du pied cette terre rouge et poussiéreuse qui caractérise les rues de Saigon.
Bien que novice dans la colonie, j’avais recueilli assez de renseignements pour savoir que je devais avant toutes choses me diriger vers un de ces innombrables marchands asiatiques dont les échoppes bordent une partie des rues basses de la ville, afin d’y faire l’emplette d’un salaco. Le salaco est le chapeau des tropiques ; il partage avec le casque en moelle d’aloès, ou pour mieux dire en tige de saja (cây diên diên des Annamites), que les Anglais de l’Inde appellent solatopi, la fonction de garantir les crânes des Européens des trop ardents baisers du soleil. Il est vrai qu’il est disgracieux et quelque peu lourd, mais on se fait assez vite à cette étrange coiffure, sous le dôme blanc de laquelle on peut braver les insolations. Figurez-vous en effet un objet arrondi, mince, concave d’un côté, convexe de l’autre, et réuni par trois montants à une couronne inférieure, de rayon beaucoup plus petit. L’honorable marchand chinois, qui répondait au nom harmonieux d’Atak, m’eut bientôt trouvé ce qu’il me fallait, et, renfonçant dans ma poche le feutre qui ne devait plus me servir qu’aux heures trop courtes du soir, je me hâtai d’entrer dans le premier hôtel qui se rencontra sur ma route.
Une véranda assez propre, au-dessus de laquelle se lisait le nom orgueilleux de ce caravansérail: Hôtel de l’Univers, me conduisit dans une pièce servant de café, où étaient installés quelques Européens. Ayant déjeuné à bord, et d’ailleurs fatigué, je ne songeais qu’aux ablutions nécessaires et au repos : une chambre me fut octroyée et, sous les rideaux d’une moustiquaire assez ample, mais hélas ! percée de trous nombreux, je reposai pour la première fois à terre mes membres quelque peu endoloris par une traversée de quarante-cinq jours.
Je me réveillai vers trois heures, et après une douche bienfaisante j’allai chercher mes bagages. Deux grands coolies chinois, nus jusqu’à la ceinture, coiffés de gigantesques et épais chapeaux de paille en clocheton et portant sur l’épaule le solide bambou traditionnel, s’élancèrent sur mes traces et s’emparèrent de mes caisses avec une très grande rapidité, non sans se crier quelques phrases de ce langage brusque et monosyllabique qui déplaît d’abord assez aux oreilles européennes. Ils attachèrent les colis au centre de leur longue perche, à chaque extrémité de laquelle ils se placèrent ensuite, et, la soulevant de leurs épaules rougies, ils se remirent en marche avec le balancement qui leur est particulier.
Cette importante affaire terminée, je m’acheminai vers la salle du festin. Une quantité de petites tables, et au-dessus d’elles deux rangées parallèles de pancas, ce fut tout ce que je vis d’abord. Le panca ou punkah





























