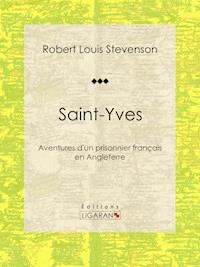
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'était au mois de mai 1813 que j'avais eu le malheur de tomber aux mains des Anglais. Ma connaissance de la langue anglaise, — j'avais appris cette langue dès l'enfance et la parlais presque aussi aisément que le français, — m'avait valu d'être choisi par mon colonel pour certaine besogne des plus délicates."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055542
©Ligaran 2015
C’était au mois de mai 1813 que j’avais eu le malheur de tomber aux mains des Anglais. Ma connaissance de la langue anglaise, – j’avais appris cette langue dès l’enfance et la parlais presque aussi aisément que le français, – m’avait valu d’être choisi par mon colonel pour certaine besogne des plus délicates. Un soldat doit toujours suivre sa consigne, quels qu’en soient les risques ; mais le risque de cette consigne-là consistait, pour moi, à être pendu comme espion, ce qui n’est jamais une perspective bien agréable : de telle sorte que je m’estimai heureux, quand je fus pris, de me voir simplement traité en prisonnier de guerre. On me transporta d’Espagne en Écosse, et je fus enfermé dans l’ancien château d’Édimbourg, qui – peut-être mon lecteur ne l’ignore-t-il pas ? – se dresse au milieu de cette ville, sur la pointe d’un rocher fort extraordinaire.
J’avais là pour compagnons plusieurs centaines de pauvres diables, tous simples soldats comme moi, et dont la plupart se trouvaient être des paysans ignorants et peu dégrossis. Ma connaissance de la langue anglaise, qui m’avait conduit à cette fâcheuse position, m’aidait maintenant beaucoup à la supporter. Elle me procurait mille petits avantages. Souvent on m’appelait pour servir d’interprète, soit que l’on eût des ordres à donner aux prisonniers, ou que ceux-ci eussent à faire quelque réclamation ; et ainsi j’entrais en rapports, parfois même assez familiers, avec les officiers anglais chargés, de nous garder. Un jeune lieutenant avait daigné me choisir pour être son adversaire aux échecs ; j’étais particulièrement habile à ce jeu, et m’arrangeais si galamment pour perdre la partie que le petit lieutenant m’offrait, en récompense, d’excellents cigares. Le major du bataillon prenait de moi des leçons de français pendant son déjeuner, et parfois il poussait la condescendance jusqu’à me permettre de partager son repas. Ce major s’appelait Chevenix. Il était raide comme un tambour-major, et égoïste comme un Anglais, mais c’était un homme d’honneur. Sans pouvoir me résoudre à l’aimer, je me fiais à lui ; et, pour insignifiante que la chose puisse sembler, j’étais fort heureux de pouvoir, à l’occasion, plonger mes doigts dans sa tabatière d’écaille, où une fève achevait de donner un goût délicieux à du tabac d’Espagne de première qualité.
Nous étions, en somme, une troupe de prisonniers d’assez peu d’apparence. Tous les officiers français pris avec nous avaient obtenu leur liberté, moyennant leur parole d’honneur de ne pas sortir d’Édimbourg. Ils vivaient pour la plupart dans la ville basse, logés chez l’habitant ; et ils s’ennuyaient de leur mieux, supportant le plus philosophiquement qu’ils pouvaient les mauvaises nouvelles qui leur arrivaient, à présent presque sans arrêt, d’Espagne et d’Allemagne. Parmi les prisonniers du château, je me trouvais par hasard le seul gentilhomme. Bon nombre d’entre nous étaient des Italiens, d’un régiment qui avait subi de grosses pertes en Catalogne. Le reste étaient des laboureurs, des vignerons, des bûcherons, qui s’étaient vus soudainement, – et violemment, – promus au glorieux état de soldats de l’empereur.
Nous n’avions qu’un seul intérêt qui nous fût commun. Tous ceux d’entre nous qui possédaient quelque adresse de doigts employaient les heures de leur captivité à confectionner de petits jouets, – que nous appelions des articles de Paris, – pour les vendre ensuite à nos visiteurs. Car notre prison était envahie tous les jours, dans l’après-midi, par une foule de gens de la ville et de la campagne, venus pour exulter de notre détresse, ou encore, – à juger les choses avec plus d’indulgence, – du triomphe accidentel de leur propre nation. Quelques-uns se comportaient parmi nous avec une certaine apparence de pitié ou de sympathie. D’autres, au contraire, étaient bien les personnages les plus impertinents du monde ; ils nous examinaient comme si nous avions été des babouins, cherchaient à nous convertir à leur religion, comme si nous avions été des sauvages, ou bien nous torturaient en nous criant les désastres des armes françaises. Mais, bons, méchants, ou indifférents, il y avait une compensation à l’ennui que nous causaient ces visiteurs : car presque tous avaient l’habitude de nous acheter un échantillon de notre savoir-faire.
Cette coutume avait même fini par provoquer chez nous un certain esprit de compétition. Quelques-uns d’entre nous avaient la main habile, et parvenaient à mettre sur le marché des petits prodiges de dextérité, comme aussi de bon goût, – car le génie du Français est toujours distingué. D’autres, à défaut de talent, avaient une apparence extérieure plus engageante ; une jolie figure servait presque autant que de belles marchandises, au point de vue de notre commerce ; et un air de jeunesse, en particulier, avait de grandes chances de provoquer chez nos visiteurs un mouvement d’attention des plus lucratifs. D’autres, enfin, avaient appris un peu d’anglais, ce qui leur permettait de recommander aux acheteurs les menus objets qu’ils avaient à vendre. De ces trois avantages, le premier me manquait tout à fait ; tous mes doigts étaient malhabiles et lourds comme des pouces. Mais je m’efforçais d’autant plus de tirer parti des deux autres avantages. Aussi bien n’avais-je jamais dédaigné les arts de société, où il n’y a point de Français qui ne se pique d’exceller. Suivant l’espèce des visiteurs, j’avais une manière spéciale non seulement de parler, mais même de me tenir ; et j’avais fini par savoir passer d’une de ces manières à l’autre sans ombre d’embarras. Voilà comment, tout maladroit que je fusse en tant que faiseur de jouets, j’avais réussi à devenir un des marchands les plus achalandés : ce qui me fournissait le moyen de me procurer maintes de ces petites douceurs qui font la joie des enfants et des prisonniers.
Le plus gros de mes ennuis, en vérité, me venait du costume dont on nous affublait. C’est une horrible habitude qu’on a, en Angleterre, de revêtir d’uniformes ridicules, comme pour les déprécier en masse, non seulement les forçats, mais les prisonniers de guerre, et même les enfants des asiles publics. On ne saurait imaginer rien de plus grotesque, en tout cas, que la livrée que nous étions condamnés à porter : jaquette, gilet et pantalon mi-partie de deux nuances différentes de jaunes, – l’une soufre et l’autre moutarde, – avec une chemise de coton à raies bleues et blanches. C’était voyant, c’était laid, cela nous signalait à la risée publique, comme une troupe de pitres devant une baraque de foire, – nous qui étions de vieux soldats, et dont quelques-uns avaient à montrer de nobles cicatrices ! J’ai appris, depuis, que le rocher sur lequel était notre prison s’était appelé autrefois la Colline peinte. Elle était peinte en effet, peinte en jaune, pendant que nous y étions ; et l’uniforme rouge des soldats qui nous gardaient se mêlait à notre livrée de prisonniers pour produire un singulier mélange des deux teintes qui sont, à ce qu’on assure, la couleur du diable. Souvent je regardais mes compagnons de captivité, et je sentais se soulever ma colère à voir ces braves ainsi parodiés. Et puis je me voyais moi-même, en imagination, et je rougissais de honte. Il me semblait que mon port le plus élégant ne pouvait que mieux accentuer l’insulte d’un pareil travesti. Je me rappelais les jours où je portais le simple, mais glorieux uniforme du soldat ; et je me rappelais aussi, remontant plus haut dans le passé, combien de soins avaient pris, pour former mon enfance, de nobles, belles, gracieuses créatures… Mais je ne veux point évoquer deux fois ces tendres et cruels souvenirs ; ils auront leur place plus loin, et c’est d’autre chose que j’ai à m’occuper ici. La perfidie du gouvernement anglais ne s’avouait nulle part plus à découvert que dans cette livrée qu’on nous imposait. Ou plutôt, je me trompe ; il y avait un des détails de notre régime où cette perfidie éclatait mieux encore : on nous interdisait de nous faire raser plus de deux fois par semaine ! Pour des hommes qui ont aimé toute leur vie à être rasés de frais, peut-on imaginer un affront plus irritant ? Le lundi et le jeudi étaient les jours, où l’on nous rasait. Représentez-vous, dans ces conditions, l’aspect que je devais offrir le dimanche soir ! Représentez-vous la mine que je devais avoir dès le samedi ! Et c’était précisément le samedi qui était le grand jour pour nos visiteurs.
Ceux qui venaient nous voir étaient de toutes qualités, hommes et femmes, gras et maigres, laids et plus jolis. Ces derniers, à dire vrai, n’étaient point fréquents ; et cependant, assis dans mon coin et tout honteux de mon apparence grotesque, mainte fois j’ai goûté le plaisir le plus fin, le plus rare, et le plus délicieux, en apercevant à la dérobée une paire d’yeux que je ne devais plus jamais revoir, – que j’espérais bien ne plus jamais revoir, accoutré en arlequin comme je l’étais. Le privilège de voir une jolie femme est, avec celui de verser son sang pour sa patrie, la chose qu’un cœur de soldat français mettra toujours le plus haut.
Il y avait notamment, parmi nos visiteurs, une jeune dame d’environ dix-huit ou dix-neuf ans, grande, élancée, d’un port admirable, et avec une profusion de cheveux que le soleil changeait en de vrais fils d’or. Aussitôt qu’elle entrait dans notre cour, – et elle y venait assez souvent, – c’était comme si un instinct m’en eût averti. Elle avait un air de candeur angélique, mais on la devinait d’âme fière et haute. Elle s’avançait comme Diane même ; chacun de ses mouvements avait une noblesse pleine d’aisance.
Un jour, le vent d’est soufflait plus encore qu’à l’ordinaire. Le drapeau se collait contre sa hampe, sur le toit de notre prison ; au-dessous de nous, la fumée des cheminées de la ville se répandait, çà et là, en mille variations fantastiques ; et plus loin, sur le Forth, nous pouvions voir les bateaux fuyant vent arrière. J’étais en train de maudire cet insupportable temps, lorsque soudain elle apparut. Ses cheveux s’éparpillaient au vent avec toute sorte de nuances délicates ; ses vêtements moulaient la grâce juvénile de son corps ; les bouts de son châle lui caressaient les oreilles et retombaient sur sa poitrine avec une gentillesse inimitable. Avez-vous vu une pièce d’eau par un jour de bourrasque, lorsqu’elle se met tout à coup à étinceler et à frémir comme une chose vivante ? De même le visage de la jeune dame s’était tout à coup animé de colère ; et à la voir ainsi debout, légèrement inclinée, ses lèvres entrouvertes, un trouble charmant dans ses yeux, volontiers j’aurais battu des mains pour l’applaudir, volontiers j’aurais acclamé en elle une vraie fille des vents de son pays. Ce qui me décida, je l’ignore ; peut-être était-ce simplement le fait que ce jour-là était un jeudi, et que j’avais été rasé le matin ; mais je résolus d’attirer sur moi l’attention de la belle inconnue, et pas plus tard que ce même jour.
Elle s’approchait de l’endroit où j’étais assis avec ma marchandise, lorsque je vis que son mouchoir s’échappait de ses mains ; dès l’instant d’après, le vent l’avait emporté et poussé jusque près de moi. Aussitôt me voilà sur pied. J’oublie ma livrée jaune, j’oublie le soldat prisonnier et son obligation du salut militaire. Avec une profonde révérence, je présente à la jeune femme le mouchoir de dentelles.
« Madame, dis-je, voici votre mouchoir ! Le vent me l’a apporté. »
Mes yeux se rencontrèrent tout droit avec les siens.
« Je vous remercie, monsieur ! dit-elle.
– Le vent me l’a apporté, répétais-je. Ne puis-je pas prendre cela pour un présage ? Vous avez un proverbe anglais qui assure “qu’il n’y a si mauvais vent qui n’apporte à quelqu’un quelque chose de bon”.
– Eh bien ! dit-elle avec un sourire, un bon service en appelle un autre. Montrez-moi ce que vous avez là ! »
Et elle me suivit à l’endroit où, sous l’abri d’une pièce de canon, j’avais étalé mes pauvres denrées.
« Hélas ! mademoiselle, dis-je, je ne suis guère un bon artisan. Ceci est censé être une maison ; mais, comme vous voyez, les cheminées sont un peu de travers. Et ceci, avec beaucoup d’indulgence, vous pouvez l’appeler une boîte ; mais j’aurais dû pouvoir la faire un peu plus d’aplomb ! Oui, je crains que vous ayez beau aller d’un de ces objets à l’autre : il n’y en a pas un qui n’ait son défaut. Défauts à vendre, telle devrait être mon enseigne ! »
Je lui désignai du doigt mon étalage, en souriant ; puis je relevai les yeux sur elle, et aussitôt je redevins grave.
« Étrange chose, ajoutai-je, qu’un homme adulte, et un soldat, ait à se livrer à un tel travail, n’est-ce pas ? et qu’un cœur plein de tristesse se trouve condamné à produire des objets si comiques ? »
Au même instant une voix déplaisante appela ma visiteuse par son nom, qui était Flora ; la jeune femme se hâta de m’acheter le premier objet venu, et rejoignit ses compagnons.
Quelques jours plus tard, elle revint de nouveau. Mais il faut d’abord que je vous explique pourquoi ses visites avaient lieu aussi souvent. C’est que sa tante, avec qui elle vivait, était une de ces terribles vieilles filles anglaises dont le monde entier a déjà beaucoup entendu parler. N’ayant absolument rien à faire, et sachant un mot ou deux de français, la vieille tante s’était prise de ce qu’elle nommait « un vif intérêt pour les prisonniers ». Grosse, bruyante, hardie, elle se pavanait dans notre cour avec d’intolérables airs de patronage et de condescendance. Je dois à la vérité de dire qu’elle achetait souvent, et sans marchander ; mais sa façon de nous dévisager à travers son lorgnon, sa façon de servir de cicérone à ses relations, tout cela nous dispensait de reconnaissance pour elle. Toujours, en effet, elle traînait à sa suite un cortège de vieux messieurs pesants et obséquieux, ou de sottes jeunes miss qui ricanaient en minaudant ; et l’on voyait qu’elle s’était constituée l’oracle de tout son auditoire. « Celui-ci, disait-elle de l’un de nous, sait vraiment découper le bois avec assez d’adresse ; et comme il est drôle, n’est-ce pas ? avec sa grosse moustache ! Et celui-ci, poursuivait-elle en me désignant avec son lorgnon d’argent, celui-ci est, sans aucun doute, le plus drôle de la bande ! »
Le jour en question, la tante était venue avec une suite encore plus nombreuse que de coutume ; et elle la promena de long en large, parmi nous, plus longtemps encore qu’à l’ordinaire, en lui faisant la leçon à notre sujet d’une façon particulièrement impertinente. Pendant tout cet examen, je tins les yeux fixés dans une même direction, mais vainement. La tante allait de l’un à l’autre, nous forçait à venir vers elle, nous montrait comme des singes en cage ; mais la nièce restait à l’extrémité du groupe, du côté, opposé de la cour, et ne fit pas mine de s’apercevoir de ma présence, jusqu’à l’instant où, enfin, elle repartit avec ses amis. Si étroitement que je l’eusse observée, je ne pouvais pas dire que ses yeux se fussent, une seule fois, arrêtés sur moi ; et mon cœur en était inondé d’amertume. J’essayais d’effacer de moi son image détestée ; je sentais que jamais plus je n’existerais pour elle ; je riais de la folle illusion que j’avais eue d’avoir de quoi lui plaire. La nuit, quand je m’étendis sur mon lit, je ne pus m’endormir ; je me tournais et me retournais, dépréciant ses charmes, déplorant et maudissant son insensibilité. Quelle grossière créature elle était ! et quel sexe grossier ! Un homme aurait beau ressembler à Apollon, c’était assez qu’il fût vêtu de jaune mi-partie pour que pas une femme ne s’avisât de ses mérites ! J’étais un prisonnier, un esclave, un être méprisé et méprisable, un objet de moquerie, pour elle aussi bien que pour le reste de ses compatriotes ! Soit, du moins je saurais profiter de la leçon ! Aucune autre orgueilleuse fille de la race ennemie n’aurait désormais le droit de pouvoir imaginer que je l’eusse regardée avec admiration ! En un mot, vous ne sauriez concevoir un homme d’humeur plus résolue et plus indépendante que je le fus, durant toute cette nuit. Avant de m’endormir, à l’aube, j’avais évoqué dans ma pensée toutes les infamies d’Albion, et je les avais toutes débitées au compte de Flora.
Le lendemain, comme j’étais assis de nouveau près du canon, j’eus soudain conscience que quelqu’un était debout devant moi ; et, en vérité, c’était elle ! Je restai assis, d’abord par confusion, puis par politique ; et elle, debout, elle se penchait un peu vers moi, évidemment par pitié. Elle était douce et timide, et parlait d’une voix infiniment douce. Elle me demandait si j’avais à souffrir du ma captivité, s’il y avait quelque mauvais traitement dont j’eusse à me plaindre.
« Mademoiselle, répondis-je, on ne m’a jamais appris à me plaindre. Je suis un soldat de Napoléon ! »
Elle soupira.
« Du moins vous ne pouvez manquer de regretter la France ! dit-elle ; et elle rougit un peu comme honteuse de ne pouvoir pas mieux prononcer ce mot.
– Que vous dirai-je à cela, mademoiselle ? Si vous vous trouviez brusquement transportée loin de ce pays, où vous semblez être si parfaitement adaptée que les pluies mêmes et les bourrasques vous siéent comme autant d’ornements, n’auriez-vous point l’âme toute pleine de regrets ? L’enfant regrette sa mère, quand il en est séparé ; l’homme regrette sa patrie : c’est notre nature qui le veut ainsi !
– Vous avez une mère ? demanda-t-elle.
– Au ciel, madame ! répondis-je. Ma mère, et mon père aussi, sont montés au ciel par le même chemin que bien d’autres, parmi les plus beaux et les meilleurs de notre race : ils ont suivi leur souverain à la guillotine. De telle sorte que, comme vous voyez, je ne mérite pas autant votre pitié que bon nombre de mes camarades, à commencer par le pauvre garçon que vous apercevez là-bas, en bonnet de drap. Son lit est dans la même chambrée que le mien, et souvent, la nuit, je l’entends soupirer. C’est l’âme la plus tendre et la plus gentille du monde. La nuit, et parfois aussi le jour, quand il peut se trouver seul avec moi, il se lamente devant moi de l’absence de sa mère et de sa fiancée. Et devineriez-vous ce qui l’a amené à faire de moi son confident ? »
Les lèvres de la jeune fille se desserrèrent, mais elle ne dit rien. Elle se borna à me regarder, et son regard s’enflamma tout entier de tendre pitié.
« Eh bien ! dis-je, c’est que, un jour, en passant avec mon régiment, j’ai entrevu de loin le clocher de son village ! N’y a-t-il point là de quoi vous toucher ? Mais, en cela, du moins, mon compagnon est plus heureux que moi, qui n’ai même personne pour parler avec moi de lieux dont me voici, sans doute, à jamais séparé ! »
Je reposai mon menton sur mon genou, et baissai les yeux.
« Tenez, me dit tout à coup la jeune fille, je vous prends cette boîte ! »
Elle me mit dans la main une pièce de cinq shillings, et s’enfuit avant que j’eusse le temps de la remercier.
Je me retirai à l’écart, laissant mon étalage à la garde de mon voisin. La beauté de la jeune fille, l’expression de ses yeux, une larme que j’y avais vu trembler, l’accent de compassion dans sa voix, une sorte d’élégance sauvage que relevait encore la liberté de ses mouvements, tout cela se combinait pour captiver mon imagination et pour enflammer mon cœur. Que m’avait-elle dit ? Rien de particulier ; mais ses yeux avaient rencontré les miens, et je sentais que le feu qu’ils y avaient allumé ne cesserait point de brûler dans mes veines. Je l’aimais ; je l’aimais si fort que je ne craignais même pas d’espérer ! Deux fois je lui avais parlé ; et, les deux fois, j’avais été heureusement inspiré, j’avais su gagner sa sympathie, j’avais trouvé des paroles que j’étais sûr qu’elle n’oublierait pas. Qu’importait que je fusse mal rasé, et accoutré d’un costume grotesque ? J’avais l’impression que l’amour, seul maître du monde, me favorisait. Je fermai les yeux, et aussitôt la voici qui surgit, sur le fond de ténèbres, plus belle encore que dans la vie. « Ah ! bien-aimée, pensai-je, je veux que, toi aussi, tu emportes dans ton cœur une image que tu reverras sans cesse ! Dans l’obscurité de la nuit, le jour en passant par les rues, je veux que tu aies devant toi ma voix et mon visage, te murmurant mon amour, conquérant ton cœur dédaigneux ! » Et alors je me revis soudain moi-même, avec mon déguisement d’arlequin ; et j’éclatai de rire.
Comme c’était vraisemblable, en vérité, qu’un mendiant, un simple soldat, un prisonnier ainsi travesti, réussît à éveiller l’intérêt de cette belle jeune fille ! J’étais résolu à ne point désespérer ; mais je compris que le jeu gagnerait à être mené habilement. Aussi bien ma situation de prisonnier me laissait-elle tous les loisirs nécessaires pour bien méditer ma partie. Je me mis à tailler, dans un morceau de bois, une figure qui, au moins dans mon intention, devait représenter l’emblème de l’Écosse, le Lion Rampant. J’employai à cet ouvrage toute l’adresse dont j’étais capable, et quand enfin je vis que je ne pouvais, plus rien y parfaire, j’inscrivis, sous le lion, la dédicace que voici :
À L’AIMABLE FLORA
Le prisonnier reconnaissant.
A.D. ST-Y.D.K.
Mon chef-d’œuvre achevé, rien ne me restait plus qu’à attendre et à espérer. Malheureusement l’attente est, de toutes les vertus, celle dont ma nature s’accommode le moins : en amour comme à la guerre, je suis toujours pour agir de suite ; et ces journées d’attente furent mon purgatoire. Chaque soir, je m’apercevais que j’aimais Flora beaucoup plus que la veille ; et voilà que, en outre, je commençais à être pris d’une frayeur folle. Qu’allais-je devenir, si je ne la revoyais plus ? Comment retomberais-je jusqu’à m’intéresser aux leçons du major, aux échecs du lieutenant, à la vente d’un jouet de deux sous sur notre marché ?
Cependant les jours passaient, et les semaines. Je n’avais, point, le courage de les compter ; aujourd’hui encore je n’ai pas le courage de me les rappeler. Mais enfin, un jour, ma bien-aimée revint. Enfin, je la vis s’approcher de moi, accompagnée d’un garçon un peu plus jeune qu’elle, et en qui je devinai aussitôt son frère.
Je me levai, et, sans rien dire, je la saluai le plus galamment que je pus.
« Voici mon frère, M. Ronald Gilchrist ! dit-elle. Je lui ai raconté vos souffrances. Il vous plaint comme moi !
– C’est plus que je n’ai le droit d’exiger, répondis-je ; mais de tels sentiments sont naturels entre honnêtes gens. Si votre frère et moi nous nous rencontrions sur un champ de bataille, nous n’aurions de pensée que pour nous couper la gorge ; mais, aujourd’hui, il me voit désarmé et malheureux, et il oublie son animosité. (Sur quoi, comme d’ailleurs je dois dire que j’avais eu la présomption de m’y attendre, le héros imberbe rougit jusqu’aux oreilles, de plaisir.) Ah ! ma chère jeune dame, poursuivis-je, vous m’avez donné une aumône, l’autre jour, et plus qu’une aumône, l’espérance de votre incomparable et précieuse amitié. Aussi, pendant que vous étiez absente, ne vous ai-je pas oubliée ! Souffrez que je puisse me dire à moi-même que j’ai essayé tout ce qui dépendait de moi pour vous remercier ; et, par compassion pour le prisonnier, daignez accepter cette bagatelle ! »
Ce que disant, je lui présentai mon lion. Elle le prit, le regarda avec embarras ; puis apercevant la dédicace, elle poussa un petit cri :
« Comment avez-vous pu savoir mon nom ? fit-elle.
– Lorsque des noms sont aussi appropriés à leur objet que celui-là, on n’a point de peine à les deviner ! répondis-je avec un grand salut. Mais, au vrai, il n’y a pas eu de magie dans l’affaire. Une dame vous a appelée par ce nom, le jour où j’ai ramassé votre mouchoir : je me suis empressé de le retenir et de le chérir !
– Ce lion est très, très beau, dit-elle, et je serai toujours fière de l’inscription. Venez, Ronald, il est temps de rentrer ! »
Elle me salua comme une dame salue son égal, et elle s’en alla, avec (du moins je l’aurais juré) plus de couleur sur les joues qu’à son arrivée.
J’étais ravi. Mon innocente ruse avait porté ; Flora avait pris mon cadeau sans l’ombre d’une idée de paiement ! Et je songeais que, désormais, j’aurais un ambassadeur en permanence à la cour de ma dame. Le lion avait beau être mal dessiné : il venait de moi. C’étaient mes mains qui l’avaient gravé ; c’était mon ongle qui avait tracé la dédicace ; et, pour simples qu’en fussent les mots, ils ne cesseraient plus de répéter à Flora que je lui étais reconnaissant, que je la trouvais infiniment aimable. Quant au frère, il semblait un peu niais, et rougissait au moindre compliment ; j’avais pu voir, en outre, qu’il me considérait avec quelque méfiance ; mais, en fin de compte, il avait une si bonne figure de garçon que je ne pouvais m’empêcher d’éprouver pour lui de la sympathie. Et, quant au sentiment qui avait poussé sa sœur à me l’amener et à me le présenter, jamais je ne pourrai dire combien j’en fus touché. Ce sentiment me paraissait plus fin que tous les mots d’esprit, plus tendre que toutes les caresses. Ce sentiment signifiait, le plus clairement du monde : « Je ne vous connais pas et ne puis pas vous connaître. Mais voici mon frère, que vous pouvez connaître ! C’est le chemin jusqu’à moi : suivez-le ! »
J’étais encore plongé dans ces réflexions lorsque sonna la cloche qui renvoyait nos visiteurs. Aussitôt notre petit marché se ferma, et nous nous précipitâmes tous vers la cuisine, où l’on distribuait à chacun de nous sa ration du soir ; car nous avions le droit de nous installer, pour manger, où bon nous semblait.
Comme je l’ai dit déjà, la conduite de bon nombre de nos visiteurs était offensante pour nous intolérablement ; elle l’était, sans doute, beaucoup plus encore que ces visiteurs ne se l’imaginaient, de même que le public, dans une ménagerie, doit offenser de mille façons, qu’il ne soupçonne pas, les nobles et infortunés animaux enfermés derrière les barreaux. Et je dois ajouter que quelques-uns de mes compagnons étaient peut-être aussi plus susceptibles que de raison. Ces vieux grognards, d’origine paysanne, accoutumés depuis l’enfance à passer en triomphateurs parmi des populations soumises et tremblantes, ne se résignaient point à leur nouvelle condition.
Il y avait là, en particulier, un homme appelé Goguelat, une brute de la plus belle eau, qui n’avait jamais rien connu de la civilisation que sous la forme de la discipline militaire, et qui cependant, par son héroïque bravoure, s’était élevé au grade de maréchal des logis au 22e de ligne. Autant qu’une brute peut être un bon soldat, c’était un excellent soldat ; la croix d’honneur brillait sur sa poitrine, et galamment gagnée ; mais, pour tout ce qui n’était pas sa consigne, ce Goguelat était bien le plus grossier, le plus ignorant, le plus hargneux pilier de cabaret. En ma qualité de gentilhomme et d’homme ayant reçu une bonne éducation, j’étais le type de ce qu’il comprenait le moins au monde, et détestait le plus. La simple vue de nos visiteurs le plongeait chaque soir, dans un transport de colère, dont il ne manquait pas de s’épancher ensuite sur la première victime qui lui tombait sous la main, mais plus souvent encore sur moi que sur les autres.
C’est à moi qu’il s’en prit, de nouveau, ce jour-là. Je venais à peine de m’asseoir dans un coin de la cour, avec ma ration, lorsque je le vis s’approcher de moi. Il avait une mine de gaîté haineuse ; une troupe de jeunes sots le suivait avec des regards d’attente ; je vis tout de suite que j’allais encore devenir l’objet de quelqu’une de ses basses et fâcheuses plaisanteries. En effet, il s’assit près de moi, étala sa ration sur le sable, but à ma santé sa pinte de bière, par dérision, et commença. Ce qu’il me dit, je rougirais de le répéter ici ; mais ses admirateurs, à chacun de ses mots, se tordaient de rire. Pour ma part, je crus d’abord que j’allais mourir de honte et de fureur. Jamais je n’aurais soupçonné que le misérable eût observé tant de choses ; mais on a raison de dire que la haine aiguise les oreilles ; car non seulement il savait le nombre de mes entrevues avec la jeune fille : il avait encore retenu le nom de Flora. Peu à peu, en l’entendant, je repris mes esprits ; mais ce fut pour me laisser aller à un élan de rage qui me surprit moi-même.
« As-tu bientôt fini ? m’écriai-je. Parce que, quand ce sera fait, j’aurai à mon tour deux mots à dire !
– À votre aise, monseigneur ! répondit-il. On vous écoute ! La parole est au marquis de Carabas.
– Parfait ! dis-je alors. Eh bien ! Goguelat, écoute-moi à ton tour et tiens-toi tranquille, si tu ne veux pas que je te prenne pour un lâche, car il y a là-bas un gardien qui a les yeux tournés de notre côté ! Tu as osé parler en de certains termes d’une certaine jeune dame qui pourrait être ta fille, et qui a la bonté de me faire l’aumône, ainsi qu’à plusieurs autres d’entre nous. Si l’empereur – je saluai – si mon empereur pouvait t’entendre, il arracherait la croix de ta vile poitrine ! Moi, je ne le ferai point ; je n’ai pas le droit de reprendre ce qu’à donne notre maître. Mais il y a une chose que je puis te certifier, Goguelat : je puis te certifier que, cette nuit même, je te couperai la gorge ! »
J’avais tellement eu à supporter de sa part, et je l’avais supporté avec tant de patience, jusque-là, que sans doute il s’était attendu à pouvoir toujours continuer impunément ; aussi parut-il d’abord stupéfait. Mais j’eus le plaisir de comprendre que quelques-unes de mes expressions l’avaient touché au vif ; et puis l’animal était vraiment un héros, pour la bravoure, et rien ne l’intéressait autant que de se battre. Au reste, quoi qu’il en fût de ses sentiments, il eut vite fait de se ressaisir, et je dois ajouter, pour lui rendre justice, qu’il prit la chose magnifiquement.
« Et moi, dit-il, par les cornes du diable, je vous certifie que vous me trouverez à votre disposition ! »
Après quoi il but de nouveau à ma santé, et je lui rendis la même politesse.
La nouvelle de ma provocation ne tarda pas à se répandre à travers la prison. Tous les visages s’illuminèrent, comme ceux des spectateurs sur un champ de courses ; et, en vérité, il faut avoir vécu d’abord la vie active d’un soldat de l’empereur, et s’être ensuite trouvé condamné à l’ennui d’une geôle, pour pouvoir bien comprendre, et peut-être excuser, le ravissement éprouvé par nos compagnons.
Goguelat et moi couchions tous deux dans la même chambrée, ce qui simplifiait grandement les choses. Un comité d’honneur fut donc formé, dont firent partie les douze hommes de notre chambrée. Ils choisirent pour président un sergent-major du quatrième dragon, le type de la vieille barbe, excellent militaire, et excellent homme. Il prit ses fonctions tout à fait au sérieux, vint s’entretenir successivement avec chacun de nous deux, et alla rendre compte au comité de nos deux réponses. La mienne avait été aussi ferme qu’il convenait. J’avais, dit au sergent-major que la jeune dame au sujet de laquelle Goguelat s’était exprimé en termes incivils m’avait, à plusieurs reprises, donné des aumônes. J’avais rappelé que, sans doute, c’était chose nouvelle pour nous d’en être réduits à tendre la main sous prétexte de vendre des tabatières ou des boîtes à pilules, et que nous avions tous vu, jadis, des bandits qui, après avoir sollicité et obtenu des passants quelque charité, avaient trouvé bon de railler ou d’injurier leurs bienfaiteurs. « Mais, – ajoutai-je, – j’ai confiance que personne de nous ne tombera aussi bas. Comme Français et comme soldat, je dois à cette jeune dame de la reconnaissance. Je me sais cru tenu de protéger son honneur et de défendre celui de l’armée. Vous qui êtes mon aîné et mon supérieur en grade, dites-moi si je n’ai pas eu ma raison ? »
Le sergent-major était un vieux bonhomme doux et tranquille. Il me donna un petit coup sur l’épaule, avec trois doigts, me dit : « C’est bien, mon enfant ! » et s’en retourna vers son comité.
Goguelat, naturellement, ne fut pas plus accommodant que moi-même. « Je n’aime pas les excuses, ni ceux qui les font ! » Ce fut sa seule réponse. Et rien ne resta plus qu’à arranger les détails de la rencontre.
Pour ce qui était du temps et de l’heure, nous n’avions pas le choix. Notre affaire devait se régler la nuit, dans l’obscurité, tout de suite après le passage d’une ronde ; et cela devait se faire dans l’espace libre ouvert au milieu du hangar qui nous servait de chambrée. La question des armes était plus embarrassante. Nous possédions bien un certain nombre d’outils, que nous employions à fabriquer nos petits jouets ; mais aucun d’eux ne convenait pour un combat singulier entre hommes civilisés ; sans compter que, ces outils étant de forme et de dimensions différentes, on n’aurait pu, avec eux, égaliser les chances des combattants. Enfin, quelqu’un eut une idée. On dévissa une paire de ciseaux et l’on fixa chacune des deux pointes à l’extrémité d’une baguette flexible, après avoir coupé les deux baguettes à longueur égale. Je ne saurais décrire l’étrange impression que j’éprouvais à tenir dans ma main une telle arme, qui n’était pas plus lourde qu’une cravache, et dont on avait peine à supposer qu’elle fût plus dangereuse.
Toute la chambrée jura ensuite solennellement que personne n’interviendrait dans le duel, ni, en cas d’accident grave, ne trahirait le nom du survivant. Après quoi, tout se trouvant ainsi préparé, nous nous recueillîmes dans l’attente du moment.
Le soir descendit, nuageux et sombre. Pas une seule étoile ne brillait au ciel lorsque, comme d’habitude, la première ronde passa par notre chambrée, et poursuivit son tour le long des remparts. Quand nous prîmes nos places, nous entendions encore, dominant les murmures de la ville qui nous entourait, le cri des sentinelles au passage de la ronde.
Leclos, le sergent-major, nous mit en position, joignit nos baguettes, et nous laissa. Pour éviter les taches de sang sur nos effets, mon adversaire et moi nous étions mis tout nus, et le froid de la nuit enveloppait nos corps comme d’un drap mouillé. Goguelat était plus habile que moi à l’escrime ; il était, en outre, plus grand que moi, et plus fort en proportion. Dans l’obscurité, d’encre de la chambrée je ne parvenais pas même à voir ses yeux ; et l’idée d’une parade m’était rendue plus impossible encore par l’extrême souplesse des baguettes. Je résolus donc, de profiter, autant que possible, de mon défaut même. Aussitôt le signal donné, je me baisserais, et foncerais au même instant ! C’était jouer ma vie sur une carte : si je ne blessais pas gravement l’adversaire, aucune défense ne me resterait. Et j’avais surtout un petit frisson de terreur à la pensée que, si j’échouais, c’était sur mon visage et mes yeux que l’animal se trouverait tout naturellement conduit à porter ses coups.
« Allez ! » dit le sergent-major.
Au même instant nous fonçâmes tous les deux avec une égale furie, et, sans ma feinte, nous nous serions sûrement embrochés tous les deux. Goguelat, dans l’espèce, se borna à me blesser à l’épaule, tandis que ma pointe lui pénétra dans le ventre, au-dessous de la ceinture ; et sa grosse masse humaine, tombant sur moi de toute sa hauteur, me précipita sur le sol, sans connaissance.
Quand je revins à moi, j’étais étendu sur mon lit ; et je pus distinguer dans les ténèbres une douzaine de têtes massées autour de moi. Je me redressai. « Qu’y a-t-il ? » m’écriai-je.
« Chut ! dit le sergent-major, Dieu merci, tout va bien ! »
Je sentis qu’il cherchait ma main, à tâtons ; et il avait des larmes dans la voix.
« Rien qu’une égratignure, mon enfant ; et puis voici votre vieux papa, qui va bien vous soigner ! Votre épaule est bandée comme il faut ; nous vous avons remis vos vêtements sur le corps ; tout ira bien ! »
La mémoire commençait à me revenir. « Et Goguelat ? » murmurai-je.
« Impossible de le remuer ! Il a le ventre crevé. Mauvaise affaire ! dit le sergent-major. »
L’idée d’avoir tué un homme avec la moitié d’une paire de ciseaux m’atterra. Je crois bien que, si j’en avais tué une douzaine avec un fusil, un sabre, une baïonnette, n’importe quelle arme régulière, je n’en aurais pas éprouvé un remords aussi angoissant. Je courus vers mon malheureux adversaire, je m’agenouillai près de lui, et ne pus que sangloter son nom.
Il fit de son mieux pour me tranquilliser. « Tu m’as donné la clef des champs, camarade ! me dit-il. Mais, tu sais, sans rancune ! »
À ces mots, mon horreur redoubla. Ainsi, c’était nous, deux Français exilés, qui avions engagé l’un contre l’autre un combat tout aussi sauvage que les batailles des bêtes ! Et cet homme, qui avait été toute sa vie une brute achevée, le voici qui mourait, en terre étrangère, de cette blessure sans nom ; le voici qui attendait la mort avec la bonne grâce héroïque d’un Bayard !
J’insistai pour que l’on appelât les gardiens et qu’on fît venir un médecin. « Peut-être parviendra-t-on à le sauver ! » criais-je en pleurant.
Mais le sergent-major me rappela notre promesse : « Si c’est vous qui aviez été atteint, dit-il, nous aurions eu à vous laisser là jusqu’au moment où la patrouille serait revenue et vous aurait ramassé. Il se trouve que la chance a tourné contre Goguelat. Le pauvre garçon doit se résigner comme vous auriez fait ! Allons, mon enfant, vite, dans votre lit ! »
Et, comme je résistais encore :
« Champdivers ! me dit-il, c’est de l’enfantillage ! vous me faites de la peine !
– Allons ! tout de suite sur vos paillasses, tas de fichus bougres ! dit Goguelat, en s’efforçant de rire pour nous rassurer. »
Chacun de nous revint donc vers son lit, dans les ténèbres ; et feignit de dormir. La soirée n’était pas encore très avancée. La ville, à nos pieds, de très loin, nous envoyait un bruit confus de roues et de voix. Et bientôt le rideau des nuages se déchira, nous laissant voir, par les fenêtres de la chambrée, la foule des étoiles sur le fond bleu du ciel. Cependant le pauvre Goguelat gisait toujours au milieu de nous, et nous entendions que, par instants, il ne pouvait pas s’empêcher de pousser un grognement.
Puis nous entendîmes arriver la ronde. Peu à peu, nous l’entendîmes traverser la cour, dépasser les sentinelles, s’approcher de nous. Enfin, elle tourna le coin des remparts et s’offrit à nos yeux : quatre soldats, précédés d’un caporal qui tenait une lanterne et l’agitait à droite et à gauche, de façon à en projeter la lumière dans tous les recoins.
« Holà ! s’écria le caporal, s’arrêtant tout à coup devant le corps de Goguelat. »
Il se baissa avec sa lanterne. Tous nos cœurs s’interrompirent de battre.
« Que diable est-ce là ? » fit-il. Puis, d’une voix vibrante, il appela du renfort.
Aussitôt nous voici tous sur pied. D’autres lanternes, d’autres soldats se pressent devant la chambrée. Un officier se fraie un chemin parmi eux, à coups de coudes. Et, au milieu de la chambrée, s’étend l’énorme corps, tout nu, taché de sang.
L’un de nous lui avait mis sa couverture sur le ventre ; mais le malheureux se secouait si fort qu’il n’avait point tardé à se découvrir.
« Ceci est un meurtre ! » déclara l’officier. Puis, s’adressant à nous : « Satanés animaux, nous verrons à régler cette affaire-là avec vous demain matin ! »
Le malheureux Goguelat fut soulevé, étendu sur un brancard. Avant de quitter la chambrée, nous l’entendîmes qui faisait un dernier effort pour nous crier joyeusement adieu.
Goguelat était évidemment perdu. Aussi ne laissa-t-on pas échapper un moment pour l’interroger, pendant qu’il était encore capable de répondre. Ses réponses furent d’ailleurs invariables : il affirma qu’il s’était donné volontairement la mort, parce qu’il en avait assez de voir tant d’Anglais. Le médecin eut beau soutenir que l’hypothèse du suicide était impossible, vu la nature de la plaie et sa direction. Goguelat répondit qu’un soldat français savait faire bien des choses dont un médecin anglais n’aurait jamais l’idée. Il dit qu’il avait enfoncé l’arme dans le sol, et s’était jeté sur la pointe. Le médecin, qui était un petit homme propret, rubicond, et d’humeur impatiente, pesta, jura, maudit le pauvre diable. « Rien à faire de lui ! criait-il. Une brute sans pareille ! Si du moins on pouvait retrouver l’arme ! » Mais l’arme avait cessé d’exister. Tout au plus aurait-on pu découvrir, dans plusieurs coins, des morceaux de baguettes dispersés ; et peut-être, à l’air frais du matin, dans la cour, quelque dandy en livrée soufre et moutarde occupé à se rogner les ongles avec une paire de ciseaux !
N’obtenant rien de Goguelat, les autorités ne manquèrent point de s’adresser à nous. Nous eûmes à subir interrogatoire sur interrogatoire, tantôt séparément, tantôt par deux ou trois. Nous fûmes menacés de toute sorte de sévérités impossibles, et tentés par la promesse de toute sorte de récompenses improbables. Pour ma part, je fus certainement interrogé plus de cinq fois : et chaque fois je m’en tirai le plus brillamment du monde. Je suis comme le vieux Souvarof, je n’admets pas qu’un soldat puisse être pris de court devant n’importe quelle question. À toute question il doit répondre, comme il marche au feu, promptement et gaîment. Souvent dans ma vie j’ai manqué de pain, d’argent, ou même d’espoir : jamais je n’ai manqué d’une réponse à une question. Et j’ajoute que mes camarades, si tous n’avaient point peut-être la répartie aussi facile, se conduisirent tous, dans l’espèce, avec la même fermeté : de manière que l’enquête n’aboutit point, et que la mort de Goguelat resta un mystère dans la prison. Tels étaient les vétérans de France !
Et cependant, pour dire toute la vérité, je dois avouer que cet échec de l’enquête ne s’explique pas seulement par le profond souvenir que nous conservions de notre honneur militaire. En d’autres circonstances, je crois bien que personne d’entre nous n’aurait trahi le secret volontairement ; mais peut-être quelqu’un se serait-il laissé entortiller par des questions perfides, ou encore laissé intimider par des menaces. Ce qui nous soutenait et nous liait tous les uns aux autres, dans notre chambrée, et nous donnait à la fois une résolution et une présence d’esprit exceptionnelles, c’est qu’il y avait entre nous un secret plus important encore à garder. Nous poursuivions un projet dont la réussite intéressait également chacun de nous ; et chacun, jusqu’à cette réussite, se serait fait tuer plutôt que de trahir un camarade. Quant à ce qu’était notre projet, ai-je besoin de le dire ? Il n’y a qu’une seule espèce de projets qui fleurisse dans les prisons, de même qu’il n’y pousse qu’une seule espèce de désirs. Et la pensée que notre passage souterrain était presque entièrement creusé, dans le rocher du Château, c’était surtout cette pensée qui nous soutenait et nous inspirait.
Je me tirais de mes interrogatoires, comme je l’ai dit, de la façon la plus brillante ; et cependant j’étais démasqué. Oui, moi que mon adversaire lui-même couvrait et défendait héroïquement, j’avais été amené à tout avouer à quelqu’un qui, plus que personne, aurait dû ignorer mon secret !
Trois jours après le duel, et pendant que Goguelat vivait encore, j’eus à donner une leçon de français au major Chevenix. Cette occupation était loin de me déplaire ; non qu’elle me rapportât beaucoup, – mes leçons m’étaient payées dix-huit pence par mois, et encore avais-je à les réclamer ; – mais j’aimais les déjeuners du major, son tabac, et, sans l’aimer lui-même, je trouvais un réel plaisir à causer avec lui. Celui-là, du moins, était un homme bien élevé, tandis que tous les autres avec qui j’avais l’occasion de m’entretenir se trouvaient être, malheureusement, je dois le répéter, de pauvres diables absolument illettrés, et pour qui le plus beau livre ne représentait qu’un paquet de feuilles de papier bonnes à allumer leur pipe.
Chevenix était un fort bel homme, encore jeune, bien fait, grand, avec des traits réguliers et des yeux gris très clairs. Aucun détail ne péchait dans sa personne, et pourtant l’ensemble était désagréable. Peut-être était-il trop propre : on avait toujours l’impression qu’il sentait le savon. Certes, la propreté est chose excellente : mais je ne puis admettre qu’un homme ait des ongles qui semblent en porcelaine. Et puis il était trop froid, trop maître de lui. Impossible de découvrir, chez ce jeune officier, le feu de la jeunesse, ni l’entrain du soldat. Sa bonté même était d’une froideur cruelle ; il m’exaspérait jusque dans ses amitiés. Et son caractère était si parfaitement l’opposé du mien que, tout en me réjouissant d’avoir affaire à lui, jamais je ne l’approchais qu’avec une réserve soupçonneuse.
Ce jour-là, selon l’usage, il me donna à corriger son exercice ; j’y trouvai six fautes.
« Hein ! six fautes ! dit-il en regardant la fenêtre. C’est ennuyeux. Jamais je n’en sortirai.
– Oh ! mais si, vous faites de grands progrès ! » lui répondis-je. Je ne lui disais cela, on l’entend bien, que pour ne point le décourager : mais, en réalité, il était incapable d’apprendre le français. C’est chose où il faut, je crois, quelque feu ; et le major avait éteint tout le sien à force de se savonner.
Il mit la feuille sur la table, s’appuya le menton dans une main, et me regarda sévèrement, de ses yeux trop clairs.
« J’ai à vous parler ! me dit-il.
– Entièrement à vos ordres ! répliquai-je ; mais je tremblais, devinant bien de quel sujet nous allions parler.
– Il y a déjà quelque temps que vous me donnez ces leçons, reprit-il, et j’incline à avoir bonne opinion de vous. Je vous crois un gentleman.
– Monsieur, dis-je, j’ai effectivement l’honneur d’en être un.
– Quant à moi, dit-il, j’ignore l’impression que je vous fais ; mais peut-être êtes-vous porté à croire que je suis, moi aussi, un homme d’honneur ?
– La chose ne saurait faire de doute ! répondis-je. Et je m’inclinai.
– C’est parfait, fit-il. Et maintenant, dites-moi donc ce qui en est de l’affaire de ce Goguelat !
– Vous avez entendu mon témoignage, hier, devant la commission !… Je dormais sur mon lit…
– Oh ! oui, je vous ai entendu hier devant la commission, en effet ! m’interrompit-il. Et je me rappelle bien ce que vous avez raconté. Mais est-ce que vous supposez que j’aie pu songer un seul instant à vous croire ?
– En ce cas, vous ne me croirez pas davantage si je vous répète la même chose ici ! lui dis-je.
– Je me trompe peut-être (c’est ce que nous verrons bien), reprit-il, mais j’ai l’impression que vous allez me dire autre chose, ici. J’ai l’impression que, étant entré dans cette chambre, vous n’en sortirez pas sans m’avoir tout avoué ! »
Je haussai les épaules.
« Laissez-moi m’expliquer, continua-t-il. Votre déposition, naturellement, ne compte pas. Je n’en ai tenu aucun compte, non plus que la commission.
– Tous mes regrets ! dis-je en souriant.
– Mais la vérité est que vous devez tout savoir ! Vous tous, dans la chambrée B, vous savez ce qui en est. Et je vous demande quel sens il y a à poursuivre indéfiniment cette plaisanterie, ici, entre amis ! Allons, allons, décidez-vous !
– Je vous écoute avec intérêt, dis-je ; au fond, peut-être est-ce vous qui allez me renseigner ! »
Le major Chevenix croisa lentement ses longues jambes.
« Je comprends, fit-il, que vous ayez des précautions à garder. J’imagine qu’un serment aura été passé entre vous. Je comprends cela parfaitement. (Il me dévisageait ; tout en parlant, de ses yeux brillants et froids.) Et je comprends aussi que vous soyez particulièrement soucieux de tenir votre parole, étant donné qu’il s’agit là d’une affaire d’honneur.
– D’une affaire d’honneur ? répétai-je, sur un ton étonné.
– Alors, ce n’était pas une affaire d’honneur ? demanda-t-il.
– Qu’est-ce qui l’était pas une affaire d’honneur ? Je ne vous suis pas ! »
Le major ne fit aucun signe d’impatience. Il se borna à rester silencieux pendant un instant ; après quoi il reprit, de la même voix placide et bienveillante :
« La commission et moi avons été d’accord pour ne pas tenir compte de votre témoignage. Mais il y avait une différence entre moi et les autres officiers : car je connaissais mon homme et ils ne le connaissaient pas. Ils voyaient en vous un soldat ordinaire, et moi je vous savais un gentleman. Pour eux, votre déposition n’était qu’un tissu de mensonges, et qu’ils n’écoutaient qu’en bâillant. Moi, je me demandais : “Jusqu’où un gentleman pourra-t-il aller dans cette voie ? Sûrement, il n’ira pas jusqu’à faire qu’un meurtre demeure impuni ?” Et ainsi, quand je vous entendis affirmer que vous ne saviez rien de l’affaire, et le reste, je traduisis votre témoignage d’une autre façon que mes collègues. Et maintenant, Champdivers, s’écria-t-il, en se relevant soudain et en allant vers moi, maintenant il faut que vous m’aidiez à tirer cela au clair ! Écoutez bien ce que je vais vous dire ! »
Au même instant il posa lourdement sa main sur mon épaule ; et je suis tout à fait incapable, aujourd’hui encore, de me rappeler s’il continua son discours ou s’il s’arrêta tout de suite. Car, comme par une malchance diabolique, l’épaule sur laquelle il avait mis la main était celle que le ciseau de Goguelat avait entamée. La plaie n’était en somme qu’une égratignure ; mais l’étreinte du major Chevenix me mit à l’agonie. La tête me tournait, la sueur découlait de mon front ; et sans doute je devins d’une pâleur de mort.
Chevenix retira sa main aussi soudainement qu’il l’avait posée.
« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il.
– Oh ! rien ! Une douleur ! C’est déjà passé !
– En êtes-vous sûr ? Vous êtes blanc comme un linge !
– Oh ! non, ce n’est rien, je vous assure ! Me voici de nouveau prêt à vous entendre ! dis-je, encore que j’eusse toutes les peines du monde à remuer ma langue.
– Eh bien ! je reprends ! Pouvez-vous me suivre ?
– Oh ! parfaitement ! répondis-je ; et j’essuyai mon visage, tout mouillé de sueur, avec la manche de ma veste.
– C’est tout de même une douleur bien soudaine et bien vive qui vous est venue là ! fit le major d’un ton de doute. Mais enfin, puisque vous êtes sûr qu’elle est passée, je continue. Je vous disais donc que, naturellement, une affaire d’honneur entre vous devait être difficile à mener à bien, que sans doute même vous n’aviez pas pu songer à lui donner une forme tout à fait régulière. Et cependant un duel peut fort bien être irrégulier dans la forme et, en tel cas particulier, rester suffisamment loyal quant à ses effets. Me comprenez-vous ? Et maintenant, comme gentleman et comme soldat… »
De nouveau il leva la main et s’avança vers moi. Je ne pus me résigner à une seconde angoisse : je me reculai.
« Non, m’écriai-je, pas cela ! Ne mettez pas votre main sur mon épaule ! Je ne puis le supporter. C’est un rhumatisme ! me hâtai-je d’ajouter. Mon épaule est enflammée et me fait très mal. »
Chevenix revint à sa chaise, se rassit, et alluma un cigare.
« Je suis fâché de vous savoir malade ! dit-il enfin. Laissez-moi appeler le médecin !
– N’en faites rien, dis-je. C’est une bagatelle ! J’y suis tout à fait accoutumé ! Et puis, je ne crois pas aux médecins !
– Soit ! dit-il. Il resta assis et fuma quelque temps sans rien dire. J’aurais tout donné au monde pour rompre ce silence.
– Eh bien ! reprit-il enfin, je crois qu’il ne me reste plus rien à apprendre ! Je crois que je peux dire que je sais tout !
– Sur quel sujet ? demandai-je héroïquement.
– Sur l’affaire de Goguelat ! dit-il.
– Je vous demande pardon…, je ne saisis pas…
– Oh ! dit le major, la chose est bien simple : cet homme a été frappé en duel, et de votre main ! Je ne suis pas un enfant !
– Non, certes ! mais vous me paraissez être un grand constructeur d’hypothèses ! hasardai-je.
– Voulez-vous que nous mettions mon hypothèse à l’épreuve ? demanda-t-il. Le cabinet du médecin est à deux pas d’ici. Si vous n’avez pas à l’épaule une plaie ouverte, c’est que je me trompe. Si vous en avez une… mais je vous engage à bien réfléchir avant de prendre un parti ! Car il y a un inconvénient grave à ce que nous tentions l’expérience : c’est que, alors, ce qui aurait pu rester une chose privée, entre nous, risque de devenir propriété publique.
– Oh ! dans ce cas, dis-je en riant, tout plutôt qu’un médecin ! C’est une espèce que je ne puis souffrir ! »
Ses dernières paroles m’avaient fort soulagé, mais j’étais encore loin de me sentir tout à fait à l’aise.
Le major Chevenix continua fumer, regardant tantôt les cendres de son cigare et tantôt moi.
« J’ai été moi-même un soldat, dit-il ensuite, et j’ai eu, moi aussi, à abattre mon homme. Je ne suis pas d’humeur à mettre quelqu’un dans la peine pour une affaire de ce genre, si seulement elle a été nécessaire, et correcte. Mais il faut que je sache si elle a été cela, et j’exige que vous m’en donniez votre parole d’honneur. Faute de quoi, j’en suis bien fâché, mais j’aurai à mander le médecin.
– Je n’avoue et je ne dénie rien, répondis-je. Mais, si la formule que voici peut vous suffire, je vous donne ma parole, en tant que gentilhomme et en tant que soldat, qu’il ne s’est rien passé entre nous, dans la chambrée, qui n’ait été parfaitement honorable.
– C’est bien ! dit-il. Voilà tout ce que je désirais savoir. Maintenant vous pouvez vous en aller, Champdivers ! »
Et, comme je me préparais à sortir, il ajouta, avec un gros rire :
« À propos, j’ai mille excuses à vous faire ; je n’avais pas la moindre idée que je vous appliquais la torture ! »
Ce même jour, l’après-midi, notre médecin vint dans la cour, tenant à la main un morceau de papier. Il paraissait échauffé, et nullement en veine de politesse.
« Holà ! cria-t-il, quel est donc celui d’entre vous qui parle anglais ? »
Puis, m’apercevant :
« Ah ! Justement, le voici ! Écoute un peu, animal ! Tu vas dire dans ta langue à tous ces gaillards que leur compagnon est en train de crever. Il a son affaire : il ne passera pas la soirée. Et dis-leur aussi que je n’envie pas les sentiments du coquin qui l’a embroché ! Allons, commence par leur dire tout ça ! »
C’est ce que je fis.
« Et maintenant, reprit le médecin, dis-leur que cet individu, ce Goggle, – que le diable emporte son nom ! – désire revoir quelques-uns de ses compagnons avant de se mettre en route pour son nouveau poste. Si j’ai bien compris ce qu’il dit, il demande à vous embrasser, ou à vous serrer la main, ou quelque autre sensiblerie du même genre. Est-ce compris ? D’ailleurs voici une liste qu’il nous a fait écrire ; lis-la tout haut, car je n’en viens pas à bout avec vos maudits noms ! et que les hommes nommés répondent présent en allant se ranger contre le mur ! »
J’éprouvai un singulier mélange d’émotions diverses en lisant le premier nom inscrit sur la liste. Je n’avais aucun désir de contempler de nouveau mon malheureux ouvrage : toute ma chair frémissait à cette pensée ; et puis, quel accueil allais-je recevoir ? L’idée me vint de passer ce premier nom et de rester dans le préau. Mais, par bonheur, je ne m’arrêtai pas à cette idée, qui aurait pu me jouer un très vilain tour. J’allai vers le mur désigné, lus tout haut le nom « Champdivers », et me répondis à moi-même : « Présent ! »
Nous étions une demi-douzaine, en tout, sur la liste. Dès que nous fûmes tous rangés contre le mur, le médecin nous conduisit à l’infirmerie, où nous le suivîmes en file, l’un derrière l’autre. À la porte, il s’arrêta et nous dit que « l’animal désirait voir séparément chacun de nous ». C’était une petite pièce blanchie à la chaux. Une fenêtre, donnant au midi, s’ouvrait sur une perspective immense et lointaine ; et, d’en bas, le bruit des roues montait clairement jusqu’à moi. Sur un petit lit, près de la fenêtre, gisait Goguelat. La vie n’était pas encore entièrement effacée de son visage, mais la marque de la mort s’y voyait déjà. Il y avait dans son sourire quelque chose de sauvage, d’inhumain, qui me saisit à la gorge. Et le pauvre diable semblait avoir honte lui-même de sa voix enrouée.
Il étendit les bras vers moi, comme pour m’embrasser. Et je dus m’approcher de lui, malgré le frisson d’horreur qui me secouait tout entier. Mais il ne fit que coller ses lèvres à mon oreille.
« Aie confiance en moi ! murmura-t-il. Je suis bon bougre, moi ! J’emporterai mon secret en enfer, pour le dire au diable ! »
Mais pourquoi reproduirais-je la grossièreté de ses expressions ? Tout ce qu’il pensait et sentait, à cette heure suprême, était d’une noblesse admirable, encore qu’il ne sût point le traduire autrement que dans un langage de brute. Après m’avoir consolé et rassuré de son mieux, il me dit d’appeler le médecin ; et lorsque celui-ci se fut approché, mon pauvre Goguelat se souleva un peu dans son lit, désigna du doigt d’abord lui-même, puis moi, qui pleurais à son chevet, et répéta plusieurs fois les mots : « Amis, amis ; nous deux, amis ! »
À ma grande surprise, le médecin sembla très ému. Il secoua vers nous sa petite tête à perruque ronde et dit, plusieurs fois de suite : « All right, Johnny, moi comprong ! »
Alors Goguelat me serra encore les mains, et je sortis de la chambre en sanglotant comme un enfant.
Dans la vie, et surtout depuis son emprisonnement, Goguelat était en général détesté ; mais, durant les trois jours de son agonie, sa magnifique constance lui avait gagné tous les cœurs ; et quand le bruit se répandit dans la prison, ce même soir, qu’il avait cessé de vivre, toutes les conversations s’arrêtèrent ou eurent lieu à voix basse, comme dans une maison en deuil.
Quant à moi, j’étais vraiment comme un fou. Je ne pus fermer l’œil de toute la nuit. Je me répétais toujours que je l’avais tué, et que lui, en échange, avait fait l’impossible pour me protéger. Et tel est le profond illogisme de nos sentiments les meilleurs que, le lendemain matin, par l’excès même de mon remords, j’étais en humeur de chercher querelle au premier venu.
Rencontrant le médecin, je lui demandai si la nouvelle était vraie.
« Oui, me dit-il, l’animal est mort !
– A-t-il beaucoup souffert ? demandai-je.
– Pas du tout. Il s’est éteint comme un mouton ! »
Le petit médecin me considéra un moment, puis je vis qu’il portait la main au gousset de son gilet.
« Tenez, me dit-il, prenez cela, et ne vous faites pas de mauvais sang ! » – Il me mit dans la main une petite pièce de quatre sous en argent, et s’éloigna.
J’aurais dû garder cette pièce pour la faire encadrer sur le mur, en souvenir du seul acte de charité qu’eût jamais fait, à ma connaissance, le médecin de la prison. Mais, au lieu de cela, je courus aux remparts, tout tremblant d’irritation et de honte ; et je jetai la pièce en l’air, bien loin, comme le prix du sang.





























