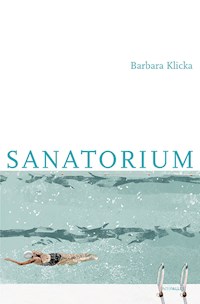
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une jeune Polonaise quitte la capitale pour suivre une cure thermale obligatoire en province dans un centre public. Là, il lui faut trouver sa place auprès des habitués et apprivoiser les codes d’un microcosme déroutant.
C’est par un ton malicieux et un humour à toute épreuve que la curiste va déjouer les pièges et percer les secrets de ce sanatorium, où son séjour prend parfois des allures de parcours de l’absurde.
Le corps, qui relie par des nœuds très variés soignants et soignés, devient vite le thème central de ce premier roman virtuose qui pose un regard ironique et subtil sur un univers singulier et méconnu.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Barbara Klicka est une représentante de la nouvelle génération d’auteurs polonais nés avant la chute du mur de Berlin mais ayant commencé à écrire peu après. D’abord reconnue comme poète (elle a publié plusieurs recueils et notamment remporté les prix littéraires Gdynia et Silesius), elle est désormais une romancière reconnue depuis la publication de
Sanatorium, qui a connu un grand succès critique et public. Elle écrit également pour le théâtre et l’une de ses pièces a été montée en 2017 par Piotr Cieplak au Théâtre National de Varsovie. Elle construit une œuvre originale qui interroge la frontière entre l’intime et le public tout en questionnant le désir et la notion de norme.
Son écriture pleine d’un humour mordant et d’une ironie subtile en font l’une des représentantes les plus douées et singulières de la nouvelle génération d’auteurs polonais.
Ses œuvres sont traduites en anglais, en allemand, en croate, en hébreu, en géorgien et en lituanien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SANATORIUM
Barbara Klicka
SANATORIUM
Traduit du polonaispar Nathalie Le Marchand
Éditions Intervalles
Ce n’est pas le plein été, me dis-je, mais quand même, ma valise est trop lourde. La voilà maintenant dans la soute à bagages du bus et il n’y a quasiment pas lieu de s’inquiéter de son poids, mais comment ne pas être inquiète puisque personne ne m’attendra à l’arrêt de bus ? Et à l’intérieur, il y a mes bottes en caoutchouc, mon manteau, quinze paires de chaussettes, autant de pulls que nécessaire, ma tenue de gym, mon maillot, mon bonnet, mes claquettes, tout ce dont une curiste peut avoir besoin le temps de son séjour. À l’automne. Je pense : Voilà à quoi ça va ressembler, c’est tout à fait ça, ils vont m’appliquer des cataplasmes, me masser, me suspendre et me pétrir, ensuite je rassemblerai mes affaires pour partir, ma valise sera trop lourde, rien que mes bottes, c’est déjà le poids de ce qu’il m’est permis de soulever, mais il faudra bien rentrer, alors je fourrerai tout dans cette valise, et sur le chemin il y aura des marches, et ni ces trente jours ni aucun bain à bulles, pas même toute la boue du monde n’auront raison de mon bagage d’automne. Je pense : J’expédierai peut-être cette valise par la poste avant de rentrer, j’arriverai chez moi, je trouverai un avis dans ma boîte aux lettres sans m’en effrayer car je saurai que c’est ma valise qui m’attend à la poste, et il n’y a pas de quoi avoir peur, j’appellerai mon frère ou n’importe qui pourvu qu’il ait une voiture ou des muscles et un peu de temps, quelqu’un me traînera cette valise jusqu’à mon réduit, je lui décocherai un sourire, donnerai dans l’autodérision en me traitant d’infirme, je lui paierai une bière ou un café et le tour sera joué. Le bus me berce, j’ajuste le petit coussin gonflable en forme de banane exagérément tordue installé sur mon cou, je pense : Plus que deux heures et je serai arrivée, le monde n’est pas si grand. Je ferme les yeux, il fait plus doux. Je pense : Quand même, c’est toujours une aventure, il y a tant de gens que je ne rencontrerais pas sans cela, et une saison, ce n’est pas l’éternité, quant à l’automne à Varsovie : rien que des flaques et du béton ; au moins, à Ciechocinek, il y aura un peu plus de vert pour se mélanger à toutes les autres couleurs dans mes yeux. Oui, de toute façon, me dis-je, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il faut être ouverte, apprendre des autres et apprendre aux autres, tu as lu cela dans tellement de journaux, quant à la valise au retour, on l’enverra par la poste et le tour sera joué. Les vibrations du moteur me remplissent le corps. Et soudain, surgissant des vibrations, de derrière mes yeux fermés, de derrière mon petit coussin, du bus, des nuages et du ciel, une pensée fuse au beau milieu de ma tête : il y aura sur le chemin de la poste les mêmes marches que sur le chemin de l’arrêt de bus.
Je descends. Je ne sais pas dans quelle direction aller. À côté de moi, une dame qui, sans doute, ne sait pas elle non plus où aller. Elle a pris le même bus que moi, mais sa valise est plus petite que la mienne. Je pense : Elle est peut-être venue pour moins longtemps. Elle tient dans sa main une ordonnance, la même que celle qui se trouve dans mon sac. Elle s’approche de moi.
— Vous ne sauriez pas, par hasard, comment aller au sanatorium de l’Union des Enseignants de Pologne ?
Elle a les cheveux courts, platinés, elle a peut-être quelques années de plus que moi mais on dirait ma tante. C’est à cause de cette veste turquoise, me dis-je. À cause de sa veste turquoise et du sérieux qu’elle dégage. Je lui souris. On ne sait jamais, je pourrais avoir besoin de l’aide de quelqu’un. Ma valise est tapie derrière moi comme un affreux bouledogue prêt à bondir.
— Malheureusement, je ne sais pas. Mais je dois moi aussi trouver cet endroit, si je puis dire.
— Pourquoi « si je puis dire » ?
Je pense : Existe-t-il une réponse à cette question ? Pas vraiment, c’est ma façon de parler, tout simplement, je voulais me donner un air drôle et agréable dès ma première phrase, si je puis dire. Un tic gentillet, rien de plus, si je puis dire.
— Un tic. De langage, dis-je. Rien de plus. J’ai vérifié sur internet avant de partir. D’après le plan, il faut prendre à gauche et continuer, ensuite c’est tout près.
Je souris car à peine ai-je dit A que je me sens obligée de répéter B jusqu’à l’obtention d’un effet.
— Ah, alors allons-y, dit-elle. Ensemble, on sera plus rapides.
Mais cela ne me convainc pas vraiment.
Nous nous mettons en chemin. Ma valise se traîne derrière moi tel un dinosaure malheureux. La sienne est tellement plus petite que je pense : Est-ce bien normal, quand on quitte la ville à l’automne, d’emporter ses bottes en caoutchouc au cas où on ferait une balade ?
— Vous restez longtemps ?, me demande-t-elle.
— Toute la saison. C’est ce qui est écrit sur mon ordonnance. Et vous ?
— Pareil.
Ah, ah, pas moins longtemps, alors. Ça veut dire que je suis une frimeuse à bottes, qui plus est sans imagination quant aux marches du chemin du retour. Je pense : Je vais l’étonner.
— Moi, c’est le ZUS1 qui m’envoie. Je suis obligée. Vous comprenez. Il y a eu une commission et la commission a décidé que je devais venir ici pour toute une saison.
— C’est encore pire quand on est envoyé par le ZUS, m’explique-t-elle. Elle active son mode « experte ». Surtout, on n’a pas la chance d’avoir une chambre individuelle. Même les chambres à deux, c’est plutôt rare.
Elle me regarde, cherche à savoir si elle m’a impressionnée. Elle m’a impressionnée.
— Moi aussi, je suis envoyée par le ZUS cette fois-ci, poursuit-elle, mais je préfère venir à titre privé.
Je m’aperçois qu’ici, pour elle, c’est comme une deuxième maison, si je puis dire, que maintenant c’est elle qui nous dirige d’un pas ferme, que nous avons tourné à gauche, elle, moi et nos valises de tailles différentes, et que nous allons droit au but. Je lui demande :
— Vous savez où nous allons, n’est-ce pas ?
— Enfin, évidemment. Je vous ai demandé le chemin, parce qu’il faut bien commencer par quelque chose pour faire connaissance.
Elle s’arrête, me tend la main.
— Beata, enchantée. Comme tu avais l’air plus jeune que moi, j’ai pensé que tu deviendrais mon amie. Tu vas voir, les amies plus jeunes, ici, c’est quelque chose de très précieux.
Je pense : Je ne vais pas m’enfuir, j’ai une grosse valise. Je pense : On m’a interdit de courir. Je pense : Ma seule certitude, c’est qu’elle sait de quoi elle parle, alors puisqu’elle sait, tends-lui la main et présente-toi poliment.
— Kama, lui dis-je. Je viens de Varsovie.
Nous voilà à nouveau en chemin. Cela veut dire que c’est moi qui marche derrière elle, car elle trotte. Et derrière moi, cette valise.
— De Varsovie, répète-t-elle une pointe de dépit dans la voix. Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Tu sais que les gens de Varsovie, personne ne les aime ?
— Je sais.
En effet, difficile de ne pas le savoir, pour peu que l’on sorte de temps en temps de la capitale.
— Mais moi, je m’y suis installée pour mes études et puis, voilà, je suis restée.
— Aaah, c’est un peu mieux, observe-t-elle.
Mais elle ne croit pas ce qu’elle dit et ça s’entend très bien.
— Moi, je suis de Włocławek. C’est une chouette ville. En tout cas, il n’y a pas de quoi en avoir honte.
Je pense : Jamais de ma vie, je n’ai eu honte d’une ville. Comment peut-on avoir honte d’une ville ? C’est quoi, la honte d’une ville ? Nous marchons. Nous avons encore pris deux virages. Le bâtiment de notre centre thermal se dessine déjà à l’horizon. Je le sais, j’ai regardé des photos sur internet.
— Je suis professeur d’E.P.S., me dit Beata. Il y a longtemps, j’ai été vice-championne junior de gymnastique artistique. Après, mon squelette s’est aperçu qu’il n’aimait pas vraiment cette discipline. Alors aujourd’hui, prendre les eaux ici, c’est une routine. Et puis d’autres choses m’amènent…
Tout à coup, elle sourit. Un sourire prolongé.
— Et toi, ton opération, tu l’attends ou tu l’as déjà eue ?
— J’en ai déjà eu deux. La dernière, c’était il y a six mois.
— Oh, oh ! dit-elle. Oh, oh !
— C’est le ZUS qui m’envoie. Pour que je puisse continuer à toucher la pseudo-pension qui m’a été accordée après l’opération, je dois passer par une rééducation réglementaire. Et un médecin réglementaire doit l’attester, dans un établissement public. C’est une sorte d’extra à cette pseudo-pension, dis-je. Si je ne venais pas ici, ils me retireraient mon allocation.
— À juste titre, dit Beata sur un ton dont il résulte clairement que ce serait à juste titre. Mais tu n’es pas enseignante, n’est-ce pas ? Depuis quelques années, ils acceptent aussi des gens qui ne sont pas de l’enseignement.
— Non, en effet.
Pas de rampe d’accès. Seulement des marches et un élévateur pour fauteuil roulant. Pour le faire fonctionner, il faut aller à la réception, après les marches, et demander à quelqu’un de se donner la peine de se lever. Non, je ne vais quand même pas faire monter ma valise remplie pour une saison par l’élévateur destiné aux fauteuils roulants. Je pense : J’aurai mes bottes aux pieds tous les jours, même si le mois d’octobre est exceptionnellement ensoleillé. Je tire ma valise sur les marches. Ça me fait mal. Beata m’attend au sommet. Un peu impatiente, ostensiblement triomphante. Elle n’a pas pris ses bottes. Le bâtiment est plutôt gris, en béton, tout en angles droits. Des portes en verre, un interphone, un hall avec des colonnes, une réception, et devant la réception un tapis rouge. Assez duveteux.
— Votre ordonnance, s’il vous plaît, me dit la réceptionniste.
Aussitôt Beata lui tend ses justificatifs. Je pense : Oui, c’est cela, avant que je ne parvienne à extirper mes papiers de mon sac, il va s’écouler des années. La réceptionniste fixe son écran, quelque chose tambourine là-dedans, l’ordinateur émet des sons inquiétants.
— Beata, vous avez de la chance, lui dit-elle. Voilà justement la dernière place dans une chambre de deux, elle est pour vous.
Beata rayonne.
— Chambre 314. L’étage des femmes, le troisième. Voici la clé. Bonne installation. À bientôt.
Elles se lancent des œillades. Beta me marmonne un « Salut ! » dans sa barbe, se retourne, sa valise pas trop grosse fait elle aussi demi-tour et, un instant plus tard, toutes deux ont disparu dans l’ascenseur.
Sécurité sociale polonaise. (N.d.T.)
Je loge dans la chambre 323, au troisième étage. C’est une chambre de trois personnes, à l’étage des femmes ; le deuxième, c’est celui des hommes. Comme équipement, nous avons une petite entrée avec, à l’intérieur, une armoire et un portemanteau. La porte de la salle de bains donne sur cette entrée. Dans la salle de bains, une douche sans moisissures mais avec une porte coulissante particulièrement brinquebalante, une cuvette orange, un tabouret, un bouton d’alarme cassé. Passé le petit couloir, on arrive dans la chambre. Elle doit faire 25 mètres carrés, ce dont je ne peux toutefois être sûre car j’ai toujours eu des problèmes pour estimer les surfaces. Dans la chambre : trois lits, trois tables de chevet, deux petites chaises. Arrivée la dernière, je n’ai pas le choix, mon lit se trouve sous la télévision et la chaise manquante m’a aussi été attribuée. Intéressant, me dis-je, sur tous les sols, dans les chambres et dans les halls, des tapis sont alignés les uns à côté des autres. À vue d’œil, ils ont tous au moins cent ans et n’ont sans doute jamais connu les environs de la Perse pas plus que ceux d’une teinturerie. Je pense : Ici nous souffrons tous des os, donc nous ne mourrons pas d’aspirer des acariens par le nez. Il y a aussi une porte qui donne sur le balcon et, derrière celle-ci, le balcon. Je pense : Une oasis.
Mes colocataires se sont déjà entichées l’une de l’autre au cours des trois heures qui ont précédé mon arrivée. Elles forment déjà une bande. J’entre. Toutes deux en position à demi allongée ont manifestement déjà choisi leur lit.
— Bonjour, dis-je.
— Comment ça, « Bonjour » ? Salut ! dit la blonde, près du mur de gauche. Salut ! Moi, c’est Zosia. De Zgierz.
— Très juste, dit la brune près du mur de droite. Bogusia. De la Podhale.
— Kama.
— D’où viens-tu ? m’interroge brusquement Zosia, ma nouvelle camarade de la rive gauche.
— J’arrive de Varsovie.
Je pense : Cette incertitude dans ma voix, ça va peut-être me sauver. Je ne vais tout de même pas mentir, je ne suis pas encore devenue folle.
— Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, dit la blonde.
— Très juste, approuve la brune.
Je patauge dans une mer de tapis jusqu’à mon lit, au-dessus duquel le téléviseur est allumé. Je pense : Comment effacer cette mauvaise impression ? Je vais peut-être leur raconter quelque chose, leur chanter une chanson. Je pense : Toute une saison. Je pense : Le ZUS. Le lit, ce n’est pas un lit mais un canapé. Convertible. Je m’assois, regarde autour de moi. Elles ont toutes les deux les yeux rivés dans ma direction, je pense : On ne sait jamais, tu auras peut-être besoin d’aide. Avec un sourire radieux collé sur le visage, je leur demande :
— Vous êtes là pour toute la saison ?
— Oui ! Exactement le temps qu’il faut pour vraiment se reposer et s’amuser un peu, dit Zosia. C’est la quatrième fois que je viens, alors j’en sais quelque chose. C’est à peu près à la moitié de la saison que les choses commencent vraiment à faire leur effet.
Elle sourit.
— Et toi, alors, c’est la première fois ?
— La première fois dans une section pour adultes, si je puis dire. Mais j’ai passé la moitié de mon enfance dans des stations thermales pour enfants. Mais ce n’est sûrement pas la même chose, pas vrai ?
— Ah, ça, certainement pas, dit Zosia en traînant sur les mots. Nous, ici, nous ne sommes plus du tout des enfants.
Nous habitons à six dans cette chambre. Comme tous les enfants obligés de se débrouiller seuls, nous reproduisons une famille en modèle réduit. La plupart du temps, cela se manifeste dans nos discussions. La plupart du temps, nous n’en avons pas conscience. Marta et moi sommes les plus vieilles, nous avons toutes deux 12 ans et, à tour de rôle, nous sommes pour les autres occupantes de la chambre une maman ou un papa. Moi, plus souvent une maman, elle, plus souvent un papa. Parfois l’inverse. Marta gouverne, moi, je cajole, je m’approprie les paquets envoyés par les autres parents, Marta administre les raclées, en cas de problème nous nous plaignons ensemble aux infirmières. Toutes les chambres sont régies selon ces mêmes lois, seulement, dans certaines, les familles sont plus dysfonctionnelles. À notre étage il y a six Marta, une seule Kama. Les garçons habitent dans le bâtiment d’en face. Nous les voyons à la cantine, pendant les cours et les promenades, parfois dans les salles d’attente des soins. Nous les observons d’un regard oblique, d’un œil qui semble répondre aux exigences du « regard séducteur ». Aucune de nous ne sait d’où elle tient la formule « regard séducteur ». Il importe autant de faire un maximum d’effet que de maximiser son efficacité, c’est ce que je dis toujours. Je ne sais pas d’où me vient l’expression « maximiser son efficacité », mais nous sommes au début des années 1990 et j’ai pu lire ça dans le magazine Bravo. Oui, dans Bravo





























