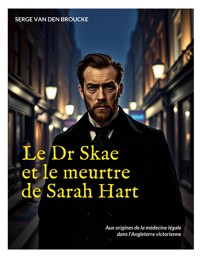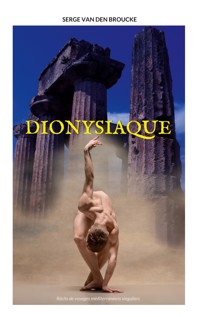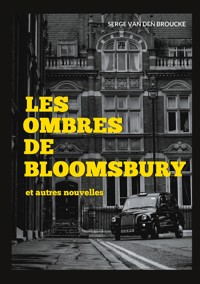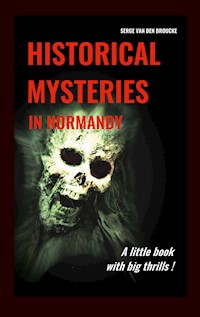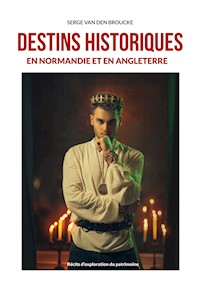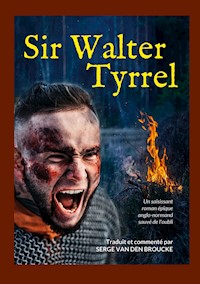
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La fureur d'un guerrier, la passion d'un amant, le remords d'un meurtrier : à l'aube du XIIe siècle, un jeune noble normand tue accidentellement le souverain d'Angleterre Guillaume Rufus, fils de Guillaume le Conquérant, que l'on surnomme le Roi Rouge. Ce geste irréparable va bouleverser son destin et celui de toute la dynastie. Sir Walter Tyrrel est un roman historique bouillonnant et spectaculaire, où les fiers chevaliers galopent bannières au vent, écrit par un auteur anglais anonyme en 1838, qui s'inscrit dans la tradition des grandes épopées médiévales de la littérature victorienne. Présentée ici dans une traduction originale et largement commentée, cette oeuvre injustement oubliée retrouve un nouvel éclat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tous mes remerciements à la British Library de Londres
et à tous ceux qui m’ont permis de faire revivre
ce roman historique anglais méconnu.
Sommaire
INTRODUCTION : A la recherche d’un roman oublié
CHAPITRE I : LA COUR
CHAPITRE II : LE CLOÎTRE
CHAPITRE III : LA FORÊT
CHAPITRE IV : LA VILLE
CHAPITRE V : LE PÈLERIN
CHAPITRE VI : LE CAMPEMENT
CHAPITRE VII : LE CONSEIL
CHAPITRE VIII : LE COUVENT
INTRODUCTION
A la recherche d’un roman oublié
Qui sait combien d’œuvres littéraires oubliées dorment dans les profondeurs des grandes bibliothèques ? Qui sait combien d’auteurs, qui ont sans doute eu jadis leur heure de gloire et séduit un vaste lectorat, sont tombés dans le puits sans fond de l’abandon et de l’indifférence ?
De combien d’ouvrages à succès, aujourd’hui portés aux nues par les medias, se souviendra-t-on dans cent ans, peut-être même cinquante ? L’histoire de la littérature, comme celle de tous les arts, est parfois plus le fruit du hasard que de celui de la pérennité et de la reconnaissance des talents. Des textes peuvent passer de mode, ils peuvent être perdus, ou épuisés, ou délaissés, voire interdits et détruits par la censure des régimes en place selon l’époque, sans que leur qualité intrinsèque soit forcément en cause.
Il y a quelque chose de fascinant à songer à tous ces romans, tragiques ou légers, terribles ou désopilants, qui ont su à un moment ravir l’imagination des lecteurs, les faire frémir d’angoisse ou éclater de rire, et qui, maintenant, s’apparentent à ces artefacts archéologiques que l’on devine sous le sable, mais auxquels on ne peut plus accéder, à moins d’avoir la curiosité et la persévérance d’effectuer des fouilles. Les splendides institutions que sont la British Library de Londres, la Bodleian d’Oxford, ou encore la Wren du Trinity College de Cambridge, parmi bien d’autres, sont donc autant de formidables terrains d’investigation pour l’explorateur dont la littérature et la civilisation britanniques sont les passions. Et on peut souvent y retrouver, avec beaucoup de patience et d’amour des livres – avec aussi, il faut le dire, un peu de chance – des trésors engloutis qui, rendus à la lumière de notre siècle, brillent encore de l’éclat des temps où ils furent créés.
En juillet 1838, juste un an après l’accession au trône de la toute jeune reine Victoria et un mois après son couronnement (28 juin 1838), parut à Londres chez l’éditeur Saunders & Otley, un volume intitulé Historical Tales of the Southern Counties. Il regroupait trois romans historiques médiévaux : The Sea Kings, dont l’action se déroule à l’époque du roi Alfred le Grand ; William of Normandy dont le héros, comme l’indique le titre, n’est autre que le Conquérant lui-même ; et Sir Walter Tyrrel, que nous présentons ici. Les trois textes ont été écrits par le même auteur… mais celui-ci est anonyme. On sait simplement qu’il s’agit d’un « jeune écrivain », et il semble que ce soit sa première œuvre. En réalité, les choses sont peut-être plus complexes. En effet, pour étrange que cela puisse peut-être nous paraître aujourd’hui, l’anonymat était loin d’être exceptionnel dans la littérature anglaise du XIXe siècle, et pas seulement pour d’éventuelles raisons de sécurité dans le cas de pamphlets ou d’écrits scabreux. Bien au contraire, c’était l’une des caractéristiques les plus communes de la condition d’écrivain, tout comme l’usage de pseudonymes. Par une forme de modestie qui confinait à l’obsession, Charles Dodgson était terrorisé à l’idée que l’on puisse découvrir qu’il se cachait sous l’identité de Lewis Carroll, l’auteur d’Alice's Adventures in Wonderland et de Through the Looking-Glass. Quand Jane Austen parvint enfin à faire publier Sense and Sensibility, en 1811, le livre parut avec comme seul nom d’auteur la mention « By a Lady », un stratagème alors très fréquent. Certaines romancières choisissaient un nom de plume masculin, la littérature n’étant pas toujours considérée comme une occupation très honnête pour une femme de qualité, comme les sœurs Brontë qui utilisèrent les pseudonymes Currer, Ellis et Acton Bell. Et inversement, des écrivains parfois très connus optaient pour des identités féminines, comme William Sharp qui, après avoir récolté de nombreux lauriers pour ses écrits sous son vrai nom, entama une seconde carrière secrète absolument fulgurante en tant que Fiona MacLeod.
Ceux qui publiaient totalement incognito, ayant pour seul patronyme « Anonymous », étaient légion. Un nombre absolument considérable de livres publiés en Angleterre aux époques georgienne et victorienne paraissait sans nom d’auteur. Plus de la moitié de tous les livres, en fait. Et cela n’avait rien à voir avec le mérite du roman, ou du poème. Même des géants de la littérature utilisaient ce subterfuge. Parmi les intellectuels, les critiques, et les simples lecteurs assidus se développait alors une sorte de jeu, tant à travers la presse qu’à l’occasion d’interminables discussions dans les salons feutrés de la bonne société, qui consistait à tout faire pour tenter de découvrir l’identité réelle d’un écrivain. Ces enquêtes étaient souvent passionnées, et l’auteur invisible, indécelable, s’en offusquait ou s’en amusait en cachette, selon sa personnalité ou ses motivations.
Saunders & Otley était une maison d’édition prolifique ayant pignon sur rue, avec en catalogue un nombre impressionnant d’ouvrages, dont beaucoup entraient dans un genre spécial appelé silver-fork, caractéristique des années 1820 à 1840, décrivant des romans qui peignaient la vie des aristocrates et des classes les plus élevées de la société. William Saunders et Edward John Otley s’étaient installés au numéro 50 de Conduit Street, où ils éditaient tous leurs livres, tout en maintenant également une activité de bibliothèque de prêt. Les romancières étaient aussi nombreuses que les romanciers : au début de l’année 1837, ils publièrent le tout dernier roman de Mary Shelley, Falkner, et il y avait chez eux pléthore de talents féminins (Agnes Strictland, Elizabeth Strutt, Arabella Shore, Frances Trollope, etc). Saunders & Otley, établissement fondé en 1824, fut en activité jusqu’en 1871. Ils installèrent même un bureau à New York, en 1836. Là-bas, ils furent particulièrement dynamiques et entreprenants pour faire respecter les droits des auteurs britanniques. En 1838, année de publication de Sir Walter Tyrrel, ils firent paraître quinze titres, dont Alice, roman du célèbre Edward Bulwer-Lytton, l’auteur des Derniers jours de Pompéi.
Le roman historique anglais, en tant que genre littéraire qui transmet l’Histoire par le biais d’une narration fictionnelle, ou qui fait revivre des faits historiques avérés en y croisant les destinées de personnages de fiction avec celles de protagonistes bien réels, est riche d’une longue tradition. On considère généralement que c’est le grand sir Walter Scott qui, avec la publication de Waverley en 1814, a posé la première pierre de cette expression artistique qui devint rapidement abondante et fut le terreau fertile sur lequel s’épanouit le talent de beaucoup d’écrivains majeurs, dont Charles Dickens avec A Tale of Two Cities, et sir Arthur Conan Doyle avec The White Company, entre autres.
Quand on voit aujourd’hui l’impressionnant monument commémoratif, haut de plus de 61 mètres, érigé dans les années 1840 à Edimbourg en l’honneur de Walter Scott, il est difficile d’imaginer que l’auteur d’œuvres aussi majeures qu’Ivanhœ (1819) et Quentin Durward (1823) publiait anonymement, n’ayant accepté de reconnaître la paternité de Waverley et des autres titres qu’en 1827, et encore avec réticence. Ses raisons semblent avoir été multiples, entre des difficultés personnelles à assumer le statut d’écrivain, et l’idée que l’écriture de romans ne convenait guère à un homme de loi, sa profession officielle qu’il n’exerça pourtant que bien peu.
L’intrigue de Sir Walter Tyrrel se déroule au tout début du XIIe siècle, précisément en l’an 1100, en Angleterre et en Normandie. On y retrouve les fils de Guillaume le Conquérant, à commencer par Guillaume II dit le Roux, ou Rufus, ou encore, pour les anglais, le Roi Rouge. Son meurtre accidentel dans la New Forest par la flèche de Walter Tyrrel (parfois orthographié Tyrrell ou même Tirel) constitue le cœur du drame, et le déclencheur de toutes les aventures du héros. Walter Tyrrel, dont certains situent la naissance dans la ville de Tonbridge, dans le Kent, mais d’autres en France, était un noble d’ascendance normande, seigneur de Poix, en Picardie, et de Langham, dans le comté d’Essex. Beaucoup de zones d’ombre obscurcissent encore sa biographie, et on en est réduit à des conjectures. En tous cas, si tous les personnages principaux du livre ont bel et bien réellement existé, de même que la trame du récit, de nombreux rôles secondaires viennent compléter et pimenter cette fresque épique souvent spectaculaire pleine d’humanité et de bons sentiments, et parfois saupoudrée d’humour. Il s’agit cependant d’un roman, et pas nécessairement d’une étude scrupuleuse où tout devrait être pris pour argent comptant dans les moindres détails : c’est dire que l’auteur, en redonnant vie avec enthousiasme à tous les acteurs de ces péripéties, attribue parfois à ses personnages des sentiments sans doute un peu décalés par rapport à la mentalité de l’époque qu’il décrit, ou frôle de temps en temps l’anachronisme : on s’étonne par exemple de voir Guillaume et Walter porter des poulaines, alors que ces chaussures, probablement une dérivation esthétique des solerets des armures, ne sont devenues à la mode que bien plus tard, avec une apogée aux XIVe et XVe siècles. D’ailleurs, de récentes recherches menées sur de nombreux squelettes par les archéologues de l’université de Cambridge ont permis de démontrer que le port trop fréquent dans les classes supérieures de ces chaussures évidemment fort coûteuses mais aussi particulièrement inconfortables, ridiculisées notamment par Geoffrey Chaucer dans les fameuses Canterbury Tales, causait bien souvent d’importantes déformations des pieds et des orteils (hallux valgus). Pareillement, on peut s’interroger sur le choix du Havre de Grâce comme lieu d’embarquement du héros en partance vers Portsmouth, au lieu d’Harfleur. Le lecteur avisé pourra sans doute déceler quelques autres détails suceptibles de poser problème. Mais qu’importe tout cela ! Aujourd’hui, au cœur de la New Forest, tout près du village de Minstead, au nord de Lyndhurst, le promeneur féru d’histoire peut se recueillir devant une stèle commémorative érigée à l’endroit précis, dit-on, où Guillaume, le Roi Rouge, tomba sous la flèche de Tyrrel : la Rufus Stone. Tout était donc vrai. Ou presque. Laissons-nous alors emporter par l’action, de bon cœur, sans bouder notre plaisir ! Sir Walter Tyrrel est avant tout une épopée anglo-normande bouillonnante où les bannières des chevaliers claquent dans le vent, où les vagues furieuses de la Manche déferlent en rugissant sur les rivages du Hampshire, où soupirent de belles dames claquemurées dans des couvents lugubres, et où l’amour et la justice triomphent dans un happy end réjouissant !
A sa publication, l’ouvrage ne laissa pas les critiques littéraires indifférents.
Dans The Spectator, on a pu lire : « Le roman fait d’abord de Tyrrel et de Rufus des rivaux en amour, puis reprend l’histoire des errances du chevalier pendant son exil plein de remords, pour avoir été la cause de la mort accidentelle de son ami royal. À ces sujets principaux se mêlent des personnes et des événements secondaires, ainsi que de nombreux éléments destinés à présenter les costumes de l’époque, voire ses coutumes. L’auteur n’a aucune prétention au mérite, que ce soit au niveau de la narration ou des personnages. Mais son livre est une lecture agréable du genre romantique, où tout se règle heureusement selon les souhaits du lecteur, et où même les voyous se repentent ou meurent à point nommé. »
Le rédacteur du Literary Gazette, lui, avait écrit : « Tous les événements sont ici ingénieusement entremêlés d’actes et de personnes fictifs. Les faits historiques, cependant, sont mis en avant et sont simplement allégés, et non perturbés, par l’histoire romanesque. Beaucoup de nos lecteurs, et plus particulièrement les jeunes, peuvent trouver un mélange d’amusement et d’instruction à la lecture de ces récits plaisants. »
Mais c’est bien dans le Monthly Review que l’enthousiasme fut le plus affirmé : « Il s’agit de la production d’un jeune homme, nous semble-t-il, un aspirant à la faveur publique qui n’a jamais encore tenté de travailler sur un sujet aussi vaste et difficile à exécuter. Si tel est le cas, nous le félicitons, car la performance est pleine de promesses et de beauté positive. Il nous semble que l’auteur ne s’est pas contenté de se familiariser avec les périodes et les traditions locales qu’il cherche à illustrer, mais qu’il possède l’art et le goût de fusionner ces éléments pour en faire des récits très efficaces. Son style est remarquable par sa grâce, tandis que son imagination est très sensible au pittoresque. » Et l’aimable critique, décidément séduit, de poursuivre avec admiration : « Il est à peine nécessaire de dire que celui qui peut, dès le début, se débrouiller ainsi, s’élèvera avec son sujet lorsqu’il sera plus expérimenté, et lancera avec aisance, liberté et habileté, tout ce que sa fantaisie esquissera et tout ce que son goût délicat voudra mettre en valeur. » Voila un avis qui a sans aucun doute enchanté le mystérieux écrivain !
Traduire, c’est trahir : on ne connaît que trop la fameuse paronomase traduttore, traditore. Mais quand on s’engage dans un travail littéraire et stylistique visant à mettre à la disposition du lecteur un texte dans une langue qu’il ne maîtrise pas, et donc à lui permettre de découvrir des œuvres qui lui seraient autrement demeurées inconnues, il faut bien faire des choix. Pour Sir Walter Tyrrel, j’ai donc délibérément écarté l’idée d’une traduction littérale, quasiment calquée mot à mot sur l’original : cela rendait la lecture pesante, et les tournures bien souvent maladroites. J’ai également banni la traduction libre qui, certes, offre une souplesse totale, mais prend le risque, à mon avis trop grand, de s’éloigner démesurément de l’esprit, de l’essence même du texte source. C’est donc pourquoi j’ai choisi de me diriger vers la traduction dite sémantique, qui autorise des reformulations affranchies de contraintes strictes, apportant ainsi beaucoup plus de naturel dans l’action et les dialogues, tout en préservant au mieux le style original, le rythme et la dynamique de l’intrigue. Ai-je parfois opté pour certaines interprétations ? Certes, de bonne foi.
Le tout premier paragraphe du roman pourrait surprendre le lecteur pointilleux, et une explication s’impose : en décrivant le Palais de Westminster, l’auteur fait ici allusion au violent incendie qui le ravagea, le 16 octobre 1834. Il ne resta pratiquement plus rien, hormis le fameux Westminster Hall datant du Moyen Âge, qui tient un grand rôle dans le début du récit. Ce désastre fut le plus important à Londres depuis le terrible incendie qui fit rage du 2 au 5 septembre 1666, et qui bouleversa complètement l’aspect de la ville. Le nouvel édifice – celui que nous voyons de nos jours sur les rives de la Tamise – a été construit au même endroit sur les plans des architectes sir Charles Barry et Augustus Pugin, chantre fervent du style néo-gothique, tellement caractéristique de l’ère victorienne.
Le texte original est aussi émaillé de jolis termes rares, qui ont bien sûr été préservés, comme le carcanet, un collier rigide que l’on portait à la base du cou, dont la mode se développa chez les élégantes fortunées non à l’époque médiévale, mais à la Renaissance. Ou encore le samite, désignant un tissu de soie particulièrement luxueux qui trouve sans doute son origine à Byzance. Quant au patronyme du héros, l’orthographe Tyrrel a été tout naturellement préférée, car c’est celle qui est utilisée dans le volume conservé dans les collections londoniennes.
Le jeune auteur anonyme aurait-il approuvé mes arbitrages ? Que l’on m’autorise au moins à croire qu’il aurait été réjoui de voir son ouvrage rendu enfin accessible, plus de 180 ans après sa création, à des lecteurs français passionnés par l’histoire de la Grande-Bretagne et de la Normandie, comme par les trésors oubliés de la littérature anglaise.
CHAPITRE I
LA COUR
Sur la rive sud du pont de Westminster, l’œil du spectateur se pose aujourd’hui sur des masses de ruines noircies et informes, où se trouvaient récemment la House of Lords et les Communes. Près de celles-ci, l’ancienne et solide structure de Westminster Hall, qui avait bravé les dangers de l’incendie de 1834, semble pouvoir encore résister aux aléas et aux changements des siècles à venir. La précision et la beauté de sa maçonnerie, et la noble sublimité de sa majestueuse conception, sont autant d’atouts capables de susciter l’admiration de la postérité et de lui servir d’exemple.
Cependant, en l’an 1100, le bâtiment constituait une extension nouvellement construite du Palais de Westminster, lui-même achevé peu de temps auparavant. L’échafaudage était encore en place à l’intérieur et à l’extérieur des murs, et des foules d’ouvriers couverts de poussière se mêlaient à la soldatesque et aux serviteurs de la cour, l’une des plus puissantes et des plus splendides d’Europe. A cette époque, il n’existait pas de pont sur le fleuve, dont les eaux étaient animées par de nombreuses embarcations navigant entre Lambeth et les villages sur la rive de Westminster. Un charmant matin d’été, au mois de juillet de la première année du douzième siècle, on a pu observer une scène d’une vivacité plus intense que d’ordinaire : une longue file de bateaux ornés de banderolles aux couleurs éclatantes s’avançait rapidement le long de la Tamise, propulsée par les bras vigoureux de leurs rameurs, dont les rames faisaient scintiller l’eau comme une broderie d’argent sous le soleil de ce beau jour. En arrivant en face du palais, on trouva la rive encombrée de badauds, et les officiers de la maison royale, avec les