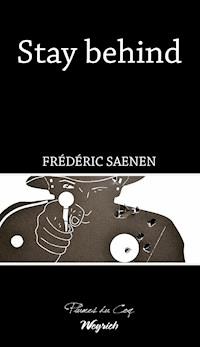
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lorsque l'un des membres de votre famille en fin de vie vous apprend une vérité à laquelle vous n'étiez pas préparé...
Stay behind, « rester derrière ».
L’expression désignait de très secrètes cellules de renseignement et de résistance armée établies par l’OTAN. Son écho a hanté la guerre froide jusqu’aux années 80, ces années de plomb à la belge, quand de mystérieux tueurs couraient les shoppings du Brabant…
Mickaël a trente ans, une petite fille et de modestes boulots de traduction. En ces jours de juin 2016, il rend quotidiennement visite à son parrain, hospitalisé en soins palliatifs. Le jeune homme va alors recueillir l’incroyable confession de celui qui a été toute sa famille, son « bâton de jeunesse ». Pourquoi mentir encore quand les jours sont comptés ?
Un roman où le suspense règne en maître, rythmé par de nombreuses références historiques
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Frédéric Saenen mixe habilement une histoire familiale - et les secrets qui se cache derrière elle - , avec une partie de l'Histoire belge des années 80. Son roman, d'une écriture mêlant la voix off et le récit oral, les confessions d'autrefois et la réalité de l'époque, fait aussi quelques clins d’œil au lecteur."
(Alain Delaunois, RTBF)
- "Polar belge, audacieux et subtil, le dernier Saenen est servi par une langue de haute volée. [...] Au fil d’une habile construction qui fait alterner les confessions de Parrain à Mickaël et les flash-backs dans les années 1980, l’auteur nous tient en haleine d’un bout à l’autre du récit, en nous gratifiant de quelques scènes d’anthologie."
(François Provenzano, culture.ulg.ac.be)
- "La langue que Frédéric met en œuvre est d’une grande précision : rendant palpable l’accent liégeois et le vocabulaire de ses personnages, puis se dotant d’une puissance de feu évocatrice et poétique dès qu’il s’agit de faire revivre ces heures brutales et poisseuses de notre Histoire récente."
(Librairie livres au trésors)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Diplômé de philologie romane,
Frédéric Saenen assure des cours de français à l'UlG. Il a débuté sa carrière d'écrivain avec la poésie pour ensuite se tourner vers des récits courts en prose. Frédéric Saenen accorde une attention particulière à la musicalité du langage et aux sonorités qui se dégagent d'un texte. Cette oralité fortement marquée provient probablement de l'influence qu'a eu Céline, auteur qu'il admire et qui fut son sujet de mémoire. Frédéric Saenen est également critique littéraire pour, entre autres,
Jibrile et
Le Magazine des livres.
EXTRAIT
- Voilà c'est fait. C'est ce qu'il fallait faire. Et je l'ai fait. Oui, je l'ai fait.
L'homme au volant à la gorge nouée en prononçant ces mots. Le passager, très pâle, se tient raide sur son siège, le regard perdu dans le vide. Il parvient à murmurer :
- Tu crois ? Tu crois vraiment que...
- C'est fini, maintenant, les menaces, les saloperies...
- Tu crois ?
L'homme au volant se tourne une seconde vers le passager.
- On a fait ça comme des pros, on n'a laissé aucune trace. Personne ne saura, jamais. Tu t'inquiètes ?
Les lèvres du passager tremblent.
- Je... je sais pas. Oui, je crois.
Sans quitter la route des yeux, l'homme au volant ôte sa main droite du levier de vitesses et la pose sur l'épaule du passager, qu'il presse intensément.
- C'est à la vie à la mort, maintenant, entre nous deux. Merci. D'avoir été là. Sans toi, rien...
Le passager éclate en sanglots. Il répète sans fin :
- Tu crois ? Tu crois ? Tu crois ?
La voiture s'enfonce dans la nuit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Roman
La Danse de Pluton (Weyrich, 2011)
Nouvelles
Quatre femmes (Maelström, 2010) Motus (Le Grognard, 2010)
Essai
Dictionnaire du pamphlet en France, de la Révolution à Internet (Infolio, 2010)
Poésie
Qui je fuis (Le Fram, 2003)
Seul tenant (L’Harmattan, 1998)
I must’ve dreamed a thousand dreams Been haunted by a million screams I can hear the marching feet They’re moving into the street
Now did you read the news today They say the danger’s gone away But I can see the fire’s still alight Burning into the night
Too many men Too many people Making too many problems And not much love to go round Can’t you see This is a land of confusion
Genesis, 1986
Traduction : Je dois avoir rêvé un millier de rêves / Avoir été hanté par un million de cris / Je puis entendre les pas cadencés / Ils envahissent la rue As-tu lu les nouvelles ce matin ?/ Ils disent que le danger s’éloigne / Mais je constate que le feu est toujours allumé / Et brûle dans la nuit Trop d’hommes / Trop de gens / Qui font trop de problèmes / Et pas assez d’amour autour de tout cela / Tu ne vois donc pas / Que c’est un pays de confusion ?
[1984]
— Voilà, c’est fait. C’est ce qu’il fallait faire. Et je l’ai fait. Oui, je l’ai fait.
L’homme au volant a la gorge nouée en prononçant ces mots. Le passager, très pâle, se tient raide sur son siège, le regard perdu dans le vide. Il parvient à murmurer :
— Tu crois ? Tu crois vraiment que…
— C’est fini, maintenant, les menaces, les saloperies…
— Tu crois ?
L’homme au volant se tourne une seconde vers le passager.
— On a fait ça comme des pros, on n’a laissé aucune trace. Personne ne saura, jamais. Tu t’inquiètes ?
Les lèvres du passager tremblent.
— Je… je sais pas. Oui, je crois.
Sans quitter la route des yeux, l’homme au volant ôte sa main droite du levier de vitesses et la pose sur l’épaule du passager, qu’il presse intensément.
— C’est à la vie à la mort, maintenant, entre nous deux. Merci. D’avoir été là. Sans toi, rien…
Le passager éclate en sanglots. Il répète sans fin :
— Tu crois ? Tu crois ? Tu crois ?
La voiture s’enfonce dans la nuit.
Mardi 14 juin 2016
Les portes de l’ascenseur s’écartent dans un grincement et l’odeur de désinfectant, qui flottait, jusque-là discrète, dans le hall d’entrée du rezde-chaussée, me prend aux narines. Je retrouve le papier peint du couloir, d’un ton pastel indescriptible, hésitant entre le bleu, le vert et le gris. C’est la couleur de la fin de vie, la couleur des soins palliatifs. Deux plaquettes marron indiquent les numéros de chambre, à gauche de 1 à 14, à droite de 15 à 32. Je prends à droite.
À cet étage, contrairement aux autres, les portes sont closes. On ne croise guère de malades en peignoir, cramponnés à un déambulateur aux roulettes couinantes, cheminant d’un pas incertain vers la fontaine à eau du « salon de détente ». Pas question de jeter au passage un coup d’œil vers les pieds des lits, où se tiennent quelques proches venus passer une demi-heure, une heure, de silence accablé auprès de celui ou de celle qu’il ne s’agit plus que d’accompagner.
Quand Tante Louise s’est retrouvée en chirurgie abdominale, c’était l’éclate comparé à maintenant. Cela devait être en 1997, vers octobre. J’avais onze ans. Je ne me rendais pas bien compte de la gravité de son état. Des bons souvenirs, en somme, cette hospitalisation. J’avais réussi à copiner avec une petite brune à couettes et appareil dentaire – tout à fait mon genre, à l’époque – qui venait, elle aussi quotidiennement, voir sa grand-mère, dans cette salle commune à quatre lits ; moi, je déposais un bisou sur la joue rêche de Tante Louise et, sur la table de chevet, la barquette de fruits achetée à son intention par Parrain, juste avant d’arriver. Elle n’y toucherait pas et la laisserait se dégrader en compagnie des autres agrumes qui s’accumulaient, chacun à un stade d’avancement différent, en nature morte graduée. J’ai compris plus tard que son régime lui interdisait strictement le sucre de fruits, mais Parrain renouvelait, comme par un fait exprès, l’erreur d’en apporter.
Je la saluais, avec un respect mêlé de timidité, encore impressionné que j’étais, malgré sa position de faiblesse, par cette femme au visage long et grave, marqué davantage par les douleurs de la vie que par la maladie. Puis je cédais la place à Parrain – qui n’appréciait guère mes escapades, je l’avais senti, pas plus que le fait d’avoir à se retrouver seul avec Tante Louise. Je me détournais du morne tête-à-tête qu’ils m’offraient pour me précipiter vers Laura.
Laura Magagnoli, brebis discrète égarée dans le clan des Siciliens qui se relayaient soir et matin auprès de la nonna agonisante. Laura qui, à mon approche, découvrait toute l’argenterie de son sourire et m’accueillait, en rougissant, d’un bonjour aussi salivaire qu’enjoué. Nous demandions la permission d’aller, dans le salon de détente, contempler le paysage. Nous restions là, devant la grande baie vitrée dont nous avons plus d’une fois cherché le mécanisme d’ouverture afin d’accéder au balcon, histoire de respirer à pleins poumons l’air faussement pur du bois de Seraing, étalé sous nos yeux. La Forêt-Noire n’aurait pas eu d’allure plus majestueuse ni plus romantique en ces instants-là, pour moi, l’amoureux transi. Pour Laura aussi, qui sait ? Mais la fenêtre demeurait désespérément inamovible, alors nous nous contentions de rester l’un à côté de l’autre, derrière l’épais double vitrage, face au feuillage dont les mordorures tranchaient avec le gris du ciel. J’attendais dans un silence contrit le moment fatal où ses parents ou une grappe de ses cousins repasseraient en se dirigeant vers les ascenseurs et l’arracheraient à moi. Elle me dirait : « Bon, j’y vais, à demain ! ? » en me gratifiant d’une baise sonore et mouillée. Laura Magagnoli que j’ai croisée en tout et pour tout six fois dans mon existence, puis qui a disparu dans la cohorte des visages sans suite qui peuplent une mémoire. Laura Magagnoli avec qui la vie aurait été sans doute… Aurait pu être.
Je me souviens avoir éprouvé une immense tristesse à découvrir le lit la veille encore occupé par sa nonna, vide et refait, rendu disponible pour une prochaine occupante. Laura avait perdu sa grandmère, mais moi, bien pire, j’avais irrémédiablement perdu Laura. Vingt ans après – foi de quelqu’un qui a essayé –, il est toujours impossible de faire coulisser la fenêtre qui donne sur « notre » panorama. Les salons fumoirs ont été supprimés depuis, mais bizarrement ils paraissent encore plus sinistres aujourd’hui. L’odeur rémanente de tabac froid, incrustée jusque dans les plinthes, n’y est pour rien. Je suis au sixième étage de l’hôpital du bois de l’Abbaye ici, pas au quatrième. Et c’est Parrain lui-même que je viens voir. On ne rigole plus.
Je passe devant le guichet de l’accueil, mais l’employée me reconnaît, plus besoin de me présenter. Je peux me contenter d’un bref mouvement de tête et d’un petit signe de l’index dans la direction que j’emprunte habituellement pour obtenir son laissez-passer. Voilà, c’est ici. Chambre 29.
Je pénètre dans la pièce aseptisée en articulant, d’une voix que je veux la plus distincte qui soit, car Parrain devient dur de la feuille : « C’est moi, c’est Mickaël. » Je fais quelques pas dans cette cellule individuelle, disposée en coude, avec le lit rencogné sur la gauche. Il apparaît, gisant, frêle chrysalide sous un drap immaculé. Intubé dans les narines, sondé dans la vessie, cerné d’une incompréhensible machinerie. Pitoyable et pourtant encore grandiose. Encore majestueux. Encore Parrain, mon Parrain. Mon tuteur, mon bâton de jeunesse.
Il m’accueille d’un sourire narquois. Il n’a plus été rasé depuis trois jours et ses joues se sont couvertes d’une mousseline de picots blancs et drus. Ses yeux, seule partie de son anatomie à encore avoir vingt ans, me lancent un salut muet, d’une complicité électrique. Dire que cet homme aux traits cavés et au visage desquamé, que la maladie a rendu en si peu de temps méconnaissable, déjà squelette, vient à peine d’entrer dans la soixantaine.
Je m’assieds doucement sur le rebord du lit, en veillant à ce que l’irrémédiable maladroit que je suis n’accroche aucun tuyau durant la manœuvre. Je lui prends la main, pas trop tendrement, non, il détesterait ce contact, le rugueux homme, le Parrain de bois sec. Plutôt avec une fraternité rude. « Hê, qué novèle, Parrain, çoula va-t-i on pô mîs ? »* « Çoula n’îrè måy pus, valèt, m’ fi ! »*, me répond-il, et il part d’un ricanement éraillé. Nous commençons en général nos entrevues ainsi, en wallon, ce dialecte dont je ne maîtrise que les phrases toutes faites, les exclamations et les insultes que Parrain m’a transmises. Oui, je parle un anglais digne d’un présentateur de la BBC, un néerlandais passable, je maîtrise des rudiments d’espagnol et d’italien (vacances obligent), mais je ne connais que les formules les plus passe-partout de la langue de mes ancêtres paternels. C’est paraît-il déjà honorable pour quelqu’un de ma génération.
— Le médecin est passé ?
— Pas encore. Vers quatre heures, en fin de tournée, hein ! Un oiseau pour le chat comme moi, ça ne l’intéresse pas…
Je suis mal à l’aise et je me cabre quand Parrain aborde avec autant de désinvolture l’évolution de son état de santé. C’est qu’il a cette lucidité dont il ne s’est jamais départi et qui lui fait rendre des arrêts brutaux sur ce qui le concerne de près. Mais je me garde bien de le contredire. Bien qu’il ne soit plus du tout en position de force, je conserve la peur de ses courroux. J’ai quelquefois eu le malheur d’assister à ce que cela pouvait donner, quand quelqu’un venait à lui marcher sur les pieds. Le mouvement vers l’avant de la mâchoire, le plissement de ses paupières, enfin l’entrée en éruption. Il n’y a qu’avec moi que jamais il ne s’est emporté de la sorte, sauf une fois. Cette seule fois…
Je perçois un léger pivotement du côté des gonds de la porte. Une bourrasque capiteuse fait irruption et annonce d’une voix claire : « La prise de 14 h, Monsieur Reynertz », puis émet un « bonjour » blasé à mon adresse, sans m’accorder un regard. Une ombre passe sur le front de Parrain. Il ne l’aime pas trop celle-là, je le comprends tout de suite. La belle infirmière métisse place à hauteur de l’aisselle de Parrain un petit baquet de carton vert où roule un seul tube. Elle s’en empare et l’ajuste, avec une dextérité toute professionnelle au cathéter qui bleuit le coude de Parrain ; et le sang monte, lentement, comme si c’étaient les ultimes gouttes qui pouvaient s’exprimer de ses veines. « Voi-làààà. »
— On me tire du jus sans arrêt, à se demander ce qu’on en fait… Et je n’ai jamais les résultats.
— Des tests de tolérance, Monsieur Reynertz, on vous a déjà expliqué, pour voir comment vous supportez le trai…
— Ouais, ça va, c’est bon. Si je vis encore, c’est que je les supporte, les traitements… Moi, je crois que mon sang, on le va sûr donner aux Nêêks. Parce que les globules de Blancs bien portants, c’est plus rare et plus cher, et que tout le monde veut se les garder…
L’infirmière, occupée à ranger ses affaires, n’a pas remarqué le clin d’œil de Parrain dans ma direction. Elle se pétrifie et reste bouche bée, « Monsieur Reynertz, enfin, comment est-il possible de dire… ? », et moi-même je pique un fard, j’aimerais rentrer sous terre, et pourtant je suis habitué aux provocations de Parrain. J’interviens, comme d’habitude trop mollement :
— Ne faites pas attention, Mademoiselle, il ne pense pas un traître mot…
— Bien sûr que si, que je les pense, mes « traîtres mots ». Alez, disqu’à d’main, èwarèye*… Et se tournant vers moi avec un air de victime :
— Regarde un peu quel bras elles te font, avec leurs prises de sang à répétition. Qu’est-ce qu’on leur apprend à l’école, donc ?
La jeune fille finit de rassembler nerveusement son matériel et tourne les talons, offusquée, sans plus prononcer un mot.
— Tu es content, je suppose ? Tu t’es encore fait une belle réputation. Tu devrais un peu te tenir tranquille quand même. Je sais bien que c’est long, mais bon, il faut ce qu’il faut.
Parrain retombe, sans transition, dans un état de profond accablement. Il fixe le plafond, et ses mâchoires chiquent un invisible reproche.
— Presque dix jours que je suis ici, gamin. Si on ne peut plus rire… Autant crever, va ! Et c’est ce qui va se passer, souffle-t-il en s’enfonçant encore un peu plus bas dans le coussin.
Puis, brusquement :
— As-tu mangé ?
— Il irait bien mal, à deux heures passées… J’ai pris un croque à la cafétéria avant de monter.
— Et Aurélie, ça lui va ?
Parrain s’évertue à me demander, comme si de rien n’était, des nouvelles d’Aurélie alors que nous sommes divorcés depuis plus d’un an. Sans doute est-ce le fait que nous ayons gardé de bons rapports – surtout pour le bien-être d’Emma – qui fait croire à Parrain que, malgré la distance, nous formons encore « un couple ».
— Je suppose que ça va, Parrain. La dernière fois que j’ai été chercher la petite, en tout cas, ça allait. Je crois que les travaux pour retaper la façade de la maison vont bientôt commencer.
— Un fameux chantier, ça.
— Mmmh.
— Et coûteux.
— Mm-mmh.
— Qui est-ce qui paie ?
Bon sang, on en a déjà parlé avant-hier.
— Je participe, Parrain, normal, non ? Aurélie est dans une situation…
Sa respiration se fait sifflante, signe d’irritation, mais il parvient à rassembler ses phrases et à les aligner, portées qu’elles sont par une certaine âcreté.
— Et toi, tu n’es pas dans une « situation » ? C’est toujours ta maison ou non ? Il faudrait savoir. Tu vis en appartement, tu n’as pas un loyer social que je sache, et tu paies pour des réparations que tu n’as rien à voir avec. Faut pas se faire couillonner, hein, je te l’aurai expliqué je ne sais combien de fois. Déjà, le meilleur moyen de garder ses brokes* avec les femmes, c’est de ne pas les quitter. Un divorce, ça coûte plus qu’un mariage. Autant les laisser où elles sont quand elles sont accrochées, leur donner l’illusion qu’elles portent la culotte et mener sa barque en douce, parce que sinon…
C’est reparti. Après l’élégante remarque à relents racistes, la rengaine misogyne. Comment puisje être tellement attaché à un bonhomme aussi infect ? Je me pose la question au moins une fois par jour, peut-être même davantage maintenant que je lui rends régulièrement visite. Et la réponse va de soi, toujours pareille. C’est Parrain. Mon Parrain. Mon tuteur, mon bâton de jeunesse. Et sans lui, il n’y aurait rien eu, je ne serais rien. Ou du moins pas grand-chose.
Le rythme qui ponctue nos entrevues va bientôt s’imposer. Je vais m’emparer de la télécommande et lui demander si je peux allumer le poste. Il va esquisser sa moue conciliante, en arrondissant les lèvres et en hochant la tête de haut en bas. Ensuite, nous allons nous engourdir, lui dans la sensation sourde et nauséeuse d’être grignoté par le crabe qui s’est démultiplié aux quatre coins de son organisme, moi devant un programme à la con – des imbéciles de cuisiniers novices qui font la course à la meilleure pâtisserie, réalisée à base de restes ou de produits exclusivement jaunes ; un jeu d’argent à 1 euro l’appel où il s’agit de trouver un mot-mystère commençant par la lettre W ; des décérébrés qui passent des journées à médire les uns des autres autour d’une piscine ou sous des couettes. Le cancer sera partout dès lors, dans le corps de Parrain, à l’écran, dans l’atmosphère.
— Ne mets pas la télé si tu veux bien, Mick. J’ai mal à la tête. Et puis, je voulais te parler aujourd’hui.
Le geste que j’esquissais vers la zapette avorte. Je me repositionne dans le fauteuil en skaï dur, mais assez confortable en somme.
— Ah bon. Tu as besoin de quelque chose ?
Sa langue claque un bref « t » agacé contre ses incisives et il fronce les sourcils. On dirait que c’est sérieux.
— C’est sérieux.
— O.K. Ça me concerne ?
— Ça me concerne moi.
— Ben… je t’écoute, mais si c’est vraiment grave, on peut demander à…
— Tais-toi un peu. D’ici une semaine, deux peutêtre, je vais y passer.
— Mais…
— Et ne dis rien, je le sens. Terminé, tout ça…
Et c’est ainsi qu’il se lance, de but en blanc : « Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, je voulais… J’ai des choses à te dire, mais il me semble qu’il y en a tellement, je ne sais par où commencer. J’ai fait le maximum pour toi quand tes parents sont… partis, j’ai essayé de jouer mon rôle de Parrain, je venais d’avoir trente ans, je sortais, je déconnais pas mal. J’avais mieux à faire qu’à m’occuper d’un orphelin. Alors j’ai fait ce que j’ai pu, avec le temps que j’avais et mes affaires à régler. Je n’étais pas très malin, je ne le suis sans doute pas encore… »
Il tousse à déchirer l’âme et s’empourpre brutalement. Je lui tends son gobelet d’eau, il se remet, après avoir repris haleine à grandes goulées, déglutit puis respire plus posément. Il tourne alors la tête vers moi, me regarde comme, je peux bien le jurer, il ne m’a jamais regardé et me dit dans un souffle :
— Ronald Reagan, c’était moi.
[Février 198?]
Ronald Reagan entre en premier, les portes vitrées ont coulissé dans un grincement, cela peut commencer, il s’agit d’appliquer ce que l’on a appris dans la rue à Willy et dans la grange à Tihogne, professionnalisme, technique et sang-froid, Ronald Reagan porte comme Mitterrand et le Vieux un blouson sombre et épais, des chaussures style godillots, et les rares clients à avoir eu le réflexe de quitter leurs commissions du regard à ce moment et à avoir prêté attention à l’irruption du trio captent en un éclair, la vague de panique se forme à la caisse 4 où une femme, la trentaine, son garçonnet assis dans l’espace rabattable du caddie prévu à cet effet, se met à hurler « C’est pour nous, cette fois-ci c’est pour nous ! », et le point de bascule est déjà atteint, elle émet un cri comme il n’en a jamais résonné dans cet endroit, Ronald Reagan avance vers le milieu de la travée où aboutissent tous les couloirs des caisses, et lance le signal, l’ouverture de la chasse, à bout portant, la tête de Jean-Paul Delrée poudroie rouge, le corps s’abat, Jean-Paul Delrée bouche bée, stupéfait, serrant encore dans chaque main les deux sachets de papier beige contenant des bouteilles de pure malt





























