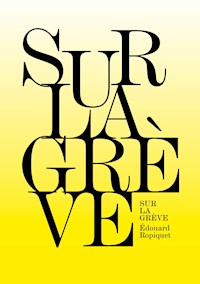
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
ROMAN. Tristan Jacques, journaliste rubricard aux pages vermeilles, développe à leur service une haine des babyboomeurs. Alors que Camping-car magazine le défraie pour un reportage on the road aux Etats-Unis, un éditeur bidon lui commande le réquisitoire qui fixera, dans les siècles des siècles, le portrait de cette "affreuse génération de jouisseurs inconséquents". Sur la grève est le récit de ces quinze jours embarqués, de New-York à San Francisco, en compagnie de Pierre-André, un photographe freelance québécois. Le journalisme et sa vampirisation par les nuls, l'Amérique et l'Europe, la filiation à l'heure du suicide de l'espèce, les misères du tourisme industrialisé, la Peur et la Technique, le Rêve et l'Action, la "révolution" numérique et la "décérébration" qu'elle entraîne ou selon le point de vue accompagne, le Mur du Pacifique, le Savoir et sa crise de foi, tous ces thèmes viennent hanter la conscience du narrateur au fil des kilomètres, et menace la chevauchée fantastique de virer à la décompensation psychotique. Outre une chronique humoristique de la génération coincée entre les babyboomeurs et les millenials, Sur la grève est aussi, et surtout peut-être, le récit d'un homme qui, tel Zarathoustra, s'en va porter ses cendres dans les Rocheuses et découvre au vent de cette "terre puissante" que sous elles gît encore une braise... Et le récit prend la forme d'une lutte au sein d'une âme, trop jeune pour se résigner, trop vieille pour s'illusionner tout à fait, entre cynisme et romantisme. Ce dernier, en dépit de ses ridicules, peut-il redevenir un geste crédible, qui fasse agir de manière positive, encore ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
à Marc Simon, « comme un sauvage au milieu des livres ».
à l’amitié, sans laquelle les déserts demeureraient infranchissables.
Sommaire
Chapitre 1. Double proposition.
Chapitre 2. Paris-New-York.
Chapitre 3. New York, USA.
Chapitre 4. Un jour à tuer.
Chapitre 5. Pierre-André à Montréal.
Chapitre 6. De New-York à Montréal.
Chapitre 7. Montréal.
Chapitre 8. Faux départ.
Chapitre 9. De Montréal à Des Moines.
Chapitre 10. La Plaine.
Chapitre 11. Du Nebraska à la route 66.
Chapitre 12. D’Amarillo à Albuquerque.
Chapitre 13. D’Albuquerque à Falstaff.
Chapitre 14. Au bord du Colorado.
Chapitre 15. De l’Utah au Wyoming.
Chapitre 16. Yellowstone.
Chapitre 17. Du Wyoming au Montana.
Chapitre 18. Du Montana au Pacifique.
Chapitre 19. La Californie.
Chapitre 20. Baie de San Francisco.
Chapitre 21. San Francisco.
Chapitre 22. Épilogue.
Chapitre 1. Double proposition.
L’avenir est aux vieux. C’est dur à dire, plus encore à entendre peut-être, pour quelqu’un qui n’a pas lui-même reçu l’onction du « bel âge », mais il faut se rendre à l’évidence, et bien que ce soit effectivement délirant du point de vue de la stricte logique du vivant : le Vieux monde s’achève en un monde de vieux. L’expérience a d’ores et déjà été réduite à leur mesure, tout est fait pour et même en un sens par eux. La société elle-même est devenue une sorte de centre de repos niché au sein d’un parc de loisirs où ce qu’il reste de jeunesse est mobilisé sous leurs ordres, à leur soin et pour leur divertissement.
Je me suis fait ces remarques aux relents d’oxymores mais ô combien empiriques il y a trois ou quatre ans, même cinq en fait, le temps passe à une telle vitesse pour ceux qui ne le sont pas encore, vieux. Depuis, et en attendant de le devenir moi-même — la retraite pensionnée comme horizon indépassable de l’espoir humain — j’ai décidé, mais il s’agit davantage d’une déduction basée sur deux mille cinq cents ans de philosophie et de science — ou pour être précis de leur échec relatif — que d’un véritable choix, de me consacrer corps et corps — il n’y a plus que ça — à eux.
Passé le moment de morne effroi suscité par la vision d’une pyramide des âges cul par-dessus tête, il y a de quoi se rasséréner : les vieux sont inépuisables, à de nombreux points de vue et d’abord en tant que fonds de commerce.
Dans ma partie, seuls les vieux consentent encore volontiers à s’alléger de quelques euros pour une chose qui se lit en plus de cent-quarante caractères. Depuis cette espèce de révélation la nuit au bout de la jetée, j’écris dans Grey is cute, Golden age, Profiter sous-titré En bonne santé, Si senior, Rester jeune, et autres mièvreries éditoriales. Je me suis même fait un petit nom, la presse généraliste me convoque régulièrement pour traiter de sujets allant du cancer de la prostate à l’euthanasie en passant par la fiscalité sur les droits de succession.
Et ça va beaucoup mieux, d’un certain point de vue. Faut dire que ma vie était arrivée dans une impasse totale. Après dix ans de « carrière », mon entêtement à vouloir faire mon métier dans les règles avait fini par me détruire, sur le plan affectif et mental d’abord, puis physique et financier ensuite. Au passage, et moyennant un arrangement moral offert clé en main par le cynisme ambiant, ont cessé mes problèmes d’argent, ce qui est tout sauf accessoire. C’est même une forme de paix très spéciale dont le prix m’est d’autant plus cher que l’accès m’en a été offert sur le tard.
J’en étais là quand le téléphone sonna, je décroche.
— Allo Tristan, c’est Franck.
Franck est mon « agent ». Le mec chargé de me trouver du boulot car seul j’en serais incapable. La dernière fois que j’ai traité en direct avec un rédacteur en chef, il m’a fallu penser très fort à Epictète pour ne pas lui faire avaler sa cravate. En revanche cela n’a pas suffi à retenir mon poing pris d’une envie subite autant qu’irrépressible de faire un trou dans le mur de son bureau. A ma décharge, la cloison d’un bureau au XXIème siècle a davantage à voir avec une feuille de papier à cigarette qu’avec ses ascendants en pierres de taille. Ça m’a valu un licenciement et dix-huit mois d’effondrement psychique, dont six médicalisés à la clinique psychiatrique L’Ange gardien, située au château de Perreuse à La-Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne.
Il est extrêmement rare pour un pigiste d’avoir un agent, à ma connaissance je suis même le seul. Lui le fait parce qu’il pense que je suis « plus » qu’un journaliste et qu’un jour il parviendra à me faire publier de la fiction, moi ça m’arrange bien qu’il pense ça même si je ne partage pas, ou plus, ses espérances. Il prend 20 % sur tout ce que je gagne. Certains trouvent ça indécent, pour moi c’est raisonnable, sans lui je mourrais la bouche ouverte.
Le personnage auquel joue Franck, un mélange de courtier en prêts immobiliers et de mondain décadent, représente tout ce que je déteste, mais quelque chose d’autre chez lui, peut-être le fait qu’il se sait jouer un rôle justement, résiste à mon antipathie. On a développé une sorte de complicité qui m’est précieuse mais que je n’arrive pas à assumer, la plupart du temps je me sens obligé d’être désagréable.
— Putain Franck je sais que c’est toi.
— Je te dérange ?
— Tu crois quand même pas que je décrocherais sinon.
— Je t’ai trouvé un super job.
— Ok maintenant je vais raccrocher.
— Camping-car magazine aimerait un reportage genre « Sur la route, la folle épopée en RV à travers les Etats-Unis ».
— Et c’est quoi le super job ?
— Je t’adore.
— Je te déteste.
— Non, t’as raison on ne peut rien te cacher, y a un truc vraiment génial, c’est que j’ai rencontré un type qui s’appelle Tim Boothe. Il vient de créer une revue tout ce qu’il y a de plus propre, Lime, je t’envoie le numéro zéro. Ça m’a donné une idée : lui vendre une version sauvage de ton trip. Tristan c’est l’occasion où jamais de faire ton truc sur la génération babyboom et son abominable passif, tu tournes autour depuis si longtemps, c’est le moment, je le sens. Je pense même que tu pourrais le faire en feuilleton, genre XIXème, et une fois tout sorti je te trouve un éditeur pour le compiler en roman. Boothe est ravi, faut dire lui n’aura accessoirement rien à débourser. Il m’a promis une carte blanche totale. Je lui ai ressorti des textes que t’avais faits avant de renoncer, il a surkiffé. Tristan, je peux le sentir on y est, putain. Tu vas pouvoir la chevaucher à ta main cette salope de vérité. Vas-y Tristan déverse moi ton doux jus. Oh oui…
Je me demande un moment si ce con ne va pas vraiment jouir avant qu’il éclate de rire, ce qui moi me laisse de marbre.
— Quoi, t’es pas content ? poursuit-il. Douze mille signes de bêtise confondante à Bailly, payés grassement soit dit en passant, et le tour est joué. La liberté au bout du Bailly, Tristan ! Tu vas pouvoir lâcher les chevaux cowboy. Purée j’ai hâte d’entendre la cavalcade.
C’est la grande théorie de Franck, je serais un auteur sous-employé. Jusqu’ici j’ai juste réussi à prouver que j’étais un journaliste moyen avec tout ce que ça suppose de soumission et de négligence. Le temps où je vivais l’écriture comme un sacerdoce, un viatique, comme le début et la fin, comme le seul horizon de liberté offert aux nés sous la mauvaise étoile, tout ça est révolu. Que sont mes rêves devenus, chantait l’autre ? Quelques vapes exhalées parfois par l’ivresse… Et encore, de loin en loin.
Je suis sceptique, si vous saviez combien de fois on me l’a fait le coup de la carte blanche. Le nombre de fils à papa qui se lancent dans le business en te disant « Chez moi t’écriras ce que tu veux » et qui finissent par ne jamais rien sortir ou par ne jamais te payer… J’ai plus l’âge de croire que les boulots géniaux sont peu voire pas rémunérés et les trucs de chiottes des coffres-forts sur pattes.
C’est sûr que ce n’est pas un truc qui risque d’arriver à Bailly, les retards de paiement. Avec tous ses défauts, grâce à eux plutôt, cet empaffé est blindé. Camping-car magazine est avec un vilain jeu de mots le poids-lourd du secteur, il est ce que Elle est (ou était peut-être) à la presse féminine. Son lectorat est le cœur du réacteur pour les annonceurs : le jeune retraité dont l’épargne est inversement proportionnelle à la capacité de raisonner. Entre 60 et 70 ans, l’individu est particulièrement faible. Il connaît un moment où le vide d’une existence insignifiante lui apparaît dans un vertige inouï. Ce qui la remplissait jusque-là se retire, laissant le bougre à une triste vérité : il a perdu sa vie à la gagner. Une situation favorable à tous les petits génies du marketing qui peuvent littéralement surfer sur cette vague hormonale composée d’angoisse et d’auto-dépréciation, dans le but de lui faire acheter toutes sortes de conneries. Ce pauvre diable est réduit en une bête de consommation prise dans les phares d’un vendeur de bagnoles. C’est la grande fuite en avant : il consomme, consomme, consomme, pour oublier, oublier, oublier que sa vie est ratée, complètement fichue, qu’il ne peut plus rien y changer et que non seulement il va bientôt crever, mais qu’en plus sa mort sera probablement précédée de quelques mois ou années pendant lesquels ils ne reconnaîtra plus les huitième et neuvième merveilles du monde (ses enfants bien entendu), remettra des couches, sera torché par des bonnefemmes qui le traiteront comme un demeuré et aux émoluments desquelles ce qui reste de ses économies sera englouti. Avec un bon Alzheimer un tant soit peu précoce, le pavillon remboursé à la sueur de toute la famille sur vingtcinq ans y passera tout entier. Voilà le cœur de cible comme disent les commerciaux en bras de chemise employés des régies publicitaires. Et moi dans tout ça je suis assis dans la salle des coffres je regarde le hold-up se faire et j’encaisse ma part, pour cela.
J’ai mis du temps avant de comprendre, et encore plus de m’y résoudre : mon boulot consiste à remplir des pages entre des pubs avec des sujets « concernants ». Le rapport avec la prostitution ? Je vends ce qu’il y a de plus intime, mon silence. Non je ne vous dirai pas que ces gens-là se contrefichent de vous apprendre quelque chose, de vous informer, ou je ne sais quels mots qu’ils emploient pour vous persuader du contraire. Je ne vous dirai pas que leur but est que vous régressiez car plus vous êtes bêtes et plus vous consommez, et plus vous consommez plus ils sont riches donc contents. Je ne vous dirai pas tout ça parce que je suis payé précisément pour le taire, et tout le talent que l’on demande à un journaliste au XXIème siècle est sa capacité à faire accroire que quelque chose est dit, alors que rien, absolument rien ne sortira jamais de ses lignes.
Ce en quoi ce métier demande quelque talent de maquilleur, voire de prestidigitateur… mais s’il s’agit au final de berner le lecteur, le premier auquel il faut mentir c’est à soi-même.
Ça m’a toujours fait marrer toutes les théories qu’ont les patrons de presse sur le déclin du papier dont internet est l’épouvantail indépassable. Ces gens habitant presque tous dans l’ouest parisien, ou ce qui peut y ressembler, ne peuvent tout simplement pas s’imaginer que les lecteurs puissent être moins débiles qu’ils se les représentent et qu’ils en ont juste marre d’avaler les fruits de leur indigence intellectuelle et morale.
— Attention, poursuit Franck en me tirant de ma rêverie, il va falloir jouer serré, si Bailly le découvre je suis cramé pour l’éternité et toi avec mon chéri. Et aussi j’oubliais… La seule condition c’est que tu partes la semaine prochaine, il veut la copie pour le 31 juillet, non négociable.
— T’as fini ?
— C’est tout ce que ça te fait ?
— On se rappelle.
Ne jamais montrer le moindre signe d’enthousiasme devant quelqu’un, en particulier quand un rapport d’argent vous lie, a fortiori donc devant son agent. Même si le mien est probablement trop attaché à moi pour ça, il y a toujours le risque qu’il en tire parti. Depuis le début de notre relation, je fais tout pour qu’il croie avoir davantage besoin de moi que l’inverse, ce qui ne trompe personne j’imagine, à part moi bien sûr.
Franck n’est pas complètement idiot, en tout cas il me connaît, il ne se trompe pas quand il dit que c’est le genre d’opportunité que j’ai toujours attendu, secrètement. Il sait bien que ça va rallumer une putain de lumière dans ma putain de cervelle.
Je fais mine de m’être converti sans réserve au cynisme, tel le fond irréfragable de la conscience contemporaine, mais ai-je véritablement renoncé ?
Ne serait-ce pas l’occasion de dire quelque chose de véridique sur les babyboomeurs ? Cinq années d’immersion auprès d’eux ont achevé de me convaincre qu’ils sont véritablement la pire saloperie de génération qu’il n’ait jamais existé sur cette terre. Aucune avant elle n’avait eu ce culot confinant au génie maléfique de refermer le monde derrière soi, privant sans vergogne les « chères générations futures » de tout avenir.
Et le mythe de la route… Celui de la traversée des States… C’est le symbole de cette génération et de son éveil. N’est-ce pas le cadre idéal pour essayer de comprendre comment leur rêve, auquel je reconnais une grandeur indéniable, a pu virer en un tel cauchemar ? Sur le papier ça peut avoir de l’allure.
Il faut préciser, quand je parle de rêve tourné en cauchemar, c’est bien évidemment pour nous, leurs gosses, qu’il a viré à l’aigre. Eux-mêmes ont toujours vécu et vivent toujours dans un rêve. Le fait que ce dernier ait évolué du rejet de la société de consommation à l’adhésion pleine et entière à la social-démocratie, n’a que peu d’importance. Ce qui est significatif, c’est que rien ne les empêchera de vivre jusqu’au bout leur destin de génération dorée dans les siècles des siècles. Ils auront tout eu et auront tout ad vitam aeternam. Tant pis pour nous, malheur à nous, si c’est au prix de notre vie que la leur a pu être et demeure une succession de plaisirs.
Quel intérêt pourrait-il y avoir à la dire, cette prétendue vérité ? Je ne sais même plus ce que ça fait de vivre en paix avec soi-même. Depuis ma fameuse « conversion », je vis scindé entre d’une part la force centrifuge inhérente à toute vérité qui tend à trouver des moyens de s’extérioriser, et d’autre part la nécessité de garder cette parole pour moi car sa divulgation me laisserait sans travail, haï des gens que j’aime et paria d’une société limitée à la fable giscardienne du monde, dont la version macronienne est une copie à peine remaniée.
Sans oublier que même si je craquais, si la folie de l’expression me prenait un matin sans défense, comment pourrais-je être à la hauteur du bidule ? C’est pas de la petite bière, il s’agit de peindre une époque, voyez un peu le tableau, ce n’est pas tout le monde qui peut tenir le pinceau. J’ai les épaules qui fondent à la seule idée de m’asseoir devant la toile. Et puis j’ai toujours pensé que ce n’était pas du manque de bons peintres dont souffrait l’époque mais de sols suffisamment fermes pour y poser leur chevalet.
Le nihilisme s’est répandu à peu près partout, et même s’il y avait caché quelque part une bande de types assez ahuris pour se souvenir que l’homme fut autre chose qu’un gamin stupide ivre de cupidité capable de ne poursuivre nul désir que celui de sa jouissance propre et sans détour, imaginons même qu’ils soient suffisamment solides pour ne pas avoir accepté d’être réduits en idiots utiles de la Culture, que pourraient-ils vraiment ? Medium is the message. Les vieux contrôlent toute la chaîne des pouvoirs et des canaux de diffusion. Prenez l’âge moyen dans les conseils d’administration ou le niveau de sénilité médian au sein des comités exécutifs… Même ceux qui sont « jeunes » dans ces milieux-là ont été choisis par des vieux en raison précisément de leur grande vieillesse d’esprit. Même quand ils sont élus jeunes, au hasard à 39 ans, ils en ont 90 dans leur manière de ne pas penser. Les sondeurs eux-mêmes ne parviennent pas à oblitérer cette inquiétante vérité : ces prétendus jeunes artisans du « nouveau monde » sont élus par les franges les plus âgées du corps électoral. De toute façon les jeunes ne prennent quasiment plus la peine de voter, voir les chiffres de l’abstention chez les moins de 30 ans. Ici aussi, internet sert d’épouvantail : « mais enfin de quoi vous plaignez-vous, aucune génération n’a eu un moyen d’expression aussi libre et facile d’accès ». Je me contente à leur manière d’un « mdr ».
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, je ne vois pas comment cette aventure pourrait être autre chose qu’un fiasco. La perspective, très bourgeoise au final, de me réconcilier avec mon petit moi ne peut pas faire le poids face au risque d’une régression massive, d’un retour à quand j’étais dans la merde, gavé de médicaments, nu sous une robe de papier bleu ciel.
Vivre en paix avec les autres ou avec soi-même, c’est l’un ou l’autre. Je croyais que ce choix était derrière moi, qu’est-ce que je vais aller me remettre dans les affres.
Que peut un rêve de jeune homme dans le cauchemar sénilisé ?
Si mon agent Franck a pu se laisser griser, moi je dessoule vite. Et de toute façon il oublie quelque chose, je suis déjà engagé ailleurs. Une « mission » annuelle avec Le Sémaphore, bel oxymore pour un hebdo qui aurait tendance à désorienter ceux qui s’en remettent à lui. Un truc chiant à mourir, le marronnier de la rentrée : « Comment se débarrasser d’un locataire mauvais payeur ? », « à quelques semaines de la trêve hivernale » étant le sous-entendu évident à chacun. Aucun intérêt mais ça fait partie des trucs qui assure la gamelle. J’ai la même deadline, le 31 juillet. Ça peut paraître bizarre pour un dossier à paraître en septembre, mais faut bien que tout le monde puisse profiter de sa maison à l’île de Ré, c’est bien connu seuls les gens hors du coup bossent en août.
Je n’aime pas trop revenir sur ma parole. Il paraît que c’est pas d’époque, mais moi je nie cette époque. Bon dieu quelle coquetterie.
— Tristan !
Mon amie m’appelle. J’oubliais presque… Il y a un autre empêchement, plus sérieux encore. Franck ne peut pas savoir, Paula m’a appris il y a trois jours qu’elle était enceinte. On s’est à peine parlé depuis. En gros il nous reste un mois pour dire si on le garde ou pas. Elle, elle veut. Moi, je ne sais pas. Dans l’absolu, pas trop, mais je l’aime cette fille. Et si jamais… C’est sûr qu’elle se tire. Je dis pas que la femelle a la voix de l’espèce en elle, je dis juste qu’une fois la chevillette tirée la bobinette choit immanquablement. Et cette espèce d’appel de l’au-delà, toutes ne l’entendent pas, mais Paula elle, l’a bien reçu, c’est sûr. Je respecte. Il paraît que cela arrive à des hommes aussi, mais en ce qui me concerne j’ai l’impression que cette espèce de convocation divine ne résonnera jamais à mes oreilles. Enfin bref, je ne vais quand même pas me tirer en reportage en ce moment, ce serait une provocation.
— Tristan !
— Quoi ?
— A table.
— J’arrive.
Ça y est, je le vois arriver, je vais devoir supporter l’opprobre réservé au dernier des phallocrates. Je vais même avoir l’air de me défendre si je dis qu’en fait la plupart du temps c’est moi qui prépare le diner. Pour une raison simple, j’aime bien bien manger et Paula, on ne peut pas dire que ce soit son truc la cuisine. Je ne lui en veux pas, le rapport que nous avons à la cuisine est tellement fondé sur des trucs qui nous dépassent. Ce qui est sûr c’est que moi je ne déconne pas avec ça. Je me suis toujours dit que toute conduite symbolique commence aux fourneaux. La première œuvre d’art sur terre n’est pas inscrite sur les parois de Lascaux mais perdue quelque part et à jamais dans le sublime de la non-inscription, elle est dans le geste du premier australopithèque ayant eu l’idée géniale d’agrémenter sa cuisse de biche d’une pincée d’herbes fraîches émincées. C’est le trait de fracture par lequel l’homme n’adhère plus tout à fait aux déterminations de la nature. Cet australopithèque est le Prométhée ignoré.
— C’était qui ?, embraie-t-elle.
— L’ascendant très lointain mais direct d’Olivier Rœllinger.
— Quoi ?!
— Non excuse j’étais dans mes pensées.
— T’es vraiment bizarre. Avec qui tu parlais au téléphone…?
Elle est en train de tapoter sur sa tablette. Je ne supporte pas, elle le sait. Non pas qu’elle s’en moque mais c’est à l’évidence plus fort qu’elle. Les dix-huit premières années de ma vie, j’ai passé mes diners entre un père scotché devant le jt de ppd et une mère à laquelle était greffé un combiné et qui ne trouvait jamais d’autres moments que celui de passer à table pour pérorer avec ses copines, belles-sœurs, et affidées. Paula sait tout ça mais elle ne s’en aperçoit même plus. Je ne lui en veux pas je sais bien que les machines sont plus fortes que nous. Il est vain de lutter et je me sens souvent ridicule quand j’essaie, c’est pourquoi j’essaie de moins en moins. Toute cette énergie, toutes ces années passées à résister pour découvrir au final que la seule sagesse consiste à nager avec le courant.
— Tu veux pas me dire ? relance-t-elle, à deux doigts de minauder.
Elle lape sa soupe en levant les yeux de trois quart sur le côté. Je suis pris de court. Pour l’instant la conversation est anodine, presque automatique, quoi que je puisse dire elle va me répondre « Et il, ou elle, va bien ? », et dans dix minutes je pourrais lui demander qu’elle ne se souviendrait plus de qui on a parlé. Mais là je sais très bien que dans la façon dont je vais dire « Franck », une alarme va se déclencher. Plus j’essaierai de le dire de manière neutre et innocente, plus l’intensité avec laquelle son radar va s’activer sera grande. Je suis pris au piège. Déjà ce bref silence, cette vague hésitation, sont gros de menaces et chaque dixième de seconde supplémentaire rendra plus violent l’orage à venir.
— C’était Franck. Elle est bonne ta soupe, m’empressé-je d’ajouter.
— Qu’est-ce qu’il voulait ?
— Ça y est je suis dans la nasse, elle a arrêté la tablette et me regarde bien droit désormais.
— Rien.
— Te fous pas de ma gueule, Tristan. Je te respire à dix mille.
C’est vrai qu’elle me sent comme personne. C’est même le seul truc qui me rassure sur la capacité de notre couple à durer, parfois.
— Il m’a trouvé un truc. Enfin deux trucs même… Un reportage sur les vieux qui refont Sur la route en camping-car. Une version officielle pour Camping-car magazine, et il a trouvé une revue qui fait dans le journalisme bon teint où je suis assuré, paraît-il, de pouvoir retranscrire ce que je vois et j’entends, et même ce que je ressens et pense, avec les mots que j’estimerai appropriés pour le faire. Le tout dans le but ultime de rédiger la somme à charge de ces affreux babyboomeurs.
— C’est super.
— Je vais dire non.
— Pourquoi ?
— Je suis déjà engagé ailleurs et en plus c’est urgent, Bailly veut que je parte la semaine prochaine, le bouclage est dans trois semaines.
— Silence intersidéral.
— Avec qui t’es déjà engagé ? rompt-elle d’une manière inattendue.
— Qu’est-ce qu’on s’en fout, c’est vraiment pas la question.
— Pourquoi t’es agressif, tu peux bien me dire.
— Excuse. Le Sémaphore, tu sais le truc que je fais chaque année sur les gentils vieux propriétaires démunis face aux méchants jeunes locataires.
— Laisse-les tomber, tu t’en fous. Tu dis tout le temps que c’est des gros cons.
— Je peux pas, tu sais bien.
— Quoi ? Tu vas réellement me parler de tes principes, là, maintenant ? Tristan, tu te fous de ma gueule. Tu passes ton temps à couper les cheveux en trente-huit, me dis pas que tu crois à tes salades. Tu vas continuer combien de temps comme ça ? Ne me la fais pas à l’envers, je te connais, tu sais aussi bien que moi ce que veut dire cette offre. Tu sais, y a que toi pour te persuader que t’as renoncé, personne n’y croit. Je peux l’entendre d’ici ta putain de voix qui te dit Vas-y Tristan. C’est l’occasion de faire ce que t’as toujours essayé de faire. Je le sais, tu le sais, tous ceux qui t’aiment le savent, il y a quelque chose en toi et rien ne pourra aller tant que t’en auras pas accouché. Alors tu vas arrêter de fuir Tristan, sinon c’est moi qui vais finir par me barrer. J’en ai marre de vivre avec un fantôme. T’es en train de flipper c’est normal mais je vais te dire cette fois tu ne vas pas te défiler. En ce qui me concerne c’est réglé tu pars, je veux plus te voir dans les parages.
Paula se lève et commence à débarrasser. Je suis sonné, pris à revers. Une frappe chirurgicale, elle n’a pour ainsi dire même pas élevé la voix. Faut que je dise quelque chose sinon elle va monter direct et je vais perdre la main, la communication sera rompue pour le reste de la soirée.
— Tu crois pas que c’est pas le moment ? On n’en a même pas reparlé.
Elle repose le saladier mais ne se rassoit pas.
— Moi j’ai rien à dire, tu sais ce que je pense. J’ai pas envie de te le vendre ce bébé. T’as envie ou t’as pas envie ! Ça doit venir de toi. Que tu sois là ou ailleurs je vois pas ce que ça change de toute façon.
Elle monte et ne claque même pas la porte. Cette fois je crois que c’est plus la peine d’espérer. Tout est dit.
Une partie de moi, sûrement pas la meilleure, est flattée par ce que Paula vient de me balancer, je crois même qu’une bouffée d’amour me parcourt, mais l’autre partie, sûrement la plus grande, est très énervée. Elle a beau jeu de jouer la gardienne des destinées, on aurait cru entendre un slogan publicitaire vantant les mérites d’un polo, d’un téléphone, ou toute chose dont selon la folie de l’époque la possession fera de nous ce que nous sommes vraiment. Le storytelling et le développement personnel sont les horizons indépassables des créatifs de l’époque. Mais ma chère Pénélope semble oublier qu’il n’y a pas si longtemps, avant que je me lance dans le vieux, elle était la première à me les briser quasi-quotidiennement avec les problèmes d’argent. Je ne suis pas sûr qu’elle soit prête à assumer si je devais retomber dans la débine… Quel prix est-elle réellement prête à payer pour que son petit copain « se réalise » ? On s’habitue au confort… Et moi qui sais bien où peuvent mener les rêves d’un homme, je serais bien le dernier à blâmer les femmes qui privilégient les placements pépères aux fonds hautement spéculatifs.
La soirée se finit comme ça, chacun derrière son ordinateur, elle sous la couette, moi dans le salon, à bonne soit faible distance du bar.
Chapitre 2. Paris-New-York.
Six heures du matin, Roissy Charles-de-Gaulle, j’ai des frissons. Je suis toujours parti en reportage le stylo à l’oreille mais cette fois c’est différent. J’ai l’estomac noué, et pas seulement à cause du café des distributeurs. C’est étrange, c’est sûrement la première fois que j’ai l’occasion après toutes ces années de frustration professionnelle de faire quelque chose de différent, quelque chose qui compte. Je devrais être tout excité, au lieu de ça je me sens grave. Pour une fois je ne pourrai pas me cacher derrière la médiocrité d’une profession ou d’une époque, ce que je ramènerai j’en serai comptable. Sentir une idée dans sa chair est un événement rare, ça n’arrive quoi, une fois, deux fois dans une vie ? et encore pas tout le monde… Aujourd’hui je sens ce que des générations de philosophes ont tenté de décrire : la liberté pèse. Et ce n’est pas une image, je sens parfaitement son poids me comprimer la poitrine.
Mon avion décolle dans trente minutes. C’est marrant cet excès de langage qui revient à s’approprier un truc qui ne nous appartient pas du tout, ça me rappelle un ancien chef qui disait « mes journalistes ».
L’embarquement est toujours un moment pénible pour moi. Comme tout moment de transport collectif du reste, il concentre tout ce qui est devenu insupportable dans la vie en société et rappelle douloureusement que le manque d’éducation atteint un niveau endémique. La non-assimilation des quelques règles permettant de donner quelques indices aux gens sur ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire en présence de leurs congénères, les transforme en troupeau de bœufs indisciplinés. Résultat, la loi du plus vulgaire l’emporte invariablement. La loi du plus fort a mauvaise presse mais je crois que je préférerais encore.
Ça ne loupe pas. A peine installé, un gamin de cinq ou six ans est en train d’emmerder vingt personnes et le père est ravi. Je lui ferais bien ravaler son sourire à ce crétin. J’essaie de rester calme, faut se méfier maintenant dans les avions, surtout à destination des Etats-Unis, tu te ferais « taser » pour un rien.
Avec le peu de réflexion qui me reste, je me dis qu’il y a cinq chemins devant moi. Sans aucun ordre : supporter sans broncher, aller voir le père, aller voir le gamin, aller voir l’hôtesse, soit lui demander de me changer de place, soit lui demander de régler le problème, après tout ce doit faire partie de sa formation. C’est merveilleux comme les mauvais génies de ce monde ont inventé une procédure pour chaque chose. Cela annihile l’intelligence et fait de nous des robots au sens propre du terme mais c’est aussi très reposant. D’ailleurs c’est peut-être ça la meilleure solution, à Rome vis comme les Romains, en Chrétienté vis comme les crétins, au milieu des robots vis selon la procédure.
— Pardon Mademoiselle.
— Madame.
— Pardon Madame, quelle est la procédure pour calmer un gamin qui est en train de mettre en pelote les nerfs de vingt personnes et dont les parents sont complètement défaillants, noyés dans l’adoration de leur chiure ?
— Pardon ? semble-t-elle sincèrement étonnée au regard que font ces yeux bleus-gris magnifiques.
— Que devons-nous faire en la circonstance ? On ne va quand même pas laisser un môme terroriser une vingtaine d’adultes !?
— Veuillez vous rasseoir s’il vous plaît, je vais demander à mon responsable.
Il se trouve que la réplique de Ken passe au même moment derrière nous. Voyant la gène de sa consœur et probable partenaire sexuelle lors des nombreuses escales récréatives que connaissent les personnels naviguant sur long courrier, la version XXIème siècle du mâle alpha — bodybuildé, épilé et bronzé toute l’année — ne pouvait faire autrement que d’intervenir.
— Bonjour Monsieur, puis-je vous aider ?
— Bonjour Monsieur, j’aimerais bien oui. Que pouvez-vous faire pour nous protéger de la petite terreur là-bas ?
Je n’avais pas besoin d’en dire plus, le drôle en question était en train de tirer les cheveux d’une femme devant lui. Comment cela pouvait-il finir huit heures plus tard ?
— Je vais voir ce que je peux faire.
— Merci Monsieur.
Je vais me rasseoir et attends de voir de quel bois notre Ken se chauffe. Je le vois se diriger vers le père, et lui murmurer quelque chose, je n’entends pas. Le mec le regarde l’air de ne rien comprendre et dit un truc à son gniard. Ce dernier se rassoit, ouf.
Une minute trente, c’est le temps qu’aura duré le calme. Notre chérubin d’amour s’est remis à crier. Des sons aussi stridents que non-articulés. La régression c’est parfois concret. Je supporte une demi-minute et retourne voir l’incarnation des poupées Mattel ici-bas dans les airs.
— C’est quoi le niveau 2 du plan Orsec ? demandé-je.
— Malheureusement je ne peux pas grand’chose d’autre Monsieur.
Mon sang ne fait qu’un tour. Je déteste perdre mes nerfs, l’avalanche une fois retombée laisse à chaque fois place à une montagne de culpabilité, mais là je suis déjà rentré dans la zone grise où la partie reptilienne de mon cerveau prend le dessus. Une fois la partie arrière aux commandes notre cerveau ne connaît que deux manières d’agir, l’agressivité ou la soumission. Le mien a clairement choisi la première, je me rue sur le type et commence par gueuler sur le môme qui ne comprend pas ce qu’il lui arrive. En deuxième coup de raquette, j’aboie sur le père :
— Vous ne voyez pas que votre gamin fait chier tout le monde. Ça vous dérange pas, non ?
Le mec ne bouge pas, hagard, il est dans la bulle où son système nerveux est comme paralysé. Dans la nature il serait déjà mort.
Une super mamie se lève et prend sa défense :
— Mais enfin Monsieur il ne nous dérange pas, c’est un enfant faut bien qu’il joue. Allez vivre dans les bois si vous ne supportez plus personne.
Un tombereau d’assentiments sourds ponctue son intervention. C’est sur moi que s’abat l’opprobre désormais. En horrible réactionnaire, j’ai omis quelque chose : pire que l’inconvenance subie par les désordres éducationnels d’un enfant est la remise en cause du statut de l’enfance comme totem indépassable de cette société. L’enfant n’est pas roi, il est l’étalon. Ce qui va parfaitement avec le pouvoir des vieux, il suffit de rentrer une fois dans la salle commune d’une maison de retraite pour s’en convaincre. Qu’at-il bien pu ne pas se passer pour que cela ressemble autant à une cour d’école maternelle ?
Les mêmes qui, il y a une trentaine de secondes, soupiraient en signe d’agacement et de dépit face à cette pauvre famille en errance pédo-psychologique, sont désormais la tête dans les épaules à acquiescer bêtement ce que dit cette connasse de vieille bonne femme.
Ken ne met pas longtemps à arriver. A sa décharge, parti comme j’étais, sans lui, je finissais « tasé », c’est sûr. Merci Ken ! Il me prend habilement par la taille et m’éloigne.
— Venez je vous prie, je vais vous mettre en business, il me reste des sièges disponibles.
Et c’est ainsi que je me retrouve exfiltré, je n’ai même pas le temps de retourner chercher mes affaires, Paloma — oui j’ai envie de l’appeler comme ça — a dans le même mouvement que son vibromasseur sur pattes rassemblé l’ensemble de mes biens et nous suit vers le monde feutré de la business class.
Je suis furieux à l’intérieur, je ne veux pas accepter, c’est une injustice, j’en fais un principe, et caetera, mais le calme ne met pas bien longtemps à revenir, comme toujours. Toute cette agitation pour finir toujours dans le calme… Il est revenu d’autant plus vite que la business est un monde de luxe et de volupté au contact duquel les principes d’un énervé de service deviennent incroyablement évanescents. Je découvre un monde de paix. Je ne sais plus qui demandait mais il savait indéniablement de quoi il parlait : Est-ce que les riches font du bruit ?
Et si le vrai luxe, c’était l’espace, chantait une pub pour je ne sais quoi encore… Les riches se sont construits un monde parallèle. Leurs architectes, urbanistes et élus ont bien travaillé pour les cloisonner du vulgaire.
J’ai appris à l’inverse de mes dépens, grâce à ma mise en quarantaine en forme de plongée ethnographique chez les dominants, que des berlines particulières viennent chercher les passagers de la business sur le tarmac, directement au pied de l’avion. Le bon peuple ne voit rien puisqu’il est condamné à attendre en se mettant des coups de valises sur le crâne vu qu’il y aura toujours des imbéciles pour se lever et descendre leurs bagages tout en sachant qu’ils resteront vingt minutes debout dans des positions fort ridicules à attendre de descendre, comme s’il existait une manière de doubler ses petits copains à la sortie d’un avion… En fait oui, c’est d’être en business.
Quand l’hôtesse me demande de monter dans cette espèce de grosse berline allemande je me demande vraiment ce qui m’arrive, je m’imagine déjà pris en charge par le NYPD, une enquête est ouverte pour l’agité du vol AF10 en provenance de Paris CDG.
Tu parles d’un interrogatoire… Le chauffeur me débarque dans un salon où je retrouve la vingtaine de mes nouveaux amis. Serviettes chaudes et rafraîchissements. En bon parvenu, bien content de pouvoir boire du Ruinart à l’œil, je m’enfile quatre coupes à la file. Je commence à être drôlement bourré après les deux bouteilles déjà sifflées pendant le vol, il est temps de me carapater.
Quand on connaît le niveau d’affabilité moyen d’un douanier en général, américain de surcroît, y a de quoi flipper. Mais pour la première fois de ma vie, le passage en douanes n’est pas un stress. Là encore c’est pas le même traitement. Derrière la moustache de rigueur, les muscles faciaux de mon officer comprennent dans son programme spécial riches un rictus que je peux assimiler à un sourire, incroyable. Ça me détend.
Je suis allé vite en besogne, il me demande un papelard, je ne comprends pas.
— Quoi l’Esta ? Qu’est-ce que c’est ? J’ai rien moi, qu’est-ce que vous me voulez !
Je pars vite quand même…
Pas d’inquiétude qu’il me dit, sa collègue va m’aider à le remplir. Je voudrais vivre désormais en business, une vie entière en business. Depuis quelques heures, je sens comme un halo de douceur et de bienveillance autour de moi. Il me préserve de toutes ces violences dont le monde en général et un aéroport international en particulier sont prodigues.
J’ai fait un choix quand j’avais dix-neuf ans, c’était soit poursuivre une carrière et la fortune, soit poursuivre mes fantômes. Avec ce romantisme idiot qui me caractérise j’ai choisi les cadavres et vingt ans plus tard j’en suis réduit à me dire que j’ai été fort con.
La douanière est charmante. Ses fesses sont serrées dans son uniforme. La chair de poule me parcourt instantanément lorsque son souffle atteint la partie de mon cou située directement sous le lobe de l’oreille, exactement comme ça me faisait quand Madame Soye, ma maîtresse d’école, venait par-dessus mon épaule. J’aimerais que ce moment dure mais il passe à une vitesse démentielle.
Merci Monsieur, et bon séjour en Amérique.
Attention à la marche, aurait-elle pu, dû, me dire pour mon retour au « monde réel », qui est juste le monde des pauvres et n’a pas plus, voire même moins, de réalité que celui des riches. Je quitte ce dernier à regret.
Chapitre 3. New York, USA.
J’ai rendez-vous avec « mon » photographe dans Manhattan. J’ai trois heures devant moi, je décide donc d’y aller en taxi collectif, un van genre minibus, ça permet de « s’immerger » comme disent les étudiants Erasmus et les reporters des radios nationales.
Trois personnes montent avec moi. Un couple de jeunes anglais probablement venus faire un tour vegan de la ville, histoire de comparer l’abattoir végétal sur la 3ème avec celui dans Carnaby street. Je pourrais déjà leur dire que les mêmes matcha, cardamone, reishi, miel hédène et lait d’amande agrémenteront les mêmes « wellness latte ». A 8 dollars ou 5 livres, le prix reste le même : indécent. Le mec parle déjà d’un bar à céréales à tester dans Brooklyn. Si je l’inventais, on me reprocherait de caricaturer…
Edith — dit avec l’accent londonien je vous jure que ça fait chic — aura attendu à peu près quarante-cinq secondes avant de dégainer son iphone. Elle attrape son julot par le cou, lui écrase la joue avec l’aide de la sienne et immortalise pour l’éternité numérique ce moment. Et puisqu’il était écrit que l’intimité « sucks », bien entendu notre jeune femme coupée au bol s’empresse de balancer son selfie sur Instagram agrémenté du commentaire « So excited, we R in NY !!!!!!! » suivi d’une demi-douzaine d’émoticônes sortis de l’espace.
Moi je me sens tout sauf excited. Ils me foutent le cafard tous ces bonnes gens avec leurs réseaux sociaux et leur vie rêvée — on a les rêves qu’on mérite — jetée à la figure de leur « communauté ». En tout cas ils sont tellement excités d’être à New York nos tourtereaux, ou plutôt de le dire, que depuis vingt minutes que nous traversons toutes ces banlieues aux petites maisons bardées de bois pastel, South Jamaica, Richmond Hill, ils n’ont pas mis un œil à la fenêtre. Je me dis que si la globalisation peut uniformiser le monde, c’est aussi parce que les hommes ont cessé de le regarder. Je me dis aussi que ce genre de phrases est un énième témoignage du délire mélancolo-métaphysique dans lequel je m’enferme.
Le malabar assis en face de moi n’a pas dégoisé un mot, il doit avoir une trentaine d’années. Il a l’air d’un Polonais, crâne rasé, blanc comme un cul, le regard dur, pas commode quoi. Je tente quand même un petit sourire assez lamentable lorsque nos regards se croisent. Il fait un effort, tente une risette aussi. J’embraie la conversation avec un pathétique « C’est la première fois que vous venez à New York ? ».
— Oui, répond-il laconique.
Je rame un peu, mais apprend rapidement qu’il vient pour voir un combat de MMA. Ce qui me plonge dans une espèce de rêverie et je souris dans ma barbe à l’idée qu’il ait pu traverser l’Atlantique, s’être privé d’un week-end avec sa copine (pas certain qu’il en ait une) et cramer un, peut-être deux, mois de salaire pour voir deux brutes se taper dessus, et sans qu’aucune idée de noblesse ne puisse y être rattachée comme dans les autres sports de combat ou arts martiaux, puisqu’ici aucune règle ne vient contraindre l’homme et faire éclore sa créativité. Il y a des choses qui me dépassent complètement. Je repense à l’injonction d’un type que j’admire plus que tout : ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester mais comprendre ; et je me demande comment comprendre ceci. Je repense à cette scène dans Le Parrain, troisième volet, quand le cardinal casse un caillou qu’il ramasse dans une fontaine et dit à Michaël : Les hommes sont comme cette pierre, ils baignent depuis 2000 ans dans le christianisme sans que cela ne les ait pénétrés. Je me fous du christianisme mais je me dis que 2500 ans de haute civilisation pour en arriver là, c’est tout de même assez incroyable. En étant d’une condescendance atroce je me dis que ce pauvre bougre n’y est pour rien. Qu’il n’est devenu que ce qu’on a bien voulu qu’il devienne. Après avoir passé mes années d’apprentissage à lire et aimer les auteurs du libre arbitre, je suis entré dans un âge où je ne vois plus les hommes que comme des petits bouchons sur la mer. Des êtres frêles soumis de bout en bout à ce que les éléments voudront bien faire d’eux. Après l’homme révolté, l’homme ballotté.
Enfin bref, la conversation est morte d’elle-même puisque je ne l’ai pas entretenue et finalement ça me va bien. Nous arrivons à la fin de Long Island, juste avant de plonger sous l’East River, on commence à voir la célèbre skyline en forme de chaîne de montagnes pixellisée.
Nous ressortons en plein Manhattan, je regarde défiler cette ville que je connais mal, je suis étonné de voir autant de briques rouges, les fameux 4×4 noirs, énormes… Une ville avec laquelle j’entretiens un rapport ambigu, à la fois fasciné par l’énergie folle qu’elle exhale et anxieux par la fuite en avant de l’homme occidental que rien au monde mieux qu’elle n’exprime. Toutes ces vagues d’hommes venant à l’assaut de ces récifs de verre et d’acier. Pour quoi au final ? Un merveilleux rêve auquel il n’aura pas fallu trois siècles pour virer au pire cauchemar. Moins de deux cents ans après Lincoln, ce peuple (bien aidé par une absurdité institutionnelle faut reconnaître, ils peuvent en être fiers de leur Constitution) a choisi Donald. Je me demande pour commencer comment peut-on appeler son gosse Donald ! Alors aller jusqu’à l’élire à la « fonction suprême »…
C’est à moi de descendre le premier. Je salue ce petit monde sans regret et pénètre dans un diner quelconque sur la 10ème. Le hasard (existe-t-il seulement !) a voulu que mon camarade de virée me donne rendez-vous dans Hell’s kitchen, un quartier bien nommé. En plus d’être la cuisine de l’enfer, ce pays est l’enfer de la cuisine. Je me suis toujours demandé comment un peuple qui bouffe aussi mal pouvait dominer le monde. Combien a-t-il fallu que les Européens soient stupides pour laisser ce peuple à moitié dégénéré remplacer leur raffinement absolu par toute cette vulgarité confondante. Imagine-t-on ce qu’ont pu être Paris ou Vienne en 1900 ? Stevenson écrivait il y a cent cinquante ans En Amérique on mange mieux que partout ailleurs ; c’est un fait. La nourriture y est divine. Que de chemin parcouru… Et dans quel sens…
J’ai toujours trouvé ça con les gens qui sont « fiers » d’être français, pas seulement du fait d’être fiers d’être Français — un peuple dont le dernier témoignage d’héroïsme remonte à quand ? — mais déjà du simple fait de s’enorgueillir d’appartenir à un groupe, une tribu, une nation, un peuple… toutes sortes de noms qui désigne le rassemblement de pauvres bougres qui suspendent leur jugement le temps de leur union pour s’en remettre avec une nécessité implacable aux plus imbéciles d’entre eux.
Et déjà, le principe d’être fier…
Et j’ai toujours trouvé ça con aussi, ne serait-ce que d’un point de vue grammatical, les phrases du type les Allemands sont comme ci, les Italiens comme ça…
J’ai beau trouver tout ça très très bête j’avoue goûter particulièrement la conversation entre Français. Mon expérience me fait dire que seul un Français est capable non seulement de supporter mais même d’apprécier de parler bectance pendant des heures, et cela de manière sérieuse. Ce sont les conversations qui m’ennuient le moins. Même le dernier des crétins peut vous apprendre quelque chose quand vous vous en tenez là.
La manière que chacun a de se nourrir me semble être un puit sans fond dans l’accès à la connaissance de l’autre. Le seul fait de regarder quelqu’un manger peut en apprendre bien davantage sur lui que n’importe quelle confidence.
Bref, je rentre dans cette chose qu’on appelle un diner ici et qui ressemble à pas grand chose de ce que l’on connaît en Europe, peut-être au croisement d’un bistro et d’un fast-food. Je m’assois au comptoir, et comme à chaque fois que je m’assois à un comptoir je pense à mes amis partis.
Une heure d’avance sur l’heure convenue. Je commande un café avec une part de tarte aux pommes. Une sorte d’hommage à Kerouac — combien a-t-il pu en manger sur sa foutue route ! Je me demande si les siennes étaient meilleures que la mienne. La mienne, faut reconnaître, n’est pas si terrible. Dans un manuel de survie d’un Français aux Etats-Unis, la tarte aux pommes devrait figurer en excellente place à la rubrique valeur à peu près sûre pour éviter les très mauvaises rencontres.
Cette pensée me recentre sur l’objet de ma présence ici. Contrairement à ce que je fais d’habitude, je n’ai rien préparé. J’ai pris une édition originale de Sur la route avec une carte des itinéraires pris par Kerouac lors de ces différentes traversées. Ce pourrait être un fil mais c’est compliqué, son chemin n’est pas toujours bien renseigné et certaines routes ont même disparu me suis-je laissé dire.
Je ne m’en fais pas plus que ça, l’idée de la route, c’est aussi de se laisser guider par elle, la laisser nous mener vers ce que l’on ne cherchait pas, ou plus…
Ça faisait bien quinze ans que je n’avais pas lu le livre de Kerouac, avant de le reprendre cette semaine. Ce n’est pas un livre que j’avais aimé plus que ça, il est loin d’être dans mon top 10, même pas mon top 50 sûrement. Ce que j’aime en revanche, c’est l’histoire de ce livre. Comment il est devenu une référence, y compris pour plein de gens qui ne l’ont jamais lu. Il est lui-même devenu un mythe depuis lequel la beat generation dans les années 50, et toutes ses déclinaisons dans les années 60 et 70, se sont racontées des tas d’histoires : la liberté sexuelle, la drogue émancipatrice, le pouvoir affranchi de sa verticalité, le refus de la société de consommation, la poésie contre le prosaïsme du monde et de ses affaires, l’égalité de tous les hommes sans distinction de couleur, de sexe, etc. Qu’un livre puisse symboliser tout ça est proprement délirant et c’est probablement ce qui a détruit l’auteur. On l’oublie vite mais Kerouac a littéralement été broyé par son grand œuvre. Il a consacré le restant de sa vie à la rendre la plus courte possible, s’aidant du suicide assisté que représente l’alcoolisme, et il a finalement versé dans la réaction (au sens politique du terme) par effet de miroir sans doute et/ou pressentiment de l’affreuse fin qu’allait revêtir tout ça.
Je prends la première page et lis dès la deuxième phrase qu’à l’origine de son départ il y a le sentiment que tout est mort : « and my feeling that everything was dead ». Jusqu’ici on est raccord avec Jack, me dis-je. Ça cadre nickel. J’aime bien l’idée que la chiquenaude qui fait rouler la bille sur ce foutu globe soit une sorte de fuite, de révolte de la vie face à la mort partout alentour. Le cri face aux ténèbres.
Je me demande s’il a trouvé quelque vie sur sa route, Jack, alors que j’enfourne la dernière bouchée de tarte. A première lecture, cela paraît évident, une incroyable vie même, celle de jeunes gens envoyant tout balader, à commencer par leurs pères, la vie dans les caves où l’on danse toute la nuit sur le Bop de Parker, et caetera.
Ai-je moi aussi des chances de trouver de la vie sur cette route ?
— Mister ! Je suis tiré de ma rêverie par la serveuse. Vous êtes Mister Jacques, n’est-ce pas ?
— Oui, dis-je étonné.
— C’est pour vous, me fait-elle en me tendant le combiné.
Une sorte d’hallucination, j’ai l’impression d’être dans un film d’avant les téléphones portables. Je ne rêve pas. Je ne suis pas bien étonné d’entendre une voix avec un accent québécois incroyable, puisque Bailly m’avait prévenu qu’il avait embauché un freelance de Montréal, à part lui personne ne savait que notre rendez-vous se situait ici.
— Tristannnnn ! C’est Pierre-André, le photographe… Ecoute j’ai un petit problème. Un gros même, mais fais toi z’en pas. J’avais complètement oublié mais c’est demain les vacances de la construction. Impossible de louer un char dans cette maudite ville. Mais t’inquiète pas, je vais me débrouiller, donne-moi un numéro de cellulaire où je puisse te joindre, je te redis dès que j’ai des nouvelles.
— Merde, que je lâche. C’est quoi les vacances de la construction ? Ça va prendre combien de temps tu penses ? Je fais quoi en t’attendant ?
Une certaine panique me gagne. Le timing est déjà super serré… Si on commence à perdre du temps alors que nous ne sommes même pas partis !
Nous avons exactement quatorze jours avant mon vol retour. Ça me paraissait déjà un peu fou de caler une traversée des Etats-Unis en si peu de temps…
Ce premier contretemps ne me donne pas exactement confiance dans la fiabilité du zigue. Bailly m’en a dit du bien, ce qui aurait déjà dû m’interpeller mais je suis sûr qu’il en dit autant de moi : « Un super photographe, pas facile à gérer mais tu sauras. » Certes j’ai toujours aimé les fêlés, gloire à eux auxquels nous devons le peu de lumière qui nous échoit, mais dans le contexte je ne cracherais pas sur la version sans étincelles, le genre à l’heure aux rendez-vous, discret et travailleur, rassurant quoi.
J’essaie néanmoins de me contenir et de préserver dans la mesure du possible la susceptibilité de mon interlocuteur. On va vivre et travailler ensemble pendant quasiment deux semaines, probablement dans une grande promiscuité, autant œuvrer à la paix du ménage.
Avant qu’il ne raccroche j’ai la présence d’esprit de lui demander un moyen pour moi de le joindre.
— 438 656 4798. Si ça marche pas, j’ai des soucis avec mon cellulaire, t’appelles au dépanneur Beau-Soir sur Papineau, je te donne le numéro, 514 765 1211, j’habite au-dessus, c’est un bon doude, il a l’habitude. Je suis vraiment content de partir avec toi, j’ai lu le synopsis, je sens qu’on va avoir bien du fun, j’ai hâte, dit-il en raccrochant, tout ça dans un débit hallucinant.
Occupe-toi de partir déjà, me dis-je à voix haute.
Il a déjà raccroché.
Je commande une bière, histoire de réfléchir à la suite. Le café est du jus de chaussettes de toute façon, ils peuvent bien offrir le refill…
Il ne m’a pas dit ce qu’étaient les vacances de la construction. Je fais comme tout le monde, je dégaine et tape sur l’écran.
« Au Québec, l’expression « vacances de la construction » désigne la période de deux semaines durant laquelle la quasi-totalité des travailleurs œuvrant sur les chantiers de construction bénéficient d’un congé obligatoire, et ce, depuis 1971. Cette mesure touche un peu plus de 120 000 travailleurs de l’industrie de la construction, mais on estime que près du tiers des Québécois prennent congé durant cette période ».
Je comprends que c’est une sorte de 15 août chez eux. Ce que je comprends moins c’est le lien avec la location de la caisse. Ce doit être possible de louer une tire à Paris le 14 août, non ? Jamais essayé tu me diras.
Machinalement je reprends le bouquin, les premières pages tournent autour de la rencontre de Kerouac avec Dean Moriarty. Je souris, je me dis que mon Pierre-André en aurait bien un petit peu. Au moins l’original ne s’embêtait pas de ce genre de considérations, il les chouravait lui les bagnoles.
Envie de pisser, je vais aux chiottes et en ressortant viens me rasseoir au comptoir, comme hagard. La serveuse doit le voir et m’interpelle : « Hey Sweaty, are you all right ? ». « Yes yes » lui dis-je mais me permets de lui demander tout de même pourquoi les pissotières sont remplies de glaçons ? Elle me répond qu’il n’y a pas de raison, c’est « just for the fun ». Il fait 40° dehors, la pisse sort de la verge à 37°, ce sont des centaines de kilos de glace (la pissotière a une contenance cinq à six fois supérieure à celle d’un modèle européen standard type Duchamps) qui doivent y être déversés chaque jour, « just for the fun ». Je suis mort de rire effectivement. Tellement mort de rire que j’ai l’impression d’avoir des Camper d’écolos qui me poussent aux pieds à la place de mes super Converse made in America. Enfin presque in America, elles sont fabriquées en Chine ou au Vietnam depuis des années. Bref. Je n’avais pas pensé débarquer au milieu d’un tel peuple de déconneurs.
J’ai ma ration de fun pour la journée, je paie et m’en vais. La serveuse me rattrape par la manche. Je comprends pas ce qu’elle me veut d’abord, puis je comprends que j’ai oublié le pourboire. Jamais compris l’idée si c’est obligatoire mais je m’y plie sans broncher. Merci, au revoir.
Je marche en direction de l’hôtel Pennsylvania. Le genre d’établissement que je déteste, une usine à touristes en transit entre la statue de la Liberté et Ground zero, mais là je n’ai plus la force de chercher autre chose. La nana me donne une clé, 27ème étage. J’ouvre la porte et entre dans une chambre froide au sens littéral : une pièce réfrigérée où l’on entrepose de la bidoche. Il doit faire 12°c là-dedans, j’ouvre la fenêtre pour que la chaleur revienne et me mets à étudier la manière de régler la clim’. J’ai l’air d’un espion qui cherche les micros planqués. J’appelle la réception qui me répond qu’il n’y a pas moyen de régler la clim’ chambre par chambre et qu’elle est réglée sur les « standards » de ce que demande la clientèle. Je finis par enfiler le pull de laine auquel j’ai pensé pour les soirées autour du feu, et me vautre sur le lit.
Combien de temps ai-je sombré ? J’ai fait un rêve horrible, mon ami merveilleux, Olivier, auquel je n’ai jamais rien à reprocher me faisait une remarque que ni lui ni personne des autres amis présents n’ont relevée, un truc complètement insignifiant mais qui m’a fait l’effet d’un coup de couteau en pleine poitrine. Alors que j’émerge je m’attends à retrouver une mare de sang dans les draps. Je n’arrive plus à me souvenir exactement ce qu’il a dit mais je me souviens de l’abîme dans lequel cela m’a plongé. Une vision extrêmement vive de l’échec que représente ma vie. Si les fenêtres n’étaient pas équipées d’un dispositif anti-suicide, il est possible que ma vie se soit arrêtée là. Comme quoi le maternage sécuritaire fonctionne.
Le succès, paraît-il, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. Toute ma joie s’en est allée, ne restent que les erreurs et les illusions dont elle se nourrissait.
Je me sens vide, surnuméraire, je m’enfonce tout ce que je peux dans le matelas et des larmes me viennent. Ce doit faire dix ans que je n’ai pas pleuré. Je reste encore quelques temps comme ça, probablement quelques heures puis la vie organique reprend son empire sous le masque de la faim.





























