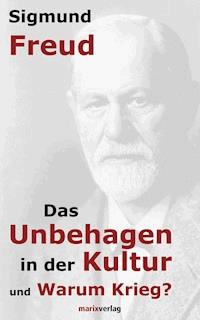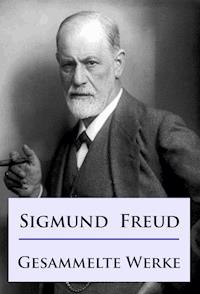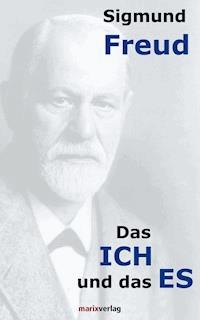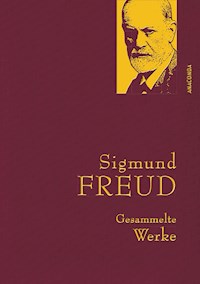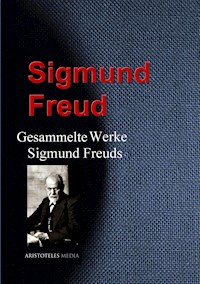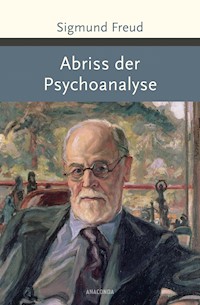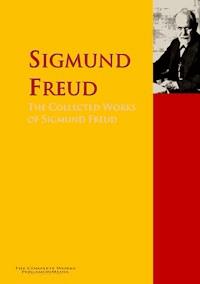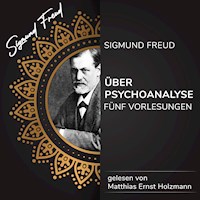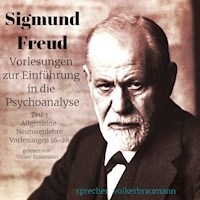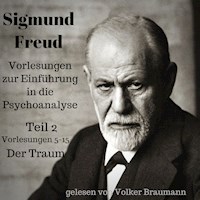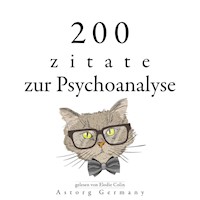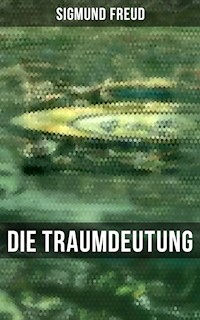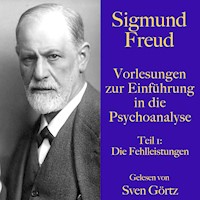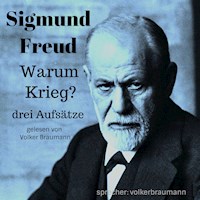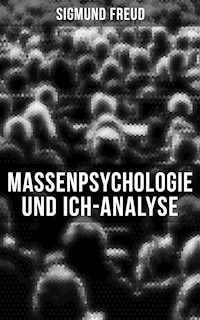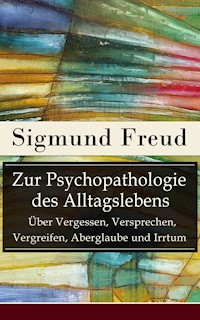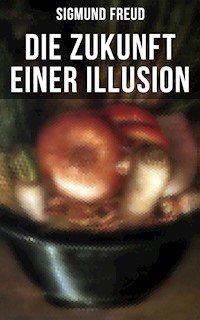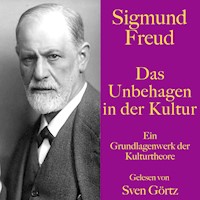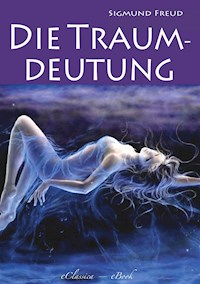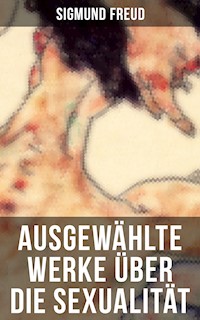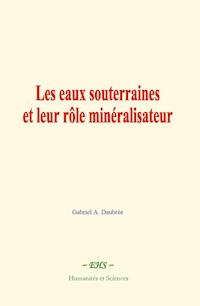
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
The subject of the sexual instinct and its aberrations has long been before the scientific world and the names of many effective toilers in this vast field are known to every student. When one passes beyond the strict domains of science and considers what is reported of the sexual life in folkways and art-lore and the history of primitive culture and in romance, the sources of information are immense. Freud has made considerable additions to this stock of knowledge, but he has done also something of far greater consequence than this. He has worked out, with incredible penetration, the part which this instinct plays in every phase of human life and in the development of human character, and has been able to establish on a firm footing the remarkable thesis that psychoneurotic illnesses never occur with a perfectly normal sexual life. Other sorts of emotions contribute to the result, but some aberration of the sexual life is always present, as the cause of especially insistent emotions and repressions.
ABOUT THE AUTHOR
Sigmund Freud (1856–1939) was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis, a clinical method for treating psychopathology through dialogue between a patient and a psychoanalyst
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les eaux souterraines et leur rôle.
Les eaux souterraines et leur rôle minéralisateur
Chapitre I.
Le travail des eaux souterraines.
Dès les temps les plus reculés, les sources bienfaisantes qui jaillissent de l’intérieur de la terre ont excité la gratitude et souvent l’admiration des hommes. Comme la mer et les fleuves, elles ont été divinisées chez les populations de la grande famille indo-européenne ; le culte qui leur était rendu, les fables dont la superstition les entourait, expriment à quel degré l’imagination populaire était frappée de leur origine mystérieuse, de leur cours intarissable et de leurs propriétés secrètes. Les Grecs attribuaient à la fontaine de Dodone, en Épire, la faculté de découvrir les vérités cachées et de rendre des oracles. Celle d’Egérie était supposée posséder le même pouvoir, et les Romains avaient confié sa garde, de même que celle du feu sacré, à des vestales. Les sources de Castalie, au flanc du Parnasse et d’Hippocrène, près de l’Hélicon, passaient pour communiquer l’esprit poétique.
Les Gaulois avaient une vénération particulière pour les sources thermales auxquelles ils allaient demander la santé, comme le témoignent les noms des divinités Lixo et Borvo, inscrits sur des ex-voto, étymologies évidentes de ceux de Luchon, de Bourbonne et de deux localités bien connues aussi, Bourbon-l’Archambault et Bourbon-Lancy. Nos vieux romans de chevalerie, en imaginant une fontaine de Jouvence, où pouvaient se retrouver les forces et les charmes perdus, ne faisaient que reproduire un mythe déjà très répandu aux premiers âges de la Grèce, tant était grande la confiance dans la vertu des eaux.
L’antiquité avait personnifié les sources sous la forme de naïades, jeunes femmes couronnées de plantes aquatiques, tenant en main une coquille ou appuyées sur une urne penchante. L’art moderne adopta cette : allégorie ingénieuse. Chacun connaît les gracieuses figures dont le ciseau de Jean Goujon, a décoré la fontaine des Innocents, et la Nymphe de Fontainebleau, à laquelle Benvenuto Cellini donna un cerf pour attribut, afin de rappeler la source découverte pendant une chasse royale. La fontaine des Haudriettes, à Paris, était surmontée d’une naïade dont Diderot a loué « le caractère fluide et coulant. » Parmi les œuvres de la peinture, est-il besoin de mentionner la plus séduisante de celles que le pinceau d’Ingres nous ait laissées ?
La pérennité des sources, regardée longtemps comme un mystère sacré et impénétrable, était aussi le caractère le plus frappant pour ceux qui, en dehors du domaine de la religion et de la poésie, cherchaient à expliquer ce continuel écoulement. Suivant l’idée d’Aristote, adoptée par Sénèque et très accréditée encore au XVIe siècle, « l’intérieur de la terre renferme des cavités profondes et beaucoup d’air qui doit nécessairement s’y refroidir. Immobile et stagnant, il ne tarde pas à se convertir en eau, par une métamorphose semblable à celle qui, dans l’atmosphère, produit des gouttes de pluie. Cette ombre épaisse, ce froid éternel, cette condensation qu’aucun mouvement ne trouble, sont des causes, toujours subsistantes et agissant sans cesse, de transmutation de l’air. »
Quelque simple et manifeste qu’elle nous paraisse aujourd’hui, l’origine des sources fut reconnue tardivement. Vitruve, dans son ouvrage sur l’architecture, l’avait soupçonnée ; mais ce fut Bernard Palissy qui, à la suite de longues études sur la constitution du pays qu’il habitait, renversa les anciens préjugés. D’après le traité de cet observateur de génie, publié en 1580 sous le titre de Discours admirable de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu’artificielles, les sources sont engendrées par l’infiltration des eaux de pluie ou de neige fondue qui descendent dans l’intérieur de la terre, au travers des fentes, jusqu’à ce qu’elles rencontrent « quelque lieu foncé de pierre ou rocher bien contigu. » Palissy recherche, en outre ; le moyen d’établir des fontaines artificielles « à l’imitation et, le plus près approchant de la nature, en suivant le formulaire du souverain fontainier » ; il ajoute cette pensée profonde, qui sert aujourd’hui de base à la géologie expérimentale : « d’autant qu’il est impossible d’imiter nature en quoi que ce soit, que premièrement l’on ne contemple les effets d’icelle, la prenant pour patron et exemplaire. » Dès lors, on comprit pourquoi les sources sont inépuisables, puisqu’elles se renouvellent sans cesse par le jeu de forces permanentes : elles résultent d’une circulation souterraine, en quelque sorte symétrique, de la grande circulation aérienne de l’eau.
Les phénomènes violents, comme les tremblements de terre, ont assurément le privilège de frapper l’imagination ; ceux qui viennent d’ébranler une portion du littoral méditerranéen de l’Italie et de la France en sont une preuve. Mais d’autres phénomènes, bien qu’ils se produisent lentement et en silence, ne sont pas moins dignes d’intérêt : tel est le mécanisme et telle est l’action si féconde des eaux souterraines, dont les sources sont la manifestation extérieure. A part l’utilité qu’elles offrent à l’homme, l’importance de leur étude est d’autant plus grande qu’elle ne s’applique pas seulement aux temps présents. Depuis que l’écorce terrestre existe, et pendant toutes les périodes de son développement, l’eau en y circulant, avec des températures parfois très élevées, a produit des effets considérables et divers, qui s’y sont en quelque sorte enregistrés d’une manière durable, et dont l’explication ressort surtout d’expériences récentes. C’est, en effet, cette circulation incessante qui a engendré un grand nombre d’espèces minérales.
Les fonctions actuelles des eaux souterraines nous occuperont d’abord, l’examen de leur rôle minéralisateur aux époques anciennes étant réservé pour une seconde étude.
I.
De même que le cours des rivières dépend des formes extérieures du sol, de même le régime des eaux souterraines est une conséquence immédiate de la nature et du mode d’agencement des masses à travers lesquelles elles se meuvent.
Abstraction faite d’une couverture très mince de terre végétale, qui en est comme l’épiderme, l’écorce du globe terrestre se compose de matériaux auxquels on applique le nom de roches, lors même que, comme le sable et l’argile, ils sont de nature très peu cohérente. Toutes ces masses ont été formées successivement, pendant des périodes de très longue durée, et au milieu de circonstances dont elles portent en elles-mêmes des marques caractéristiques. Ce sont de véritables monuments qui, par leurs traits essentiels, retracent les évolutions successives de notre globe.
Les roches constitutives de la plus grande partie des continents sont dites stratifiées, parce qu’elles sont divisées en grandes plaques parallèles, auxquelles on donne le nom de strates, de couches, et quelquefois aussi de bancs et d’assises. Il est certain que les roches de cette grande catégorie, quelle que soit leur composition, ont été formées dans la mer ou dans des lacs, par des sédiments et par des organismes : une première preuve de cette vérité est fournie par leurs cailloux et leurs sables, dont l’origine ne peut différer de celle des dépôts actuels de l’Océan ; les innombrables débris d’animaux marins, devenus fossiles, en sont un témoignage plus éloquent encore ; enfin, la disposition par couches complète l’analogie avec les sédiments contemporains. Le granit et les roches cristallines de la même famille constituent le soubassement universel des roches stratifiées. Tous les terrains dont il vient d’être question peuvent être traversés par des masses minérales, disposées en plaques irrégulières plus ou moins verticales et qui contrastent d’ordinaire avec la nature des parties encaissantes. Ayant surgi de régions très profondes, elles sont désignées sous le nom de roches éruptives.
Parmi ces divers matériaux, il en est qui refusent passage à l’eau et sont imperméables. Au premier rang se présente l’argile, silicate d’alumine hydraté très abondant, surtout à l’état de mélange avec la chaux carbonatée, c’est-à-dire de marne. Le granit et ses analogues, ainsi que les schistes, dont l’ardoise représente une variété bien connue, partagent la même propriété, à la condition que les fissures qui les traversent soient suffisamment étroites. Aussi, bien que l’invasion incessante des eaux constitue l’un des principaux obstacles au travail du mineur, il est des exploitations qui restent tout à fait sèches, par suite de l’imperméabilité des masses encaissantes. L’ancienne mine d’étain de Bottalack, en Cornouailles, s’étendant sous la mer jusqu’à 700 mètres de la falaise escarpée et pittoresque par laquelle on y descendait, ne recevait pas d’infiltrations notables ; et pourtant, le toit granitique de cette mine était assez mince, en quelques points, pour que le roulement des galets, balancés par de fortes vagues, se fît entendre dans l’intérieur des galeries. Les houillères de Whitehaven, en Cumberland, pénètrent aussi sous la mer jusqu’à une distance de 3 kilomètres du rivage. Nous avons vu les galeries préparatoires du tunnel sous la Manche rester presque étanches sur plusieurs kilomètres, même dans les parties où elles étaient séparées du fond de la mer par une paroi argileuse peu épaisse. En dépit des appréhensions d’abord soulevées par le projet du percement du Mont-Cenis, le tunnel, sur son parcoure de 12 kilomètres, n’a rencontré que peu d’eau ; souvent même il fallut en aller chercher au dehors pour les besoins des ouvriers. Il en a été de même au tunnel du Saint-Gothard, d’une longueur de 15 kilomètres ; c’est à peine si, en quelques parties, des fissures profondes, situées à proximité du fit de la Reuss, ont livré passage à des irruptions boueuses.
D’autres matériaux, au contraire, se laissent facilement pénétrer par l’eau. Chaque jour nous avons occasion de voir combien le sable et le gravier sont perméables. Il en est de même de roches qui, sans être aussi poreuses, sont coupées et recoupées de fentes plus ou moins larges. Beaucoup de calcaires compactes se laissent instantanément traverser par l’eau, qui est drainée par leurs crevasses comme par des conduits artificiels.
Le régime des eaux souterraines se montre avec des caractères simples et clairs dans les dépôts connus sous le nom d’alluvions anciennes, de diluvium, de dépôts quaternaires, qui couvrent comme un tapis la plus grande partie des continents. Leurs graviers et leurs sables, associés ordinairement à des limons, absorbent avec une sorte d’avidité l’eau, à travers des interstices qui représentent une fraction notable, quelquefois un tiers du volume total. Arrêtée dans sa descente par des masses imperméables, elle s’accumule en formant une nappe, d’où on la voit exsuder par toutes les entailles qu’on y pratique. Cette nappe, presque superficielle, a reçu différents noms vulgaires : on l’appelle chez nous nappe des puits, nappe d’infiltration ; en Allemagne, grundwasser ; en Angleterre, groundwater ; en Italie, acqua di suolo, acqua di livello. Une dénomination empruntée à la langue grecque, par conséquent cosmopolite, est préférable : celle de phréatique exprime bien sa relation avec les puits ordinaires. Dans le sens horizontal, les nappes phréatiques peuvent occuper de grandes surfaces, même des pays entiers, comme les dépôts arénacés qui leur servent de réceptacles : elles se déploient, presque sans discontinuité, dans la plaine du Rhin, de Bâle à Mayence, et ensuite reprennent au-delà de Coblentz, à la hauteur de Strasbourg ; sur la rive gauche du fleuve seulement, leur largeur dépasse 20 kilomètres.
Il n’est pas toujours besoin d’une excavation artificielle pour que l’existence de la nappe des puits se manifeste. Des échancrures naturelles du sol la font apparaître, par exemple aux environs de Berlin et dans les plaines sablonneuses de la Baltique, où elle alimente de très nombreux étangs et petits lacs. Ailleurs, elle profite de rigoles peu profondes pour sortir en sources limpides, parfois impétueuses et d’un volume tel qu’elles forment, dès leur sortie, de véritables rivières. La grande nappe de la plaine de la Lombardie s’épanche ainsi dans le fit des rivières qui la sillonnent, de sorte que ces dernières, après avoir été mises à sec par les prises d’eau de nombreux canaux d’irrigation, renaissent spontanément plus bas et sans recevoir, en apparence, aucune nouvelle alimentation. L’inépuisable abondance de cette nappe intérieure trouve d’ailleurs là une application agricole, peut-être unique jusqu’à présent : l’eau qu’on en extrait, à l’aide de puits peu profonds nommés fontanili, est éminemment propre à l’irrigation, à cause de sa température à peu près constante et très supérieure en hiver à celle de l’air ambiant ; en la forçant à s’écouler sans cesse en une couche : mince, malgré un climat aussi froid en hiver que celui du nord de la France., on coupe de l’herbe en janvier comme, en été. Ces fontaines artificielles d’eau réchauffée dans le sous-sol sont au nombre de plus d’un millier, et occupent une zone d’environ 200 kilomètres de longueur, depuis le Tessin jusqu’à Vérone.