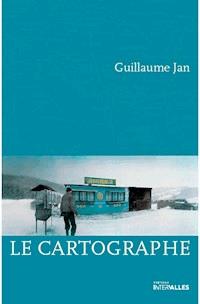Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sur les traces du célèbre explorateur du Congo
Deux amoureux se perdent dans la jungle et rêvent de se marier au prochain village pygmée :
Traîne-Savane raconte l’histoire (vraie) de ce mariage romanesque décidé sur un coup de tête, au bout d’une longue errance au cœur de la forêt congolaise. Cent cinquante ans plus tôt, le zélé missionnaire David Livingstone déambulait le long des fleuves d’Afrique centrale, à la recherche d’une terre promise, d’une autoroute du commerce ou de sources miraculeuses. Fantasque et têtu, rêveur et maladroit, l’explorateur menait vaillamment ses combats impossibles jusqu’à ce que Stanley le retrouve sur les berges du lac Tanganyika et lui lance son mythique : « Doctor Livingstone, I presume... »
En tressant ces deux parcours picaresques, Guillaume Jan relie le destin de ces Don Quichotte qui, chacun à leur manière, donnent leur cœur au continent noir. Curieusement, aucune biographie solide du Docteur Livingstone n’avait été jusqu’ici établie en langue française.
Mêlant aventure et histoire, ce roman est une fabuleuse source d'éléments biographiques sur David Linvingstone
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "La plume de Guillaume Jan est fine, sensible et douce. Ouvrir ce livre, c’est comme se jeter dans les bras du Congo, les laisser se refermer sur nous et nous emporter dans une histoire aussi drôle que passionnante."
(Marie Musy, Librairie du Midi)
- "On ne regrette pas ce voyage picaresque, haut en couleur et en humanité. Un récit pépite enchanteur."
(Alphonse Guillaume, Modes & Travaux)
- "Sa passion pour l’Afrique vibre chaque instant dans ce récit vif et captivant."
(Nathalie Kermorvant, Le Télégramme)
- "
Traîne-Savane est une ode à l’Afrique centrale qui se termine avec brio par une description poignante de la capitale de la République démocratique du Congo et du vibrant quotidien des Kinois."
(Léa Desrayaud, Le Point)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Guillaume Jan, né en 1973, est reporter dans la presse magazine française. Son métier lui a permis d’être chercheur d’or en Guyane, de partager le quotidien des jeunes Irakiens sous l’empire de Saddam Hussein, de slalomer entre les mines à Kaboul, de séjourner dans le charmant village d’Al-Qaida au Yémen, de suivre les enseignements d’un gourou biterrois dans son ashram en Inde, d’infiltrer une filière de concubines en Chine, de jouer au ballon avec l’équipe de foot de Grozny ou au billard avec des gangsters anglais. Il vit à Paris. En 2009, il a publié
Le Baobab de Stanley, ballade douce-amère au cœur de l’Afrique.
EXTRAIT
Le lion est à trente pas, tapi dans les hautes herbes. Livingstone lève lentement le canon de sa carabine, tente de viser entre les yeux jaunes et tire. Deux coups. Le fauve est sûrement touché, puisque son furieux rugissement déchire la savane. Le missionnaire n’a pas le temps de recharger sa pétoire qu’il le voit bondir, et déjà l’animal enfonce ses crocs dans l’épaule de l’homme blanc et le secoue dans tous les sens. Deux indigènes tentent de le secourir, le fauve les envoie valdinguer mais s’écroule quelques secondes plus tard, foudroyé. Les balles ont finalement fait leur effet. Le lion meurt, Livingstone survit. C’est le premier miracle d’une longue série pour l’ardent voyageur. Seule séquelle, il n’arrivera plus jamais à lever le bras gauche. Ce qui ne l’empêchera pas d’aller taquiner l’au-delà dans ses expéditions futures, convaincu d’être envoyé par Dieu pour placer l’Afrique sur la voie du salut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Lili
Le lion est à trente pas, tapi dans les hautes herbes. Livingstone lève lentement le canon de sa carabine, tente de viser entre les yeux jaunes et tire. Deux coups. Le fauve est sûrement touché, puisque son furieux rugissement déchire la savane. Le missionnaire n’a pas le temps de recharger sa pétoire qu’il le voit bondir, et déjà l’animal enfonce ses crocs dans l’épaule de l’homme blanc et le secoue dans tous les sens. Deux indigènes tentent de le secourir, le fauve les envoie valdinguer mais s’écroule quelques secondes plus tard, foudroyé. Les balles ont finalement fait leur effet. Le lion meurt, Livingstone survit. C’est le premier miracle d’une longue série pour l’ardent voyageur. Seule séquelle, il n’arrivera plus jamais à lever le bras gauche. Ce qui ne l’empêchera pas d’aller taquiner l’au-delà dans ses expéditions futures, convaincu d’être envoyé par Dieu pour placer l’Afrique sur la voie du salut.
Ce mois de février 1844, David Livingstone a 31 ans. Le missionnaire écossais est arrivé en Afrique australe trois années plus tôt, peu après avoir obtenu son diplôme de médecine et s’être fait ordonner pasteur. Il est à la recherche d’une terre promise où il annoncera l’évangile, où il apportera les lumières du progrès : l’incorrigible vagabond sillonnera cette partie du continent jusqu’à sa mort, parcourant quarante ou cinquante mille kilomètres, à pied le plus souvent. Il s’égarera dans le désert du Kalahari, il croira être le premier à découvrir les majestueuses chutes Victoria ou à descendre le cours du Zambèze. Avec le temps, le soleil, la solitude, avec la fatigue, avec l’ennui, les fièvres, l’orgueil, le chagrin, avec l’émerveillement, le missionnaire aventurier se transformera en farfelu de la géographie approximative, en clochard céleste qui espère pourfendre la traite négrière avec ses sermons ; enfin, en traîne-savane gagné d’une affection sincère et profonde pour l’Afrique et les Africains – une attitude diablement progressiste à l’époque victorienne, quand le nègre était plus souvent considéré comme un sauvage sans importance. Le bon vieux docteur se fait happer par le continent noir au point de perdre contact avec sa famille, avec la London Missionary Society et avec la Royal Geographical Society, avec ses derniers amis et avec le monde. Mais toujours il se balade dans la savane, à la recherche de ses chimères, à la poursuite de son bonheur, de son malheur peut-être.
La mer à boire
« Sois attentif au hasard, Piotr ! Prends-le au sérieux. »
Vassili Golovanov, Éloge des voyages insensés
BAM BAM BAM BAM !
— Monsieur Guillaume ! Il est l’heure de se réveiller !
Le poing d’Elvis a cogné si fort que la porte de la case a failli se briser. L’autre poing d’Elvis suspend une lampe à pétrole sous le toit de palmes. Notre hôte s’assure que je l’ai bien entendu et retourne se fondre dans la nuit. Quelques oiseaux font froufrouter leurs plumes, un rongeur gratte le mur de boue séchée et si je tends l’oreille, je crois reconnaître un bruit de tam-tam, une rumeur sourde, étouffée par la végétation. Je me retourne sur le lit de branches sèches, le premier coq va bientôt chanter, puis ce sera toute la bassecour de fortune qui s’activera.
À côté de moi, Belange dort encore, immobile comme une étoile. Ce ne sera pas une mince affaire de la réveiller : je lui chuchote des mots doux, lui caresse le front, lui flatte la joue ; j’effleure sa nuque, je promène mes doigts sur son épaule et fais claquer quelques baisers dans le creux de son oreille. Enfin, elle ouvre un œil. Nous ne devons pas traîner, la route nous attend. Cent dix kilomètres de marche au cœur de la forêt équatoriale. Sans un village, a prévenu Elvis. Il a même ajouté : Ce voyage, c’est la mer à boire.
Nous étions partis de Kinshasa pleins d’optimisme, avec cette belle idée d’aller saluer les Pygmées, les derniers Mohicans du bassin congolais, des hommes qui connaissent la forêt comme leur étui pénien et qui assistent tous les jours à l’enterrement de leur culture en se doutant bien où cela les mènera, ils ne sont pas idiots. Avant de quitter Paris, j’avais étudié ma carte routière, j’avais soigneusement défini l’itinéraire qui me semblait le plus sûr, encore que rien ne soit jamais sûr au Congo. Mais j’avais oublié de la glisser dans mon sac, en partant pour l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce n’était pas une catastrophe : j’allais voyager avec Belange, elle connaîtrait sûrement les meilleurs itinéraires, elle serait ma guide, mon interprète, mon repère. Inutile de m’inquiéter. Seulement, on peut être la plus jolie fille du continent africain et confondre les noms des villes de son pays, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons pris le mauvais autobus, qui nous a emmenés dans une mauvaise ville. Ensuite, il a fallu rectifier notre itinéraire, à moto cette fois, à travers un plateau d’herbes ternes et d’arbres rabougris, pour arriver jusqu’à la rivière Kasaï et jusque chez Elvis qui a bien voulu nous accueillir dans sa maison craquelée. Nous avions son nom griffonné sur un bout de papier, il était le neveu du voisin de l’oncle (autant dire : un membre de la famille proche) d’un pasteur que nous avions rencontré sur la route, dans des circonstances infernales que je raconterai plus loin. Quatre jours harassants, au lieu des six heures qu’on nous avait promises à Kinshasa.
Et nous n’en avions pas terminé avec la route : Elvis nous signale qu’il faut encore aller jusqu’au village d’Oshwé pour trouver les Pygmées. C’est à cent cinquante kilomètres et le chemin est trop mauvais pour s’y engager en 4x4, ou même à moto. Il y a trop de troncs d’arbres à contourner et de toute façon le village est à court de carburant. À la rigueur, on pourrait prendre le raccourci, un layon en zigzag à travers la forêt vierge.
— Ça ne vous fera plus que cent dix kilomètres.
À pied.
Je n’ai rien contre la marche à pied. J’ai passé des milliers d’heures à trimarder sur les routes, mes orteils s’en souviennent très bien. Les foulées monotones sur les sentiers blanchis par le soleil ou par la lune, une biche croisée près de la rivière, le frissonnement des arbres dans la bise des aprèsmidi, un enfant qui vient vous apporter des pommes du jardin, l’apparition d’une femme que l’on rêve soudain d’aimer à la folie, ça fait partie des surprises du chemin ; un emmerdeur qui vous colle aux basques, qui veut vous raconter toute sa vie comme je suis en train de le faire, une auberge perdue où l’on s’arrête claquer son dernier billet pour un repas chaud et d’où l’on ne ressort que le lendemain parce qu’on y a trouvé une nouvelle famille, l’espace d’une soirée. Mais cette fois, au milieu de la jungle, il n’y aura pas de restauroute.
— Qu’est-ce que vous en dites, monsieur Guillaume ?
Je lance un regard interrogateur à Belange. Elle hausse une épaule, sourit, ça ne lui fait pas peur. Elle connaît la forêt. Quand elle était enfant, elle s’en allait loin sous les frondaisons, jusqu’au soir, sa grand-mère se demandait ce qu’elle pouvait bien aller chercher par là-bas. Et puis il y a des guerres, de temps à autre, en République démocratique du Congo, elle sait ce que c’est que de prendre la fuite avec un petit sac, le plus léger possible, pour pouvoir tenir le temps que les rebelles finissent de piller le village. Belange – c’est son prénom authentique – est gracile, élancée, c’est une brindille mais elle me surprend toujours par sa force, par son endurance, par son énergie, voilà le premier de ses mystères. Je l’avais prise en photo devant sa case lorsque nous nous étions connus, trois ans plus tôt : sur l’image, elle décapsule une bouteille de Schweppes avec ses jolies dents blanches et ses yeux brillent de bonheur ou d’insouciance. Ma mise au point est un peu imprécise, je devais être déstabilisé par son regard, et puis il faisait très chaud ce matin-là. Elle m’avait présenté à sa tante, qui était en fait la cousine de la femme du frère du mari de la sœur de sa mère, et à d’autres nièces qui partageaient la même case. Je traversais l’Afrique en solitaire, mon baluchon sur l’épaule, pour me changer les idées, pour tirer un trait sur une vie d’à-peu-près et de plus-ou-moins. Pour soigner une vieille blessure amoureuse aussi, la recoudre avec du fil d’arpenteur.
J’avais rencontré Belange à Kisangani, à l’endroit où le cours du fleuve Congo bifurque franchement vers l’ouest – il se jette dans l’Atlantique deux mille kilomètres plus loin. Je peux l’avouer, maintenant : j’avais été séduit par sa beauté, par sa dignité, par sa science du moment, par la force de son âme et par son français original – elle appelle les pigeons des tourtereaux et dit la grâce matinale au lieu de la grasse matinée. Séduit aussi par les romans d’amour qu’elle rédigeait au stylo Bic sur des cahiers de brouillon, des histoires lumineuses et baroques, pleines d’espérance et de mélancolie. Nous avions parlé toute une soirée à la lueur d’un réverbère, peut-être le seul qui fonctionnait encore à Kisangani, comme si nous nous attendions depuis le début de notre existence. Sa main était venue se blottir dans la mienne, j’avais sursauté d’émotion. Oh, ce n’était pas l’amour qui arrivait déjà, c’était juste que nous nous sentions proches ce soir-là. Nous savions bien que c’était trop tôt, ça n’aurait pas marché. Je l’avais quand même embrassée quelques jours plus tard, un seul baiser au bord des lèvres, j’en étais devenu gauche et maladroit tout le reste de la journée. Elle m’avait troublé, c’est sûr. Le lendemain, j’avais repris mon voyage sur le fleuve, à bord d’une barge surpeuplée ; je devais terminer mon voyage, en finir avec l’à-peu-près. Il me restait encore une moitié d’Afrique à traverser. Je ne savais pas du tout si je la reverrais.
Dans la cour d’Elvis, sous le manguier, nous tombons d’accord pour la marche à pied. Nous partirons demain, à l’aube. Il ne nous reste plus qu’à trouver un guide : on se perd facilement dans ces forêts et il peut y avoir des bandits de petit chemin. Mais tout peut s’enchaîner avec une facilité déconcertante en Afrique – oh, ce n’est pas toujours le cas, il faut savoir saisir ses chances quand elles se présentent. Nous commençons à discuter avec Joël, un des voisins d’Elvis, qui s’est assis à côté de nous sur une racine grosse comme la trompe d’un éléphant. Et voilà que Joël lance, l’air de rien, qu’il n’a rien de précis à faire cette semaine. Qu’il pourrait nous accompagner, si on le lui demandait. Cent dix kilomètres à l’aller et cent dix au retour. Je lui dis que je n’aurai pas beaucoup d’argent à lui donner pour le rémunérer, presque pas du tout, même. Joël prend un air vexé.
— Vous donnerez ce que vous pourrez, ça ira de toute façon.
— Combien de temps nous prendra le voyage ?
— Si nous marchons vite, peut-être deux jours, monsieur Guillaume. Mais il vaut mieux compter trois jours.
Joël me regarde plus attentivement, il jauge mes bras tout blancs et ma chemisette trop grande, il réfléchit quelques secondes.
— Ou plutôt quatre.
Le chemin des murmures
« Nous voyagions un peu partout, au hasard, préférant les chemins de terre aux routes franches. »
Eugène Savitzkaya, La Traversée de l’Afrique
Au petit jour, à la lueur de la lanterne d’Elvis, nous rassemblons nos affaires dans la case de boue sèche. Ce n’est pas très difficile, nous sommes partis légers de Kinshasa. Belange n’a que son sac à main bleu ciel, avec une bande de tissu imitation léopard, un camouflage idéal pour la jungle. À l’intérieur, elle a fourré en vitesse un coupe-ongles, du talc, des médicaments pour soigner les crises de paludisme et des comprimés pour atténuer les courbatures, trois culottes à fleurs, un tee-shirt First Lady et des boucles d’oreille bleues, pourquoi s’encombrer davantage ? Mon sac à dos est à peine plus grand. J’y ai casé deux caleçons de rechange, un honnête morceau de savon, de la crème solaire pour épargner mes bras pâles, une lampe de poche, mon téléphone portable, qui ne devrait pas beaucoup servir, une brosse à dents et nos deux pagnes – le pagne, c’est le couteau suisse africain, il sert de drap ou d’oreiller, d’écharpe pour les soirées un peu fraîches, de vêtement léger mais digne quand on descend se laver à la rivière, de serviette, de paravent ou de marquise, de porte-bébé pour les mamans, de baluchon de fortune, de ceinture de sécurité dans les minibus qui n’en sont pas toujours pourvus ou encore à se protéger la tête du soleil ou des accidents de moto si on l’enroule en turban ; et si l’on noue une de ses extrémités, il fait porte-monnaie. J’ai aussi un livre, une épaisse biographie de David Livingstone, 1813-1873, le père des explorateurs de l’Afrique, le premier Blanc à vouloir s’y fondre corps et âme, ça peut être instructif. En cours de route, nous avons également acheté des boîtes de lames de rasoir pour les offrir aux Pygmées, qui en sont dépourvus, ce sera notre cadeau d’arrivée. C’est tout. Je ne connais pas très bien l’Afrique, mais suffisamment pour savoir qu’il vaut mieux s’y charger au minimum ; je suis toujours épaté par les voyageurs qui partent vadrouiller dans le monde lestés d’une montagne sur le dos – où la mettront-ils, cette montagne, quand il faudra s’entasser pêle-mêle dans une pirogue ou marcher toute la journée sous le soleil écrasant ? Nous n’avons rien pour nous protéger de la pluie – ce n’est pas du tout raisonnable, d’autant que l’orage a tonné une partie de la nuit. Nous n’avons pas non plus de moustiquaire et nous portons des tongs aux pieds, tant pis si nous croisons un serpent en colère.
Finalement, nos plus redoutables adversaires seront les fourmis : voyager, ça sert aussi à revoir ses préjugés.
Le jour dessine maintenant les contours de la forêt en ombres chinoises, Elvis revient voir où nous en sommes. Prudence, sa femme, nous a préparé des chikwangues pour la route – de la pâte de manioc tassée et roulée dans des feuilles, l’aliment des voyageurs congolais : léger, compact et plein d’amidon pour réguler notre énergie. Elle nous en donne six, Belange les noue avec une brindille et les pose en équilibre sur sa tête, comme savent si bien le faire les Africaines. Nous voilà prêts pour l’aventure. En nous accompagnant jusqu’à chez Joël, Elvis nous met encore en garde contre les criminels en cavale et les trafiquants de drogue qui sévissent dans la région.
— Même ici ?
Nous sommes dans le Bandundu, un des territoires les plus reculés de la planète.
— Oui, oui, monsieur Guillaume. On fabrique de la cocaïne dans la brousse, elle est revendue à Kinshasa et les transporteurs en prennent pour tenir la cadence.
Ceux qu’il appelle les transporteurs n’ont pas grand-chose à voir avec nos conducteurs de poids lourds, ce sont des traîne-misère aux muscles durs comme la pierre qui, pour le prix de quinze ou vingt bouteilles de bière, parcourent des centaines de kilomètres avec leur vélo chargé à bloc : de maïs, de charbon de bois, de manioc, de bananes plantains, de singes boucanés ou de poissons séchés. Peut-être qu’Elvis me parle de drogue pour tester ma crédulité, pour faire peur au Blanc, qu’on appelle Mundélé en lingala. En tout cas, nous n’avons pas d’armes pour nous défendre. Je n’ai même pas un canif.
Joël a sa machette, cela devrait suffire ; il est en train de l’affûter dans sa cour quand nous arrivons. Derrière lui, son épouse – Divine, prénom authentique – et leurs deux enfants adorables, qu’il va abandonner pour guider les étrangers. Divine n’a pas l’air de nous en vouloir, qu’on lui vole son homme. Elle nous a préparé des rouleaux de chikwangue, elle aussi, et des œufs durs. Elle ajoute un sac d’arachides grillées et un régime de bananes, que nous commençons à manger dans la cour, avec de copieuses rasades de thé trop sucré pour faire descendre. Je bois beaucoup, je m’emplis comme un dromadaire, la méthode a déjà fait ses preuves. Mais, dans l’heure qui suit, je devrai m’arrêter trois fois pour vider ma vessie dans les herbes folles.
Notre équipée est parée, les adieux sont faits : il ne reste qu’à partir. Elvis, qui nous aime bien, nous accompagne encore un bout. Il en profite pour saluer bruyamment les gens que nous croisons, derrière les palissades en bambous puis dans les champs de maïs de la lisière du village, où les paysans ont déjà commencé à s’activer avant que la chaleur n’ait raison de leurs velléités agricoles. Au-dessus de nos têtes, le ciel est d’un bleu disons métallique. C’est très joli, mais bientôt il disparaît : nous entrons sans cérémonie dans la cathédrale de la forêt, avec ses murs épais de soixante kilomètres et, pour carillons, le boucan des perroquets jaco. De longs toboggans de lumière dégringolent de ses vitraux, comme si Jésus Christ allait débarquer, comme si nous assistions au tournage d’un clip de Michael Jackson. Une flopée de papillons bleus s’égaille autour de notre groupe, nous nous extasions quelques secondes. Puis Elvis donne ses dernières recommandations à Joël et nous confie l’adresse du pasteur Félicien, qui possède la plus belle villa d’Oshwé : grâce à son sésame, nous y serons hébergés dans les conditions les plus luxueuses. Enfin, Elvis indique un point imaginaire avec son gros index, c’est notre azimut, cent dix kilomètres à travers les mystères de la jungle.
— Cette route, on l’appelle le chemin des murmures.
Puis il regagne la lumière, tandis que notre colonne modeste et géniale s’enfonce dans la pénombre. Nous parlons un peu avec Joël, pour faire connaissance. Il prépare un diplôme de « juriste en sciences sociales », mais il n’a guère le temps d’étudier puisqu’il doit travailler aux champs pour nourrir sa famille. Et, même avec ça, il lui manque 40 000 francs congolais, l’équivalent de 30 dollars américains, pour payer son droit d’examen – sans cette taxe, ce n’est pas la peine de compter sur l’obtention du diplôme. Quand nous traversons une clairière, les rayons du soleil tombent comme des fûts de nitroglycérine sur nos têtes, ce qui nous cloue le bec. Nous ne faisons plus que marcher, marcher, marcher, toujours au même rythme. Nous pénétrons par petits bouts dans les entrailles de cette nef enchantée et j’ai à peine le temps de m’émerveiller devant les troncs qui s’élèvent jusqu’au ciel. Tout est vert, la lumière est tamisée par les branches et la végétation paraît de plus en plus démesurée : les feuilles des mauvaises herbes sont grandes comme des lits king size américains. Bientôt nous entendrons les singes s’enfuir à notre approche. De loin en loin, les oiseaux colorés inventent des ritournelles lancinantes. Nous sommes dans le jardin d’Éden, mais ce n’est toujours pas le temps de la contemplation. Nous montons et nous descendons, nous butons sur des racines, nous tournons à droite, nous tournons à gauche, parfois Joël taille une liane à la machette, ou un groupe de plantes sans-gêne venues coloniser notre chemin. Nous enjambons le cadavre d’un arbre mort de vieillesse, affalé au milieu du sentier : la pourriture et les termites lèveront patiemment son corps, ça leur prendra deux ans. Quelques libellules aux ailes d’écailles transparentes nous escortent sans un mot jusqu’aux limites de leur territoire. Ici, le sol est jonché de feuilles sèches qui coiffent d’autres univers que le nôtre, ceux des milliers de scarabées, de coléoptères, d’orthoptères, d’hémiptères, de lucanes, de chrysomèles, de charançons, de carabes, de phasmes, de mantes, de gastéropodes ou de myriapodes, attentifs à rien d’autre que leur survie. Dans un virage, nous croisons une colonne de fourmis : Joël lance l’alerte, il faut les enjamber en levant haut les pieds, celles qui arriveront à grimper sur nos tongs planteront leurs mandibules acérées dans nos mollets – on raconte qu’elles nettoient la dépouille d’une antilope en une journée. Nous les dégommons d’une simple pichenette, car nous n’avons peur de rien, et nous reprenons notre rythme. D’autres insectes mystérieux lancent leurs signaux, sonores comme des sagaies qui fuseraient à travers la touffeur de la forêt. Il est 9 heures, nous avons parcouru dix kilomètres.
Trompe-la-mort
« Il crut bon et nécessaire, tant pour l’éclat de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant, et d’aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures. »
Miguel de Cervantes, Don Quichotte
Le 11 novembre 1853, David Livingstone s’apprête à quitter le village de Linyanti, au nord de l’actuel Botswana, pour accomplir le plus long de ses voyages insensés : à 40 ans, après treize années d’Afrique, l’Écossais à la peau déjà parcheminée par le soleil s’est mis en tête de traverser le continent de part en part. D’abord vers l’ouest, jusqu’à l’Atlantique. Puis vers l’est, jusqu’à l’océan Indien. Un espace resté blanc sur les atlas de l’époque, faute de volontaires pour le répertorier.
Au milieu du XIXe siècle, la géographie de cette partie du globe est encore un mystère. Les cartographes y dessinent des plantes farfelues et des fauves imaginaires pour décorer, pour meubler. Le cœur de l’Afrique ressemble à un motif de tapisserie et la communauté scientifique n’arrive toujours pas à croire que les sommets des plus hautes montagnes, comme le Kilimandjaro, puissent y être couverts de neige alors qu’ils sont si proches de l’Équateur – en 1849, quand les explorateurs allemands Johannes Rebmann et Johann Krapf font part de cette découverte, les experts de salon mettent sérieusement en doute leurs allégations. On les traite d’affabulateurs ou de naïfs, on les ridiculise. Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers.
Livingstone n’est pas très bien équipé. Il manque d’étoffes ou de perles pour troquer vivres et droits de passage avec les tribus qu’il croisera sur sa longue route. Mais il est pressé de partir et n’a pas les moyens, ni la patience, d’envoyer chercher des ravitaillements au Cap, deux mille kilomètres au sud. Et puis, c’est un battant, un obstiné, un dur à cuire. Un trompe-la-mort, malgré sa santé déjà abîmée par les fièvres. Sa caisse de médicaments, contenant ses réserves de quinine contre la malaria, a été dérobée la nuit dernière ? Qu’importe, on s’en passera. Comme dans tous ses voyages, jusqu’au dernier, le docteur fait preuve d’une désorganisation aussi stupéfiante que sa détermination est admirable – mais on pourrait aussi parler d’inconscience. C’est son art, sa marque de fabrique, sa force et sa faiblesse. Livingstone donne le signal du départ à ses vingt-cinq porteurs indigènes et se lance à corps perdu dans l’inconnu. Il n’a qu’une chance sur mille d’arriver vivant.
Sa troupe est prise dans les pluies, ses paquetages moisissent, son mousquet rouille ainsi que ses instruments de précision – son sextant, sa montre chronomètre, son matériel chirurgical. Il mange des sauterelles et des racines. Vingt fois, l’intrépide voyageur tombe malade et vingt fois il manque de mourir. Ses hommes, des Makololos du Haut-Zambèze, attrapent toutes sortes de fièvres également, des maladies totalement inconnues de la faculté de médecine de Glasgow. Il faut faire de nombreuses haltes. Quand il est sur pied, Livingstone prospecte autour de ses campements, à la recherche d’un emplacement pour installer une antenne de la London Missionary Society, l’organisation missionnaire qui finance – chichement – son expédition. Il déchante. Les moustiques et les mouches tsé-tsé ne lui laissent aucun répit, la météo non plus. Surtout, les tribus rencontrées se révèlent souvent hostiles ou cupides, ou les deux. Car tout se paye, ici comme en Occident : à peine inventé, le mythe du bon sauvage vire déjà à l’aigre. Au lieu d’arriver dans un paradis vierge, l’explorateur en herbe découvre une terre compromise par la traite négrière, prise en sandwich entre les Portugais, venus chercher des bras à l’œil pour leurs plantations du Brésil, et les razzias arabes qui fournissent en domestiques tous les sultans de l’océan Indien. Sur la longue route, les indigènes se méfient de ce sorcier blanc qui dissimule ses orteils dans des brodequins malodorants, refuse stoïquement les femmes qu’on lui offre et raconte l’histoire d’un Jésus sacrifié sur une croix de bois pour sauver l’humanité. Celui-là, ils veulent bien en entendre parler, mais sûrement pas abandonner leurs coutumes polygames ni leurs animismes ancestraux. Le missionnaire écossais n’est pas doué pour faire des convertis, comme il n’a jamais été doué pour prêcher : le jour de son premier sermon, sans doute complexé par quelques problèmes d’élocution dont il n’arrive pas à se défaire, sans doute impressionné par les quarante fidèles qui dressent l’oreille devant lui, il oublie tout ce qu’il était venu dire, il rougit et s’enfuit en courant. Pendant les trente-deux années qu’il passe en Afrique, de 1841 à 1873, l’homme de Dieu ne fait qu’un seul converti – Kgosi Sechele, un chef de tribu qui accepte le baptême en 1848, mais préfère apostasier quelques mois plus tard car ses nouvelles obligations de chrétien lui paraissent trop contraignantes. Même ses porteurs makololos, il n’arrive pas à les intéresser à la Bible. Ils rigolent en écoutant ce prêcheur égaré leur parler du Sauveur, les yeux hallucinés par la fièvre, le pantalon en accordéon sur ses guiboles amaigries.
Et quand la colonne atteint Saint-Paul de Luanda, sur l’Atlantique, six mois plus tard, après un chemin de croix de mille six cents kilomètres, le brave est à l’article de la mort. Il ne tient plus debout, ni même à califourchon sur son bœuf. Il chie du sang, il vomit du sang. Les Portugais le ramassent à la petite cuillère et le présentent à Edmund Gabriel, le seul Anglais en poste dans la ville et peut-être sur toute la côte occidentale. Gabriel est commissaire de Sa Majesté la reine Victoria, il a la charge d’œuvrer très diplomatiquement pour mettre fin au commerce des esclaves : Livingstone voit en lui un allié, un compagnon de lutte, et puis c’est bien agréable d’échanger dans la langue de Shakespeare. Les deux Britanniques parlent de Silva Porto, un commerçant, un métis appointé par le roi du Portugal pour rejoindre l’autre colonie portugaise sur l’océan Indien, l’actuel Mozambique. Pragmatique, sans scrupules, ce voyageur arrondit ses fins de mois en achetant et revendant des hommes, précisément sur la route que Livingstone espérait inaugurer. Son exploit sera donc devancé par un esclavagiste, ce n’est pas de chance pour celui qui, toute sa vie, rêvera de terrasser la traite des Noirs. Le missionnaire apprend aussi l’existence d’autres VRP partis sur ses plates-bandes, souvent des Arabes venus de Zanzibar pour étudier les opportunités de négoce du côté de l’océan Atlantique. Dans sa précipitation, il n’avait pas vraiment pris le temps de se renseigner sur les voies déjà ouvertes dans la région. Une exploration mal préparée donne toujours un résultat approximatif.
Il ne veut pas rester sur cet échec, même si cette première étape qu’il vient d’accomplir est déjà un exploit surhumain. En attendant de reprendre des forces, il écrit des lettres enthousiastes et optimistes à ses commanditaires de la London Missionary Society, en omettant de les avertir qu’il a failli y passer plusieurs fois. Il continue d’implorer la venue de nouveaux évangélistes, en minimisant les risques de la région – et ces pionniers de la parole du Christ seront décimés par les fièvres quand ils débarqueront en Afrique, quelques années plus tard. Mais Livingstone a une idée derrière la tête et puis il est têtu. Il veut la tracer, sa route commerciale, celle qui apportera le progrès, le salut et la liberté aux autochtones. Il est convaincu que le commerce et le libre-échange affranchiront les tribus de la traite négrière. Il n’est pas près d’y renoncer, même si la tâche est ambitieuse. Très ambitieuse. Le Royaume-Uni a bien aboli l’esclavage en 1833, mais le commerce triangulaire continue jusqu’à la fin des années 1860. Dans son enfance écossaise, Livingstone a probablement lu les mémoires du stupéfiant Olaudah Equiano, l’un des premiers esclaves affranchis, devenu barbier à Londres en 1767, puis marin dans l’Atlantique, et enfin une figure influente de l’abolition. En 1789, pendant que le peuple de Paris prenait la Bastille, Equiano publiait son autobiographie, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano : le livre se vend à presque autant d’exemplaires que Les Aventures de Robinson Crusoé et bouleverse beaucoup de bonnes âmes. D’où que l’on prenne son histoire, Livingstone s’est toujours opposé à l’esclavage. Toujours, il a voulu combattre cette injustice, comme Don Quichotte s’en prend aux géants des plaines espagnoles, aux outres de vin et aux moulins à vent.
Le missionnaire écossais repart de Luanda au mois de septembre 1854. Il est un peu moins mal équipé : les Portugais, qui ont eu pitié de sa horde dépenaillée, lui fournissent des vêtements, une jument grise et des mousquets. Edmund Gabriel lui donne quelques fioles de quinine. Cette fois, Livingstone est déterminé à accomplir sans faillir la seconde étape de son odyssée, une traversée intégrale du continent, d’ouest en est. A-t-il eu l’heur de s’entretenir avec le Hongrois László Magyar, établi en Angola depuis la fin des années 1840 ? Un autre excentrique de l’exploration, celui-là, qui partait dans des expéditions tout aussi mal ficelées, vers les fleuves de l’Afrique centrale, à la recherche de la grande mer intérieure qui devait certainement alimenter ces cours d’eau majestueux. Ce qui le passionnait, ce n’était pas tant la géographie que la vie des indigènes, leurs coutumes, ce qu’ils mangeaient, comment ils enterraient leurs morts, les contes et les légendes qu’ils transmettaient à leurs enfants. Mais il n’a jamais pris le temps de mettre de l’ordre dans ses notes, de publier ses passionnantes découvertes et, quand il meurt en 1864, son existence se réduit à un petit tas de poussière.
Raide comme un cierge, le regard fiché dans les collines bleues de l’horizon, Livingstone avance fièrement sur sa jument grise et rousse. Il pense à la gloire ou à Dieu, il pense à la postérité. Il pense à ses quatre enfants qui grandissent en Écosse avec Mary, son épouse, dont nous parlerons plus tard. Il pense aux siens et au bivouac de ce soir, bien que le soleil soit encore haut dans le ciel. Puis il tombe malade et il faut s’arrêter au bord de la rivière. C’est la rivière Kasaï, un affluent du fleuve Congo qui coule vers le nord à la vitesse d’un enfant qui trottine. Quelques jours, le temps qu’il reprenne assez de forces pour se mettre en selle. Ensuite, ce sont les porteurs qui trébuchent, qui tremblent, qui tombent, qui s’écorchent un genou, qui saignent ou qui pleurent, et il faut leur donner des coups de bâton et puis les consoler. La jument grise et rousse, rouanne, est piquée par une mouche tsé-tsé ou par une autre bestiole, elle tremble elle aussi, elle tremble tant qu’on lui tranche la gorge. Enfin, ce sont les pluies qui arrivent, un peu plus tôt que prévu, et les instruments de précision rouillent de plus belle, même ceux qu’il met sous ses aisselles pour les protéger. Cette exploration n’est pas une partie de plaisir, écrit sobrement le missionnaire dans son journal. Ce n’est rien de le dire. La troupe mettra un an pour retourner à Linyanti, le village du centre de l’Afrique australe d’où elle était partie vingt-deux mois plus tôt. Les porteurs retrouvent leurs épouses. Mais à peine ont-ils le temps de les engrosser que Livingstone les pousse à reprendre la route, vers les vagues salées de l’océan Indien.
Ils posent quelques pirogues sur le Zambèze, quatrième fleuve du continent, qui s’élargit un peu plus chaque jour. À l’est, on note la présence d’un épais nuage blanc. Le bourdonnement gonfle, s’épaissit, devient grondement, devient rugissement, devient hurlement, fait trembler le sol, fera même bouillonner le sang dans les veines. Livingstone ne s’en étonne pas complètement, il sait ce qui l’attend, les indigènes l’ont prévenu que ce serait du grand spectacle. Le 16 novembre 1855, il découvre le plus beau des paysages qu’il verra de toute sa vie, le plus remarquable en tout cas. Le 16 novembre ou le 17 novembre, il s’émerveille devant les chutes Mosi-oa-Tunya, la-fumée-qui-tonne : le Zambèze s’écroule dans un précipice de cent mètres de profondeur, une faille dans l’écorce terrestre, une plaie longue de deux kilomètres, avant de reprendre sa route au fond d’un canyon tout aussi vertigineux. Sur son carnet, Livingstone, premier Blanc à contempler le spectacle, bâcle un peu ses descriptions, comme s’il n’y avait pas de quoi s’ébaubir. L’explorateur ne prend pas la peine de détailler l’émotion qui pourrait bien nous étreindre devant ce spectacle de la nature, mais il fait tout de même quelques croquis des cataractes, pour immortaliser le moment. Dans la fine écume, il est d’abord fasciné par les arcs-en-ciel qui coiffent ce fabuleux panorama, puis il s’agace de cet accident géologique qui contrecarre superbement son projet d’autoroute commerciale. Il tape du pied dans la poussière ou dans la boue, il vocifère, il s’époumone, mais personne ne l’entend. Avant de poursuivre son chemin, il prend tout de même soin de rebaptiser le site Victoria falls, les Chutes Victoria, pour faire plaisir à la reine d’Angleterre : ça ne coûte rien et peut-être que ce cadeau relancera l’intérêt de la couronne pour cette partie du monde et pour ses lubies d’autoroutes. Peut-être que ce cadeau donnera davantage de poids à son combat contre la traite des Noirs.
En aval, les eaux sont vertes et les berges grouillent de crocodiles. Livingstone annote son journal d’observations sur l’écorce des arbres, le plumage des oiseaux, le cri des insectes, le relief. Il n’oublie jamais de dessiner sa carte, il trace son parcours à la main, tous les soirs ou très tôt le matin. Il s’écarte souvent du fleuve avec ses hommes, parfois sur de longues distances, pour explorer des collines ou des vallées, toujours en quête de la terre qu’il a promise à la London Missionnary Society. Il arrive sur une plaine verdoyante, bien irriguée sans être marécageuse : c’est le plateau de Batoka. Il croit bien avoir trouvé l’endroit idéal pour fonder une prochaine mission. Ce jour-là, il est content. Mais ses hommes reçoivent une bordée de sagaies, les tribus locales prennent ces vagabonds indécis pour des trafiquants d’esclaves et les forcent à déguerpir.
Lors de ces échappées du Zambèze, Livingstone passe trop loin des rapides de Kébrabasa pour les remarquer. Or, sur cette partie du fleuve, le dénivelé est si fort qu’il ruine à nouveau tout espoir de navigation – cette petite négligence l’entraînera, quelques années plus tard, dans une expédition infernale et totalement foireuse – les riverains lui avaient pourtant signalé l’obstacle, mais le prince de l’approximation avait préféré le sous-estimer, ayant décidé une fois pour toutes que le Zambèze serait la prochaine artère de l’Afrique. Sourd et téméraire, il avance sans répit, l’œil froid, le front brûlant. La fièvre le rend triste, parfois, mais il retient ses larmes et il avance tout de même. Pour se consoler, il trace sa carte, minutieusement, le soir ou le matin. Les vivres commencent à manquer, ses hommes se plaignent de la faim, ils trébuchent, ils râlent, tout le monde est malade, le missionnaire coupe au plus court pour abréger leurs souffrances et pour abréger les siennes.
Quand il débarque à Quelimane, sur l’océan Indien, le 25 mai 1856, il est à bout de forces, une fois de plus. Tout l’abandonne, au point qu’il dicte son testament, au cas où le Seigneur le rappellerait dans la nuit. Mais qu’a-t-il à léguer, lui qui ne possède rien d’autre que les kilomètres enroulés bien serré dans un coin de sa tête ? Sa Bible à Mary, ses notes à la London Missionary Society et quelques défenses d’éléphant négociées en cours de route ? Juste avant de succomber, il est recueilli de justesse par des Portugais, d’autres Portugais, qui avaient leurs comptoirs sur la côte du Mozambique. Ils le soignent, c’est-à-dire qu’ils lui font boire de la soupe à l’ail avec une petite cuillère et lui posent un linge humide sur le front. Le missionnaire guérit miraculeusement, à nouveau. Voilà une aube qui survient, puis une autre : c’est dans une chambre aux murs immaculés qu’il se remet de sa prodigieuse traversée, accomplie au courage, à la détermination, à la foi, à l’astuce et à la chance. À la chance, surtout. Ses porteurs descendent tremper leurs orteils dans l’eau grise et salée de l’océan et Livingstone se requinque sur son lit de convalescence. Les Makololos se rafraîchissent les pieds, ils soignent leurs plaies, l’œil sombre, pendant que leur chef rédige de nouvelles lettres enthousiastes à destination de Londres. Il se demande comment on l’accueillera à son retour, il se doute un peu que ses exploits seront célébrés. Il pense à la gloire, même s’il s’en défend – tout de même, il voudrait bien voir son nom écrit quelque part, sur une pierre d’église ou dans un livre de géographie.
Là-bas si j’y suis
« Mais on le sait, les choses commencent cent fois, en cent lieux différents, comme notre vie recommence sans cesse dans nos souvenirs. »
Éric Vuillard, La Bataille d’Occident
Belange ondoie devant moi, agile et noble, délicate, habillée comme à la ville avec ses tongs décorées d’arabesques et ses jambes de sauterelle serrées dans un pantalon extra slim, l’avant-bras glissé dans les poignées de son sac à main, façon reine d’Angleterre, et ses chikwangues sur la tête. Son corps épouse sans effort le méli-mélo végétal et sa bonne humeur fait rejaillir la lumière autour de nous, malgré les conditions militaires. Elle connaît toutes les plantes de la forêt, celle-là guérit l’asthme, celle-ci le mal de gorge, cette écorce soigne les hémorroïdes ; elle en apprend même à Joël, qui montre ses premiers signes de fatigue. Il souffle derrière nous, maintenant, et nous devons parfois nous arrêter pour l’attendre. Belange me conseille de bien regarder les branches que l’on écarte avec les mains, des fois qu’un serpent s’y serait enroulé, et nous parlons encore des histoires qu’elle écrit sur ses cahiers de brouillon. Celle de Monama nous amuse : la plus jeune épouse d’un chef de tribu s’enfuit dans la forêt pour échapper au carcan des traditions. Elle est rejointe par un Blanc qui admire secrètement sa beauté, et les deux jeunes gens caracolent dans l’immense jungle où ils apprennent la vie, où ils partagent leur sang et des baisers. Mais voilà Joël qui apparaît, sa machette à la main et de grosses gouttes de sueur retenues par ses épais sourcils. Dans le petit sac de toile qu’il porte sur le dos : une moustiquaire et son précieux manuel de droit, puisqu’il a prévu de bûcher ses examens les soirs de veillée.
Nous reprenons la marche jusqu’à une ravine, une espèce de vasière infranchissable. Un tronc est posé en travers, pour rejoindre l’autre berge : sans cérémonie, Belange ôte ses tongs et avance gaiement sur l’écorce pourrie, en équilibre précaire, tout en sifflotant un tube à la mode sur les ondes de Kinshasa. Plus loin, nous débouchons sur une source d’eau claire et Joël suggère une petite pause, histoire de nous rafraîchir. Nous n’avons pris ni gourde ni bouteille, pour ne pas alourdir inutilement nos bagages – nous savions que la forêt serait assez bonne fille pour nous abreuver à intervalles réguliers. Nous avançons contre le courant timide, à pas légers pour ne pas troubler son lit de sable blanc, nous plongeons nos mains en écuelle dans le liquide limpide, presque frais, qui nous guérit de toutes les fatigues. Une gorgée, deux autres – les premières, on ne les sent même pas. Je bois, je bois sans m’arrêter, j’ai l’impression que je pourrais avaler toute l’eau du Congo, le bonheur c’est simple comme une goulée d’eau pure. Quand j’ai absorbé tout ce que je pouvais, fidèle à la méthode du dromadaire, je regagne la berge où Joël semble perplexe, indécis. Il regarde en l’air, puis derrière lui. Il se gratte la tête, pose les poings sur ses hanches, hausse les sourcils, marmonne, fait trois pas, recule et nous avoue son dilemme : il ne s’est jamais aventuré aussi loin et s’inquiète du chemin à suivre. Il est comme nous, après tout, il avait envie de visiter, il voulait prendre un peu l’air. Il a 29 ans, un corps trapu et une tête d’intellectuel. Son regard est doux, sa voix posée et il rigole de bon cœur à toutes nos blagues. Mais il est aussi perdu que nous. Impossible de nous souvenir de l’azimut donné par Elvis, qui nous a échappé dans le slalom géant de la brousse. Nous devrons faire confiance à notre instinct.
La première fois que j’ai marché dans la jungle, c’était en Amazonie : le magazine qui m’employait m’avait envoyé enquêter sur les chercheurs d’or de la Guyane française. J’avais traîné des heures dans les ruelles de terre rouge de Maripasoula et j’avais rêvé devant les eaux boueuses du Maroni. J’avais bu de la bière avec quelques aventuriers, à l’ombre d’un rade mélancolique et bruyant. Je cherchais un moyen de me faire embaucher dans une de leurs prochaines expéditions, mais ils ne voulaient pas de moi, j’étais trop faible et je ne connaissais rien à la forêt. Quelques jours plus tard, mon ami Alan était venu me rejoindre – un Breton enthousiaste, généreux et toujours maladroit, un bon compagnon de voyage qui passait justement dans le coin. Nous avions bu encore un peu de bière et Alan nous avait porté chance : un matin, nous avions embarqué dans une longue pirogue taillée dans un seul tronc, nous étions partis à contre-courant avec quelques provisions, des pioches, un détecteur de métaux, une carabine et du fil de pêche. Nous avions remonté le fleuve en compagnie d’une poignée de garimpeiros, jusqu’à ce que les arbres des deux berges forment une seule voûte sombre, jusqu’à ce que leurs branches s’entremêlent. Puis nous avions marché à travers les plaies et les bosses de la forêt, dans la chaleur et dans la sueur, tandis que des insectes se collaient à nos fronts. Nous avions monté notre camp au crépuscule, quatre piquets et un toit de feuilles sous lequel nous avions suspendu nos hamacs. Cette nuit-là, j’avais entendu pour la première fois les grognements rauques des singes hurleurs, pleins de colère ou de désespoir. Dès le lendemain, nous avions attaqué le filon avec nos pelles et nos pioches et nous n’avions rien trouvé.
Mais j’avais vu mon premier scorpion, mes paumes s’étaient couvertes de cloques et j’avais contemplé la majesté de la forêt. Les hommes cherchaient l’or dans la terre rouge, ils déshabillaient la jungle sans lui demander son avis et faisaient tourner de la boue dans leurs tamis, en y ajoutant des rasades de mercure. Ils cherchaient de l’or et ils salissaient la rivière. Un jour, l’un des conquistadors avait crié très fort et nous avions vu deux pépites briller au fond de l’écuelle. Avec tout le mercure qu’ils avaient versé, des générations d’Amérindiens seraient atteintes de maladies incurables. Les pépites, elles, seraient dépensées en tournées de rhum, les jours de relâche.
Le filon s’avérait de plus en plus prometteur. Tellement prometteur que Popo Machine, le chef de notre équipée, décida de rentrer chercher du renfort à Maripasoula. J’avais été tenté de rester, de rester toute ma vie dans ce décor qui m’enchantait. Mes mains auraient durci, mes épaules se seraient élargies et je serais devenu un homme des bois. J’avais été tenté, mais je n’avais pas osé : j’étais finalement rentré à Paris pour écrire mon article. Avant cela, Alan et moi avions dû suivre Popo Machine dans la confusion végétale de l’Amazonie. Là aussi, il avait fallu avancer à l’instinct dans la jungle. Après six heures de marche, nous avions débouché dans un village d’Indiens Wayanas, trente paillotes sur pilotis vides de toute âme excepté celle d’un chiot stupide mais affectueux, aux pattes infestées de chiques. Les habitants étaient partis faire la fête dans une localité voisine ou bien ils étaient tous morts. En traînant sur la berge, nous avions découvert une pirogue abandonnée, à moitié immergée, dont la coque était fendue. Nous l’avions colmatée tant bien que mal, avec des touffes d’herbe et de la glaise, nous avions improvisé des pagaies avec deux branches et nous nous étions lancés sur le courant placide. Alan écopait à l’avant, avec un demi-jerrican, en braillant des chansons de marins. Plus tard dans la nuit, nous avions accosté au village suivant, et le lendemain matin nous avions pu embarquer dans la pirogue scolaire qui amenait les petits indigènes au collège de Maripasoula. J’étais rentré à Paris quelques jours plus tard et le cri des singes hurleurs m’avait longtemps accompagné dans mon sommeil. Depuis cette première expédition sous la canopée, je garde une attirance compulsive pour la forêt ; pour ses mystères, pour sa puissance et pour l’énergie qu’elle distille dans nos veines, longtemps après que nous l’avons quittée.
Ensuite, j’ai erré dans toutes sortes de villes, dans les bazars poussiéreux de Kaboul, entre les yourtes sales d’Oulan-Bator, que les Mongols appellent des ghers, aux pieds des gratte-ciels de New York, sous les câbles électriques des rues suffocantes de Saïgon, au milieu des places vides de Minsk ou de Gdańsk, sur les quais décatis de La Havane, au creux des ruelles féeriques de Sanaa. Je me suis perdu dans des déserts de sable jaune et je me suis abîmé les chevilles sur des collines pierreuses. J’ai essayé de gravir des montagnes bleues, noires, rouges, blanches. J’ai dormi sur de la mousse, sur des brindilles, sur les pentes d’un volcan, dans les fourrés, dans des pirogues, dans un couvent, dans un bordel, mais jamais dans un igloo. J’ai rêvé sur les remparts des châteaux abandonnés, au bord de la Méditerranée et ailleurs, j’ai passé des heures au fond des bus, mal assis sur des sièges défoncés, à respirer des bouffées noires de gasoil. J’ai galopé dans les steppes. Je me suis baigné dans beaucoup de lacs et dans beaucoup d’océans. J’ai marché sur la muraille de Chine, j’ai vu les chutes du Niagara, j’ai navigué dans la tempête et j’ai été malade. J’ai fait du stop dans les Balkans, pendant des étés, des étés, sans m’arrêter, subjugué par cette Europe du Sud, désuète et libre – émerveillé par sa folie contagieuse, son allégresse, sa sagesse et son je-m’en-foutisme.
Mais c’est la forêt qui m’a happé, pour de bon. L’année où j’ai rencontré Belange, je descendais le fleuve Congo jusqu’à son embouchure. Je voulais me fondre dans la jungle, escorté par ses bruits, son odeur, sa langueur : les journées s’étireraient en semaines et je pourrais toucher le temps comme on trempe sa main dans le fil de l’eau. Il m’avait fallu trois mois, une petite fièvre et quelques péripéties pour arriver au bout de mon voyage. À Mbandaka, à cinq jours de bateau de Kinshasa, j’avais été envoûté par les mélopées déchirantes des Pygmées, leurs chorales improvisées rythmées par une simple cuillère frottée contre le cul d’une bouteille de bière. Ils m’avaient proposé de les accompagner dans la forêt et m’invitaient à séjourner dans leur village, à quelques jours de marche, mais le voyage ne s’était pas fait – les Pygmées étaient lancés dans une fête à durée indéterminée, je les entendais chanter le jour et la nuit, personne ne savait quand la nouba s’arrêterait. Et puis, mes finances s’asséchaient, je ne pouvais pas me permettre d’embardées supplémentaires. J’avais renoncé et j’en avais gardé de l’amertume. Dans l’avion qui me ramenait en France, je m’étais promis de ne jamais abandonner ce pays qui m’avait tout donné, tout de suite. J’étais fasciné par son destin irréaliste et tragique, par sa grandeur et sa décadence, par toutes les promesses qui n’avaient jamais vu le jour, par la gentillesse de ses habitants, par leur créativité, par leur humour, par les Pygmées, par Belange. Un jour, je retournerais au Congo.
Je bute sur une racine. Il faut faire attention, conseille Joël. Il ne faut pas rêver en route. Je me concentre quelques minutes sur mes pas, je règle ma respiration, puis je retourne dans mes pensées tout en musardant au pied de notre muraille végétale. Pas longtemps. Belange, qui chantonnait derrière moi, pousse un petit cri aigu. Je me retourne.
— Regarde, dit-elle.
— Quoi ? Où ?
Elle me montre un long serpent noir et brun, luisant, la tête dressée à la hauteur de mon mollet, les yeux brûlants de haine ou de peur, la langue fourchue. Je viens de passer à dix centimètres de ses crochets venimeux sans m’en apercevoir. J’inspecte fébrilement les alentours, au cas où il aurait des copains, et Belange le fait déguerpir à coups de sac à main. Il faut faire attention, répète Joël – qui ne l’avait pas vu non plus.
La symphonie de Kinshasa
« Terre promise / redis-moi ton nom »
Alain Bashung, « Sommes-nous »
Je voulais revenir au Congo et je suis revenu, un jour de février. J’avais trouvé le prétexte d’y faire un reportage sur un orchestre symphonique monté à partir de trois fois rien, quelques violons, une contrebasse fendue et des flûtes découpées dans des tuyaux en plastique. En quinze ans de travail, et avec une remarquable obstination, les musiciens autodidactes ont assemblé un orchestre au complet, cent virtuoses d’une musique à deux mille lieues de leur culture. Ils jouent du Bach et du Mozart sur leurs instruments de récupération – un câble de frein de vélo pour remplacer une corde de violoncelle ou du fil de pêche pour le crin des archets – et leurs prestations sont éblouissantes.
Belange m’attendait à l’aéroport de Kinshasa, dans une robe à dentelles. Elle pouvait m’héberger dans la cour des miracles où elle logeait, près du marché central : treize appentis où s’entassent une centaine de personnes, des veuves de guerre, des fonctionnaires licenciés, des vendeurs de marijuana, des filles-mères et des familles de dix. Avec un seul robinet pour abreuver toute cette palanquée. Les kulunas, c’est-à-dire les voyous du quartier, y terminent parfois leur nuit, ils dorment quelques heures sur le ciment sale avant de se revigorer avec un joint et quelques gorgées d’alcool de maïs. Le fatras de cabanes est rebaptisé Maman Yemo, du nom de l’hôpital le plus insalubre de Kinshasa, où l’on a plus de chance d’attraper une infection mortelle que de ressortir guéri. Ici, les maladies se faufilent dans la crasse, prévient Belange. Quand elle va faire sa toilette, entre trois murs de parpaings branlants, elle ajoute des gouttes de crésyl dans son seau d’eau, en espérant que ça suffira pour tuer les microbes.