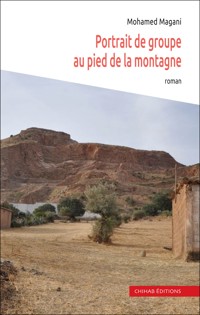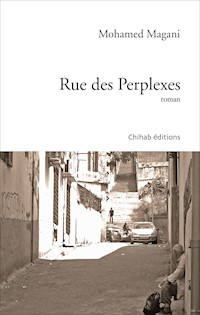Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Entamée avec le roman "Scène de pêche en Algérie" (2006), poursuivie par "Portrait de groupe au pied de la montagne" (2023), "la trilogie chorale" s’achève sur Le meilleur de nous-mêmes (inédit). Ce sont trois ouvrages écrits chacun dans le genre roman choral, ou roman en nouvelles, se distinguant par la diversité des personnages, points de vue et regards, et l’autonomie de chaque nouvelle. Les trois romans réunissent les mêmes personnages et les mêmes lieux. Des thématiques communes les lient également. Des personnages des première et deuxième parties réapparaissent dans la troisième, conférant une grande unité à la trilogie, et accentuant la polyphonie inhérente au roman choral. De même, la voix de l’auteur y fait intrusion au travers de la non fiction qui « fracture la narration » et la fait voyager vers de lointaines contrées.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Mohamed Magani est né à El Attaf. Auteur de romans en français et de nouvelles en anglais, il parcourt le monde et s’inspire de ses voyages dans l’écriture. Mohamed Magani vit à Alger et enseigne à l’Université.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trilogie chorale
صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة والفنون
Mohamed Magani
Trilogie chorale
Scène de pêche en Algérie
Portrait de groupe au pied de la montagne
Le meilleur de nous-mêmes
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2024.
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-773-2
Dépôt légal : octobre 2024
Première partie : Scène de pêche en Algérie
Les journées consacrées exclusivement à la pêche
ont pour étrange conséquence d’effacer votre esprit
et de vous faire retourner à la réalité ordinaire à pas
prudents, sinon à reculons.
Jim Harrison
The river is the water’s true form and it is a very
satisfactory form for the water…
Gertrude Stein
Le buste de l’Émir
Un soir de mars, vers sept heures, alors que je m’apprêtais à déguster le premier poisson d’eau douce depuis des lustres, la sonnerie retentit. Il y avait du monde devant la porte. Accompagnés de mon voisin direct, d’un palier l’autre six individus se tenaient sur les marches de l’escalier. Le voisin dit avoir besoin de la clé de notre cave commune. Je la lui remis et fis remarquer que tous les locataires, en principe, devaient en posséder une. Les six inconnus observaient un silence calculé.
Le lendemain, la visite des six hommes, son but surtout, fut sur toutes les lèvres. La Brigade de recherche des objets d’art n’existait pas encore, mais l’équipe des cinq hommes remplissait déjà ses fonctions. Ils pistaient un objet d’art, mystérieusement disparu d’une place publique, et mirent la main dessus dans notre immeuble. Laguerrecontrelescivils n’avait pas épargné les statuaires et autres sculptures, quand bien même leur sort fut autre que celui des bouddhas géants d’Afghanistan terrassés au canon. Dans la cave noyée de notre immeuble, la nouvelle brigade repêcha un buste de l’Émir Abdelkader.
Il y eut bien quelques froncements de sourcils et haussements d’épaules, doutes que les faits levèrent rapidement. Il s’agissait sans erreur possible d’un buste de l’illustre Émir, pièce de valeur volatilisée au milieu d’une place publique. Les mensurations correspondaient avec exactitude à celles de l’œuvre authentique. Buste en bronze lourd. Matière, poids, dimensions, inscriptions, couleurs : tout y était.
Surencombrée d’objets remisés, la cave débordait en outre d’une eau gluante et huileuse, noire comme du cirage, fruit pourri des dernières pluies diluviennes. Plus personne n’osait s’y aventurer et risquer sa santé, hormis le nouveau et dernier venu dans notre immeuble, lorsqu’il voulut se réserver un débarras une fois le beau temps revenu. Nul parmi les voisins ou dans les autres immeubles ne pouvait dire d’où il ne venait ni ce qu’il faisait dans la vie. D’apparence riche, il saluait quelquefois, adressait peu, pour ne dire jamais, la parole aux voisins. C’est lui qui alerta la police sur la présence de l’objet insolite dans notre cave. Incapables d’en savoir plus sur lui, les langues se délièrent au sujet de son prédécesseur dans l’appartement.
Chef de daïra, ce dernier aurait agi sur instruction de ses supérieurs. Il dissimula le pesant buste sous une eau morte et opaque, dans la seule et méritoire intention de lui épargner le sort de maintes autres œuvres d’art plantées dans les lieux publics : le pillage ou la destruction.
La question demeurait cependant, pourquoi la cave et sa mare captive et empuantie ? (Sa fétidité, miracle du séisme, ne put gravir les marches de notre immeuble encore debout.) D’après un voisin, le chef de daïra s’était approprié le buste de son propre chef. La cave noyée fournit une cache idéale. Une intempestive mutation, dans un coin reculé du pays, aurait contrecarré ses plans. Se hasarder à sortir le buste de l’Émir, le transporter si loin, l’exposait à de gros risques, par-dessus tout compromettre sa carrière.
Selon deux autres voisins, une enquête, diligentée en réalité sur tous les objets d’art détruits ou disparus, aurait permis de remonter jusqu’à l’indélicat haut fonctionnaire. Partagés, les locataires de notre immeuble ne pouvaient s’expliquer son acte ambigu ni être tout à fait affirmatifs sur ses intentions, encore moins témoigner de l’innocence du chef de daïra en le présentant comme un protecteur des arts (du genre à patauger dans la vase, si nécessaire, par passion de sa mission), ou à l’opposé coupable de recel et malfaiteur fini.
Carnages
À l’exception du locataire occupant le cinquième et dernier étage, nous nous retrouvâmes à l’entrée de l’immeuble. La veille, nous avions pris la résolution d’aller admirer, au marché à côté, les premières pastèques de l’été.
Dès l’entrée du marché, nous vîmes deux hommes décharger une camionnette lourde de pastèques. Les beaux fruits s’entassaient et nous rêvions, à haute voix, de leur chair aqueuse et désaltérante à souhait en cette journée de chaleur accablante. Le fruit de saison idéal. Un voisin du deuxième nous signala que la pastèque était une plante qui donne ce fruit. Nos propos dérivèrent sur les frontières tenues que la science établit parfois, propos qui nous évitèrent en fait de demander le prix du kilo du fruit convoité. Nous savions qu’il était inabordable à ce stade de son arrivée sur les marchés.
Nous continuâmes rapidement notre chemin. Les ventes à la criée battaient leur plein pour tout, à l’exclusion des pastèques. Silencieux et immobiles comme des momies, les vendeurs savaient leurs prix hors de portée et nous lorgnaient de loin, sans doute considérant notre groupe au même niveau qu’une colonie de vacances en promenade surveillée.
Vers la sortie, nous assistâmes à une scène ahurissante entre les deux hommes qui déchargeaient les pastèques d’une camionnette. Associés en apparence, l’un perché sur le véhicule lançait des pastèques à l’autre qui, au lieu de les déposer par terre avec précaution, les éventrait l’une après l’autre à l’aide d’un couteau à lame cendrée.
– Elle est mûre, celle-ci ?
Il découpa la pastèque en deux et attrapa la suivante au vol.
– Elle est mûre, celle-ci ?
Il l’étripa.
– Et celle-ci, elle est mûre ?
Il ne se retenait pas d’éventrer.
Il exécuta ainsi un bon tiers du chargement de la camionnette. Les morceaux, à la chair d’un blanc jaunâtre, se répandaient autour de lui. Un public médusé entoura l’homme qui ne décolérait pas contre son associé gardant insolitement les yeux mi-clos et les oreilles inattentives, appliqué à lui lancer mécaniquement les pastèques, pareil à un automate activé par le moteur de la camionnette.
Au bord de l’explosion, l’homme destinataire des pastèques les laissait à présent choir sur le sol. Elles se fendaient avec l’éclatement mat d’un paquet de pétards mouillé. Il sautait sur les tranches grossièrement charcutées.
– Et ça… et ça… ?
Il poursuivit le massacre tout en se déchaînant contre les morceaux à coups de pied.
– C’est mûr, ça ? et ça ?
De retour à notre point de départ, un autre spectacle nous attendait. Tous les immeubles aux fenêtres, nous observions la scène et ne vîmes personne intervenir. Le nouvel épicier dans notre quartier, jeune homme plein de force et de santé, brandissait un couteau à fromage contre le visage d’un habitué de son épicerie, malingre et court sur ses pieds.
Les menaces s’enchaînaient de part et d’autre. Des grossièretés fusèrent, puis les insultes plurent, surtout du côté du nouvel épicier. Lorsqu’il souleva brusquement le couteau au-dessus de la tête, son adversaire prit la fuite.
L’épicier se lança à sa poursuite. Il le rattrapa juste devant la décharge à ordures. Nous vîmes alors le père du jeune menacé accourir et s’interposer. « Frappe-moi ! Frappe ! C’est moi que tu dois tuer, implorait-il, c’est moi ! »
Derrière le père, le fils esquivait les coups de couteau.
Des attroupements s’amassèrent, à bonne distance. La scène nous fascinait et terrorisait à la fois. Ni gendarmes ni policiers ne montraient le bout du nez.
L’épicier réussit à atteindre la jambe droite du jeune malingre. Il se figea avant de porter un deuxième coup, fixant le couteau sanguinolent. Affolé à présent, il tournait sur lui-même. Le blessé s’écroula, son père suppliait pour faire venir une voiture qui emmènerait son fils à l’hôpital. Des hommes s’approchèrent, se regardèrent, indécis. Finalement, l’épicier se précipita vers sa camionnette. Des bras l’aidèrent à soulever et porter le blessé. Il fila aux urgences.
Les gendarmes arrivèrent sur les lieux une demi-heure plus tard.
À dater de ce grave incident, la clientèle affluait chez notre nouvel épicier. Ce fut un changement de tendance aussi dramatique que le moment où la chrysalide devient papillon. Femmes et enfants volaient en direction de son local, dans une remarquable ignorance des autres épiceries. Une femme se distingua par une rare preuve de dévouement.
Elle envoya son fils acheter un paquet de semoule et de la levure. Elle lui remit un billet de 100 dinars. Notre nouvel épicier rendit la monnaie et ajouta à l’enfant un autre de 100 dinars. La femme renvoya le billet à l’honnête commerçant.
L’épicier le redonna au garçon, affirmant qu’il avait reçu un billet de 200 dinars.
La femme le lui retourna une deuxième fois.
L’épicier ne voulut rien entendre. Il maintint ferme avoir reçu 200 dinars.
La femme persista dans sa version.
Son fils remonta et redescendit tant de fois les escaliers qu’à la sixième il écarta toute idée de retourner chez lui. Après de sévères réprimandes, dignes d’un grand frère, notre nouvel épicier lui administra une correction mémorable, qu’il n’avait pas volée pour cause de désobéissance à sa mère, de l’avis de clients fidèles, témoins du fait.
Ahmed le pêcheur
Ce matin calme et éclatant, Ahmed a perdu l’envie de remonter aux années fastes de la pêche, bien que son regard traîne depuis des heures sur le lit calciné de l’oued à sec. Le bel optimisme qu’a affiché un autre pêcheur assis à son côté, peu avant, ne l’a guère touché : le Cheliff est noble. Il ne peut vivre ces temps d’abomination. Mais il est là, il coule et se purifie en profondeur. Qui a disparu avec l’oued ? – les poules d’eau et les canards, bien avant l’indépendance déjà – et qui d’autres ? se dit Ahmed le pêcheur. Son père, bien sûr, (la mère est toujours vivante) et trois noms viennent aussitôt s’ajouter dans son esprit. Il ne peut s’expliquer cette association avec la pêche ni s’il en existe une réellement.
Trois hommes qu’il croisait bien souvent, pas d’assez près toutefois, et n’échangeait des mots avec eux qu’en de rarissimes occasions. Ils lui faisaient grande impression, lui inspiraient un respect infini, tant il voyait dans leur vie, réglée comme une montre, la plus haute illustration du don de soi à des causes supérieures et indéfinissables, enfouies profondément en eux.
Ouamer le cordonnier. Un visage sévère : l’homme se gardait de l’éclairer par un sourire en public. Un cordonnier toujours en manque de temps. « Pas le temps ! », lançait-il invariablement, manifestement contrarié, lorsque Ahmed le pêcheur se présentait avec des chaussures abîmées dans son échoppe.
Adolescent, hormis son âge, le fils quant au caractère ne différait en rien du père avec qui il partageait aussi un vélo.
À la tombée du soir, le cordonnier quittait son échoppe. Lui et son vélo cheminaient jusqu’aux rails, ensuite il l’enfourchait et l’homme et les roues se dérobaient bientôt aux regards. Le matin, tôt levé, Ahmed ne pouvait le croiser, car il était déjà en route vers ses endroits de pêche préférés
Merrah l’épicier. Ahmed le pêcheur ne l’apercevait que le soir également. Il tenait épicerie à des kilomètres et retournait chez lui par train. À heure précise, il l’observait suivre, une canne à la main, le chemin menant de la gare vers sa maison en deux lignes droites, formant angle parfait au niveau du café.
Tout être vivant, à commencer par les animaux de trait et ceux domestiques, racontait-on, tous avaient droit à une inclinaison de tête et à des salutations articulées à voix claire et distincte. Et un sourire éclatant, en prime. Le matin à l’aller, le soir au retour, les gens sur son passage l’entendaient de sa voix pleine égrener les politesses d’usage.
Jusqu’à sa mort, nul n’aurait prétendu l’avoir vu dans un café.
Ses enfants, en revanche, à la différence du fils d’Ouamer le cordonnier, ne marchaient guère sur les pas du père. De vrais sauvages. Tous excellents nageurs qui, où et quand ça leur chantait, s’arrogeaient des droits sur l’oued dans toute sa longueur en interdisant la baignade à tout le monde
Si El Guerrab le coiffeur. Ni train ni vélo, adepte de la marche Si El Guerrab avalait huit bons kilomètres chaque jour que Dieu fait. Quatre le matin, quatre le soir. Le train-train quotidien entre sa maison et le semblant de salon où il officiait ne saurait, jamais, entrer en comparaison avec le voyage de sa vie : le pèlerinage à La Mecque.
L’odyssée commençait aussitôt le peigne, les ciseaux ou le rasoir à barbe entre les doigts. Le coiffeur n’entendait plus que le son de sa voix. L’histoire de son pèlerinage défilait, dix, quinze, vingt fois par jour sans tremblement de main ou changement d’expression sur le visage. Si El Guerrab refaisait l’unique voyage de sa vie pour ses clients, en relatait tous les détails, décrivait les petites et grandes contrées visitées, les villes et village, les ports et terres désertiques. À peu près rien d’autre ne se discutait dans son salon. Les mots collaient alors au rythme de la marche mythique et les mains du coiffeur travaillaient au ralenti.
Jadis, l’oued regorgeait de poissons, mais Ahmed était le seul et unique pêcheur à en retirer les plus belles pièces. Très peu friands de poissons, sinon jamais oserait-il dire, le cordonnier, l’épicier et le coiffeur occupent son esprit aujourd’hui, et Ahmed en ignore la raison.
Assis sur un promontoire à contempler le souvenir d’aux vives, il se creuse la cervelle. L’explication : elle lui vient brusquement à l’esprit, portée par les plus belles crues de son enfance, il y a en elle comme un relent de l’oued qui rugit maintenant, gros comme une mer sous la tempête, charriant des tonnes de terre fraîche et des végétaux déracinés.
Si El Guerrab le coiffeur. La pêche tient beaucoup de la marche de Si El Guerrab qui ignorait la précipitation, les grandes enjambées et l’impatience. Les clients revenaient chez lui, aucun ne cherchait à le fuir à cause de ses rabâchages qui ne sont que des récits d’émerveillement en définitive. La lenteur de ses gestes rassurait, épousait le rythme de ses pas et forçait l’attention. La pêche possède les qualités de la marche propre à Si El Guerrab le coiffeur. Que dire de plus ? Ahmed le pêcheur se promet de ne pas égarer l’idée tant que les traces du lit de l’oued à sec resteraient visibles. Tant que le béton ne serait pas coulé dessus.
Merrah l’épicier. Ahmed le pêcheur lui connaissait cinq robustes garçons, dont l’un, encore enfant, venait souvent jeter sa ligne tout près de la sienne, curieux et attiré par ses grosses prises, les barbeaux et anguilles qu’on regardait avec envie. Devenus de grands gaillards, très souvent les cinq garçons délimitaient tout l’oued leur territoire et interdisaient la baignade à quiconque. Non sans accompagner l’interdiction d’une défense absolue de pêcher aux nombreux amateurs, à l’exception d’Ahmed le pêcheur dont ils appréciaient les poissons grillés sur le brasero. Il comprend à présent qu’il vidait l’oued de ses baigneurs par souci de lui assurer des parties de pêche paisibles et, suprême faveur, il leur arrivait d’ensemencer ses lieux de prédilection en morceaux de pain émiettés avec l’espoir de les rendre davantage encore poissonneux.
Ouamer le cordonnier. Ahmed le pêcheur notait davantage la présence de son deux-roues usagé, adossé au mur de l’échoppe, que celle de son propriétaire à l’intérieur, cordonnier revêche et constamment à court de temps. Ce vélo, ou un autre, se volatilisa et assouvit toute une journée la passion d’un enfant de dix ans aveugle. L’enfant contracta la variole quelques mois auparavant, mal soigné ou pas du tout il perdit la vue à jamais. Seulement, il ne put se résoudre à mettre fin à ses randonnées à bicyclette. Il essuyait les refus en silence, mais savait saisir toutes les occasions pour emprunter une bicyclette et s’en griser à pédaler par voies et par chemins, accompagné d’un gamin qui lui donnait une main.
Âme magnanime, Ahmed le pêcheur l’initia par degrés à une passion de rechange et réussit à l’y maintenir avec succès sur la durée. Pendant des mois, la pêche exerça sur l’enfant aveugle une ensorcelante attraction. Si bien que le duo de pêcheurs donna lieu à quelques supputations dont l’une, et non des moindres, prêtait à l’adulte une action intéressée. Ahmed le pêcheur apprendrait de l’enfant beaucoup plus qu’il ne lui dispensait un apprentissage. Non-voyant, l’enfant, cela va de soi, se passait de bouchon, il reposait par conséquent entièrement sur la sensibilité de ses mains, le toucher qui pallie le reste des sens, sert de guide et boussole dans le noir. De cette époque, courrait la légende halieutique, date l’abandon irrémédiable du flotteur dans l’art d’Ahmed le pêcheur.
Une odeur de barbeau
C’est en fin d’après-midi que le commun de mortels prenait la pleine mesure de l’art et de la science d’Ahmed le pêcheur. Les clients fidèles réapparaissaient les uns après les autres, ils estimaient le poids des barbeaux, humaient à pleins poumons leur bouquet suave et aromatique, demandaient le prix de chaque pièce finalement.
Pêcheur inégalable, avec de surcroît un incomparable art de griller les poissons, Ahmed ne prenait jamais à l’oued plus de quatre ou cinq barbeaux par jour. La règle qu’il s’imposait demeurait un mystère, de même que sa capacité unique à ferrer les plus gros barbeaux. Ces derniers l’attendaient autant que les clients, racontait-on.
Nombreux étaient ceux à vouloir l’égaler. Jusqu’aux genoux dans l’eau, ils le regardaient faire, les yeux rivés sur son bouchon. Ils jetaient leurs lignes tout à côté de la sienne. Ahmed le pêcheur restait indifférent à leur présence. Il lui arrivait quelques fois de changer d’endroit, ses admirateurs et jaloux ne pouvaient dire si leur présence l’importunait ou si le barbeau tardait à mordre à son hameçon. D’un endroit l’autre, la différence manquait rarement d’apparaître au grand jour. Alors qu’ils sortaient de la menuaille de l’eau, lui, au bout de son fil s’accrochaient les plus belles pièces à barbillons.
Son temps de pêche était compté. De même ses prises qui passaient frétillantes du couffin au feu de charbon, au grand plaisir de clients fidèles qui s’impatientaient.
Au commencement, Ahmed le pêcheur proposait ses barbeaux grillés, assaisonnés aux fines herbes, sur une table ambulante. Plus tard, lorsque l’indépendance parut inéluctable, il acquit une sorte de cabane grill-room qui ne pouvait contenir plus de six personnes, contraintes de faire bonne chère coude contre coude.
L’offre, en toute circonstance limitée, n’évolua guère plus avant qu’après l’indépendance.
Changer de lieu de travail ne prit que le temps de traverser une rue. La petite table au plateau étroit, sur laquelle il grillait les barbeaux en premier, et merguez et brochettes accessoirement, déménagea d’un trottoir l’autre où se trouvait le grill-room de fortune.
Enfant, je remarquais la présence à longueur d’après-midi et de soirée d’un petit verre à café sur la table. Ahmed le pêcheur lui réserva sa place d’un côté comme de l’autre de la rue. Son contenu m’intriguait, il arrivait à certains de ses clients de le siffler d’un trait, sans que le maître des lieux ne s’en offusquât. Le contenu de la tasse à café ne se sirotait pas comme une boisson chaude, observaient les enfants de mon âge. Pour tenter de comprendre il fallait se courber, jeter un coup d’œil sous la petite table et découvrir un cageot soigneusement recouvert d’une étoffe. La curiosité s’arrêtait au seuil du domaine privé, nous n’étions plus à l’oued où quiconque se permettait de jeter sa ligne tout près de la ligne d’un chevalier de la gaule sans pareil.
Techniques de pêche
Avril s’approchait de mai. De retour au prix de quatre longues années d’absence vécue dans la hantise d’une mort violente, Amokrane Lebsir ouvrit la porte de l’appartement qu’il avait quitté chassé par d’impitoyables événements. Il se dirigea droit vers son modeste bureau, comme s’il se fût agi d’une priorité absolue. Il pénétra dans une pièce obscure, plongée dans la chaleur suffocante d’un printemps passé sans transition à l’été caniculaire.
Contraint et forcé à la fuite, il emporta peu de souvenirs du, à présent, pitoyable bureau dans la précipitation du départ. Il fit de la lumière, jeta un premier coup d’œil circulaire, puis un deuxième, un troisième, et s’étonna de ne pouvoir se dire que rien n’avait changé. Il ne pouvait en être autrement, néanmoins. Personne ne mit les pieds dans l’appartement protégé par deux portes, dont une blindée à trois serrures, indévissables avec leurs renforts de paumelles.
Amokrane Lebsir se remémora ses fréquentes inspections de la poussière, qui avait maintenant uniformisé d’un jaune sale murs, rayons et livres dessus, anciens et relativement récents. Devant les rangements littérature, il commença à lire les titres. Il se rappela la quasi-majorité, un petit nombre résista à la mémoire.
Un titre attira son attention : « LesTechniquesdepêcheutiliséesenAlgérie ». Pourquoi pareil livre au milieu de tous ces romans ? Comment se fait-il qu’il ait pris place parmi toutes ces œuvres littéraires ? Il feuilleta ses premières pages, il s’agissait sans équivoque possible d’un ouvrage de vulgarisation de tous les engins de pêche connus en Algérie. Son propos n’entrait en aucune manière dans la catégorie littérature.
Le livre avait sa place entre « TroutfishinginAmerica » et « Revengeofthelawn » de Richard Brautigan. Contre « TroutfishinginAmerica » se trouvait un roman d’Ismaël Kadaré. Sans doute, était-ce là l’origine de la confusion, car l’auteur de « Les TechniquesdepêcheutiliséesenAlgérie » avait pour nom Ghachem Kadari. Mais, à elle seule, la confusion des noms pouvait-elle expliquer la confusion des genres ?
L’auteur de « LesTechniquesdepêcheutiliséeenAlgérie », Ghachem Kadari, aurait-il pu un jour face aux caméras de télévision, à l’instar de l’écrivain Ismaël Kadaré, proférer ces mots : « L’écrivain ne peut être Président. », (Pourquoi ?), « C’est un dictateur ! »
Amokrane Lebsir chercha encore du côté de « TroutfishinginAmerica », en quatrième de couverture il était clairement signalé que le livre ne vous aidera pas à capturer plus de truites, mais il a certainement à voir avec la pêche de la truite. Encore une autre prose inclassable !
Il lui était toujours des plus facile et tentant d’encager, par passion des livres, son esprit dans le bureau exigu. Et de l’y maintenir sans peine des heures d’affilée. Où l’avait-il à la veille de son départ forcé pour avoir commis pareille aberration ? La période où le droit à la vie était à son plus bas degré remonta à un passé récent. C’était aussi la période de grande cherté des livres, leurs prix atteignaient des sommets inimaginables. Paradoxalement, la littérature, si dépréciée auparavant, devint hors de prix. Amokrane Lebsir achetait donc tout ce qui, abordable, lui tombait sous la main.
Les livres spécialisés constituèrent le gros de ses achats en ces temps féroces. Il les achetait, d’abord, par fidélité au principe de dépenser en toutes circonstances pour la lecture, ensuite, principale raison, pour meubler les espaces vides des rayons : il avait, en effet, abdiqué tout plaisir et volonté de lire. Nul récit ne pouvait dissiper l’angoisse de la mort qui planait en tout temps.
Il se cloîtrait dans l’appartement et rêvait, quand cela devenait possible, de se mettre en route vers le plan d’eau du barrage où, adolescent, il pêchait à longueur de journée, plongé dans de profondes contemplations.
Un coq et des langues étrangères
À Bou Haroun, vit un coq auquel la vue d’une sardine grillée fait pousser des dents.
D’où son extrême aversion des chats concurrents. Il les pourchasse sans relâche, impitoyablement. Par bonheur, la maison à deux étages, avec cave et grenier, est une construction nouvelle. De ce fait, la présence des chats, leur éventuelle assistance dans la lutte contre les souris, n’a pas encore été sollicitée.
Lorsque le propriétaire des lieux, pêcheur de son état, rentre sans les sardines, le coq n’a que mépris pour les rougets, les daurades et autres chiens de mer. Si les sardines continuent de briller par leur absence dans les prises quotidiennes, le volatile s’en prend aux espadrilles et chaussures noires, qu’il confond probablement avec les chats de la même couleur, porteurs de funestes auspices depuis la nuit des temps.
Le coq de Bou Haroun n’est pas à une singularité près. Monogame avérée, Il ne fréquente aucune basse-cour et chérit une poule, une seule, voisine à deux rues de là, native de la région de Chlef, nom que portait par ailleurs un oued autrefois fleuve long de 800 kilomètres, riche en barbeaux et anguilles, en faveur duquel toute opération d’empoissonnement friserait le non-sens absolu : son lit consumé demeure à ciel ouvert une année à la suite de l’autre.
Tout Bouharouni qui tracerait le portrait du coq n’omettrait pas de signaler un dernier détail : il fait un excellent chien de garde. Le coq de Bou Haroun déteste les visiteurs et les étrangers qui osent s’approcher de la maison. Il les poursuit à coups de bec, fait un boucan du diable sautant haut, les ailes déployées, lance des cocoricos stridents. Tout Bouharouni vous dirait que seuls les aboiements lui font défaut.
Dans la cuisine de la voisine
La recette promet du changement, l’oubli pour une fois des plats à sauce épaisse qui défilent, lourds et indigestes, le soir en particulier.
Sans un autre regard pour le journal où elle vient de dénicher « Tourte aux œufs et aux légumes », Asma Sahli entreprend de rassembler les ingrédients, trois heures avant le dîner, compte tenu des vingt minutes de préparation et des deux heures de cuisson. Ce faisant, elle se rappelle qu’elle manque d’œufs.
Locataire au rez-de-chaussée, il lui faut cinq minutes pour se ravitailler chez l’épicier à vingt minutes de notre immeuble, sur le côté opposé de la rue.
De retour chez elle, un oubli persiste dans sa tête. Elle rouvre le journal et se penche sur la recette, tout en déposant ses composantes sur la table : « Bœuf : 400 gr, Navet : 150 gr, carottes : 150 gr, petits pois : une boîte, pâte brisée, aubergine : un demi, oignons hachés : 125 gr, huile : 2 c. à soupe, bouillon de bœuf : 1 l, farine : 2 c. à soupe, bouquet garni (persil, thym, laurier) : 1, ail haché : 1 c. à café, beurre : 50 gr, sel, poivre. » Elle ne retrouve pas les œufs.
Étrange recette aux œufs sans leur mention dans les ingrédients. Asma Sahli se gratte la tête et sourit.
Les œufs sont de trop, vu que la recette dit « Tourte au bœuf et aux légumes ». C’est bien moi, se dit Asma Sahli. Depuis précisément le milieu des années quatre-vingt-dix, elle collectionne les titres d’articles de journaux mal lus dans sa tête. Mais, c’est bien la toute première fois que cela arrive avec les recettes de cuisine, qui auparavant la détendaient en maintes occasions stressantes. Elle peut s’expliquer d’avoir pris « œufs » pour « bœuf », mais que dire des autres titres ?
Tous ceux – articles soigneusement conservés dans un tiroir –, altérés par la conscience continuelle d’un agonisme social toxique. Si prendre des œufs pour du bœuf prêtait à rire, les autres erreurs de lecture maladives entrent dans le droit fil du contexte de la cruelle guerrecontrelescivils. Une paire, en particulier, a rarement déserté la mémoire d’Asma Sahli : « Abattoir fermé faute d’hyènes » (Une nouvelle mesure d’hygiène réparait l’injustice faite à l’hyène qui devenait sans préavis comestible) et « Explosion d’une fleur » (en des temps incléments, l’éclosion d’une fleur faisait l’effet d’une bombe). Soudaine réminiscence : Elle se souvient de ce mot autre que l’original dans le titre en gras, « Une guerre se meurt » (alors qu’il s’agissait d’une gare). Et encore : « Alger compte quatorze circoncisions » (les limites territoriales de circonscriptions réduites à des prépuces sanguinolents).
Le sismographe écrit
Trois jours après le tremblement de terre, Mohsen Mohgen se risque à constater de visu les dégâts. Dans le salon, les éclats de la vaisselle tapissent le sol. Dans la pièce qui lui sert de bibliothèque, les rayons s’affaissent en diagonale, des livres affichent leurs titres renversés. Mohsen Mohgen laisse tout en l’état.
Sa femme le rejoint. L’air contrarié, elle balaie du regard la pièce sens dessus dessous, dont son mari, pas peu territorial, interdisait l’entrée à tout le monde. Elle le fixe et ne peut retenir les mots :
– Tu es responsable de ce que tu écris !
Les enfants accourent, s’émerveillent du désordre et lui lancent ce qu’ils ont toujours réclamé :
– Tu vas jeter tout ça dehors, papa ?
– Ça nous fera une autre chambre !
– Oui, oui, oui ! Papa ! nous en avons bien besoin !
Lesismographeécrit :
Sitôt le jour levé, l’épicier que l’on continue d’appeler « le nouveau », malgré près de trois années parmi nous, commence à vider sa boutique de produits alimentaires essentiels et de bouteilles d’eau minérale. Jeune homme violent s’il est provoqué, il fait preuve aujourd’hui d’un sang froid exemplaire et d’un altruisme dont on connaît peu d’exemples dans le voisinage. Les sinistrés qui sortent du sommeil agité d’une nuit à la belle étoile, se demandent si les phénomènes sismiques ininterrompus ne leur jouent pas des tours.
Le nouvel épicier entasse, empile les vivres dans sa camionnette, épaulé dans son acte de générosité indécelable auparavant, vision rare et singulière, par le plus notoire des cambrioleurs. Celui-ci, quoique de nature pacifiste, est un as du vol à l’escalade et du « déménagement net et propre des appartements ». Ses victimes habitent les plus bas comme les plus hauts étages.
Le tandem entre et ressort dans le silence du matin. La camionnette, pleine comme un œuf, démarre en trombe en direction des zones ravagées par les secousses telluriques.
Lesismographeécrit:
Alors que la réplique s’éternisait et le sol tanguait sous ses pieds au deuxième étage, Amokrane Lebsir se surprit à paraphraser Hanif Kureishi : « Chaque jour est un séisme. »
Lesismographeécrit :
Dès les premières heures du terrible tremblement de terre, 5 et plus, 6 ou 7 et plus sur l’échelle ouverte de Richter selon différents Centres d’enregistrements, un sinistre plus fort que le séisme ressurgit et lui dispute la place dans les médias, le terrorisme en l’occurrence.
Lesismographeécrit :
Les séismes ne sont nullement une mécanique horlogère. Avec leurs répliques interminables, ils imposent un rythme tellurique quasi pareil au régime carcéral, assorti de liberté provisoire.
Par crainte d’une trop forte réplique qui les surprendrait dans le sommeil, les familles veillent à la belle étoile. Elles attendent la bonne réplique qui leur annoncera le retour dans les appartements, la fin d’une autre nuit cauchemardesque.
Cela compris, la bonne réplique, la plus tellurique possible, celle qui renvoie aux appartements, a en commun avec les répliques plus ou moins faibles de n’avoir pas d’heure fixe. Elle peut survenir à tout moment de l’aube, de la journée, de la soirée ou de la nuit.
L’attente est très souvent longue. Les répliques n’ont de place que dans le hasard. Par nouvelle tradition, les familles veillent tard, très tard la nuit, à l’écoute des convulsions de la terre.
Lesismographeécrit :
Les répliques mettent les nerfs à bout. Dans toute la zone sismique touchée, soit le littoral Est d’Alger, elles ne peuvent se distinguer en répliques des villes et répliques des champs. Nul n’est à l’abri, tous sont logés à la même enseigne, pour la bonne raison que l’épicentre se trouve en mer. Les premières répliques frôlent la magnitude de l’onde de choc initiale, la plus dévastatrice. Ne sont-elles pas d’autres nouveaux séismes ? Ne peuvent-elles pas venir « en une fois » et épargner ainsi aux familles ces nuits blanches sous les étoiles ?
Lesismographeécrit :
Les rencontres télévisées du sport roi attirent et repoussent depuis le 21 mai. Elles repoussent beaucoup plus en réalité, les inconditionnels du football gardent en mémoire que la terre a commencé à les secouer à l’instant précis où deux équipes, ténors de la balle ronde européenne, faisaient leur entrée dans le stade. L’écran a soudainement viré au gris bleuté, suivi de la terrifiante instabilité du sol.
Lesismographeécrit :
Une femme accouchait chez elle lorsque son immeuble s’effondra. Elle rendit l’âme sous les plafonds et les murs. Le bébé est tiré sain et sauf des décombres, le cordon ombilical coupé.
Lesismographeécrit :
Le séisme a forcé bon nombre de portes d’armoires, de placards et de bibliothèques, et a expulsé à l’extérieur un nombre tout aussi important d’objets tombés dans l’oubli. Maha Bessaï du quatrième, frappé de stupeur, jette la vue sur la corde de remorque verte, éjectée d’un placard. Elle s’était déroulée de plusieurs mètres sur le sol et semblait lui dire de ne pas la négliger, elle pourrait encore servir.
Maha Bessaï l’avait achetée au pic de la violence, il pensait ainsi contourner les gratuites atteintes à la vie de la décennie quatre-vingt-dix en la fixant solidement à la poignée de la fenêtre. Il pourrait alors, de cette manière descendre à la force des bras les quatre étages afin d’échapper aux éventuels visiteurs assassins.
Le tremblement de terre n’est pas moins assassin et tue des foules d’innocents, près de 3 000 victimes ont déjà été dénombrées. Les escaliers sont à éviter, se dit Maha Bessaï, il enroule d’une main ferme la corde autour de la poignée d’une fenêtre, de crainte d’une secousse par trop forte
Lesismographeécrit :
Le dernier mercredi de mai est l’anniversaire du petit Nissou. Il trotte aux côtés de son père et n’ose lui demander s’il peut inviter ses amis. La question reste collée à ses lèvres. Au bout d’une longue hésitation, il trouve le courage de dire : « Cela fait une semaine, c’est l’anniversaire du tremblement de terre aujourd’hui. Pourquoi la terre tremble chez nous ? »
Le sismographe enregistre
– Tu conçois ça, toi ? ma femme, que la plus innocente des répliques fait dévaler les escaliers, hier elle a fait l’inverse !
– Comment ça ?
– Quand la terre a commencé à bouger, je dirai bien un 4,2 ou 4,7, vers minuit, elle faisait la causette avec des voisines au bas de l’immeuble. Alors que la terre tremble, elle les quitte et remonte au quatrième, comme une reine !
Lesismographeenregistre :
– Ils ont vu une baleine calcinée à Dellys.
– Un requin calciné !
– Un météorite
– Ali, de cet immeuble là-bas, a juré avoir vu une baleine au large de Zemmouri.
Le sismographe enregistre :
– Ah ! voilà le troisième survivant qui s’emmène ! Alors, tu l’as acheté ton PC ? La plupart sont tombés avec les télés, les meubles et vaisselles.
– Pas le mien, pas le mien ! il est sur des roulettes !
– Ah ! Ah ! c’est malin ! Ça me rappelle cet ami d’enfance qui se saoulait avec nous dans un champ, la nuit. Il avait enlevé ses chaussures et n’arrivait pas à les retrouver dans le noir. Soudain, il se mit à hurler, « Rendez-moi mes roulettes ! Rendez-les moi ! ».
– Un ami à moi, lui, une fois ivre, étalait sa natte de prière et te tombait soixante sourates. Un phénomène !
– Dans mon lycée, un autre phénomène attendait l’heure de la prière le soir, dans la lingerie – nous étions internes – pour foutre des olives aux élèves en prière, il attendait le moment où ils avaient les fesses en l’air.
– Des phénomènes !
– Pendant les compositions, ce même élève prenait place à côté des meilleurs dans chaque matière et copiait le maximum. Il a pu arriver jusqu’en seconde sans le moindre effort. Il s’est retrouvé, dans les années soixante-dix, en Tchécoslovaquie avec une bourse et a épousé une Tchèque.
Nous, nous avons cru au socialisme, la gauche, Nous avons tout perdu.
– Nous avons fait des études et nous cherchons du travail à gauche.
– Il a épousé une belle Tchèque et il vit toujours en Tchéquie. Il a tout gagné.
– Nous avons tout perdu.
Le sismographe enregistre :
– Le tremblement de terre est arrivé jusqu’en Espagne.
– Incroyable ! c’est un tremblement du ciel !
– Les côtes espagnoles ont subi un déferlement de vagues sismiques, les embarcations ont coulé par dizaines.
– Nous n’en sommes pas coupables, ni d’ailleurs de l’existence de leurs TOROristes !
Un baiser voilé
La légendaire bonne fortune à capturer barbeaux et anguilles, les plus beaux spécimens de surcroît, Ahmed le pêcheur la devait à sa taille selon les uns, à sa canne aux dires d’autres. Parmi ces derniers, nombreux furent ceux qui cherchaient à acquérir, à tout prix, sa ligne qu’on disait orfévrée dans d’impondérables métal et roseau d’une lointaine contrée.
Les hautes statures, les perches malchanceuses dont les hameçons attiraient singulièrement les tortues, raillaient sa taille. Solide et court sur ses jambes, Ahmed le pêcheur pratiquait le wading à volonté, il se glissait dans les courants rapides et les ondes tranquilles comme le sable dans l’eau, se figeait, monument de l’immobilité halieutique.
Une catégorie de gens, inoffensive, n’avait d’autre prétexte à leur présence dans ses parages que le spectacle premier des produits de l’oued dont ils allaient se délecter, le jour même, dans son modeste grill-room.
Il ne se sépara jamais de sa ligne, Ahmed le pêcheur, un magicien peut-il léguer sa baguette ? Il ignorait superbement les pêcheurs qui lui collaient aux semelles, comme les enfants suivaient le joueur de flûte dans la rivière.
Une fois, la nuit tombée le surprend dans l’eau, la ligne à la main. Il avait oublié ses clients friands de barbeaux grillés et demeurait dans l’eau, l’esprit paradoxalement en rupture totale avec la pêche. Il y avait si longtemps qu’il n’était revenu à l’endroit lui rappelant ses tendres années. Les souvenirs couraient dans sa tête à la vitesse du courant qui caressait ses jambes.
Tout à de douces pensées, Ahmed ne vit pas un autre pêcheur, sur le chemin du retour, qui s’approchait. L’homme se trouvait auparavant à un jet de pierre et s’était attardé, du reste, par
curiosité, dans l’espoir caressé d’éventer le secret d’Ahmed le pêcheur, de ses prises exceptionnelles alors que dans la nuit, l’espoir même s’effaçait
Soucieux de ne pas passer à côté d’une découverte, l’homme, une vieille connaissance sans prise sur le poisson, prit du temps avant de prononcer les premiers mots.
– La pêche est de tout repos pour certains. On vous voit rarement de ce côté-ci de l’oued.
Ahmed, un brin ironique :
– Pour tout le monde, la pêche consiste simplement à rendre les poissons visibles. Cet endroit n’est pas poissonneux…
– Vous savez, on ne vous aime pas trop par ici, je veux dire vous voir pêcher par ici.
– Je le regrette.
– Il se fait tard, mais je suis resté pour vérifier quelque chose.
– Dans l’obscurité ?
– Il semble qu’il y a de la magie dans votre ligne. Les gens disent qu’elle émet à son bout, mais très rarement, une lumière du plus bel effet… qui n’est pas sans effet sur les poissons.
– Balivernes !
Ahmed le pêcheur se retira dans ses souvenirs et songea au premier baiser échangé à l’endroit même où il se trouvait. De crainte d’être vue, la fille avait tenu à être embrassée par un mètre de fond. Après les profondeurs de l’oued, ils continuèrent les baisers dans les airs : ils se rencontraient entre les branches d’un arbre massif, un vénérable mûrier qui les élevait du sol et abritait leurs rendez-vous, non loin de la berge.
La pêche et la pitié
Il avait connu son père, homme des plus honnêtes et affables, peintre de profession en charge d’une famille fort nombreuse, filles et garçons auxquels son gagne-pain rapportait le minimum vital, rien de plus. Le père décéda des suites d’une maladie qui encombra ses poumons de chaux et de relents de peinture cellulosique. Le garçon, promu chef de famille dès sa première jeunesse, quitta le lycée et se mit en quête d’un travail.
La vie ne lui ayant pas encore mis d’outil dans sa main inexperte, le garçon fit toutes sortes de menus travaux pour les voisins et quelques âmes charitables au fait des nombreuses bouches à nourrir. Ahmed le pêcheur lui offrit du travail. Il lui proposa de l’accompagner sur les berges de l’oued, de le regarder faire, ensuite de s’armer d’une gaule et de vivre des produits de la pêche, au besoin vendre aussi barbeaux et anguilles au marché. L’orphelin repoussa l’idée.
Ahmed le pêcheur revenait en maintes occasions à la charge, et à tous les pas lui remettait les prises du jour : deux, trois énormes barbeaux qui laissaient le garçon admiratif. Mais, il s’entêtait à devoir son existence et celle des nombreux siens à tout, sauf à la pêche.
Le garçon quitta alors sa famille et commença à parcourir le pays. Il se lança dans la conquête des grandes villes, avec en poches quelques économies. Ses tentatives de trouver du
travail n’aboutirent pas, il échoua de même dans les petites villes, villages et hameaux du pays. Au bout de cinq mois d’infructueuses recherches, amaigri et désargenté, il partit à l’assaut des routes.
À la limite du vagabondage, il se présenta un jour aux services de police pour s’accuser spontanément d’avoir mortellement blessé un homme. Les faits se seraient produits deux semaines avant son entrée dans le commissariat, lorsqu’un inconnu, avec toutes les apparences d’un mendiant, l’aurait sauvagement agressé sur la route. En se défendant, il s’empara d’une grosse et asséna plusieurs coups sur la tête de l’inconnu à terre. Les services de police menèrent une enquête et ne découvrirent nulle trace de meurtre ou de cadavre. Le garçon avoua finalement : il avait inventé toute l’histoire pour se mettre à l’abri du froid et de la faim.
Lorsqu’elle arriva aux oreilles d’Ahmed le pêcheur, l’histoire le remua jusqu’au tréfonds.
Le garçon reprit les menus travaux chez les voisins et amis des voisins. Ahmed s’empressa de remettre sa proposition sur le tapis, cette fois avec un argument irrésistible. Les pêcheurs à la ligne ne paient pas d’impôts.
La réponse du jeune chômeur, sans détour, le laissa sans voix.
– Les peintres et les maçons, les pêcheurs et les vendeurs de sardines exercent des métiers maudits. Quitte à crever de faim, je ne me ferais jamais pêcheur !
Scène de pêche en Algérie
Le réchauffement climatique lui apparut concentré sur un point unique de la terre, le lieu de destination que choisit notre voisin du troisième pour ses vacances à la campagne. Il partit en voyage tenir parole et emmener son fils taquiner le barbeau et l’anguille : la toute première fois. Il l’avisa qu’ils n’avaient nul besoin d’emporter des appâts et lui conseilla même de prendre un livre plutôt, sans oublier sa casquette rouge.
Au lieu de vers de terre, ils amorceraient les hameçons avec des sauterelles pèlerines. Au lendemain de leur descente sur le coin, en tandem avec les milliers de millions de criquets pèlerins, il en resterait fatalement quelques centaines d’individus, le tube digestif sans doute trop lourd pour pouvoir s’élever dans les airs.
L’enfant comprit qu’il n’avait aucune chance de trouver des vers de terre dans les champs privés de pluie des années à la file.
L’oued serpentait en filet mince, s’étirait le long d’une berge en surplomb afin de se dérober aux regards, d’échapper aux assoiffés hommes et bêtes, aux irrigateurs clandestins et baigneurs pollueurs. Le père et le fils marchaient au bord de l’eau, remontaient le lit de l’oued plus qu’aux trois quarts tari. Ils marchaient tantôt sur un cailloutis uni, ciselé et bleuâtre, tantôt sur du sable poudreux. À leur droite, le cours grossissait timidement. Ils arrivèrent à leur destination, une sorte de barrage d’à peine deux mètres de hauteur, d’où chutait une pluie limpide, chantante comme une source poétique. Une traînée crayeuse festonnait le pourtour de la retenue d’eau qui se désertifiait.
À l’angle du muret et de l’eau, le père déposa les attirails sur un banc de sable, endroit familier de son enfance. Il entreprit de garnir les hameçons sous le regard plus qu’attentif du fils, qui ne cessait de lui poser des questions sur son passe-temps d’autrefois.
Les yeux brillants d’excitation, le garçon découvrit bientôt que le barbeau est un poisson à bouche dure et, qu’avec cette espèce-là, on perdait rarement sa prise. Il lança sa ligne avec l’aide du père et riva aussitôt les yeux sur le bouchon.
Notre voisin Mestor Rezzaka guidait maintenant les premiers gestes de son fils dans l’art de la pêche. L’enfant apprenait avec docilité.
Vingt minutes ou plus s’écoulèrent, le père leva sa ligne et la relança dans l’eau. Le garçon refit les mêmes gestes, prêtant l’oreille aux consignes de précaution que l’adulte murmurait.
Une demi-heure plus tard Mestor Rezzaka et son fils se retrouvèrent assis sur le sable, à quelques pas l’un de l’autre, sans quitter les bouchons des yeux. Dix autres minutes d’attente, de silence et d’immobilité, puis le garçon tira un livre de son sac à dos et l’ouvrit à une page cornée. Du coin de l’œil, le père l’observait. Il finit par délaisser les bouchons et se tourner vers son fils qui tenait la ligne d’une main, le livre de l’autre, tournant les pages avec le menton.
Il était assis sur le monticule de sable, à se dire que la pêche seule peut offrir pareil tableau. L’agitation sourd dans l’attitude figée et concentrée du garçon, le mouvement affleure en l’absence même du poisson qui mord, l’action se trouve dans les pages auxquelles il consacre toute son attention. D’où cette compatibilité vivante entre la pêche et la lecture. Un livre entre les mains d’un pêcheur peut tout aussi bien lui tenir lieu de prise, ce qui n’est guère le cas du fusil sur l’épaule du chasseur. La pêche inculque la contemplation, non la vigilance propre à la chasse, elle donne au temps une qualité bien connue des chevaliers de la gaule.
Au fil de l’attente, semblable au temps entre l’envoi d’une lettre et la réponse qui tarde à venir, le pêcheur laisse jouer son imagination.
– Alors fiston, tu ne peux lire tout le temps ?
– Non.
– Tu ne peux pêcher tout le temps non plus.
– Non.
– Alors, que te reste-t-il à faire ?
– Aucune idée, fit le garçon.
Mestor Rezzaka sortit sa ligne de l’eau. La sauterelle pèlerine s’effilochait au bout de l’hameçon. « Je vais te dire ce qui te reste à faire », la lenteur et la minutie des gestes retenaient les mots du père.
– Quoi ? dit le garçon, impatient.
– Raconter l’histoire que tu n’aimes pas raconter. Elle commence sur un pont. Un jour, un matin pour être plus précis, tu passais ce pont avec ton grand-père. Tu portais cette casquette rouge à cause du soleil qui tapait fort, un peu moins fort qu’aujourd’hui tout de même. Vous étiez sortis pour quelques petits achats, et une promenade dans la foulée. Sur le chemin du retour, au beau milieu du pont, tu t’arrêtes, tout étourdi par la chaleur. Le dos contre le parapet, tu te laisses glisser lentement sur le sol.
Ton grand-père marchait à cinq mètres devant toi. Il se retourna. Tu veux savoir ce qu’il fit ?
– Oui, continue.
– Il vint vers toi. Arrivé à ta hauteur, il se saisit de ta casquette. Et la posa à tes pieds. Veux-tu savoir ce qu’il fit ensuite ?
– Je crois deviner, il s’assit dessus et l’écrasa sous son poids.
– Tu es loin du compte, fiston. Il jeta une pièce d’un dinar dans la casquette et reprit la
marche, sans se retourner. À ton grand étonnement, tu vis des passants jeter des pièces dans ta casquette. Tu restes là, incapable de bouger, les yeux ronds, allant des hommes et femmes, – même d’enfants généreux – au tas de pièces qui grossissait. Vingt bonnes minutes s’écoulèrent avant que tu ne coures rejoindre grand-père, sans rien lui dire de l’argent dans ta poche. C’est que, une grande idée a déjà germé dans ta tête. Ta longue vie d’enfant te pèse déjà…
Le soir, après mûre réflexion, tu dis à ton père : « papa, un jour je serai plus riche que toi. » Quand bien même tu savais que le train de vie de ton père, de ta famille, était aux antipodes de l’aisance et de la richesse. D’ailleurs, tu n’arrêtais pas de lui demander l’argent de poche, de lui dire de lever le nez des copies de ses élèves et de trouver un emploi plus rémunérateur.
Le jour suivant, tu joues au mendiant. Oh ! Juste une petite demi-heure, car tu craignais d’être reconnu malgré la précaution d’éviter le pont ; tu cherchais un endroit éloigné de la maison. Autre précaution : tu t’arranges pour mettre de vieux habits. À ta grande surprise, ça marche ! Et mieux que la première fois ! Les pièces s’entrechoquent dans la casquette. Le surlendemain tu te donnes une autre demi-heure, dans un endroit différent, toujours loin de chez toi.
– Tu ne t’es pas rendu compte ? dit le garçon.
– Comment l’aurais-je su ? dit Mestor Rezzaka, tu étais en vacances de printemps, et je te voyais souvent avec tes camarades de classe. Je me disais que vous passiez le temps au cybercafé ou que vous alliez au stade, au cinéma…
– Dois-je penser que j’ai continué ?
– Évidemment ! ton grand-père t’avait mis dans la tête, involontairement, un plan pour t’enrichir et pouvoir dire à ton père qu’il n’était plus indispensable dans ta vie.
Tu continues donc à travailler de la main tendue et à amasser de l’argent. Les vacances de printemps arrivées à leur fin, tu comptes et recomptes ta fortune. Un beau tas de pièces que tu as pris le soin de changer en beaux billets chez des épiciers, hors de vue de ta famille et de tes connaissances. Tu caches les billets et attends le jour de les dépenser comme bon te semble.
Tu retournes à contrecœur au collège et attends avec impatience les grandes vacances.
Tu auras tout le temps de faire fructifier ta petite affaire. Seulement voilà, une idée de ton père va contrarier tes projets.
Le livre encore entre les mains, le garçon tournait les pages d’une histoire captivante.
Est-ce trop te demander d’arrêter de tourner ces pages, fit Brahim Rezzaka, tu ne peux pas oublier ce livre ?
– Je sais pas. Quelle est cette idée ?
– Ton père s’est mis dans la tête de passer l’été du côté de tes grands-parents. Ta mère et tout le monde sont de son avis. Ils veulent fuir la ville et son été infernal. Ils rêvent d’un peu de verdure, d’arbres fruitiers, de figuiers de Barbarie qui foisonnent autour de la maison de tes grands-parents. L’idée te déplaît souverainement.
– Fais-tu semblant d’oublier que c’est moi, tout le temps, qui te demande, te supplie de nous emmener chez grand-père et grand-mère ? À cet instant, par trois fois, le bouchon du garçon s’évanouit en une fraction de seconde de la surface de l’eau. « Attention ! » s’écria à mi-voix le père. Affolé, le fils tournait sur lui-même. Ses gestes incontrôlés firent tomber et livre et ligne. Mestor Rezzeka se précipita et les repêcha.
– Fiston, dit-il, l’œil à la fois sévère et amusé, ni la pêche ni les livres ne te réussissent. Tiens, reprends tes instruments.
– Puisque tu en parles, mes grands-parents me manquent, soupira le garçon avec dépit, ne sachant plus quoi faire de ses mains et des deux objets dégoulinant.
– Non, pas cette fois-ci, tu te dis qu’il n’y aurait pas moyen de faire la manche du côté de tes grands-parents. Voyons ! C’est la campagne, le bled ? Tout le monde se connaît à des kilomètres à la ronde. Quand arrive un étranger, tu peux être sûr qu’il ne passera pas inaperçu. Un petit mendiant ! Tu imagines la réaction… Tu enrages à l’idée de ne pouvoir lancer à ton père : « papa, un jour je serai plus riche que toi ».
Le garçon déposa le livre ouvert en son milieu sur une pierre chauffée comme une braise. « Il sera sec avant que tu n’aies attrapé une sardine, fit le père. Tiens, accroche cette sauterelle à ton hameçon, dans le sens de la longueur. Et tu pourras continuer la lecture de ton livre. » Le garçon prit délicatement l’insecte aux ailes coupées.
– Et mon histoire ?
– Elle est tombée à l’eau avec le livre.
– Je ne te crois pas.
– Tu as de la suite dans les idées, fiston, tu ne te laisses pas souffler ton histoire. Tandis que tu passes les grandes vacances à la campagne, entouré de tous tes proches, un autre garçon en habits de mendiant se charge de demander la charité pour deux. Un ami de ta classe, sûr, que tu as mis dans le secret. Tu lui as indiqué les bonnes adresses où tendre la main sans risque : les heures de pointe de la mendicité, ce qu’il faut faire et ne pas faire. Bref, tu l’as transformé en authentique mendiant. Lui, par contre, va aller plus loin. Il aime l’argent plus que tout. Il va mettre la moitié de ta classe au courant. Tes camarades, du fait de leur nombre, rêvent désormais, non de petites pièces, mais de trésors !
– À l’avenir, je ne lui confierai plus rien, réagit le garçon.
– Il va les entraîner tous derrière ton slogan : « papa, un jour je serai plus riche que toi ». Tes camarades devenaient audacieux, ils s’aventuraient partout ailleurs, et dédaignaient les endroits connus de toi. Ils changeaient de ville dans leur quête de richesse. Chacun de son côté amassait de l’argent et ils se rencontraient pour échanger astuces et habits usés de circonstance. Et c’est à la suite d’une de ces rencontres que deux pères aperçurent leurs enfants, fagotés comme des gueux, assis à même le sol et tendant la main, à quelques mètres l’un de l’autre. Dès ce moment-ci, tu seras le grand responsable des égarements de tous ces enfants. À la rentrée, des foules de parents demandent ton expulsion du collège.
– Que va-t-il se passer ?
– Les journées calmes au bord de l’eau te reviennent et tu vas reprendre ta ligne.
– Ça ne mord pas et mon livre est tout mouillé !
– Tu dois croire de toutes tes forces que ce que tu tiens à la main n’est pas une canne à pêche, mais une baguette magique. Tu ne sens pas l’orage venir ?
L’enfant leva les yeux. Depuis longtemps il n’avait vu un ciel aussi bas et noir.
C’est le murmure d’un oued qui ruisselait à peine audible d’abord, puis bruissait, s’agitait et basculait dans l’orage torrentiel, tandis qu’un paquet d’eau se balançait dans tous les sens, que le reste du jour s’obscurcissait et devenait propice à tous les déchaînements.
Les cataractes de pluie lessivaient les champs nus en amont et firent surgir des flots qui se déversaient, couleur de terre, de toute la longueur du barrage. « Tu peux te jeter dans l’oued ! cria Mestor Rezzaka, faisant signe à son fils de se débarrasser de sa casquette, cette pluie est une bénédiction ! »
– Regarde ! dit le garçon, les pages de mon livre se détachent !
– Ne crains rien, demain tu le retrouveras tout sec.
– Tu penses revenir ? Moi, pas ! Il nous faut rentrer !
– Si tu me quittes, tu n’entendras plus jamais le reste de ton histoire. Passe-moi d’abord ton hameçon que je l’amorce !