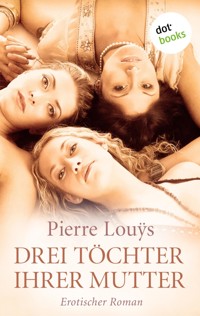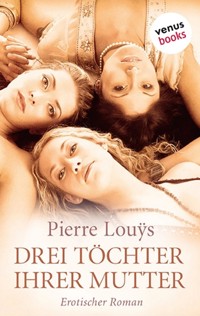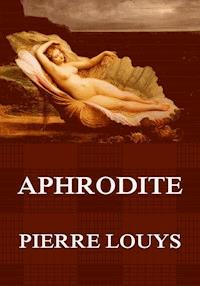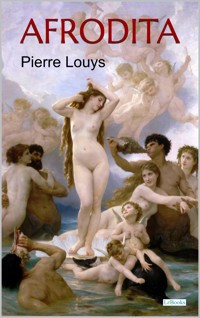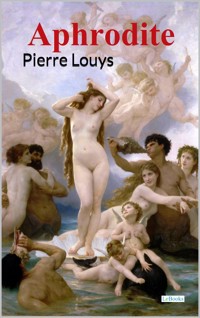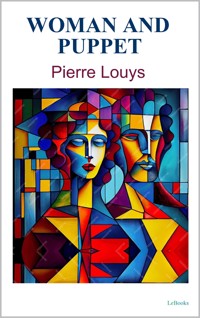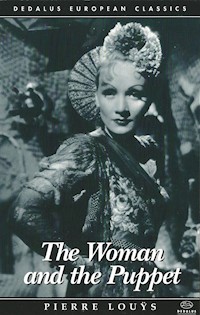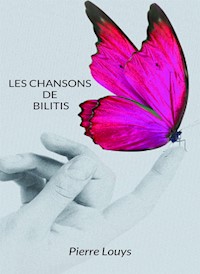Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GrandsClassiques.com
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Quand trois sœurs et leur mère érigent la perversité en principe moral, il faut s'attendre à tout...
POUR UN PUBLIC AVERTI. Trois sœurs et leur mère prostituée, avec chacune leur histoire, vice et génie acrobatique, se succèdent auprès d'un homme voisin qui, d'après l'auteur, n'est autre que lui-même ! Un roman érotique à la croisée du récit autobiographique donc, où sont décrits les rapports sexuels débridés d'une famille. Dans son récit provoquant et plutôt réaliste, Pierre Louÿs lance un torrent obscène sur l'institution familiale et les valeurs du milieu bourgeois.
Un texte érotique transgressif et publié sous le manteau, présentant une famille débauchée. Parmi les chefs-d'œuvre de Pierre Louÿs.
EXTRAIT
La jeune personne de quinze ans qui était devenue ma captive portait des cheveux très noirs noués en catogan, une chemisette agitée, une jupe de son âge, une ceinture de cuir.
Svelte et brune et frémissante comme un cabri lancé par Leconte de Lisle, elle serrait les pattes, elle baissait la tête sans baisser les yeux comme pour donner des coups de corne.
Les mots qu’elle venait de me dire et son air de volonté m’enhardissaient à la prendre. Pourtant, je ne croyais pas que les choses iraient si vite.
— Comment vous appelez-vous ? dit-elle.
— X... J’ai vingt ans. Et vous ?
— Moi, Mauricette. J’ai quatorze ans et demi. Quelle heure est-il ?
— Trois heures.
— Trois heures ? répéta-t-elle en réfléchissant...
Vous voulez coucher avec moi ?
Ahuri par cette phrase que j’étais loin d’attendre, je reculai d’un pas au lieu de répondre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pierre Louÿs (1870-1925), né à Gand et mort à Paris, est un poète et romancier français, également illustre sous les noms de plume Chrysis, Peter Lewys et Pibrac. Il fonde en 1891 la revue littéraire
La Conque, où sont publiées les œuvres d'auteurs parnassiens et symbolistes, parmi lesquels Mallarmé, Moréas, Verlaine ou encore Leconte de Lisle. Outre
Aphrodite,
La Femme et le pantin ou encore
Les Aventures du Roi Pausole, Pierre Louÿs a rédigé de nombreux romans érotiques, peu à peu révélés à titre posthume.
À PROPOS DE LA COLLECTION
Retrouvez les plus grands noms de la littérature érotique dans notre collection
Grands classiques érotiques.
Autrefois poussés à la clandestinité et relégués dans « l'Enfer des bibliothèques », les auteurs de ces œuvres incontournables du genre sont aujourd'hui reconnus mondialement.
Du Marquis de Sade à Alphonse Momas et ses multiples pseudonymes, en passant par le lyrique Alfred de Musset ou la féministe Renée Dunan, les
Grands classiques érotiques proposent un catalogue complet et varié qui contentera tant les novices que les connaisseurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AVIS À LA LECTRICE
Ce petit livre n’est pas un roman. C’est une histoire vraie jusqu’aux moindres détails. Je n’ai rien changé, ni le portrait de la mère et des trois jeunes filles, ni leurs âges, ni les circonstances.
PIERRE LOUΫS
1
— Eh bien, vous êtes vif ! dit-elle. Nous emménageons hier, maman, mes sœurs et moi. Vous me rencontrez aujourd’hui dans l’escalier. Vous m’embrassez, vous me poussez chez vous, la porte se referme… Et voilà.
— Ce n’est que le commencement, fis-je avec toupet.
— Ah ! oui ? Vous ne savez pas que nos deux appartements se touchent ? Qu’il y a même entre eux une porte condamnée ? Et que je n’ai pas besoin de lutter si vous n’êtes pas sage, monsieur. Je n’ai qu’à crier : « Au viol, maman ! Au satyre ! À l’attentat ! »
Cette menace prétendait sans doute m’intimider. Elle me rassura. Mes scrupules se turent. Mon désir délesté fit un bond dans l’air libre.
La jeune personne de quinze ans qui était devenue ma captive portait des cheveux très noirs noués en catogan, une chemisette agitée, une jupe de son âge, une ceinture de cuir.
Svelte et brune et frémissante comme un cabri lancé par Leconte de Lisle, elle serrait les pattes, elle baissait la tête sans baisser les yeux comme pour donner des coups de corne.
Les mots qu’elle venait de me dire et son air de volonté m’enhardissaient à la prendre. Pourtant, je ne croyais pas que les choses iraient si vite.
— Comment vous appelez-vous ? dit-elle.
— X… J’ai vingt ans. Et vous
— Moi, Mauricette. J’ai quatorze ans et demi. Quelle heure est-il
— Trois heures
— Trois heures ? répéta-t-elle en réfléchissant… Vous voulez coucher avec moi ?
Ahuri par cette phrase que j’étais loin d’attendre, je reculai d’un pas au lieu de répondre.
— Écoutez-moi, dit-elle, en posant le doigt sur la lèvre. Jurez de parler bas, de me laisser partir à quatre heures… Jurez surtout de… Non. J’allais dire : de faire ce qui me plaira… Mais si vous n’aimez pas ça… Enfin, jurez de ne pas faire ce qui ne me plaira pas.
— Je jure tout ce que vous voudrez.
— Alors je vous crois. Je reste.
— Oui ? c’est oui ? répétai-je.
— Oh ! mais il n’y a pas de quoi se taper le derrière par terre ! fit-elle en riant.
Provocante et gaie comme une enfant, elle toucha, elle empoigna l’étoffe de mon pantalon avec ce qu’elle y sut trouver, avant de fuir au fond de la chambre où elle retira sa robe, ses bas, ses bottines… Puis, tenant sa chemise des deux mains et faisant une petite moue :
— Je peux toute nue ? » me demanda-t-elle.
— Voulez-vous aussi que je vous le jure ?… En mon âme et conscience.
— Vous ne me le reprocherez jamais, fit-elle en imitant mon accent dramatique.
— Jamais !
— Alors… la voilà, Mauricette !
Nous tombâmes tous deux sur mon grand lit, dans les bras l’un de l’autre. Elle me heurta de sa bouche. Elle me poussait les lèvres avec force, donnait sa langue avec élan… Elle fermait presque les yeux, puis les ouvrait en sursaut… Tout en elle avait quatorze ans, le regard, le baiser, la narine… À la fin, j’entendis un cri étouffé, comme d’une petite bête impatiente. Nous bouches se quittèrent, se reprirent, se séparèrent encore…
Et, ne sachant pas très bien quelles mystérieuses vertus elle m’avait juré de ne pas lui ravir, je dis au hasard quelques balivernes pour apprendre ses secrets sans les lui demander.
— Comme c’est joli, ce que tu t’es mis sur la poitrine ! Quel nom cela prend-il chez les fleuristes ?
— Des nichons.
— Et ce petit karakul que tu as sous le ventre ? C’est la mode, maintenant, de porter des fourrures au mois de juillet ? Tu as froid là-dessous ?
— Ah ! non ! pas souvent !
— Et ça ? je ne devine pas du tout ce que ça peut être.
— Tu ne devines pas, répéta-t-elle d’un air malin. Tu vas le dire toi-même, ce que c’est.
Avec l’impudeur de la jeunesse, elle écarquilla les cuisses, les dressa des deux mains, ouvrit sa chair… Ma surprise fut d’autant plus vive que la hardiesse de la posture ne me préparait guère à une telle révélation.
— Un pucelage ! m’écriai-je.
— Et un beau !
— Il est pour moi ?
Je pensais qu’elle me dirait non. J’avouerais même que je l’espérais.
C’était un de ces pucelages impénétrables comme il m’est arrivé d’en prendre deux. Hélas ! J’ai bien souffert.
Néanmoins, je me piquai de voir Mauricette répondre à ma question en se passant un doigt sous le nez, avec une bouche moqueuse qui voulait dire « flûte » ou même pis. Et comme elle ouvrait toujours sous mes yeux ce que je ne devais pas toucher, une taquinerie me fit dire :
— Vous avez de bien mauvaises habitudes, mademoiselle, quand vous êtes toute seule.
— Oh ! à quoi vois-tu ça ? dit-elle en fermant les jambes.
Ce mot fit plus que tout le reste pour la mettre à l’aise. Puisque je l’avais deviné, rien ne servait plus de le taire : elle s’en vanta. D’un air gamin, frottant à chaque fois sa bouche sur ma bouche, elle me répéta tout bas :
— Oui. Je me branle. Je me branle. Je me branle. Je me branle. Je me branle. Je me branle. Je me branle. Je me branle.
Plus elle le disait, plus elle était gaie. Et ce premier mot lâché, tous les autres suivirent comme s’ils n’attendaient qu’un signe pour s’envoler :
— Tu vas voir comment je décharge
— Je voudrais bien le savoir, en effet.
— Donne-moi ta queue.
— Où cela ?
— Trouve.
— Qu’est-ce qui est défendu ?
— Mon pucelage et ma bouche.
Comme on ne peut aller au cœur féminin que par trois avenues… et comme j’ai une intelligence prodigieusement exercée à la divination des énigmes très difficiles… je compris.
Mais cette nouvelle surprise me coupait la parole : je ne répondis rien. Je donnai même à ce mutisme un air d’imbécillité pour laisser Mauricette expliquer elle-même son mystère. Elle soupira en souriant, me jeta un regard de détresse qui signifiait : « Dieu ! que les hommes sont bêtes ! » puis elle s’inquiéta ; et ce fut elle qui me posa des questions.
— Qu’est-ce que tu aimes faire ? Qu’est-ce que tu aimes le mieux ?
— L’amour, mademoiselle.
— Mais c’est défendu… Et qu’est-ce que tu n’aimes pas du tout, du tout ?
— Cette petite main-là, qui est pourtant jolie. Je n’en veux pour rien au monde.
— C’est pas de chance que je… fit-elle avec un trouble extrême… que je peux pas sucer… Tu aurais voulu ma bouche ?
— Tu me l’as donnée, fis-je en la reprenant.
Non, ce n’était plus la même bouche. Mauricette perdait contenance, n’osait plus parler, croyait tout perdu. II n’était que temps de ramener un sourire sur ce visage désolé. Une de mes deux mains qui la tenaient serrée contre moi se posa tout simplement sur ce qu’elle désespérait de me faire accepter et même de me faire comprendre.
La timide enfant me regarda, vit que ma physionomie n’était pas sérieuse ; et, avec une brusquerie de métamorphose qui me fit tressaillir :
— Oh ! Crapule ! s’écria-t-elle. Animal ! Brute ! Putain ! Cochon !
— Mais veux-tu te taire !
— Depuis un quart d’heure, il fait semblant de ne pas deviner et il se fiche de moi parce que je ne sais comment le dire.
Elle reprit son air de gosse en bonne humeur, et, sans élever la voix, mais nez à nez :
— Si je n’en avais pas envie, tu mériterais que je me rhabille.
— Envie de quoi ?
— Que tu m’encules ! fit-elle en riant. Je te l’ai dit. Et avec moi, tu n’as pas fini d’en entendre. Je ne sais pas tout faire, mais je sais parler.
— C’est que… je ne suis pas sûr d’avoir bien entendu.
— J’ai envie de me faire enculer et de me faire mordre ! J’aime mieux un homme méchant qu’un homme taquin.
— Chut ! chut ! mais que tu es nerveuse, Mauricette !
— Et puis, on m’appelle Ricette quand on m’encule.
— Pour ne pas dire le « Mau »… Allons ! calme-toi.
— II n’y a qu’un moyen. Vite ! Tu veux ?
Pas fâchée, peut-être même plus ardente, elle me rendit à pleine bouche le baiser que je lui donnais et, pour m’encourager sans doute, elle me dit :
— Tu bandes comme du fer, mais je ne suis pas douillette et j’ai le trou du cul solide.
— Pas de vaseline ? Tant mieux.
— Oh ! la la ! pourquoi pas une pince à gants !
Par une virevolte, elle me tourna le dos, se coucha sur le côté droit et joua au doigt mouillé avec elle-même, sans autre préambule au sacrifice de sa pudeur. Puis, d’un geste qui m’amusa, elle ferma les lèvres de son pucelage, et elle fit bien car j’aurais pu croire que j’y pénétrais malgré mes serments. Ce doigt mouillé, c’était assez pour elle, c’était peu pour moi. Je trouvai qu’en effet elle n’était « pas douillette » ainsi qu’elle venait de me le faire savoir.
Et j’allais lui demander si je ne la blessais pas quand, tournant sa bouche vers la mienne, elle me dit tout le contraire :
— Toi, tu as déjà enculé des pucelles.
— À quoi sens-tu cela ?
— Je te le dirai quand tu m’auras dit à quoi tu as vu que je me branlais.
— Petite saleté ! tu as le bouton le plus rouge et le plus gros que j’aie jamais vu sur un pucelage.
— II bande ! murmura-t-elle en faisant les yeux doux. Il n’est pas toujours si gros… N’y touche pas…Laisse-le-moi… Tu voulais savoir à quoi je sens… que tu as enculé des pucelles ?
— Non. Plus tard.
— Eh bien ! la voilà, la preuve ! tu sais qu’il ne faut rien demander à une pucelle qui se branle pendant qu’on l’encule. Elle n’est pas foutue de répondre.
Son rire s’éteignit. Ses yeux s’allongèrent. Elle serra les dents et ouvrit les lèvres.
Après un silence, elle dit :
— Mords-moi… Je veux que tu me mordes… Là, dans le cou, sous les cheveux, comme les chats font aux chattes…
Elle dit ensuite :
— Je me retiens… je me touche à peine… mais… je ne peux plus, je vais jouir… Oh ! je vais jouir, mon… comment t’appelles-tu ?… mon chéri… Va comme tu veux ! de toutes tes forces ! comme si tu baisais !… J’aime ça !… Encore !… Encore !
Le spasme la raidit, la tint frémissante… Puis la tête retomba et je serrai le petit corps tout faible contre moi.
***
Amour ? Non, petite flamme d’une heure. Mais en moi-même, je ne pus m’empêcher de dire : « Bigre ! » et je saluai son réveil avec moins d’ironie que d’admiration :
— Tu vas bien pour une pucelle !
— Hein ! fit-elle sous une œillade.
— Naïve enfant ! Sainte innocence !
— L’ as-tu senti que j’ai le trou du cul solide ?
— Du rhinocéros.
— Et nous sommes toutes comme ça dans la famille.
— Quoi ?
— Ha ! ha ! ha !…
— Qu’est-ce que tu dis ?
— Je dis : voilà comment nous donnons le derrière. Et tiens ! voilà comment nous jouissons par-devant.
Avec la vivacité de son caractère, elle déploya d’un coup ses cuisses dont les muscles saillirent… Je reconnus à peine le paysage.
— Les Jardins sous la Pluie ! m’écriai-je.
— Et avec le doigté ! répéta-t-elle en riant. Tiens, je vais te donner quelque chose. Dis d’abord : on s’aime ?… Oui… As-tu des ciseaux ?
Elle tira du couvre-pied un fil de soie qu’elle se mit sur le ventre :
— Une mèche de mon pucelage, tu la garderas ?
— Toute ma vie… Mais choisis-la bien, ta mèche. Si tu veux que cela ne se voie pas, prends la plus longue.
— Oh ! tu sais ça aussi ? fit-elle avec désappointement.Est-ce que tu en as une collection ?
Pourtant elle coupa sa mèche, ou plutôt sa boucle indomptablement arrondie. M. de La Fontaine, de l’Académie française, a écrit un poème La Chose impossible pour apprendre à la jeunesse que les poils de certaines femmes ne peuvent être défrisés. Il avait essayé, sans doute… Quels vieillards libidineux que ces académiciens !
D’un fil de soie verte, Mauricette lia les poils de sa boucle noire, puis les trancha par la base :
— Un accroche-cœur… mouillé par le foutre d’une vierge ! dit-elle.
Sur un éclat de rire elle sauta du lit, s’enferma toute seule au cabinet de toilette… mais elle en sortit aussi vite qu’elle s’y était éclipsée.
— Puis-je savoir maintenant… commençai-je.
— Pourquoi nous sommes toutes comme ça dans la famille ?
— Oui.
— Dès ma plus tendre enfance…
— Comme tu parles bien !
— J’ai été mise en pension, pendant que maman et mes sœurs gagnaient leur vie ensemble avec les messieurs, les dames, les gosses, les putains, les jeunes filles, les vieux, les singes, les nègres, les chiens, les godmichés, les aubergines…
— Et quoi encore ?
— Tout le reste. Elles font tout. Veux-tu maman ? Elle s’appelle Teresa ; elle est italienne ; elle a trente-six ans. Je te la donne. Je suis gentille. Veux-tu mes sœurs aussi ? Nous ne sommes pas jalouses. Mais garde ma boucle et tu me reviendras.
— Ricette ! Crois-tu que je pense à…
— Turlututu ! On nous prend toutes les quatre ; mais on me revient. Je sais ce que je dis quand je ne me branle plus.
Après un nouveau rire de jeunesse, elle saisit ma main, roula jusqu’à moi et reprit aussi sérieusement que possible :
— Jusqu’à treize ans je suis restée en pension avec des jeunes filles du monde. Puisque tu sais tant de choses, dis ce que c’est que les directrices et les sous-maîtresses qui ont la vocation de vivre leur putain de vie dans un bordel de pensionnaires.
— Un peu gousses ?
— Je n’osais pas le dire, fit Mauricette avec une ironie charmante. Et comme elles devaient avoir des renseignements sur ma mère, tu penses qu’avec moi elles ne se gênaient pas.
— Les infâmes créatures ! Elles ont abusé de ta candeur ? Elles t’ont fait boire de force le poison du vice ?
— De force ! Elles m’ont pervertie ! fit Mauricette qui plaisantait et prenait de l’assurance. Quatre fois elles m’ont surprise en train de branler mes petites amies…
— Ah ! tu…
— Elles se cachaient dans le jardin, dans le dortoir, dans les corridors et jusqu’à la fenêtre des cabinets pour faire les voyeuses ! Crois-tu que c’est vicieux, une sous-maîtresse !
— Elles payaient pour ça ?
— Un mauvais point. Et pourtant !… Qu’est-ce qu’on leur montrait sans le vouloir ! Des combinaisons épatantes qu’elles n’auraient jamais trouvées toutes seules !… Enfin, je suis devenue l’amie d’une grande qui m’a enseigné en dix leçons le saphisme tel qu’on le parle…
— Ça veut dire ?
— L’art de faire mimi doucement au point sensible. L’art de ne pas s’écorcher le petit bout de la langue n’importe où. C’est ce que je savais le mieux quand je suis sortie de pension ; beaucoup mieux que l’histoire sainte et la géographie. Mais, avec ma grande amie, on se retrouvait dans tous les coins ; et la cent vingt-cinquième fois, je me suis fait pincer par MllePaule.
— Laquelle t’a pervertie un quart d’heure après ?
— Oui. Dans sa chambre, sous sa jupe. Avec un pantalon fermé qui avait des boutons partout. Et un joli petit chat, la cochonne ! Les poils, le pucelage, le bouton, les lèvres, tout me plaisait. J’aimais mieux faire minette à elle qu’à mon amie. Crois-tu que c’est vicieux, une sous-maîtresse !
— Sardanapalesque. Et tu ne dis pas tout.
— Non. J’oubliais quelque chose. Elle ne savait pas même faire minette. C’est moi qui lui ai appris.
***
Ici, Mauricette fut prise d’un fou rire qui la renversa presque à bas du lit, et elle mit tant de grâce à perdre l’équilibre que j’eus hâte d’achever l’intermède. J’étais redevenu plus curieux de son présent que de son passé.
À mon tour, je quittai la chambre pour le cabinet de toilette. M’y attardai-je plus qu’il n’était prudent ? Quand je revins, Mauricette, déjà rhabillée, se chaussait.
— Tu t’en va ? fis-je avec chagrin.
— Pas tout entière. Il y a une petite mèche de moi qui reste ici. Et je ne vais pas loin : là, derrière la porte. Tu ne sais plus que tu as juré de me laisser partir à quatre heures ?
— Du matin !
— Du soir, malheureusement ! dit-elle dans mes bras.
Au lieu de fuir, elle était venue se faire embrasser, avec une confiance qui rassurait la mienne, quand elle se dégagea d’un saut. Je ne pus la retenir dans ma chambre ni la rejoindre sur le palier. Elle trouva sa porte entrouverte, s’y glissa et disparut.
2
Une demi-heure après, la mère entrait chez moi. Dès le premier regard mon roman se compliqua tout à coup. La mère était beaucoup plus belle que la fille… Je me rappelai son nom : Teresa.
À peine couverte d’un peignoir serré qui tournait sur sa taille souple, elle refusa le fauteuil que je lui offrais, vint s’asseoir au bord de mon lit et me dit à brûle-pourpoint :
— Vous avez enculé ma fille, monsieur ? »
Oh ! que ces questions-là me déplaisent et que j’ai peu de goût pour les scènes de ce genre. Je fis un geste noble et lent qui ne voulait rien dire du tout… Elle y répondit.
— Ne protestez pas. C’est elle qui vient de me le raconter. Je vous arracherais les yeux si vous l’aviez dépucelée ; mais vous ne lui avez fait que ce qui lui est permis… Pourquoi rougissez-vous ?
— Parce que vous êtes belle.
— Qu’est-ce que vous en savez ?
Moi aussi, j’allais au fait en peu de mots. Le départ prématuré de Mauricette m’avait laissé plus ardent que ne m’avait trouvé sa rencontre. D’ailleurs, avec les femmes, j’aime toujours mieux exposer ma science de la pantomime que mon aptitude à la discussion.
Teresa ne put rien me dire de ce qu’elle avait préparé. Changer le parcours d’une scène périlleuse est la seule façon de la mener à bien. J’avais tourné le volant sans ralentir. Elle en perdit le souffle une seconde, quoiqu’elle fût plus forte que moi ; mais elle serra les cuisses avec un sourire. Avant que j’eusse rien touché, elle réussit à constater de la main les motifs que j’avais de choisir l’itinéraire ; et je lus dans ses yeux que mon brusque virage ne m’avait pas culbuté sous la disqualification.
Cet échange de gestes mit entre nous beaucoup de familiarité.
— Qu’est-ce que tu veux que je te montre ? Qu’est-ce que j’ai donc entre les jambes
— Ton cœur ! répondis-je.
— Tu crois qu’il est là-dessous ?
— Oui.
— Cherche.
Elle riait tout bas. Elle savait que la recherche n’était pas facile. Ma main s’égara dans un fouillis de poils extraordinaire où je fus quelque temps à perdre mon chemin. À la naissance des cuisses, il en poussait comme sur le ventre. Je commençais à me troubler quand Teresa, trop adroite pour me démontrer que j’étais maladroit, ôta son peignoir avec sa chemise, pour me consoler ou pour me distraire, ou peut-être pour m’offrir un second prix d’encouragement.
Un admirable corps, long et plein, mat et brun, tomba dans mes bras. Deux seins mûrs, mais qui ne semblaient pas maternels et que leur poids ne faisait pas fléchir, se pressèrent sur ma poitrine. Deux cuisses brûlantes m’étreignirent et comme j’essayais de…
— Non. Pas ça. Tu me baiseras plus tard, fit-elle.
— Pourquoi ?
— Pour finir par là.
Elle se vengeait. À son tour elle prenait la direction ; et la formule de sa mainmise était assez bien trouvée pour qu’en me refusant ce que je lui demandais, elle parût me l’accorder avec un surcroît de sollicitude.
Au silence que je gardai, elle sentit que son corps était maître. D’un ton nouveau qui m’interrogeait et ne m’offrait rien du tout, elle me dit :
— Veux-tu ma bouche ou mon cul ?
— Je veux tout toi.
— Tu n’auras pas mon foutre. Je n’en ai plus une goutte dans le ventre. Elles m’ont trop goussée depuis ce matin.
— Qui ?
— Mes filles.
Elle me vit pâlir. L’image de Mauricette revint à moi toute nue avec les mots : « Je te donne maman. » Je ne savais plus très bien ce que j’éprouvais. Une heure auparavant, j’avais cru que Mauricette serait l’héroïne de mon aventure… Sa mère m’enflammait dix fois davantage. Elle le comprit mieux que moi, se coucha sur mon désir et, sûre de sa puissance, caressant des poils et du ventre ma chair éperdument raide, elle eut l’audace de me dire :
— Veux-tu encore Mauricette ? Elle a un petit béguin. Elle se branle pour toi. Tu avais envie de la retenir. Veux-tu que j’aille la chercher ? Que je t’ouvre ses fesses ?
— Non.
— Tu n’aimes pas les petites filles ? Alors, prends Charlotte, ma fille aînée. C’est la plus jolie des trois. Ses cheveux tombent jusqu’aux talons. Elle a des seins et des fesses de statue. Le plus beau con de la famille, c’est le sien ; et je mouille pour elle quand elle ôte sa chemise, moi qui ne suis pas gousse, moi qui aime la queue. Charlotte… Imagine une très belle fille brune, molle et chaude, sans pudeur et sans vice, une concubine idéale qui accepte tout, jouit n’importe comment, et qui est folle de son métier. Plus tu lui en demanderas, plus elle sera contente. La veux-tu ? Je n’ai qu’à l’appeler à travers la cloison.
C’était le diable amoureux que cette femme. Je ne sais ce que j’aurais donné pour la prendre au mot et pour lui crier : « Oui ! » en pleine figure. Comme je serrais les muscles de ma volonté, comme j’ouvrais la bouche et prenais haleine.… Teresa me dit assez vite avec l’expression d’un intérêt sincère :
— Est-ce que je te fais bander ?
Cette fois, j’entrai en fureur. Sur un « tu te fous de moi ! » suivi d’autres paroles, je la battis. Elle riait de toute sa voix sonore en luttant des bras et des jambes. Désarmée par son rire, elle se défendait à l’aveuglette. Je la couvrais de coups et d’attouchements qui ne semblaient lui faire aucun mal ; puis ce rire m’exaspéra, et, ne sachant pas où la prendre pour la battre, j’empoignai une touffe de poils, je tirai… Elle poussa un cri.
Et comme je crus l’avoir blessée, je tombai dans ses bras avec confusion. Je m’attendais à mille reproches ; mais elle ne songeait guère à me dire quoi que ce fût qui eût refroidi mon ardeur pour elle. Même en criant, elle ne cessa de rire que pour sourire et s’accuser :
— Voilà ce que c’est que d’avoir tant de poils au cul ! Quand tu coucheras avec Lili, je te défie d’en faire autant.
L’incident rompit ma violence et hâta le dénouement. Teresa n’avait pas un instant à perdre pour m’offrir son caprice en guise de pardon. Elle me l’offrit sans me consulter, avec une habileté d’organe et de posture qui tenait de la jonglerie.
Couchée avec moi sur le flanc et me prenant les hanches entre ses cuisses relevées, elle passa une main sous elle… y fit je ne sais quoi… puis me dirigea comme il lui plut.
La prestidigitation de certaines courtisanes réussit des tours incompréhensibles… Comme un jeune premier qui s’éveille dans le jardin d’une magicienne, je faillis soupirer : « Où suis-je ? » car mon enchanteresse demeurait immobile et je ne savais pas bien où j’étais entré. Je me tus pour garder un doute qui me laissait une espérance. Mais le doute s’évanouit aux premières paroles.
— Ne t’occupe pas de moi, dit-elle. Ne bouge pas. N’essaie pas de me prouver que tu sais t’y prendre. Ricette vient de me le dire ; je m’en fous pour ce soir. Quand tu m’enculeras toi-même, je déchargerai sans me toucher. En ce moment, c’est moi qui me fais enculer et tu vas voir ça ! mais je ne veux pas jouir.
— Et si j’aime mieux ta jouissance que la mienne ? Si je te la donne de force ?
— De force ? dit Teresa. Ne me touche pas ou je te vide les couilles en un tour de cul… Tiens… ! Tiens… ! Tiens !
Elle était affolante. La violence et la souplesse de sa croupe dépassaient tout ce que j’avais éprouvé dans les bras des autres femmes. Cela ne dura que l’instant de m’en faire une menace. Et elle reprit son immobilité.
Alors, malgré le trouble où elle jetait mes sens, je ne voulus pas même attendre la séparation de nos corps pour faire savoir à Teresa que je n’aimais point être bousculé.
Je lui déclarai que je la trouvais belle, extrêmement désirable, mais qu’après ma vingtième année je me croyais un homme et non un enfant ; que je n’avais nullement le vice de prendre plaisir à la tyrannie d’une femme ; et je ne sais comment je le lui dis, car mes esprits étaient fort agités. Elle aurait pu me répondre que sa menace avait suivi la mienne : elle n’en fit rien, redevint plus douce et garda pourtant un certain sourire autour de sa pensée intime.
« Sois tranquille, je ne te casserai pas la queue, dit-elle tendrement. Je te la suce, tu le sens ? Je te la suce avec le trou du cul. »
Ce qu’elle faisait, je n’aurais su le dire. Mais sa bouche, en effet, ne m’aurait pas énervé davantage. II me devenait difficile de parler.
Elle suivit sur mon visage le reflet de ma sensation et, sans avoir besoin de m’interroger pour savoir s’il en était temps, elle pressa peu à peu l’allure de ses reins jusqu’à l’adagietto, me sembla-t-il. Je crois que je murmurai : « Plus vite ! » et qu’elle n’y consentit pas. Je n’ai qu’un vague souvenir de ces dernières secondes. Le spasme qu’elle obtint de ma chair fut une sorte de convulsion dont je n’eus pas conscience et que je ne saurais décrire.
***
Aussi ma première question fut-elle, après deux minutes de silence :
— Qu’est-ce que tu m’as fait
— Un joli petit travail avec mon trou du cul, fit-elle en riant. Tu as déjà enculé des femmes…
— Oui. Il y a une heure. Une toute jeune fille qui ne s’y prend pas mal, pourtant.
— Pas mal du tout. Elle a du muscle, hein ? Et elle galope
— Mais toi…
— Mais moi je suis la première qui t’ait sucé la queue par là. Tu veux savoir comment je fais ? Je te dirai ça demain.Laisse-moi me lever. Tu veux savoir aussi pourquoi ? pour accoucher de l’enfant que tu viens de me faire : la petite sœur de mes trois filles.
… Quand elle m’apparut à nouveau, toujours nue et corrigeant des deux mains sa coiffure derrière la nuque, ma jeunesse méconnut que, par ce geste relevé, Teresa voulait moins rentrer ses petits cheveux que tendre ses deux seins dont elle était fière.
Je n’ai jamais été de ces adolescents qui dépérissent pour les maturités : mais une pécheresse de trente-six ans, quand elle est belle de la tête aux pieds, c’est un « morceau », disent les sculpteurs ; c’est une « femme », disent les amants.
Et qu’est-ce que n’était pas cette femme ? Mettez la question au concours : elle départagera curieusement les hommes.
Teresa nue ressemblait à un mezzo d’opéra. Vous alliez dire : à une fille de bordel ? Pas du tout. Vous murmurez : c’est la même chose ? Non. C’est le jour et la nuit. Si vous ne connaissez les actrices que par les conversations de fumoir, n’en dites rien.
Les belles cantatrices qui vivent de leur lit et les filles souvent plus belles qui chantent leur âme sentimentale en montant un escalier rouge n’ont guère d’autre analogie que leur commune aisance à marcher presque nues, et à se faire traiter de putains.
La fille de théâtre aspire de toutes ses forces à la liberté. La fille de bordel a besoin d’esclavage. En apparence, la profession la plus servile des deux est plutôt la première. En fait, la cabotine est montée en scène pour se libérer de sa famille ou de son amant par esprit d’indépendance ; la bordelière s’est jetée dans la servitude, aimant mieux obéir aux caprices des autres que forger elle-même les jours de sa vie.
Dès sa première année de Conservatoire, la fille de théâtre se hausse à connaître par cœur toutes les crudités du langage français. Pour elle, c’est un jeu que d’en grouper quinze autour d’une pauvre idée qui n’en mérite aucune ; et c’est un de ses talents que de les détacher selon les strictes règles de l’articulation. Au contraire, la fille de bordel n’a vraiment ni le goût ni la science du vocabulaire cynique. La liberté des mots la tente aussi peu que celle de la vie. Pas de confusion possible en présence d’une inconnue : les cris d’amour d’une femme suffisent à révéler si elle vient du bordel ou de l’Odéon ; mais beaucoup d’hommes s’y trompent, faute de songer à cela.
Donc, j’avais plus de raisons qu’il ne m’en fallait pour deviner ce qu’on ne m’avait pas dit. Le physique de Teresa, la désinvolture de son caractère et la brutalité de ses expressions, tout en elle me semblait marqué de la même empreinte.
— Tu fais du théâtre ? lui dis-je.
— Plus maintenant, j’en ai fait. Comment le sais-tu ? Par Mauricette ?
— Non. Mais cela se voit. Cela s’entend. Où as-tu joué ?
Sans répondre, elle se coucha près de moi, sur le ventre. Je repris ironiquement :
— Tu me le diras demain ?
— Oui.
— Reste avec moi jusque-là.
— Jusqu’à demain matin ? Tu veux ?
Comme elle souriait, je la crus sur le point d’accepter. J’étais encore un peu las, mais elle m’inspirait presque autant de désir que si j’avais été dispos. Elle se laissa étreindre et me dit :
— Qu’est-ce que tu veux de moi jusqu’à demain ?
— D’abord, te faire jouir.
— Ce n’est pas difficile.
— Ne me dis pas ça, tu m’exaspères ! Pourquoi t’es-tu retenue ?
— Parce que mon « petit travail » aurait été mal soigné. Allons ! Qu’est-ce que tu veux encore ?
— Tout le reste.
— Combien de fois ?
— Oh ! je crois qu’avec toi je ne compterais guère. Ce ne serait « pas difficile » non plus.
Teresa fixa sur moi un de ces longs regards silencieux à travers lesquels j’avais tant de peine à distinguer sa pensée. Et cette femme qui ne voulait répondre à aucune de mes questions me fit soudain la confidence la plus imprévue, comme si la certitude qu’elle avait de m’attirer l’assurait de ma discrétion ; ou dans un autre dessein : peut-être pour m’obliger à garder le secret si je venais à l’apprendre d’une autre source.
— Ricette m’a dit qu’elle t’a fait jurer et que tu lui as tenu parole. Je peux te dire un secret ? Oui ? Eh bien, j’habitais Marseille avec mes trois filles, en appartement. Je suis partie parce qu’on a changé le commissaire de police. Voilà. Tu comprends ?… Ici, je vais me tenir tranquille pendant quelque temps ; mais comme j’ai une fille qui a le feu dans le derrière, elle est venue se faire enculer chez toi le premier jour… et sa mère y est venue ensuite.
Sur ce mot elle se remit à rire, d’abord pour me persuader que son histoire marseillaise n’avait aucune importance, et ensuite parce qu’elle voulait me voir de bonne humeur avant de me dire ses projets.
Du rire elle passa aux caresses. Quand elle fut sûre de mon état, elle me posa une question sous la forme qui convient à l’extraction des aveux :
— Tu n’es pas assez puceau pour ne pas savoir encore ce que c’est qu’une petite fille ? Une vraie, sans poils, sans nichons ; tu en as baisé ?
— Oui ; mais pas souvent. Deux… ou quatre… en tout. Deux vraies, comme tu dis ; et les deux autres un peu moins vraies.
— Deux, ça me suffit. Tu sais qu’on n’enfile pas une gosse comme une femme, et que quand on lui a logé le bout de la queue dans la moniche, c’est tout ce que la môme peut prendre ? Tu sais ça ?
— Évidemment. Pourquoi me le demandes-tu ?
— Parce que je vais t’envoyer ma Lili et, comme tu as la manie de baiser, je ne veux pas que tu me la défonces.
Les patientes personnes des deux sexes qui ont assumé la charge de mon éducation m’ont appris qu’au bal, si la belle dame que l’on invite répond au jeune homme : « Faites danser ma fille », il ne peut manifester ni regret, ni plaisir, ni indifférence. La situation est très complexe.
Je le savais ; mais, tout nu, je suis moins bien élevé qu’en habit. Et puis j’ai quelque similitude avec Alexandre. Je tranche les complexités.
— Je crois que je ne saurais pas m’y prendre. Donne-moi une leçon, dis-je à Teresa.
Elle devenait assez nerveuse et rit en détournant la tête.
— Ce que tu me demandes, tu ne l’as même pas vu.
— Montre-le-moi.
— Pas par-devant. Tu m’as enculée par-devant. Tu verras mon chat par-derrière. Mais tu sais ce que j’ai dit ?
— Ce sera pour la fin ?
— Pauvre petit ! Si je me fourre ta queue dans la bouche, tu seras bien à plaindre. Et si je te fais danser les couilles du bout de ma langue… Tu ne la connais pas, ma langue ? Tiens ! Regarde ! Regarde !
Comme, sans m’abstenir de regarder, j’essayais de prendre Teresa d’une façon plus simple et non moins agréable, elle serra les cuisses, elle arrêta mon bras :
— Est-ce que tu ne comprends pas qu’on n’attache pas trois filles avec une chaîne à la ceinture comme trois singes autour d’un piquet ? Qu’elles faisaient l’amour à Marseille et qu’elles ne le font plus à Paris ? Que si je prends un amant elles en prendront six ? Écoute-moi. Tu me veux ? tu m’auras. Mais tu nous auras toutes les quatre.
Je faillis demander avec effroi : « Tous les jours ? » Je me retins et j’essayai de dissimuler mon inquiétude sous un masque reconnaissant.
— Je vais t’envoyer Lili, poursuivit-elle, parce que Lili se couche de bonne heure et que les môminettes sont comme les dames du monde : elles grouillent du cul l’après-midi. Ce soir, je t’enverrai Charlotte pour toute la nuit. Demain soir, c’est moi que tu verras entrer. Et si tu n’es pas content de nous, tu demanderas le registre des réclamations.
— Je suis comblé… Malheureusement, je vois que tu t’en vas ?
— Non. Dans cinq minutes ; quand j’aurai tenu mes promesses. Mais à deux conditions : tu ne jouis pas ; moi non plus. Je ne te montre pas mes beautés pour que tu leur fasses minette…
Recommandation inutile. J’aime beaucoup mieux prouver ma virilité que rivaliser avec les lesbiennes, et cette préférence devient exclusive quand je couche avec une femme qui a d’autres amants.
Toujours souple et agile, Teresa fit un saut d’écuyère pour tenir ses deux promesses, tête-bêche sur mon corps étendu.
Ce qu’elle déploya sur mes yeux me parut extraordinaire. Toutes les parties en étaient anormales : un clitoris protubérant ; de vastes lèvres minces, délicates, noires et rouges comme des pétales d’orchidée ; une gorge vaginale redevenue étroite, qui donnait par contraste aux lèvres une proportion monstrueuse ; un étrange anus en cocarde, largement teinté de bistre sur un fond pourpre ; mais autour de ces détails, les singularités les plus invraisemblables étaient celles des poils. Je crois que jamais une femme aussi velue de noir n’avait couché dans mon lit. Ses poils envahissaient tout : le ventre, les cuisses, les aines ; ils croissaient entre les fesses ; ils obscurcissaient la croupe ; ils montaient jusqu’à…
Tout à coup, je ne vis plus rien. La langue de Teresa m’avait touché la peau. Mes muscles piqués se crispèrent. La langue erra, tourna, passa par-dessous… Je frémissais. Cela ne dura qu’un instant d’angoisse. Teresa releva la tête et, sautant du lit :
— Assez pour ce soir ! dit-elle.