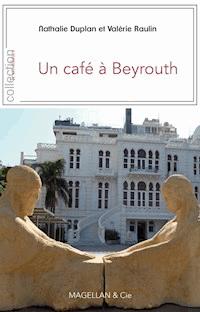
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Je est ailleurs
- Sprache: Französisch
Un portrait contemporain du quotidien à Beyrouth.
Un café à Beyrouth est un vagabondage inédit au cœur d’une ville particulièrement attachante et d’une richesse – humaine, historique, culturelle – insoupçonnée : on y croise des chrétiens, des musulmans, des juifs, des Arméniens, des cireurs de chaussures, des petits vendeurs ambulants, des militaires avenants, des réfugiés syriens et irakiens, des travailleurs africains, des Libanais amoureux de leur pays et ardents défenseurs du patrimoine, des chauffeurs de bus improbables, des éleveurs de chevaux ; on y devine l’ombre du général de Gaulle, du futur résistant Missak Manouchian, de Lamartine, Barrès, Nerval, etc. ; on y contemple des pierres multiséculaires, une architecture traditionnelle en péril, une nature maltraitée mais luxuriante… Surtout, on y découvre une âme singulière, fière de ses racines mais pétrie de mille influences, qui se dévoile autour d’un café.
Le cœur battant du Liban, sa capitale, vue par deux passionnées qui y séjournent chaque année plusieurs mois.
EXTRAIT
Dans la fraîcheur des petits matins, la lumière monte doucement sur l’hippodrome de Beyrouth, Sabâ’ el-Kheil, révélant le terre-plein vert et le sol rouge de la piste. Le claquement de sabots ferrés frappant le béton, du côté des écuries, et les hennissements qui enflent sont la seulemusique perceptible de ces aubes étranges. Beyrouth n'est pas encore livrée à l’agitation trépidante, ni engorgée par les voitures ou saturée de klaxons. Ces concerts champêtres, en plein cœur de la capitale libanaise, tranchent avec les bruits coutumiers de la ville. Et si l’ouïe est surprise, la vue l’est tout autant. Autour de 6 heures du matin, une vision aux contours imprécis émerge de la pénombre : des chevaux traversent la large chaussée, rue Omar-Beyhum, au milieu des voitures. Les animaux de l’hippodrome ne respirent ni ne vivent au rythme de la grande cité.
À PROPOS DES AUTEURES
Nathalie Duplan travaille au Figaro magazine et a collaboré à plusieurs titres de presse dont National Geographic ; Valérie Raulin, accréditée auprès du ministère de la Défense, est une spécialiste du Proche-Orient. Ensemble, elles ont publié plusieurs ouvrages dont Le Camp oublié de Dbayeh, pour lequel elles ont reçu le prix littéraire de L’Œuvre d’Orient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AVANT-PROPOS
UN PUITS DE SENTIMENTS
Beyrouth est plus qu’une ville, comme le Liban, message de convivialité, est plus qu’un pays.
Nous aimons Beyrouth. Nous l’avons découverte chacune de notre côté. Depuis vingt ans, nous la sillonnons ensemble, comme nous parcourons le Proche-Orient : pour la réalisation de reportages, l’écriture de livres, le désir de rencontres, la passion de l’échange. Beyrouth, le Liban, l’Orient, ses fils, son histoire, ses paysages, son patrimoine, ont conquis nos cœurs.
Au fil des ans, nous avons découvert des défauts, indiscernables à l’œil du néophyte. Ils n’ont pas altéré notre tendre affection pour cette ville. Beyrouth est peuplée de visages que nous chérissons.
Le tracé de ces lignes est subjectif. Le contenu de ces pages a des reflets très personnels. Puissent les amoureux de Beyrouth y reconnaître la dame qui leur est familière, et les novices soupirer de l’apprivoiser.
Et, guidé par l’ardeur des sentiments, puisse le lecteur se laisser haler plus loin que les apparences, et s’abîmer dans les entrailles de la ville, au plus profond de son âme.
Nathalie DUPLAN et Valérie RAULIN
Beyrouth, riche et déroutante comme la Méditerranée, enivrante comme cette mer propice aux échanges.
- 1 -PASSION
« Ô Beyrouth… Dame de l’univers […]Nous confessons maintenantQue nous n’avons pas été justes envers toi ni miséricordieuxNous ne t’avons pas comprise…»
Majida El Roumi,Beirut set el-dounia
Éblouie de soleil, enveloppée de brume, Beyrouth émerge des flots, mais se dérobe à nos yeux. Tout juste offre-t-elle ses teintes mordorées, ses formes et son relief à nos regards avides. Beyrouth est souvent insaisissable, gorgée de lumière, drapée d’obscurité, nimbée de brouillards. Les jours d’orage, après la pluie, quand le ciel est de soufre, Beyrouth semble un mirage pastel posé sur la Méditerranée.
Derrière les hublots d’un avion, impossible de distinguer les ficus, les grenadiers, les bougainvilliers, les frangipaniers, les lauriers-roses, dont les fleurs empourprent jusqu’aux axes les plus bétonnés. Les contours de quelques constructions emblématiques se détachent parfois, subrepticement. Beyrouth se rapproche, mais Beyrouth nous échappe. Coutumière du fait, elle avait plongé Maurice Barrès dans un grand désarroi :
Mais quelles contrariétés ! Après trente-deux heures de navigation, ce matin, quand nous touchons à Beyrouth, rien qu’un immense brouillard, épais, universel et tout chargé de pluie. Aucun Liban ! […]
Il n’est point de brouillards comme il n’est point d’algèbres
Qui résistent, au fond des nombres et des cieux,
À la fixité calme et sereine des yeux…
Pardon ! les brouillards du Liban résistent. Ils ne me laissent voir que la scène bariolée des barques et des mariniers lancés à l’assaut de nos bagages, et, au ras de la mer, la ville1.
Tel un promontoire, Beyrouth s’avance dans la mer, comme donnée au monde. Pourtant, elle ne se laisse pas découvrir facilement. Les localités libanaises se tiennent en retrait, dans les montagnes ou sur le littoral. Elle, la capitale, le chef, fait office de tête de pont, de figure de proue du pays tout entier. Dans sa géographie de ville en quête de large, Beyrouth se révèle résolument tournée vers l’inconnu, livrée à ses influences, vulnérable à ses vents et à ses marées.
Dix-sept civilisations successives ont enrichi cette dame honorable, l’une des plus vieilles cités : trois mille ans de plus que Lutèce, deux mille cinq cents de plus que Rome. L’unique capitale à avoir été habitée sans discontinuité depuis cinq mille ans cache, entre six et douze mètres de profondeur, des traces phéniciennes, hellénistiques, romaines, byzantines, médiévales, mameloukes, ottomanes… Et elle s’enorgueillit d’abriter dix-huit confessions religieuses.
Beyrouth aux mille visages : refuge des persécutés de la terre et colline de rejet ; montagne de spiritualité et fleuve de débauche.
Beyrouth, mosaïque de convivialité, jadis crânement dressée vers le ciel, et désormais étendue sous le pas de passants indélicats, gisant, comme autant de tesselles fragiles foulées aux pieds.
Beyrouth, chantre de la vie et antre de la mort.
Nous l’avons découverte en guerre, à feu et à sang, agonie de mitraille et de déluges d’acier, abandonnée aux herbes folles et à la démence des hommes.
Sortie du conflit, elle ne s’en est pas totalement exemptée. Marquée de cicatrices béantes, Beyrouth se présente comme la poésie d’une ville meurtrie, mais non dénuée de superbe. Elle garde la tête haute, tente de faire bonne figure.
Beyrouth « mille fois morte, mille fois revécue », écrivait Nadia Tuéni.
Pénétrer dans les méandres de la ville est un enchantement, une émotion de chaque instant. Tel un puits sans fond, Beyrouth dissimule ses trésors. L’antique Béryte est bien nommée, elle que les anciens avaient baptisée du terme araméen birut, « les puits ».
Nul ne se rend à Beyrouth par hasard. Une raison insoupçonnée prévaut souvent à l’aventure. Mais laquelle ? La promesse d’un exotisme modéré, garanti par l’aspect familier de cette cité à l’abord accessible, bien qu’elle ne se dévoile pas aisément ?
Son histoire exceptionnelle ne s’affiche pas d’emblée. Beyrouth a du charme, mais elle n’est pas la plus belle ville du globe, ne possède pas un cadre ou des paysages à couper le souffle. Quel appel mystérieux conduit donc jusqu’à elle ? Quel magnétisme fait succomber le voyageur ? Barrès se le demandait, conscient d’être guidé par une force irrationnelle :
Qu’est-ce donc qui m’attire dans ce vague et cet indéterminé? Une fois pour toutes, je veux savoir de quoi je suis obsédé. Quand je ne ferais que dresser un questionnaire, du moins je reviendrai avec des curiosités claires, substituées aux parties nocturnes de mon désir2.
À défaut de cerner ses propres motivations, l’académicien pressentait ses dispositions :
Je n’y vais pas chercher des couleurs et des images, mais un enrichissement de l’âme. […] Je vais voir des âmes et des dieux3.
Combien de voyages en Orient – la « terre maternelle » pour Gérard de Nerval – masquent la sourde recherche universelle des origines ? « Voyager en Orient, c’est revivre, dans le présent, les diverses étapes de notre propre évolution », se plaisait à affirmer le diplomate et archéologue Melchior de Vogüé. Touchant au but, Lamartine résumait bien :
Le capitaine du brick a reconnu les cimes du mont Liban. […] C’est une des plus magnifiques et des plus douces impressions que j’aie ressenties dans mes longs voyages. C’était la terre où tendaient toutes mes pensées du moment, comme homme et comme voyageur ; c’était la terre sacrée où j’allais de si loin chercher les souvenirs de l’humanité primitive4…
Mais choisir, dans cet Orient, une ville qui a implosé et s’est consumée durant quinze longues années n’est pas anodin. Il y a là comme l’intuition d’un tête-à-tête essentiel, d’un face-à-face fondamental. La guerre révèle ce que l’homme porte de meilleur et de pire en lui, ce que chacun tait. Engager ses pas dans ceux de Beyrouth entraîne sur des sentiers non balisés. Au contact de cette capitale, nous sommes happés par les paradoxes de nos existences, la violence de nos sentiments, la magie de nos émotions.
Chaque année, tels des oiseaux migrateurs, nous mettons le cap sur le Liban. Nous croisons les volatiles qui commencent à emprunter ce corridor migratoire exceptionnel. Leurs escadrilles formées en triangle se succèdent au-dessus de l’eau, en direction de l’Égypte et au-delà. Ils préparent leur hiver tandis que nous effectuons notre transhumance orientale.
Nous avons coutume de poser nos valises sur la côte libanaise aux premiers jours de septembre. Non pour imiter Lamartine qui y accosta le 6 septembre 1832, mais parce que l’automne est une période propice.
Le climat, à l’exception de quelques coups de vent sur la mer et de quelques orages de pluie vers le milieu du jour, est aussi beau qu’au mois de mai en France5.
La lumière y est plus douce qu’en été. Complice des pierres, elle n’écrase plus les bâtiments, mais les caresse et les embrase parfois. Quant aux Libanais, ils sont plus disponibles, moins tiraillés entre un oncle venu d’Amérique, un cousin débarqué d’Australie, un frère rentré d’Afrique, un fils arrivé d’Europe.
Dès que nous atterrissons, nous jetons nos premiers regards inquiets et inquisiteurs alentour afin de vérifier que tout est en place. Ici tout bouge, mais rien ne change : Beyrouth est l’étonnant mariage entre agitation et immobilisme.
Mais avant même de toucher terre, nous sommes déjà au Liban. Car dans l’avion, c’est Beyrouth ! Le joyeux désordre auquel les hôtesses tentent de remédier, la frénésie des voyageurs à communiquer les uns avec les autres, les valises obèses débordant de cadeaux et n’entrant pas dans les coffres à bagages, les passagers prompts à vouloir négocier un changement de siège, les apostrophes mêlant le français, l’anglais, l’arabe, dans une seule phrase, le tourbillon d’enfants se coursant dans les couloirs pour se dérober les consoles de jeux, les conversations téléphoniques se poursuivant au-delà de la limite autorisée… disent mieux qu’une carte d’embarquement, ou que les annonces d’un steward, que l’appareil est en partance pour Beyrouth.
Et le moindre dialogue avec un voisin de siège propulse, à son tour, en terre libanaise : « Vous êtes Françaises ?
– Oui.
– C’est la première fois que vous voyagez (allez) au Liban ?
– Non, nous venons régulièrement.
– Comment avez-vous trouvé le Liban ? Vous avez aimé?
– Oui beaucoup.
– Ah, vraiment, c’est bien ! Qu’est-ce que vous avez aimé?
– Tout, nous aimons beaucoup le Liban.
– ‘An jadd (vraiment) ? Où habitez-vous en France ?
– À Paris.
– Hîîî! J’ai beaucoup aimé Paris. I love Paris ! »
En poursuivant la conversation, en énumérant les sites parcourus depuis des années, l’étonnement se lit sur les visages. Les Libanais sont toujours surpris de l’intérêt porté à leur pays, ses habitants, son patrimoine. Rien n’a changé depuis l’époque de Lamartine :
Ils ne comprennent pas d’abord que l’on vienne habiter et voyager parmi eux, uniquement pour les connaître et pour admirer leur belle nature et leurs monuments en ruines6…
Cela ne les empêche pas de convier le voyageur à prendre un café chez eux. Le café, ’ahweh en libanais, qahwah en arabe, la boisson par excellence. Au Liban, il est l’assurance de la convivialité. À lui tout seul, il scelle des relations plus solides que n’importe quel contrat. En plusieurs décennies de reportages, combien d’informations, d’éléments cruciaux à la bonne compréhension des situations ont-ils été recueillis grâce aux tasses de café? Les interviews formelles sont… pour la forme. Le café, lui, est pour l’échange, le partage, la confidence, immédiate ou à venir. Au détour d’une phrase légère, après une discussion futile, à l’occasion d’un proverbe énoncé, des histoires se dénouent ou s’éclairent. À Beyrouth, qui ne « perd » pas de temps à palabrer autour d’un café ne peut saisir l’âme de la ville.
Dès que le train d’atterrissage flirte avec la piste, un petit pincement au cœur se fait sentir : durant des années, à peine l’appareil touchait-il le tarmac que la carlingue vibrait sous les applaudissements. Cela arrive encore parfois. L’anecdote a inspiré des comiques : « Je cesserai d’avoir peur en avion quand les gens arrêteront d’applaudir. » Mais ces applaudissements nourris étaient émouvants. Ils disaient l’attachement à leur patrie de personnes condamnées à l’exil. Ils trahissaient leur joie de retrouver leurs familles. Ils exprimaient leur gratitude pour ce pilote qui venait de les ramener sur leur terre.
Longtemps, Beyrouth a été notre port d’attache, la plaque tournante de nos déplacements. De Beyrouth, nous poursuivions par route ou par air vers Damas, Alep, Antakya, Diyarbakir, Mossoul, Bagdad. Nous partions sillonner la vallée de l’Oronte, les massifs du Tur Abdin, l’Anatolie du Sud-Est, la plaine de Ninive, le Kurdistan irakien, la Djézireh syrienne, à la rencontre de civilisations oubliées, de populations prises en otages, de groupes malmenés, de sites archéologiques en péril. Par sécurité, à l’ère où le numérique n’était qu’une chimère, nous revenions confier nos films, nos notes et nos archives, au Liban où nous avions moins à craindre la censure de régimes autoritaires ou l’indiscrétion de services maladivement fureteurs. Tous nos chemins menaient à Beyrouth, désormais ultime « réduit » d’une région dévastée que nous avons vue sombrer, impuissantes. Fidèle à sa vocation, malgré les risques et le danger, le Liban continue d’être « un refuge, une arche de salut pour les races traquées »7.
À force de traverser Beyrouth pour nous focaliser sur d’autres métropoles, nous y avons noué des amitiés. Notre univers est peuplé de personnes qui, un jour, nous ont confié leur vie. Aucune n’a été une parenthèse, aucune n’a constitué un « bon sujet ». Toutes ont été des êtres de chair et de sang, de larmes et de rires, dont nous avons partagé les joies, les peines, les abattements, l’espérance.
Les médecins et le personnel soignant apprennent à se blinder contre la maladie, et la mort éventuelle, de leurs patients. Sans cela, il leur serait impossible d’exercer leur profession. Aucun équivalent n’existe pour les journalistes. Pas de formation pour ne pas se sentir affecté par les misères qui frappent les interlocuteurs d’un jour. Nulle recette pour neutraliser une douloureuse empathie.
À l’instar de nombreux étudiants en journalisme, nous avions cru, en nos jeunes et naïves années, que les lignes consacrées aux laissés-pour-compte en tous genres inverseraient leur destin, l’inclinant vers un avenir plus clément. Avec la maturité, l’expérience, le leitmotiv de certains professeurs s’était imposé à chacune de nous : « Ne vous imaginez pas que vous allez changer le monde avec vos écrits. En tant que journalistes, vous pensez être investis d’une mission ? Alors rappelez-vous deux choses : la moitié des gens liront vos articles assis sur la cuvette des toilettes ! L’autre moitié utilisera vos journaux pour trier leurs légumes et emballer les épluchures ! »
À regret, nous avons dû admettre que nous ne modifierions aucune existence. En revanche, ces personnes sont entrées dans nos vies et n’en sont jamais sorties.
Beyrouth est généreuse en rencontres. Moins grandiose que d’autres capitales ou cités mythiques qui arborent des lieux époustouflants, elle est riche d’échanges inattendus. Ils se méritent, sont réservés aux êtres réceptifs à l’imprévu, ou disposés à prendre un café…
Voilà qui est particulièrement séduisant. Ici, la vie se déroule dehors et en relation. Des relations bonnes ou mauvaises, mais toujours lisses et courtoises, du moins en apparence, « hypocrites » médisent ceux qui n’ont pas percé l’âme orientale. L’architecture des maisons traditionnelles, l’agencement des pièces, les ouvertures franches sur l’extérieur par le biais de cour intérieure, véranda, iwân8, riwâq9, illustrent cette conception de l’existence. Sans compter les expressions enjouées qui ponctuent les journées, à faire pâlir de jalousie un Parisien bougon.
« Tfaddalô » (Entrez, je vous en prie), « Ta‘ô, chrabô ’ahweh » (Venez prendre le café). Qu’il est doux de s’entendre inviter de la sorte, même s’il serait discourtois d’accepter, d’emblée, la première invitation, et de se précipiter dans le salon de tous, à tout instant. Qu’importe que l’hôte installé sur sa terrasse ou celui assis devant la devanture de sa boutique, et qui forment ces vœux, soient des inconnus. Leur démarche est appréciable.
Et comment résister au « kîfik ‘ayounî? » (Comment vas-tu, prunelle de mes yeux ?) du gardien d’immeuble ? D’autant qu’en libanais, il ne dit pas « prunelle de mes yeux », mais « mes yeux » purement et simplement : une partie du lui-même et non des moindres. Quelle Parisienne pourrait trouver au fond de sa mémoire le souvenir d’avoir été appelée ainsi par son concierge, ne serait-ce qu’une fois ?
Maurice Barrès a parcouru l’Orient il y a un peu plus d’un siècle, en 1914. Le déclenchement de la Grande Guerre a retardé la publication d’Une enquête aux pays du Levant jusqu’en 1923, quelques mois avant la mort de l’écrivain. Ce qui frappe dans son récit, hormis sa plume dont la qualité n’est pas à démontrer, c’est la justesse de ses observations. Les traits qui ont retenu son attention sont identiques à ceux qui font toujours réagir. Il y a quelque chose d’immuable dans le corps et l’esprit du Liban. Ils ont saisi Barrès comme Lamartine. Et Barrès comme Lamartine les ont saisis.
Maurice Barrès a effectué une traversée en bateau et non un vol en avion. De son temps, Beyrouth comptait moins d’habitations anarchiques. Pourtant, dans ses grandes lignes, dans son impression globale, la description de son arrivée correspond à ce que tout voyageur peut ressentir avec cent ans de décalage :
Douceur générale de Beyrouth, avec les petits carrés blanchâtres de ses maisons coiffées de toitures légèrement pointues, dont les tuiles rouges font le plus plaisant effet dans la verdure. Je n’oublierai jamais cette chaleur, cette humidité, cette brume qui nous enfermaient et, dans ce désordre du bateau tirant de cale tout son chargement, la sorte d’émoi sacré qui me soulevait. De telles minutes s’incorporent à notre être, comme les dernières attentes d’un premier rendez-vous d’amour. Je respirais l’odeur de l’Asie10…
Oui, cette chaleur moite qui s’abat dès la descente de l’avion sent l’Asie, l’Orient tout proche.
Il fut un temps où le portrait du président d’un pays voisin réceptionnait les visiteurs à l’aéroport. Ce temps est révolu. L’accueil, lui, ne change pas. Invariablement, lorsque la première d’entre nous se présente au poste de contrôle, l’agent noue avec elle un dialogue inimaginable ailleurs : « Ahlân ! Bienvenue ! »
L’homme en uniforme scrute le passeport avec attention, en tourne les pages, observe, revient en arrière. Puis : « Pourquoi as-tu payé un visa ? Moi je te le donne gratuitement.
– Mais si je veux rester plus d’un mois, je dois le renouveler à la Sûreté générale.
– Ma‘leich (ça ne fait rien) ! Sois la bienvenue ! »
Avec les menaces terroristes, les mesures de sécurité se renforcent chaque jour davantage. Mais par le passé, combien de Français distraits ou négligents, quittant le territoire libanais avec un visa expiré, se sont entendu asséner en guise de procès-verbal : « Ahlân ! Tu as aimé le Liban ? Quand est-ce que tu retournes (reviens) ? »
Le plongeon dans l’atmosphère beyrouthine est immédiat. Devant le terminal des arrivées, des voitures de police toutes sirènes hurlantes se fraient un passage au milieu de chariots noyés sous d’énormes paquets, poussés par des employés, et escortés par des femmes voilées, en hijâb et ‘abâ’eh (abaya), elles-mêmes accompagnées de jeunes filles aux t-shirts très moulants, soulignant leurs rondeurs, et de femmes en tenue très sexy, en jupes au ras de la vertu. Bienvenue à Beyrouth !
Le Liban n’est pas un pays laïc au sens français du terme, il est multiconfessionnel. Personne ne s’offusque de ce que quelqu’un affiche des signes extérieurs de religion. Les taxis le confirment généralement. Leurs habitacles peuvent être de petits oratoires ambulants : chapelet enroulé autour du rétroviseur, image de la Vierge sur le tableau de bord, photo de saint Charbel glissée dans les montants du toit. Les chauffeurs musulmans n’ont rien à envier à leurs collègues chrétiens : la mesbheh, ou subha, le chapelet qu’ils utilisent pour proclamer les quatre-vingt-dix-neuf noms d’Allah, pend aussi aux rétroviseurs, tout comme des versets du Coran lorsqu’ils ne sont pas apposés près du volant. Et sur les clés de contact, il n’est pas insolite de trouver une petite chaussure – également prisée chez certains chrétiens – destinée à « chasser le mauvais œil », c’est-à-dire éloigner les malédictions.
Parfois, mais plus rarement, des inscriptions plus neutres détonnent : « Ici on est toujours content, soit de vous voir monter, soit de vous voir descendre…»
En Orient, la religion fait partie de la vie quotidienne. Les locutions le rappellent à chaque occasion, plusieurs fois dans la journée : « Inchâllah (si Dieu veut), on se verra », « Hamdellah (Dieu soit loué), ça va bien », « Nochkor Allah (merci mon Dieu), il a retrouvé la santé», etc. Entendant proclamer le mot d’Allah, certains Occidentaux s’imaginent que ces expressions ne concernent que les musulmans, Allah ne pouvant être, dans leur esprit, que le dieu des mahométans. C’est ignorer que l’arabe Allah viendrait de l’araméen Alaha, en syriaque oriental, ou Aloho, en syriaque occidental, à rapprocher vraisemblablement du terme hébreu ‘Elohim.
Que la foi soit profonde ou teintée de superstition, elle colle à la peau de tout Oriental qui n’aurait pas idée de s’en départir. À diverses reprises, nous avons assisté, amusées, au dialogue entre un Libanais dubitatif et un Français laïcard, fraîchement débarqué en Orient :
« Tu es chrétien ?
– Non.
– Musulman ?
– Non.
– Juif ?
– Non.
– Quoi alors ?
– Rien.
– Comment ça, rien ? »
Dépité, le Français cherchait un soutien autour de lui : « Mais dites-lui, vous, que je ne suis pas croyant, mais que je suis quelqu’un de bien. »
Sur la route de l’aéroport, les visages enturbannés fixés aux pylônes, ou accrochés çà et là, rappellent que la zone est chiite. Il est possible de se perdre à Beyrouth. Mais grâce aux drapeaux des formations politiques ou aux portraits de leurs leaders, on a toujours une idée du secteur dans lequel on s’est égaré.
Une année, quelqu’un lança une sorte d’album Panini où la tête des politiciens remplaçait celle des joueurs de football : une bonne façon de réviser ses classiques, vu que les hommes politiques d’aujourd’hui sont les mêmes qu’hier. D’une manière générale, ceux qui s’affrontaient sur les champs de bataille se battent désormais au Parlement ou en Conseil des ministres, eux ou leurs héritiers.
Leurs figures sont placardées sur le bord des routes. Cette pollution visuelle vient s’ajouter aux pollutions sonore et atmosphérique. Sur les accès aux agglomérations, les enseignes pullulent. Il faut reconnaître que certaines publicités sont l’illustration de l’humour salvateur des Libanais. L’une des plus réussies demeure celle d’une célèbre marque de whisky, réalisée en 2006. De juillet à août, le pays avait été ravagé par une guerre entre le Hezbollah, une milice chiite, et Tsahal, l’armée israélienne. Cette dernière avait détruit nombre d’infrastructures civiles et notamment tous les ponts du pays. Le conflit terminé, des panneaux publicitaires mettaient en scène le héros de la marque de whisky, marchant avec flegme sur un pont effondré, en écho à la campagne précédente qui le montrait progressant sur un ouvrage solide. Étant donné les circonstances, le slogan était d’une exquise impertinence : « Johnnie Walker is still walking » (Johnnie Walker marche toujours).
Maintes fois, la ville a été maltraitée par la main de l’homme, armée d’une kalachnikov ou d’un marteau-piqueur. Beyrouth est magnanime. De la pire désolation surgit toujours quelque chose de beau : une douce odeur de ’ashteh, anone (pomme cannelle), sur l’étal d’un primeur au milieu des effluves des pots d’échappement, ou de flamboyantes fleurs d’ibiscus pour conjurer le morne béton.
Et puis, dans ce pays qui mérite d’être qualifié de « lait et de miel » quand les cimes des montagnes se couvrent de neige et que la lumière joue avec les façades ocre des maisons, il y a la mer. Sa simple vue lave des pires horreurs, ouvre à tous les horizons. À Beyrouth, se promener au bord de la Méditerranée permet une entrée paisible dans une journée trépidante, une sortie réparatrice, une réflexion au goût d’embruns.
Le général de Gaulle, grand ami du Liban, ne prétendait pas autre chose. Dans une lettre écrite le samedi 2 novembre 1929, à bord du Lamartine, alors qu’il vogue vers le Liban où il est affecté, il confie à son père :
La seule vue de la mer et de celle-là rend plus claires et plus profondes les idées et les espérances, et l’on admire Thémistocle qui fit placer la tribune de l’Agora de telle façon que les orateurs eussent toujours sous les yeux la Méditerranée11.
La convergence d’analyse entre des stratèges, français ou athénien, tels de Gaulle et Thémistocle, et un poète, également homme politique, Lamartine – « le voyant de génie » comme le nomme Barrès – est saisissante :
Tout paysage où la mer n’entre pas pour élément n’est pas complet […]. C’est de ce contraste incessant que naissent le choc des pensées et les impressions solennelles qui font du Liban des montagnes de prière, de poésie et de ravissements12 !
Mer, miroir de nos cieux tourmentés…
1. Maurice Barrès, Une enquête aux pays du Levant, tome I, 1923.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient, tome I, 1835.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Maurice Barrès, op. cit.
8. Grand arc qui flanque une pièce l’ouvrant à l’air libre et permettant de rester dehors, tout en étant à l’abri. Par extension, ce nom est donné à la pièce qui porte cet arc et qui est munie d’un divan, de tables basses où l’on peut deviser et prendre le café.
9. Galerie d’arcades sous lesquelles on peut s’installer.
10. Maurice Barrès, op. cit.
11. Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets : 1919-Juin 1940.
12. Alphonse de Lamartine, op. cit.
Le centre-ville offre une plongée dans l’Histoire, un voyage à travers les différentes religions dont les lieux de culte se partagent un même périmètre, comme la cathédrale Saint-Georges des Maronites et la mosquée Mohammed al-Amine.
- 2 -NOSTALGIE
«… elle est mille fois morte, mille fois revécue.Beyrouth des cents palais, et Béryte des pierres,où l’on vient de partout ériger des statues,qui font prier les hommes et font hurler les guerres…»
Nadia Tuéni,Beyrouth
Peu importe que cela paraisse convenu : nous aimons arpenter la place des Martyrs, le cœur historique de Beyrouth, son cœur nostalgique. À l’instar des Libanais, nous nous lamentons de ce que cette place ne soit plus ce qu’elle était. Comme eux, nous avons tendance à l’enfermer dans un prétendu passé glorieux à jamais perdu. L’amnésie guette. Les clichés sont tenaces : les photos en noir et blanc, les cartes postales aux couleurs désuètes et affadies, ont marqué durablement les esprits. Nul n’échappe à ces vues d’une place ourlée de palmiers, festonnée de nouvelles boutiques, ornée de récents cinémas, animée par la valse étourdissante des calèches, des omnibus, des voitures, de la fameuse diligence jaune, du tramway, des marchands ambulants, des passants. D’autant que, quelques années plus tard, ce centre de la vie sociale, son agitation permanente, son mouvement incessant seront frappés de plein fouet par les «événements13». Avec le déclenchement de la guerre, la place deviendra infréquentable. Située sur la « ligne verte », la ligne de démarcation entre l’est et l’ouest de la ville, elle va se muer en fief des tireurs embusqués, figeant le souvenir des jours heureux sur ces inévitables clichés.
Pourtant, la place des Martyrs est bien plus riche que l’image d’Épinal, car le temps béni de la splendeur, que l’homme de la rue regrette inlassablement, n’a pas été tendre avec elle. En la pleurant, les Libanais pleurent, en réalité, l’époque insouciante qui a précédé le chaos.
Les quinze années de cette guerre interminable ont ravagé le Liban. Elles ont été un désastre, comme tout conflit. Mais, par l’un de ces paradoxes dont le Liban a le secret, cette destruction a également constitué une chance. Elle a permis de se soucier du patrimoine archéologique et architectural jusqu’alors malmené.
Chaque fois que nous débouchons sur la place, nous avons besoin d’un peu de temps pour nous ancrer dans le présent. Irrépressibles, les souvenirs refont surface, ceux du lieu dévasté, dévoré par la végétation sauvage, et ceux de la renaissance amorcée mais encore inachevée.





























