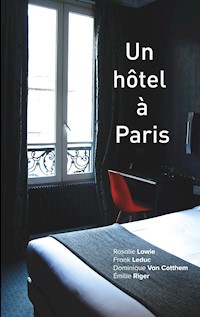
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un hôtel à Paris... 4 auteurs, 4 nouvelles insolites... Un hôtel a ceci de particulier qu'il est une étape dans un voyage. Un lieu de passage et de brassage où le temps n'efface jamais vraiment le souvenir de ceux qui y font escale. Un endroit empreint de mémoire collective et d'histoires individuelles. Jean, à l'hôtel des Anges, au 110 rue Lepic, voit sa vie basculer en ouvrant un tiroir de commode dans lequel se niche un secret bien gardé depuis des années révélant les clés d'un passé saisissant. Bouleversant. Alberto, dont le secret trop lourd à porter lui ouvre les portes de l'hôtel Paradis. Et bien au-delà. Tragique. Clémentine, veilleuse de nuit occasionnelle à l'hôtel des Petits Miracles, ne s'attendait pas à ce que ce mystérieux visiteur de la chambre n°18 lui ouvre grand les yeux sur un secret bien plus ancien que l'hôtel. Touchant. Enfin, Louis, l'emblématique portier du légendaire Bristol, trouvera-t-il chaussure à son pied après être tombé au plus bas, lui dont le destin a été transformé par un soulier de verre? Poignant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
À Florence
… et à tous nos pingouins
TABLE DES MATIERES
Préface
Ergé
Hôtel des Anges
Dominique VAN COTTHEM
Hôtel Paradis
Rosalie LOWIE
Le mystère de la chambre 18
Frank LEDUC
La 13
ème
paire
Emilie RIGER
PRÉFACE
8H10. Paris. Gare de Lyon. Les trains font crisser leurs essieux d’airain et déversent leurs flots d’humains sur le quai d’une gare engloutie dans l’épaisseur des volutes matinales. Happé par la foule, je tente une trajectoire à contre-courant pour m’extirper de ce tsunami humain. Une rampe d’es-calier me sert de point d’arrimage et me mène au Train Bleu, havre de quiétude temporaire, avant que je ne replonge dans les entrailles de la capitale intemporelle. Quelques bouches de métro plus tard, j’abandonne mon apnée sur les quais moribonds et me rends à ce petit hôtel de charme, lové dans le quartier Saint Paul, où m’attendent quatre auteurs impatients de me donner de leurs nouvelles et d’échanger une de leur nouvelle contre un portrait. Ah oui ! J’ai oublié de vous dire ; je suis photographe et je fais des photos uniquement de gens qui ont des choses intéressantes à écrire. Avec eux, je suis servi sur un plateau.
L’hôtel, sobre et néanmoins cosy, mêlant déco rococo et dorures bucoliques ne paie pas de mine. Je ne suis pas étonné car les écrivains - même ceux à la page - vont toujours dans des hôtels qui ne paient pas de mine, histoire de passer inaperçus entre les lignes. Jusqu’au jour où le succès les rattrape, effaçant ainsi leur mine de papier mâché patiemment sculptée par les nuits blanches, le café noir et les insomnies à répétition.
Ces quatre auteurs, je les appelle les quatre fantastiques. Ils font partie de cette nouvelle vague d’écrivains post années 2000 dont les écrits mériteraient un quatre étoiles au Michelin de la littérature, s’il existait, vue la délectation avec laquelle leurs lecteurs les consomment goulûment, accompagnés d’un verre de Pouilly fumé à la terrasse du Café de Flore.
Aujourd’hui, je suis chargé de préfacer leur dernier recueil jusqu’à ce que mots s’ensuivent. Mais ne nous voilons pas la face, ce n’est pas chose aisée que de décrire en quelques mots ce que, eux, se sont évertués à écrire en quelques folios. Ma parole ! Si j’avais su que ce serait aussi difficile de parler d’eux, je leur aurais laissé la parole et ils vous auraient démontré par leurs mots, que le silence est d’or, comme leurs écrits. Car, oui, chaque nouvelle qu’ils nous dévoilent ici peut s’enorgueillir d’être dorée à l’or fin et sertie d’une histoire minutieusement ciselée.
Je salive d’avance rien qu’à la pensée de lire leurs nouvelles toutes fraiches à ces quatre-là, qui n’ont pas la langue dans leur poche pour nous mettre l’eau à la bouche. Confortablement installés dans les poufs lounge de la cour intérieure de ce charmant hôtel, à l’ombre des jeunes tiges en fleurs, ils sirotent un cocktail fait maison par le patron et me proposent en guise d’apéritif le nectar de leurs nouvelles, intitulées ‘’un hôtel à Paris’’.
4 nouvelles insolites comme des cocktails explosifs s’alignent ostensiblement devant moi me tendant leur mixologie, chacune révélant une saveur particulière dont les assemblages à coup sûr recueilleront mes faveurs.
Un hôtel a ceci de particulier qu’il est une étape dans un voyage. C’est un lieu de pèlerinage où ceux qui y font escale laissent derrière eux les traces de souvenirs dont l’empreinte marque à tout jamais le lieu. Parfois le hante. C’est le cas de Jean à l’hôtel des Anges, au 110 de la rue Lepic, dont la vie bascule en ouvrant un tiroir de commode dans lequel se niche un secret bien gardé depuis des années révélant les clés d’un passé saisissant. Bouleversant.
Je déguste la seconde nouvelle. Dès les premiers mots, il faut avoir le cœur bien accroché et s’accrocher encore pour vivre les derniers maux. Mais la plume est tellement aiguisée que le tragique a des allures de ‘’féérique’’, que l’esprit balance entre émotion et rébellion. La rébellion d’une vie pas comme les autres pour Alberto aux prises avec un destin impitoyable mais sous l’emprise d’un souffle de vie invraisemblable. Dans cet hôtel Paradis, l’enfer n’est pas forcément l’envers du décor. Tragique.
Pas le temps pour un trou normand, j’engloutis la troisième nouvelle.
Celle de la bienveillante Clémentine, veilleuse de nuit occasionnelle à l’hôtel des Petits Miracles, face au secret de la chambre N°18. Comme une impression de me retrouver dans un escape game où les murs rétrécissent au fur et à mesure que le dénouement se profile. Mystérieux mais plein de spontanéité, à l’image de son auteur, ce huis clos nous entraîne bien au-delà de ce qui se cache derrière sa porte. Touchant.
La porte justement. C’est celle du Bristol, célèbre palace parisien, qu’ouvre depuis des années, Louis, portier de son métier mais pas que. À force de croiser toutes sortes de gens, il arrive que les destins s’entrecroisent et qu’un pas de côté suffise à tout bousculer. Louis, pour sortir de ce mauvais pas, a préféré être bien chaussé. Mais j’étais à mille lieux de deviner ce qui allait lui arriver… Poignant.
Quatre histoires aux secrets bien gardés, aux destins bien particuliers et aux accents souvent pathétiques. Parfois dramatiques. Quatre histoires fantastiques faisant planer sur l’existence le souffle de la fragilité avant d’en faire basculer l’équilibre. Quatre histoires qui résonnent comme des notes de musique sur la partition des vies de Louis, Alexis, Célia, Germaine, Jean, Lucie, Hannah, Alberto, Héloïse, Clémentine, Isaac et les autres…
23H55. De retour à mon hôtel à Paris, après une journée pas comme les autres avec des gens pas comme les autres, je salue Frank le portier, impeccable dans son uniforme mordoré magnifiant sa prestance devant la porte tournante de l’établissement. Dominique, la réceptionniste - veilleuse de nuit intermittente, me tend la clé de la chambre N° 137 avec un sourire bienveillant qui pourrait faire d’elle une veilleuse de vie à temps plein. Je traverse le piano bar, percevant les notes de musique que Rosalie, la joueuse de blues, égrène de son instrument aux derniers noctambules plongés dans la plénitude du moment. Dans l’ascenseur, je croise une jeune femme, pieds nus, tout de rouge vêtue dans sa robe de soirée tenant à la main de somptueuses chaussures dont les talons sont aussi grands que le sont ma surprise et ma curiosité mises bout à bout. Les portes de l’ascenseur s’ouvrent et laissent filer la belle inconnue. Je n’en saurai pas plus d’elle si ce n’est le galant ‘’bonsoir Emilie’’ que lui adresse Frank lorsqu’il lui ouvre la porte à son passage. Il est minuit. Elle disparait dans la nuit, emportant avec elle son secret éphémère. Reprenant mon pèlerinage ascensoriel jusqu’à mon étage final, je m’apprête à regagner mes pénates, l’esprit encore happé par la soudaineté de cette scène insolite. Arpentant nonchalamment l’interminable couloir feutré qui me ramène à mon nid d’aigle, j’aperçois, malgré la clarté obscure des appliques murales, un objet non identifié posé, à quelques encablures de là, sur un guéridon Napoléon. Il est comme animé de soubresauts, légers et réguliers, et auréolé d’un halo particulier. Plus je m’avance, plus son rythme tachycardique s’affole. Je devine alors un livre dont les quatre lettres thermo-gaufrées sur la couverture battent à l’unisson. E…R…D…F. Je l’ouvre. Tout le monde est là. Dans ce livre d’or. L’histoire ne fait que commencer…À toi, cher lecteur, de fouler le tapis rouge et de tourner les pages qui suivent.
Bonsoir Paris. Tu étais Fantastiques.
Ergé
Hôtel des Anges
Dominique Van Cotthem
Germaine Lediaux était morte d’une fausse route en avalant un morceau de pain perdu. Les causes de sa disparition résumaient à elles seules sa vie d’errance.
Enfant de la DASS, elle était née sous X, appellation que Germaine se plaisait à transformer en « née sous dix ». Sa mère biologique ne lui ayant pas donné de prénom, c’est donc l’infirmière qui la baptisa Germaine Henri (prénoms de ses parents). À quatre ans, elle avait été placée dans une famille d’accueil en banlieue parisienne. En termes de famille, il eût été plus juste de parler de smala, voire de tribu, car le couple chapeautait déjà une fratrie de sept gosses. Une ménopause précoce avait mis fin aux espoirs de nouvelle grossesse, ce qui généra un drame au sein du clan. Obnubilés par les chiffres pairs, les parents ne pouvaient concevoir un total de progénitures indivisible par deux, c’est pourquoi Germaine était venue arrondir la somme à huit. C’était d’ailleurs devenu son nom, Lahuit. Un petit mot gentil, selon eux, qu’elle tentait de digérer avec le sourire. Cependant, à chaque fois qu’ils l’interpellaient : « Lahuit, t’as encore la vaisselle à finir ! Apporte le tabouret, Lahuit ! Fais gaffe, Lahuit, ma main me démange ! », à chaque fois, elle sentait une boule se serrer dans son ventre. Elle ne pouvait s’empêcher de penser à madame Lousberg, celle qu’ils appelaient Lacentmille, une magnifique jeune femme d’une trentaine d’années avec des yeux d’un bleu profond et la silhouette gracile d’une ballerine. Ils se moquaient d’elle, parfois, ils devenaient carrément offensants. Germaine, du haut de ses six ans, ne comprenait pas leurs railleries à l’égard de la si jolie madame Lousberg. Ils s’en prenaient à ses tenues vestimentaires, mimaient sa façon de tirer sur les manches de son gilet qu’elle portait hiver comme été. « T’as vu Lacentmille ? Fait trente degrés et elle a ses manches ! Hihihi, hahaha, Lacentmille cache ses bras ! ». Ils étaient méchants, Germaine s’en rendait compte et elle savait que Lahuit, ce n’était pas un petit mot gentil.
Quand Lahuit eut huit ans, elle fut retirée à sa famille d’accueil à cause de son comportement étrange. En effet, Germaine comptait tout. Les pas entre sa maison et l’école, les marches des escaliers de la butte Montmartre, les voitures en stationnement additionnées à celles en circulation multipliées par quatre, totalisait le nombre de pneus, les gouttes d’eau pour remplir l’évier, les secondes dans une année, les lettres des mots, les phrases d’un livre, tout, tout, tout ! Elle était incapable de lire ou d’écrire, mais elle comptait plus vite que son ombre. De retour au foyer de la DASS, à cause de sa « manie », elle devint définitivement Germaine Lahuit. Personne n’avait envie d’investir de l’énergie à soigner Germaine de ses « troubles mentaux », ni les éducateurs de la DASS, ni une potentielle famille. Elle dut attendre sept ans avant d’être adoptée par un couple de quinquagénaires en mal d’enfant. Deux braves personnes dont les maigres revenus de gardiens d’immeuble incitaient les responsables d’adoption à repousser le dossier chaque année en dessous de la pile. Pour le couple, Germaine, malgré ses quinze ans, était l’enfant de la dernière chance. Pour elle, les Bardinet étaient des parents inespérés. Dans la loge de 42 m2, Germaine Bardinet découvrit la caresse des mots : ma chérie, ma douce, mon adorable. Quand son prénom sortait de la bouche de sa mère, il lui soufflait un amour tel que dans les premiers temps, à chaque fois, elle se mettait à pleurer. Germaine se réconciliait un peu avec les lettres, même si les chiffres continuaient de la hanter : Germaine Bardinet : 16 lettres, 1 G, 3 E, 2 R, 1 M, 2 A, 2 I, 1 B, 2 N, 1 D et 1 T.
Quand monsieur Bardinet fut emporté par une mauvaise grippe, quatre ans plus tard, le bonheur de Germaine s’effilocha peu à peu, tout comme la mémoire de sa mère. Le décès de son mari rendait celle-ci inconsolable. Elle montrait des signes d’oubli de plus en plus inquiétants. Le médecin finit par diagnostiquer une maladie d’Alzheimer foudroyante. En moins d’un an, la pauvre femme ne distinguait plus le jour de la nuit, elle mangeait les croquettes du chat, refusait de se laver, portait les vêtements de son mari, mais surtout, elle appelait sa fille « mademoiselle » ! Germaine avait beau lui répéter son nom des milliers de fois, il n’évoquait plus rien dans l’esprit de madame Bardinet, rongé par la maladie. Germaine était devenue une étrangère dont sa mère avait peur parfois quand elle la voyait « fouiller » dans ses affaires. Elle finit par la placer dans une institution spécialisée. C’est là qu’elle rencontra Ferdinand Lediaux. Une tante éloignée partageait sa chambre avec madame Bardinet. Ferdinand, agriculteur en Corrèze, était un homme bien bâti, solide, un peu rustre, mais gentil. La quarantaine affirmée, il recherchait une compagne bien bâtie, solide, pas chochotte, mais gentille pour fonder une famille. Les vingt ans de Germaine, imprimés sur son visage plutôt joli, avec de grands yeux noisette, une bouche en cœur, donnèrent à Ferdinand l’audace de se lancer. Il sentait qu’en argumentant un maximum sa demande, elle accepterait peut-être de devenir sa femme. Et des arguments, il en avait !
– 200 hectares de terres cultivées.
– 259 tonnes de céréales récoltées chaque année.
– 17 vaches.
– 22 poules.
– 8 canards.
– 283 m2 de surface habitable dans la maison, répartis sur 3 étages.
– 1 tracteur dernier cri.
Tous ces chiffres se mirent à danser dans la tête de Germaine. Elle les additionna : 793. Elle dut ajouter 1 chien et 5 chats qu’il avait oubliés sur sa liste : 799.
Quel chiffre magnifique ! Germaine en avait les larmes aux yeux. Elle le prononçait joyeusement, visualisait l’angle du 7, les courbes des 9. Une revanche s’offrait à elle, car elle pensait à sa famille d’accueil et leur phobie des nombres impairs. 7,9,9, pas de pair, pas de huit ! Plus jamais de Germaine Lahuit !
Elle répondit « oui », sans hésiter.
L’idée de quitter Paris pour aller vivre en Corrèze enchantait Germaine à un point inimaginable, surtout depuis que Ferdinand lui avait révélé le nom de son village : Millevaches ! Sans le savoir, l’agriculteur cumulait les atouts. Ils se marièrent sans tarder, un été de 1975, avant la moisson du blé et après la mise en jachère des parcelles Est.
Germaine s’occupait de la grande maison, labourait les champs, récoltait les céréales, nourrissait les animaux et son mari, avec une joie éternellement collée aux lèvres. Ferdinand n’était pas un homme de mots, comme elle, il aimait les chiffres, leurs conversations ressemblaient à un bilan comptable rempli de tendresse. Elle ne pouvait être plus heureuse. Pourtant, le bonheur n’avait pas encore atteint son apogée. Il prit des proportions gigantesques quand Germaine donna naissance à leur fils. Jean, prénom du défunt père de Ferdinand, vint illuminer la ferme d’un rayon de joie. Quand elle serrait son petit contre sa poitrine, le cœur de Germaine s’emballait au point qu’elle n’arrivait plus à en dénombrer les battements. Une émotion presque divine s’emparait de son esprit. Les additions se brouillaient, les soustractions se décomposaient, la division devenait inconcevable tandis que la multiplication lui donnait le vertige. Elle finit par compter de moins en moins. Dans son cœur tout neuf, l’amour était impossible à chiffrer.
Les années s’écoulèrent sans heurt, jusqu’en 2013 quand Ferdinand succomba à une crise cardiaque à l’âge de 80 ans. Germaine et son fils poursuivirent le travail d’exploitation de la ferme en tentant de maintenir un minimum de rentabilité malgré un contexte économique difficile pour les agriculteurs. Plus rien n’était pareil, mais ils n’en parlaient pas. Avec son fils aussi, elle était économe de mots. Le temps filait au rythme des moissons, puis vint ce jour de janvier 2020, où Germaine Henri, 65 ans, devenue successivement Germaine Lahuit, Germaine Bardinet et enfin Germaine Lediaux, mourut d’une fausse route en avalant un morceau de pain perdu.
Jean Lediaux se retrouva à la tête d’une ferme inexploitable à lui tout seul, un découvert bancaire plutôt alarmant et des restrictions sur le prix du lait à faire rougir le pis des vaches. Il avait commencé par se séparer des animaux pour se consacrer exclusivement aux parcelles agricoles. Il travaillait comme un forcené, équilibrait minutieusement son budget en jonglant avec les dépenses et les entrées. Il chiffrait les économies possibles sur l’électricité, les engrais, l’eau. Il délaissa les machines à moteur au profit des machines mécaniques. Malheureusement, le prix du kilo de blé ne couvrait plus le prix de revient et il ne pouvait grappiller davantage sur le coût de production. La mort dans l’âme, il décida de vendre, il n’avait plus le choix. Quitter la ferme représentait une terrible souffrance, sa vie entière s’était inscrite dans les murs, mais s’il ne réagissait pas rapidement, on lui saisirait ses biens et il en retirerait une misère.
Il eut beaucoup de chance. Deux jeunes couples toulousains, écolos jusqu’au bout des ongles, tombèrent sous le charme du village de Millevaches et eurent un véritable coup de cœur pour la ferme des Lediaux. Ils rêvaient depuis longtemps de créer une exploitation biologique dans un écrin de verdure, au calme, loin des turpitudes citadines. L’endroit réunissait tous leurs critères. Ils proposèrent une somme beaucoup plus élevée que ne l’espérait Jean, la seule condition était qu’il parte au plus vite afin de pouvoir semer et obtenir une première récolte l’année même. Jean se pressa donc de vider les lieux. Il rassembla les quelques objets qui décoraient le salon, deux ou trois tableaux accrochés dans la cage d’escalier. Il proposa aux nouveaux propriétaires de garder une partie du mobilier. Il restait une seule pièce à vider. Il avait reporté la tâche de jour en jour, car pour lui, s’occuper des effets de sa mère représentait une sorte de violation. Mais le moment était venu de pousser la porte de la chambre de Germaine, ce cocon douillet où, gamin, il venait se réfugier les soirs d’orage. Assis sur le lit, le cœur comprimé par le chagrin, il hésitait à tout laisser en l’état. Sa conscience martelait le souvenir de cette femme si aimante, si présente. Elle avait su le remplir sans jamais rien demander en retour. Il avait reçu beaucoup, vraiment beaucoup. Et lui, qu’avait-il donné ? À cet instant précis, où les vêtements de sa mère suspendus à des cintres lui racontaient l’histoire de son enfance, il comprit que d’elle, il ne savait rien. Elle avait caché au fond de ses poches la petite fille qu’elle avait été et la femme qu’elle était devenue. Jean se retrouvait également orphelin d’un passé. Dans son esprit d’enfant comblé, les origines de sa mère remontaient au moment de son ventre arrondi, berceau où le petit Jean nageait dans l’eau douce de son amour. Auparavant, il n’y avait rien et ce rien aujourd’hui devenait une existence enfouie





























