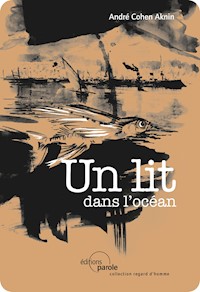
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Parole
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les femmes d’Afrique savent dénouer le temps, effacer les distances. Le narrateur est le fils de Juliette, une vieille femme juive d’Algérie atteinte par la maladie d’Alzheimer. Après des mois d’éloignement, il lui rend visite dans le sud de la France où elle vit. Il tente de la faire émerger du brouillard dans lequel elle est enlisée en évoquant sa vie de couturière à Oran, de rapatriée à Paris et, aussi, les plaisirs et les tragédies du passé. Il raconte ses voyages dont il ne lui a jamais rien dit. Juliette s’exprimait avec sa cuisine. Chacun de ses plats était une page sur laquelle s’inscrivaient une histoire, une tradition. Alors, il se met au fourneau. « L’important, ce sont les haricots », dit-il. La mère sort de son silence, émet des sons, des mots qui se délitent, parle une langue imaginaire. Le fils est pris par le rythme, la vibration. Des dialogues étranges surgissent. La musique arabo-andalouse l’entraîne dans un tourbillon, le ramène à l’Algérie, leur source commune. Ces retrouvailles le disloquent, le recomposent.
André Cohen Aknin nous offre un regard tendre et lumineux sur le pouvoir des sons, qu’ils soient mots ou musique, porteurs d’images bien vivantes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Cohen Aknin écrit d’abord du théâtre, puis passe au roman et au récit poétique où le texte se fait parole, chant et musique en même temps. Un rayon de lumière venu de l’enfance en Algérie éclaire ses paysages intérieurs tourmentés et imaginatifs. Il donne des lectures-récitals, travaille avec des musiciens, forme à la lecture à voix haute. Depuis mars 2020, il écrit et adresse des « lettres d’un colporteur-liseur » autour de la poésie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
◦◦◦
ISBN : . 978-2-37 586-11 3-4
© 2021, Éditions Parole
Groupe AlterMondo 83500 La Seyne-sur-Mer
Courriel : [email protected]
www.editionsparole.fr
Tous droits réservés pour tous pays
◦◦◦
André Cohen Aknin
Un lit dans l’océan
roman
Pour Juliette et Geneviève.J’entends chaque jourl’écho de leur terreet de leur langue.
ton cri ma mèreguerrier d’éternitédormant dans ma gorgeje bâtissais dans son oubliun jardin clairquand une épine de ma phrase a effleuré sa paupière…
Rabah Belamri
Corps seul
Il lui reste de son passé des consonances irrémédiables, des mots qu’elle paraît dérouler, très doux, des sortes de chants qui humectent l’intérieur de la voix, et qui font que les mots sortent de son corps sans qu’elle s’en aperçoive quelquefois, comme si elle était visitée par le souvenir d’une langue abandonnée.
Marguerite Duras
La pluie d’été
1
J’adore les haricots ! Les gros, les petits, les longs, les courts, les froids en salade, les chauds à l’ail ou sucrés à la manière des dorayakis1 japonais. J’aime surtout quand ils fondent dans la bouche après avoir mijoté toute une nuit. Il m’arrive de rêver de tafina2, une sorte de cassoulet à la mode algérienne qu’on servait le samedi midi, le jour de chabbat.
Je ne saurais dire quels haricots ma mère cuisinait. Ce que je sais, c’est qu’ils étaient blancs, légèrement veinés. Les frais, elle les achetait au marché rue de la Révolution, à Oran dans le quartier juif. Quand ce n’était pas la saison, elle les prenait secs chez Simon l’épicier, rue de Lutzen. Je l’accompagnais parfois. J’ai encore dans l’oreille le bruissement des haricots secs que l’on verse dans un sac en papier et le tintement des poids jetés sur la balance.
Le vendredi, au cours du petit-déjeuner composé principalement d’un bol de lait chaud et de tartines de miel, j’avais tout le loisir de contempler les ingrédients posés çà et là dans la cuisine, destinés aux repas du soir et du lendemain. La préparation commençait très tôt et quand, nous les enfants, nous nous levions, tout était déjà là. On y trouvait les haricots écossés la veille, le hachoir pour le pâté de viande, le boyau de bœuf roulé sur une petite assiette, des œufs, certains pour le pâté, les autres seraient cuits avec leur coquille dans la sauce. Il y avait aussi des herbes, principalement du persil et du kesbour, c’est-à-dire de la coriandre, de l’ail qu’on gardait en chemise et un morceau de bœuf pris dans l’épaule, car les juifs ne mangent aucun morceau de la cuisse en mémoire du combat relaté dans la Bible entre Dieu et Jacob. Des épices, la nora et le cumin exhalaient déjà leurs odeurs. Un pilon de cuivre trônait au milieu de la table ; il était le symbole de cette cuisine juive d’Algérie transmise de mère en fille ; il avait appartenu à la mère de ma mère qui avait été cuisinière. Ce pilon servait à écraser les épices, les herbes, le pain sec pour faire de la chapelure ; il pilait aussi les cerneaux de noix, les amandes, les pois chiches. Aujourd’hui, il est sur mon bureau et tient des livres.
Tous ces ingrédients seraient pour la tafina du samedi. Avant, il fallait préparer le repas du vendredi soir, l’entrée du chabbat, où l’on servait du poisson dans une sauce faite de tomates et de piment rouge. C’était la tradition à Oran, une ville qui puisait sa joie dans la mer et ses plages, dans le vol des Fous de Bassan au-dessus des dunes et dans la lumière des lamparos à la proue des barques de pêche. Maman ferait aussi le pain, un pain doré qui ressemblait à de la brioche. Un avant-goût de la douceur que l’on pensait trouver en ce jour de prière et de repos.
La tafina pouvait être aux pois chiches ou au blé. Celle de Pessah, la Pâque juive, à base de petits pois et de fèves, était servie avec des morceaux de galettes sans levain. Moi, je préférais celle aux haricots avec son pâté de viande de bœuf roulé dans un boyau qui ressemblait à une grosse saucisse. Il y avait aussi les boulettes. Surtout les boulettes ! Dodues et moelleuses, avec un goût prononcé de cumin et de poivre rouge. Y ajoutait-on du miel ? Une sensation de sucré m’envahissait, même quand je goûtais les œufs brunis par la cuisson. Ce plat portait les senteurs des femmes de la maison.
Comme traditionnellement les juifs ne cuisinent pas le samedi, la veille, ma mère portait la marmite chez le boulanger qui la cuirait après la dernière fournée. Il m’arrivait de l’accompagner. Notre marmite n’était pas la seule. Tout le quartier était représenté. On reconnaissait les familles aux marques sur les couvercles et aux torsions des fils de fer qui les tenaient. Les pains juifs dorés au jaune d’œuf donnaient leurs éclats au fournil.
Autant le dire tout de suite, je suis incapable de faire une tafina. Bien trop compliquée. Je suis du genre à cuisiner des œufs au plat ou en omelette, des pâtes, trop cuites au dire des connaisseurs, un steak, des salades. Des choses simples, en somme.
Je n’ai commencé à cuisiner que très tard. Quand j’étais gosse, on m’interdisait d’entrer dans la cuisine en dehors des repas, parce que j’étais un garçon. Néanmoins, j’ai gardé ces saveurs d’antan. C’est pourquoi je vais m’attaquer à une loubia, une soupe de haricots, une soupe de pauvre. J’ai aussi envie de fèves chaudes au cumin3 et de calientica4, un gratin à la farine de pois chiches que l’on pouvait acheter dans de petites gargotes.
Cette soupe a un parfum d’enfance au même titre que la tafina ; elle a l’avantage d’être plus facile à préparer. Alors pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Simplement parce que la tafina a quelque chose de noble, c’est le plat du chabbat. Alors qu’une soupe de pauvre !
J’ai déjà eu l’idée de cuisiner une loubia. Je me souviens avoir appelé maman, qui était encore vaillante, pour lui demander la recette. Sa première réaction fut embarrassée, elle ne voyait pas pourquoi je me mettais à la cuisine puisque j’avais une femme. Je vivais alors avec Marie, une écrivaine poète, amoureuse des mots et du désert. Son kif était de traverser l’Algérie jusqu’à Ghardaïa, de suivre les pistes de sable jusqu’à Tamanrasset, de photographier le Grand Erg oriental, de visiter l’Assekrem et de se laisser envahir par la lumière crue de midi ou par le gel de la nuit. Elle aimait côtoyer les hommes et les femmes de là-bas, les femmes surtout. Elle faisait chanter leurs mots dans ses bouquins. Marie était une amoureuse de l’Algérie. Et je n’y étais pour rien.
Ma mère avait fini par me concéder une recette approximative. « Tu vois, tu prends un peu de ci, un peu de ça, tu mélanges, tu ajoutes des épices, tu mets sur le feu et puis c’est tout. » Je ne voyais rien, nous conversions au téléphone !
Aujourd’hui, elle va sur ses quatre-vingt-dix ans et vit quasiment cloîtrée à Cannes, dans un appartement avec vue sur la mer. Je viens d’y passer quelques jours.
Ma mère ne peut plus m’héberger. La seule chambre disponible est utilisée par la jeune femme qui s’occupe d’elle. Je prends une chambre dans un petit hôtel, rue Hoche. Nous sommes alors fin avril, à une quinzaine de jours du Festival du film, on sent la ville dans une respiration, prête à bondir. Des affiches de cinéma et des photos démesurées habillent des façades, les hôtels dévoilent leurs atours et sur les terrasses de cafés, les gens se parlent plus que d’habitude. La foule des curieux viendra bientôt envahir la Croisette et les abords du festival, tandis que les artistes apparaîtront avec leurs cortèges d’assistants, leurs meutes de journalistes et l’exubérance des soirs de projection.
Je connais cette ville. J’y ai habité des années. J’étais menuisier. Un métier appris chez un artisan où il n’y avait qu’une unique machine, une scie circulaire. Cela voulait dire que nous, les ouvriers, devions débiter les bois, les tracer avant de les porter à un machiniste. Il nous arrivait de devoir façonner nous-mêmes les moulures à la main, de scier les tenons et de creuser les mortaises au bédane. Je suis, disons, de la vieille école. Un métier que je n’exerce plus, mais dont je me souviens toujours avec bonheur. Depuis, j’ai fait pas mal d’autres boulots.
J’écris aussi. J’ai besoin d’écrire. La proximité du plateau et des comédiens me jette dans l’action. Les mots deviennent corps, sang et sueur. Les voix résonnent avec leurs tessitures, leurs couleurs.
Juan Antonio, un ami comédien, avait été pressenti pour jouer dans La Vie de Galilée de Bertolt Brecht. Il m’avait présenté au metteur en scène qui m’avait pris comme assistant. Un assistant un peu particulier. J’avais pour mission d’être là chaque jour, d’écouter, de prendre des notes, d’être « l’autre regard ». Je naviguerais en passager clandestin. Ce qui m’allait comme un gant. La création du Brecht a duré deux mois d’hiver.
J’en ai écrit une chronique. Maurice, qui jouait le rôle de Galilée, l’a appréciée ; il cite dans une lettre ma « forêt des pluriels » qui remet en question l’ego des comédiens. C’est le fondu des personnages qui donne réalité et émotion.
Fin mars, la pièce commençait à tourner. Je pouvais prendre du temps pour moi. Avant tout autre projet, j’ai décidé d’aller voir ma mère. La dernière fois remontait à loin. J’ai prévenu mon frère aîné au téléphone, il m’a assailli de recommandations : il ne faut pas faire trop de bruit, lui donner de la banane et des bouts de biscuits, elle adore ça. Il est en voyage, il reviendra rapidement. À aucun moment, il n’a pris de mes nouvelles. C’est sa façon d’être. Quand je lui ai demandé comment elle allait, il ne m’a rien dit. Tu verras, a-t-il conclu.
Chez elle, à Cannes.
Devant l’immeuble où habite ma mère, j’ai subitement chaud. Ce n’est pas la chaleur du mois d’avril, mais l’appréhension de la revoir. La dernière fois, ça ne s’est pas bien passé. Elle a voulu me gifler et a même souhaité ma mort. J’attends que mon souffle se calme, puis je sonne.
On m’ouvre la porte du hall d’entrée. Près de l’ascenseur, le local poubelles transpire une odeur de javel qui, heureusement, disparaît à mesure que je monte. J’ai mis une eau de toilette, « Pour un homme » de Caron, celle-là même que mettait mon père. Va-t-elle la reconnaître ? Au cinquième, j’entre dans l’ombre du palier. On a entrouvert la porte.
Sandra, la jeune femme qui s’occupe d’elle me conduit jusqu’au salon. Ma mère est calée, le dos droit comme un i, entre le bahut vitré et le sofa. À peine la place pour une chaise. Ses doigts décrivent des arabesques que son regard traverse. Est-ce un langage, l’évocation d’un souvenir ? Des photos jaunies sont accrochées au mur. Ce sont celles de ses petites-filles. Face à elle, la télé est allumée. On annonce un feuilleton. Les après-midi télé, on connaît dans la famille. Déjà à Oran, dans notre dernier appartement, rue du Capitaine Enkaoua, les femmes se réunissaient, belles-sœurs, tantes, cousines, amies, voisines pour voir un film égyptien avec ses éternelles chansons langoureuses que toutes reprenaient en chœur, surtout celles d’Oum Kalsoum. Il y avait même mon arrière-grand-mère Khalifa. C’était un temps où les femmes riaient, un temps de soleil, d’insouciance et de pâtisseries au miel.
La nuque contre le mur, ma mère ne se lève pas pour m’accueillir, pour saluer l’enfant prodigue. Mon regard s’attarde sur ses habits défraîchis. Je ne reconnais pas ses vêtements. Je m’avance doucement, pose un baiser sur son front. Ses mains se sont arrêtées. Je m’éloigne. Visiblement, elle ne sait pas qui je suis. Nous restons tous deux figés. Ma mère semble en transit. Je me doutais que sa santé s’était dégradée, mais à ce point ! Oh, je ne m’attendais pas à ce qu’elle me saute au cou ou qu’elle entonne un youyou, non, j’espérais un simple geste qui me fasse comprendre que je suis toujours son fils. Peut-on se prémunir contre les déceptions ? J’ai comme principe de rester sur ma réserve, de ne rien attendre d’exceptionnel de l’autre, afin de jouir pleinement de l’inattendu. Mais que ma mère ne me reconnaisse pas !
Sandra passe de la cuisine au salon où nous nous tenons. Elle ne m’est d’aucune aide. Au contraire, son regard m’interpelle : « Vous vous attendiez à quoi, à ce que votre mère coure comme un lapin ? » Ce n’est pas la première fois que je dois affronter son regard mi-moqueur mi-accusateur. Le reproche n’est pas direct, elle procède par sous-entendus, en particulier lorsqu’elle évoque son propre pays. Là-bas, les enfants s’occupent de leurs parents jusqu’au bout. Un pays de rêve à l’entendre. Pourquoi alors est-elle venue s’installer en France ? Elle a changé son prénom ; elle s’appelait Sanka, Dandra, Tanka ou quelque chose d’approchant.
En vérité, ses allusions sont d’une cruelle lucidité. « Ne pouvez-vous pas vous occuper de votre mère vous-même ? » Elle s’adresse à moi, pas à mon frère. Lui au moins s’occupe de maman, même s’il ne le fait pas directement, il paie pour ça.
Je suis à peine assis sur le sofa que la jeune femme m’annonce qu’elle sort, elle reviendra dans une heure. Elle ne m’en dit pas plus. J’aurais voulu avoir une ou deux consignes. La porte refermée, je me tourne vers ma mère qui ne réagit pas au départ de Sandra. Un détail me saute aux yeux, ses cheveux sont coupés court. C’est la première fois que je la vois coiffée ainsi. Impossible de repérer son ancienne mèche de cheveux blancs sur la nuque, elle est maintenant noyée parmi d’autres mèches. Il faut imaginer maman jeune, la chevelure ondulée, presque noire, d’où émergeait une mèche blanche, comme une coquetterie. Il me semblait qu’il y avait là un secret.
« Maman, c’est moi. »
Je suis le clignement de ses yeux. Qu’exprime-t-elle ? Le plaisir de me voir ? De l’agacement ? Au ronron de la télé se mêlent des bruits de la rue, quelques klaxons et des cris de mouettes à travers la vitre.
Avec sa chaise, son sofa, sa table, sa vieille machine à coudre Singer et son lit en métal, le salon s’est transformé en chambre à coucher et salle de soins. À Oran déjà, l’appartement du quartier juif était si exigu que le salon servait aussi de salle à manger, de chambre à coucher et surtout d’atelier couture. Des transformations comme on change un décor.
J’enlève mes chaussures. Un geste d’enfance. Je me revois avec mes frères assis sur un canapé, l’un avec un journal, l’autre avec un illustré et les autres, le regard vers la télé. Ce qui nous rassurait, c’était d’entendre les bruits dans la cuisine, maman et sa sœur s’activant sans relâche, l’une au ménage, l’autre à la vaisselle. Le temps s’écoulait dans une espèce de liquide amniotique. Nous renaissions en plein après-midi. Ce qui, pour l’heure, n’est absolument pas le cas. J’ai plutôt le sentiment de m’enfoncer devant cette mère qui ne dit mot. Pas la moindre syllabe. Si, au moins, elle proférait un son, je pourrais essayer de la comprendre. Mes yeux vont de l’écran à cette vieille dame impassible. C’est quoi cette odeur ? De la pisse ! Elle doit avoir une couche. Cet abandon du corps, ces exhalaisons au fond naturelles me désorientent. J’ai l’impression que l’odeur vient de partout, même de moi. Il me faudrait un remontant : un cognac ou une douche froide. Je n’ai que cette foutue télé.
Le temps s’étire, angoissant, devant cette mère méconnaissable. Cette femme fragile et muette, est-ce bien ma mère ? Elle parlait tellement avant, avec parfois quelques sarcasmes, ce qui donnait du piment à nos soirées. Ces dernières années, c’était surtout avec sa sœur aînée qu’elle échangeait. Sa sœur est morte à présent. Cela explique-t-il son silence, son apathie ? Je me demande si je ne préférais pas quand elle était violente. Si la maladie d’Alzheimer est une forme de démence, elle n’explique pas tout.
Ah ! J’entends la porte. C’est Sandra. Son entrée recompose l’espace. Elle lance : « Madame Juliette, c’est moi, Sandra ! »
Elle se dirige directement vers ma mère dont elle essuie la bouche avec un mouchoir en papier. Zut, je n’avais pas remarqué la goutte sur son menton. Sandra examine mes chaussures abandonnées au milieu de la pièce. Elle demande si je lui ai donné à boire. Non ? Tout est pourtant sur la table.
Je suis pris au dépourvu, incapable de répartie. La jeune femme va dans sa chambre au fond de l’appartement.
Le temps se suspend. Je prends un mouchoir en papier, au cas où elle baverait de nouveau. Pourquoi ne réagit-elle pas ? On ne peut pas avoir autant changé en si peu de temps. Je dois trouver le moyen de lui parler, sinon à quoi bon venir ?
Que la jeune femme appelle ma mère Juliette m’irrite au plus haut point. Il y a quelque chose de familier et de distant dans son comportement. Je suis contrarié, même si, en réalité, son attitude de garde-malade est sûrement celle qui convient.
J’ouvre la baie vitrée. Des mouettes virevoltent, dansent avec la mer. Je m’accoude à la rambarde et observe leur ballet. J’ai envie de les rejoindre. Calme-toi, me dis-je, ce n’est pas étonnant que ta mère ne te parle pas, tu viens si rarement. L’idée me traverse qu’elle boude, qu’elle fait semblant de m’avoir oublié, histoire de me rendre la monnaie de ma pièce. Un jour, elle m’avait attendu plus d’une heure à la gare. J’avais eu un contretemps et je n’avais pas eu le moyen de la joindre. Elle avait cru que je l’avais oubliée. Elle me l’a ensuite souvent reproché.





























