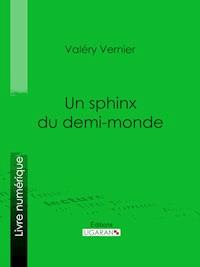
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Par une belle matinée de mai, une jeune fille sortait d'un magasin de lingerie de la rue de Tournon et se dirigeait vers le Luxembourg. Elle était mise proprement, avec la plus grande simplicité. On devinait à ses vêtements qu'elle était pauvre mais rangée, humble mais courageuse. Sa démarche, quelques détails de sa toilette, disaient que ce n'était pas une ouvrière des villes, mais une paysanne."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTICE PAR ANDRÉ THEURIET
Presque toujours, les œuvres littéraires, et surtout les œuvres d’imagination, ont un goût de terroir qui trahit le pays natal de l’auteur. Parfois, cependant, cette règle générale reçoit de singuliers démentis, et les critiques sont exposés à diagnostiquer à faux. Ainsi, par exemple, quand on lit ce passage de l’un des principaux poèmes de Valery Vernier :
on croirait volontiers que l’auteur est né dans cette gaie et plantureuse vallée de la Loire, dont les châteaux, les vergers et le ciel clément sont si bien en harmonie avec sa poésie pleine de grâce et de naturel. Point : il est né à Lille, et a fait ses études dans un collège de la Flandre, « sous ce ciel de fumée », dont parle Brizeux, – qui y avait aussi terminé les siennes, – et où l’air de la campagne
Au sortir du collège, il a fait tout prosaïquement son droit à Paris et son stage d’avocat à Douai, et c’est en feuilletant les Pandectes pour préparer sa thèse de docteur qu’il a écrit les premières pages d’Aline. En 1856, quand le poème fut achevé, Valery Vernier le déposa bravement dans les bureaux de la Revue des Deux-Mondes, et s’en alla faire un voyage en Suisse. À son retour, il fut très étonné d’apprendre que la Revue n’avait pas dédaigné ses vers, et, en effet, quatre fragments d’Aline parurent dans le numéro du 1er janvier 1857. Soit dit en passant, ceci prouve qu’il y a bien à rabattre sur les prétendues habitudes inhospitalières qu’on a tant de fois reprochées au directeur de ce recueil. La Revue des Deux-Mondes était peut-être, au contraire, la seule revue où l’on examinât avec attention les manuscrits signés d’un nom inconnu, et où ils eussent chance d’être imprimés. Pareille aventure est arrivée, vers la même époque, à un poète de ma connaissance qui avait jeté tout simplement son poème dans la boîte de la Revue de la rue Saint-Benoit. On lut ses vers et on les publia. Je crois que, parmi les journaux, petits ou grands, qui ont le plus crié contre le despotisme farouche de F. Buloz, bien peu alors se fussent montrés aussi hospitaliers envers un poète débutant.
Pour en revenir à Aline, le poème parut quelques mois après en volume, chez Dentu. Il fut accueilli par tous ceux qui aiment les bons vers avec une sympathie que l’œuvre méritait et qu’elle a toujours rencontrée depuis. Ce poème est un essai de roman en vers, un genre que les Allemands et les Anglais ont cultivé avec succès et que nous avons trop complètement négligé. À la Louise, de Voss, à Hermann et Dorothée, de Gœthe, à Aurora Leigh, de MM. Browning, et à Enoch Arden, de Tennyson, nous n’avons guère à opposer que Jocelyn ; encore, dans le poème de Lamartine, la partie lyrique est tellement développée qu’elle étouffe presque la partie purement familière. Et, pourtant, c’est dans le poème narratif que nos qualités françaises : l’observation, le naturel, l’esprit et le mouvement, auraient pu largement se donner carrière. Nos vieux poètes du XIIe et du XIIIe siècles y ont excellé, et on se demande pourquoi nous n’avons pas su cultiver un champ si bien préparé par nos devanciers. Depuis vingt ans surtout, nos jeunes poètes semblent avoir peur des longs ouvrages ; ils s’exercent de préférence aux sonnets, aux petits tableaux ; est-ce paresse de leur part, ou sentent-ils qu’ils ont l’haleine trop courte ? Un seul, François Coppée, a fait dernièrement, avec succès, une tentative de ce côté. Son poème d’Olivier renferme des morceaux remarquables, et, par une curieuse coïncidence, le sujet qu’il a traité a plus d’un point de ressemblance avec la donnée d’Aline.
Cette donnée, du reste, est fort simple et elle a été déjà exploitée en prose. Les romanciers de l’école de 1830 semblaient surtout avoir pour elle une prédilection marquée.
Albert, le héros de Vernier, est un jeune enthousiaste, un peu poète et byronien, comme on l’était en plein romantisme ; dans une partie de campagne, il s’aperçoit, de même que l’Octave de la Confession d’un enfant du siècle, que sa maîtresse le trahit avec un de ses amis. Cette découverte l’accable ; désespéré, dégoûté de Paris et de la vie, il tombe dangereusement malade. Il est recueilli et sauvé par un honnête médecin de campagne, le père d’Aline, et il retrouve dans la maison de son docteur à la fois la santé du corps et le calme de l’esprit. Naturellement, il devient amoureux d’Aline, qui l’aime à son tour, et tout serait pour le mieux si, tout à coup, – un peu trop brusquement même, à mon avis, – l’humeur byronienne d’Albert ne reprenait le dessus. À la vue d’une inconnue, moitié grande dame, moitié bas-bleu, avec laquelle il a échangé deux mots à peine, il perd la tête. Il trouve l’intérieur du médecin trop bourgeois, l’amour d’Aline trop prosaïque, et s’enfuit dans le château de son inconnue. Celle-ci, qui a eu elle-même une jeunesse agitée, est lasse des orages de la passion et n’aspire plus qu’au repos. Elle le fait comprendre maternellement à Albert, et, après l’avoir doctement catéchisé, elle le renvoie chez Aline. Mais il est trop tard ; quand Albert rentre au logis du docteur, il se heurte sur le seuil avec la noce de la jeune fille, qui s’est fatiguée d’attendre et qui vient d’épouser un amoureux à l’esprit plus rassis.
Valery Vernier a traité ce sujet avec beaucoup d’esprit, de délicatesse et de fraîcheur. À chaque instant, dans son poème, on a la bonne fortune de rencontrer des morceaux d’une grâce charmante, comme celui-ci, sur la musique de Mozart :
La langue du poète est souple, naturelle, bien française ; elle sait être familière, tout en restant poétique, comme dans cette courte description du logis du docteur :
Le seul reproche qu’on pourrait adresser à Valery Vernier, c’est que, parfois, ses rimes ne sont pas assez riches. L’école parnassienne est arrivée, au point de vue de la versification, à une perfection si merveilleuse, que nous ne pouvons plus maintenant nous contenter de vers rimant par assonance. La vieille liberté, « par Voltaire laissée », avait, avouons-le, tellement appauvri le sang de notre vers français, qu’il en était devenu anémique, sans solidité, sans couleur et sans voix. Vernier, qui aime les beaux vers, doit le sentir mieux que personne, et je suis convaincu qu’il négligerait moins ses rimes s’il avait aujourd’hui à écrire Aline.
Depuis l’époque où il a publié Aline et les Filles de Minuit, l’auteur n’a pas dit adieu à la poésie ; mais, semblable à l’oiseau divin d’Horace qui s’élance vers l’azur,
il a pris son essor en pleine fantaisie dans une œuvre curieuse, spirituelle et hardie, intitulée l’Étrange voyage. Utilisant les riches découvertes des astronomes contemporains, il a rajeuni une fiction chère à Lucien de Samosate et à Cyrano de Bergerac et a emmené ses lecteurs dans les planètes du tourbillon solaire.
Son nouveau poème, qu’on pourrait aussi bien appeler la Céleste comédie, nous montre le poète ayant pour guide Gérard de Nerval, comme Dante avait pour compagnon Virgile, et visitant tour à tour la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, il dépeint les splendeurs, les étrangetés, les effrois du monde planétaire, avec une imagination charmante, une verve tantôt malicieuse et tantôt sentimentale, qui donnent à son livre un accent très personnel et un intérêt des plus vifs. Si quelque lecteur, de « ceux qui ont le goût difficile », lui reproche ses hypothèses audacieuses et ses amusantes inventions, il pourra répondre aux critiques ce que dit Lucien au début de l’Histoire véritable : « Je ne trouve point la chose étrange de la part d’un poète accoutumé à dire des fables, puisque nous voyons tous les jours les philosophes en user de même… Il m’a pris envie, pour n’être pas le seul au monde qui n’ait pas la liberté de mentir, de composer quelque roman à leur exemple ; mais je veux, en l’avouant, me montrer plus juste qu’eux, et cet aveu me servira de justification. »
Non seulement Valery Vernier est un poète, mais il sait comprendre les poètes étrangers, et il les fait admirer aux autres. Nous lui devons une traduction des poésies de Léopardi, très fidèle et fort appréciée des lettrés. De plus, le poète est doublé d’un romancier. Je n’ai pas le loisir d’analyser ici le roman de Philo fils, si plein de sentiment et de fantaisie. Je voudrais du moins, avant de terminer, dire un mot de Gréta, publié, vers 1863, chez Amyot. Ce roman, qui avait vivement frappé Jules Janin, fit le sujet d’un de ses plus pimpants feuilletons. On pourrait citer cette œuvre comme un des types du roman romanesque. Il est difficile d’y être plus spirituellement invraisemblable. Aujourd’hui, peut-être, exigerait-on de l’auteur qu’il serrât la réalité d’un peu plus près ; mais on n’en lit pas moins avec plaisir ce livre finement écrit, où se trouvent souvent des détails délicieux, comme celui-ci :
« Ce petit cloître était d’un aspect antique et charmant dans son abandon solitaire. Le côté des arcades était dans l’ombre, le côté de l’église et du bas de la tour était brûlé par le soleil. Au milieu se trouvait une petite pelouse ovale, dont l’herbe, d’un vert pâle, était émaillée de soucis et de marguerites, et, au milieu de cette pelouse, un rosier dont les maigres rameaux portaient en tout trois roses blanches. Deux de ces roses étaient jaunies et presque effeuillées ; la troisième, nouvellement éclose, ouverte du matin sans doute, tentait les doigts par la pureté de son éclat virginal. »
Quel joli tableau, et comme il donne bien en raccourci une idée de l’esprit et du talent de celui qui l’a peint ! De la simplicité, du naturel, une émotion délicate unie à une fine gaieté, avec une pointe de romanesque qui ne gâte rien, voilà comme nous apparaît Vernier dans la nouvelle édition de ses poèmes. La poésie de Valery Vernier, avec sa grâce légère et discrète, me fait penser à certains tableaux de l’école française du XVIIIe siècle, où, sur un fond de paysage un peu fantaisiste, de jeunes dames en robes à ramages et de jeunes galants en habits de satin, devisent tendrement. La lumière est gaie, transparente, d’un gris argenté ; elle éclaire doucement des figures éveillées et spirituelles, dont les lèvres sourient et dont les beaux yeux sont noyés d’une langueur mélancolique.
ANDRÉ THEURIET.
Par une belle matinée de mai, une jeune fille sortait d’un magasin de lingerie de la rue de Tournon et se dirigeait vers le Luxembourg.
Elle était mise proprement, avec la plus grande simplicité. On devinait à ses vêtements qu’elle était pauvre mais rangée, humble mais courageuse. Sa démarche, quelques détails de sa toilette, disaient que ce n’était pas une ouvrière des villes, mais une paysanne.
Elle était à Paris depuis un mois à peine, et en ce moment elle retournait vers sa chambrette, après avoir reporté de l’ouvrage fini.
Elle s’appelait Suzanne Duchamp, et était orpheline. Elle ne connaissait en tout à Paris que deux personnes : une femme de son village, qui était établie fruitière dans le Marais, et un jeune homme, lithographe de son état, qu’elle avait rencontré près de la maison où demeurait cette femme.
Ce jeune homme, dont le prénom était Ludovic, s’était pris à première vue d’un grand amour pour elle, et le lui avait ensuite déclaré honnêtement. Elle ne s’en était pas offensée, ayant appris que c’était un garçon d’une excellente conduite et d’une honnêteté irréprochable.
Cependant quelques propos de la marchande, renfermant de mauvais conseils, l’avaient alarmée. Elle avait pris peur d’elle-même, de sa faiblesse, et elle avait quitté le Marais, désolée de se voir contrainte à fuir Ludovic pour échapper à l’ascendant pernicieux que sa compatriote prétendait prendre sur elle.
S’il y a un dieu pour les ivrognes, il en est un certainement pour les amoureux.
Ludovic, conduit par ce dieu protecteur, n’avait pas tardé à retrouver Suzanne, un dimanche, après-midi, dans les parages de l’Odéon.
Il avait si bien plaidé sa cause, que l’honnête fille lui avait permis de monter dans sa chambrette de la rue de l’Ouest, après lui avoir fait prendre l’engagement solennel de ne plus lui parler de son amour avant qu’elle eût fixé le jour où ils iraient prier le maire de l’arrondissement de vouloir bien entendre l’affirmation de leur mutuel consentement.
Ludovic, qui aimait et respectait Suzanne de toute son âme, avait promis avec autant de joie que de solennité d’observer ce pacte. Il venait, chaque jeudi et chaque dimanche, passer une heure rue de l’Ouest, à un quatrième étage, à regarder sa future femme faire de la passementerie en se piquant les doigts à plaisir, tant elle était distraite.
Ce jour étant un lundi de fête, le jeune homme, qui était venu la veille, devait encore ce jour-là honorer Suzanne de sa visite. Aussi l’eussiez-vous vue, au sortir du magasin, marcher vite et se souriant à elle-même, sur le trottoir de droite de la rue de Tournon.
Elle était à mille lieues de songer à une rencontre qui allait pourtant influer d’une manière extraordinaire sur sa vie pendant quelques mois.
Suzanne entra dans le jardin par la grille qui s’ouvre dans la rue de Vaugirard, en face la rue Servandoni. Elle pénétra dans l’allée longeant le Petit-Luxembourg ; puis, tournant à gauche, elle se trouva devant la grande pelouse qui occupe presque toute cette partie du jardin, et à l’extrémité de laquelle s’élève une maison de garde.
Elle s’assit sur un banc pour jouir de la vue des grandes corbeilles de géraniums, qui étaient dans tout leur éclat. Elle s’amusait à voir tomber sur le gazon, d’un vert d’émeraude, la pluie fine des tuyaux d’arrosage d’où jaillissaient par intervalles quelques gouttes plus larges qui brillaient au soleil comme des perles.
Elle riait en elle-même du ramage insensé des oiseaux, vraiment fous de joie, dans les feuillages des aubépins et des faux ébéniers. Chaque cri parti de ces petits gosiers sonores perçait son cœur délicieusement. Elle aurait voulu les prendre tous dans sa robe d’un seul coup et les couvrir de baisers, ces petits enragés chanteurs.
Tout à coup elle s’aperçut qu’un vieillard de haute stature s’était arrêté devant elle, et la contemplait avec une surprise attendrie qui bouleversait tellement les traits de cet homme qu’elle eut peur de lui et le crut fou.
Le vieillard fit quelques pas à droite, puis à gauche, et revint se placer devant Suzanne. Il vit qu’il la troublait au point qu’elle pâlissait et tremblait. Alors il s’assit près d’elle sur le banc et lui dit :
– Pardonnez-moi, mademoiselle, et permettez-moi de vous demander si vous êtes née à Paris ; quel est votre âge, votre nom ; si vos parents vivent encore ; si vous vous trouvez heureuse, à l’abri du moins de la misère, si dure à supporter à votre âge. Daignerez-vous répondre à tant de demandes indiscrètes ?
Suzanne était une âme naïve et n’avait aucune idée de ce que pouvaient cacher de dangereux les propos, doucement protecteurs, d’un vieillard élégamment vêtu et dont l’œil brillait d’une certaine flamme sous un sourcil blanc comme neige.
Elle répondit simplement, et sans entrer dans de longs détails, qu’elle était la fille d’un vigneron habitant un village près d’Auxerre ; que ses parents étaient morts ; qu’elle avait quitté le pays parce qu’elle était détestée et maltraitée d’une vieille tante, sa seule parente, auprès de laquelle vivait sa jeune sœur Mariette. Elle avait bien quelques cousins qui devaient, après la mort de la tante, reprendre l’auberge. Mais ces gens-là ne l’aimaient pas du tout non plus et la regardaient comme une étrangère.
Elle dit son âge et son nom avec autant de simplicité que s’il eût été question d’une autre. Sa voix s’émut quand elle parla de sa sœur Mariette.
Le vieillard la regardait plus qu’il ne l’écoutait. Il semblait à la fois heureux et triste en la contemplant.
Un étonnement dont il ne pouvait revenir se peignait aussi sur ses traits. Il se répétait sans cesse à lui-même : C’est extraordinaire ! c’est extraordinaire !
– Pourquoi me regardez-vous ainsi ? demanda Suzanne.
– Auriez-vous la bonté, dit le vieillard, de m’accompagner jusque chez moi ? C’est à deux pas. Je suis sûr que, à peine entrée dans mon appartement, vous comprendrez pourquoi je vous regarde ainsi, et vous me pardonnerez mon indiscrétion. C’est une prière que je vous fais. Consentez à monter chez moi.
Suzanne se serait reproché éternellement d’avoir repoussé la prière d’un homme à cheveux blancs. Elle se leva du banc en même temps que l’inconnu et sortit avec lui du jardin du Luxembourg.
Ils furent bientôt arrivés au domicile du vieux monsieur, qui demeurait rue Madame.
Ils gravirent deux étages. L’inconnu tira une clef de sa poche, ouvrit une porte, et Suzanne se trouva dans un grand atelier de peinture tout encombré de tableaux, de chevalets, de grands bahuts, de meubles de forme antique, sur lesquels étaient jetées çà et là des pièces d’étoffes aux couleurs éclatantes, brochées, satinées, à ramages, ornées de broderies d’un dessin bizarre.
Le vieillard alla vers le fond de l’atelier, prit à deux mains un cadre tourné contre la muraille, le porta avec effort sur un chevalet, mit le tableau dans son jour, et, muet, immobile, se mit à contempler alternativement Suzanne et le tableau, qui était un portrait.
Suzanne, ayant regardé la toile, poussa un petit cri de surprise. Elle crut qu’elle venait de se regarder dans une glace, tant le portrait lui ressemblait.
– C’était ma fille, dit le vieux peintre. Je l’ai perdue. Je n’aimais qu’elle au monde. Je suis seul maintenant avec mon chagrin. Comprenez-vous, à présent ?
– Oui, monsieur, répondit Suzanne toute bouleversée en voyant l’inconnu, qui s’était laissé tomber dans un fauteuil, pleurer de grosses larmes. Elle n’aurait pas cru que des pleurs si abondants pussent tomber des yeux d’un vieillard.
Un mois après cette rencontre, c’est-à-dire par une matinée de la fin de juin, nous retrouvons Suzanne dans un appartement du second étage d’une maison neuve de la rue de Ponthieu.
Que s’était-il passé ? Le voici.
Le vieux peintre, qui se nommait Hardestaime et qui était riche, par parenthèse, non du produit de ses œuvres, mais de patrimoine, avait tant supplié Suzanne de le laisser pourvoir à tous ses besoins, ne lui demandant en retour que la permission de la venir voir tous les jours de trois à cinq heures de l’après-midi ; il avait tant pleuré devant elle, tant promis qu’il ne s’arrogerait aucun droit sur sa destinée, qu’il ne contrarierait aucunement les honnêtes inclinations qu’elle pourrait avoir, que notre paysanne avait fini par accepter les dons du vieillard et la petite pension qu’il lui servait.
De graves et honnêtes motifs l’avaient décidée.
Un médecin, amené par M. Hardestaime, lui avait affirmé qu’en se prêtant à l’illusion qui faisait qu’en la voyant le vieillard croyait revoir sa fille, elle contribuerait à le guérir d’une maladie noire qui le consumait lentement.
Ensuite, pendant que Suzanne restait encore en suspens, une lettre de Mariette était venue.
Cette lettre n’était pas gaie. La vieille tante maltraitait maintenant Mariette et la laissait manquer de tout. Si Mariette, qui avait seize ans (Suzanne en avait dix-huit) pouvait trouver un brave garçon qui lui offrît de l’épouser, elle conquerrait son indépendance en travaillant avec son mari. Mais le moyen, quand on est sans un sou ?
Suzanne, en lisant ce passage, avait pleuré ; puis, jetant les yeux sur son ouvrage de passementerie, elle s’était écriée résolument :
– Acceptons les offres du vieux monsieur ! Je n’aurai plus ainsi à m’occuper de trouver mon pain et mon loyer : ce que je gagnerai avec ma passementerie sera pour Mariette. Et qui sait ? je finirai peut-être par lui amasser une dot avec mon travail.
Il avait été convenu entre elle et M. Hardestaime qu’elle passerait pour sa filleule. L’innocent mensonge eut un plein succès ; les concierges de la maison de la rue de l’Ouest, qui estimaient grandement Suzanne, pleurèrent presque de joie en apprenant qu’elle avait retrouvé un parrain ; un homme si riche !
Ludovic avait été mis au courant de tout. Il avait d’abord fait mine de froncer le sourcil et d’avoir des velléités de soupçon ; mais un seul regard de Suzanne l’avait rappelé à l’ordre et l’avait forcé à lui demander pardon à genoux de sa vilaine supposition qu’elle avait fort bien devinée.
M. Hardestaime aurait pu obtenir de Suzanne qu’elle vînt le voir chaque jour à son atelier. Mais il préférait la surprendre dans son intérieur, à son travail, qu’il était bien loin de lui faire abandonner. Il aimait aussi à la voir s’occuper des soins de son petit ménage. En vêtements de chez soi, sans chapeau, Suzanne ressemblait encore plus à sa fille.
C’était en silence, la tête penchée, les yeux attentifs, qu’il la regardait aller et venir, coudre, broder, ranger les sièges, mettre le couvert. Il n’osait faire un geste, pousser un soupir de peur de faire envoler la consolante illusion.
Suzanne avait fini par ne plus s’apercevoir presque de sa présence ; et quand il lui disait tout à coup : Ma filleule ! ou quelquefois : Ma fille ! ils s’entre-regardaient avec surprise et croyaient l’un et l’autre être dans un rêve.
Le médecin, ami de M. Hardestaime, avait un jour déclaré que monter chaque jour quatre étages était une grande fatigue pour un vieillard. Depuis longtemps, d’ailleurs, il engageait son malade à changer de quartier, à aller habiter les alentours des Champs-Élysées ou le voisinage du Bois. L’animation, la gaieté d’un quartier aristocratique, influeraient avantageusement sur sa santé.
On s’informa. On découvrit l’appartement de la rue de Ponthieu, qui devait convenir parfaitement à Suzanne, en même temps que l’on trouvait, rue de Balzac, un entresol donnant sur une cour avec jardin, lequel semblait attendre avec impatience que M. Hardestaime vint s’y installer.
On eut vite fait de céder à un jeune peintre l’atelier de la rue Madame. Les bahuts, les armes, les chevalets, les mannequins, les tableaux de M. Hardestaime, à l’exception des portraits de sa fille, furent vendus. Enfin, dans les derniers jours de juin, le vieux peintre prenait possession de l’entresol de la rue de Balzac, pendant que Suzanne s’installait à son deuxième étage de la rue de Ponthieu.
Deux choses troublaient le vieux peintre dans la jouissance de sa paternelle illusion. La première, c’était que Suzanne (qui avait d’ailleurs le même son de voix que sa fille) ne parlait pas sa langue, étant du village, aussi purement que la chère défunte. La seconde, c’était quand il voyait Suzanne occupée à ourler quelque grossier linge de cuisine. L’illusion s’évanouissait alors naturellement, cette besogne n’étant pas de celles auxquelles s’adonnait son enfant.
Cela fut cause que bientôt il y eut dans l’intérieur de Suzanne, outre la bonne, deux femmes : une lingère et une maîtresse de français dont il convient de dire deux mots avant d’entrer dans le vif du récit.
Mlle Plock, la lingère, était un de ces oiseaux voyageurs qui visitent successivement tous les climats, selon les hasards d’une domesticité vagabonde ou selon les fantaisies, les rêves d’une ambition jamais satisfaite.
C’était une grande fille maigre, blondasse, au nez pointu, au corsage privé de tout indice féminin ; la voix rogue, l’air patelin, le regard sournoisement vindicatif ; elle était vêtue avec austérité d’une éternelle robe de mérinos noir dont ses coudes pointus perçaient les manches. Elle affichait la prétention d’être modeste et résignée, quand elle n’était que prude et grincheuse, de même qu’elle prétendait au titre de gouvernante, quand elle était simplement raccommodeuse et incapable d’être autre chose.
Sa pose était d’aspirer à être gouvernante dans une riche et nombreuse famille anglaise, aux mœurs sévères et aristocratiques. N’ayant pu atteindre à ce poste, selon elle éminemment honorable, elle se regardait comme exilée dans les fonctions qu’elle exerçait.
Elle avait de fréquentes altercations, au sujet des mœurs, avec le nommé Saturnin, portier de la maison de la rue de Ponthieu.
Ce Saturnin était veuf, légèrement ivrogne, très avide de toutes sortes de voluptés qui, vu sa laideur et sa position infime, échappaient à ses désirs comme l’eau aux lèvres de Tantale.
La maîtresse de français, ou plutôt d’orthographe, se faisait appeler Mme Fiammati, sans qu’on sût trop ce qu’il y avait d’authentique dans ce nom à désinence italienne. C’était une petite femme grasse, ronde, aux yeux noirs, le nez retroussé, le front bas, les lèvres sensuelles, le teint légèrement couperosé.
Elle était d’une vanité excessive, ce qui ne l’empêchait pas d’être servilement obséquieuse et d’avoir pour système de n’employer que la flatterie pour obtenir tout ce qu’elle désirait.
Depuis que ces deux femmes, choisies par M. Hardestaime sur on ne sait quelles vagues recommandations, étaient auprès de Suzanne, la paysanne avait peu à peu disparu en elle. La filleule prétendue du vieux monsieur s’était parisianisée.
Comme elle avait de l’esprit naturel, une intelligence ouverte, beaucoup de bon sens, elle avait fait de si rapides progrès qu’elle en savait maintenant beaucoup plus que la Fiammati sur la grammaire et la syntaxe. Elle avait même pu constater que la soi-disant maîtresse de français était d’une ignorance crasse et qu’il lui fallait être douée d’une forte dose d’effronterie pour oser enseigner aux autres ce qu’elle ignorait absolument.
D’aller dire cela à M. Hardestaime et faire congédier Mme Fiammati, c’est ce à quoi Suzanne ne pouvait se résoudre, croyant que la dame n’avait que ses leçons pour vivre. Elle la gardait par charité ; l’autre, s’en apercevant, trop vaniteuse pour supporter bénévolement le poids de la plus légère reconnaissance, détestait naturellement Suzanne. Pour se venger des services qu’elle en recevait, elle cherchait à la corrompre.
Elle y serait parvenue sans l’amour profondément honnête et sincère que Suzanne avait pour Ludovic. Le nouveau train de vie n’y avait rien changé. Elle le regardait comme son fiancé, absolument comme si on eût célébré leurs accordailles dans son village devant les grands-parents et tous les amis de la famille.
Ludovic continuait ses visites bi-hebdomadaires, rue de Ponthieu, comme il les faisait à la chambrette de la rue de l’Ouest. Sa position s’était un peu améliorée. Il demeurait maintenant avec son père, qui venait de recueillir un petit héritage, et il était devenu sous-directeur de l’atelier de lithographie où il travaillait. Sa confiance en Suzanne, en son honnêteté, en ses promesses, était toujours la même. Il n’eût pas fallu cependant qu’une apparence même légère de tromperie vînt éveiller en lui des soupçons. La Fiammati, à plusieurs reprises, par méchanceté et envie contre Suzanne, avait tout fait pour les désunir.
Ajoutons que la confiance de Ludovic eût été ébranlée s’il avait rencontré chez la paysanne un autre personnage dont elle ne lui avait jamais parlé et qu’il est temps de présenter au lecteur.
Ce qu’il y avait de bizarre dans ce petit intérieur, quand on songe à la conduite irréprochable de Suzanne, c’est que tout y concourait à donner l’idée d’un intérieur de petite dame, pour nous servir de l’appellation usitée à l’époque où se passe cette histoire.
La présence du personnage en question n’était pas faite, on en conviendra tout à l’heure, pour diminuer cette apparence.
Un œillet rouge à la boutonnière, un stick à la main, des gants de peau de chien rouges sang-de-bœuf, un habit de cheval à boutons oxydés représentant une hure, un pantalon jaune à bandes ressortantes, un chapeau très haut de forme, à bords très étroits, des cheveux plaqués sur la tempe et couvrant la moitié des yeux, des favoris à l’américaine flottant en fumée et atteignant, au repos, le milieu du buste ; voilà l’aspect.
Comment ce sportsman de vingt-huit ans fut-il mis en rapport avec l’enfant des coteaux bourguignons ?
Voici :
Une après-midi que le médecin de M. Hardestaime s’était chargé de remettre en passant un paquet de bonbons à la filleule de son client, une pluie torrentielle s’abattit sur Paris juste au moment où la voiture s’arrêtait devant la porte. Juste à ce moment aussi, le sportsman se réfugiait sous le porche, et le médecin, reconnaissant en lui un autre client, l’invitait, pour éviter une pleurésie (médecin rare !), à monter un instant chez Suzanne.
Présenté bien en formes, accueilli par le charmant sourire de Suzanne qui était toujours d’une bonté aussi angélique qu’imprudente, le sportsman emportait, en se retirant après l’orage avec le médecin, le trait barbelé de l’archer Amour profondément fixé dans son cœur.
Le jeune centaure (nous l’appellerons Léo ; le nom de sa famille ne nous importe guère) eut la crânerie de faire une visite le lendemain en revenant du Bois et offrit un beau bouquet de violettes. La rustique Suzanne trouva la chose aussi simple qu’aimable.
Léo, qui était de l’espèce peu commune des viveurs mélancoliques, pensifs et lettrés, s’avisa de plus en plus que cette fleur bourguignonne répandait un parfum étrange et doux. Il réitéra ses visites et il prit l’habitude d’envoyer tous les matins un bouquet de violettes. Elles étaient chères, mais enfin on en trouvait.
Suzanne ne savait rien de rien en fait de galanterie. Elle crut être dans les règles et les voies de l’usage en contractant avec le rêveur sportsman un pacte d’amitié, et bientôt elle l’appela Léo tout court, sans permettre aucune familiarité de gestes.
Léo, devant la naïveté de Suzanne, s’était résigné à laisser son naissant amour se métamorphoser en amitié.
Tel était moralement le petit intérieur. Nous avons omis la description de l’appartement. Pas un lecteur qui ne la devine, si peu qu’il ait navigué dans Paris. Un salon blanc enjolivé de quelques dorures et pourvu de sièges en damas de laine rouge ; une salle à manger où règnent en bon accord le chêne et le noyer. La chambre à coucher, royaume du bleu et de la mousseline. Enfin, cuisine assez petite et antichambre où Mlle Plock, l’aiguille en main, rêve aux heureux destins dus au mérite de sa vertu.
Maintenant, avant de continuer le récit, nous conviendrons de bonne grâce avec toi, ô lecteur, si tu le veux, que la charmante filleule de M. Hardestaime donnait prise à bien des propos, le plus innocemment du monde. Le vieux monsieur ! l’ami Léo ! le visiteur bi-hebdomadaire Ludovic ! C’était bien plus qu’il n’en fallait !
Le veuf Saturnin, concierge folâtre, ne pensait pourtant rien de mal de sa locataire. La Fiammati prenait parfois de faux airs mystérieux en sortant de chez Suzanne, où elle venait tous les matins et quelquefois l’après-midi. Mlle Plock, en son humeur revêche, affectait de se retirer de bonne heure dans sa chambre, au quatrième, afin de ne rien voir et de ne rien savoir, disait-elle à Saturnin d’un air discrètement scandalisé.
Pauvre excellente Suzanne ! Mais que voulez-vous ? Sa situation n’était pas nette, en vérité ! Le Diable boiteux lui-même s’y serait trompé, à moins que, descendu la nuit par la cheminée, il n’eût vu la filleule seule dans son lit, dormant de tout son pouvoir, de tout son appétit, et murmurant en songe :
– Oh ! Mariette ! ma bonne petite Mariette !
Le 28 juin, vers onze heures du matin, le portier Saturnin, tenant une lettre à l’adresse de Suzanne, pénétra dans l’antichambre, et de là dans la salle à manger, où il rencontra Mlle Plock, dont les traits indiquaient une crise intérieure de rébellion très prononcée.
Saturnin contemplait la lettre avec béatitude et marmottait dans un faux aparté confidentiel :
– Ça vient de la campagne ! Oh ! les champs ! C’est là qu’on rigole à la sournoise ! Ouh ! ouh ! J’en ai-t’y fait des farces champêtres, à Longjumeau !
– Taisez-vous, s’écria tout à coup Mlle Plock indignée.
Et comme Saturnin continuait à retracer ses souvenirs de fredaines rustiques par des gestes expressifs :
– Tenez, ajouta-t-elle, vous n’êtes pas un portier, vous êtes un satyre déguisé.
– Un satyre ! mademoiselle Plock !… Sans ma dignité de concierge…
– Eh bien ?
– Eh bien, je vous dirais que vos grimaces de vertu me sont excessivement désagréables.
– Oh ! mon rêve ! soupira la prude en minaudant ; servir une noble famille anglaise aux mœurs pures, où je n’aurais pas à rougir à chaque instant et où ma vertu ne courrait aucun danger !
– Au lieu de ça, vous êtes chez une petite dame bien gentille, bonne comme du pain, et belle à elle seule comme tout un sérail ! Ah ! si je l’avais rencontrée, jadis, à Longjumeau !…
– Oui, je sers chez une impure, murmura Mlle Plock, avec une sorte de résignation solennelle.
Elle avait lu ce mot impure dans quelque tome dépareillé d’un roman du dix-huitième siècle que lui avait prêté une modiste, sa voisine de chambre.
Saturnin se fâcha tout rouge.
– Une impure ! Ah çà, voulez-vous taire vot’bec, mademoiselle Plock ?
– Silence au vice, Lovelace !
Lovelace étant complètement inconnu au portier, il resta pendant quelques instants coi, puis s’écria :
– Elle m’exaspère !
– Oui, une impure ! Qu’est-ce que c’est que ce M. Ludovic ?
– Son adorateur, parbleu ! répondit Saturnin prenant un air bonhomme, pour mieux faire enrager la prude.
– Et M. Hardestaime ?
– Eh ! eh ! fit le portier avec un sourire tout confit en mystère, ça, ça ne compte pas.
Plock haussa les épaules et fit avec les lèvres un susurrement de mépris en disant :
– Et l’autre ? M. Léo ?
– Oh ! celui-là, c’est… c’est son ami, parbleu !
– Oui, je connais ça. Si vous n’étiez pas si bête, vous sauriez que pour les femmes il n’y a pas d’amis, il n’y a que des hommes.
– Vous vouliez dire un autre mot, mais vous n’avez pas osé.
– Avec ça que je vous crains, vieux libertin.
– Libertin ! Tenez ! vous n’êtes qu’une momie.
– Momie ! moi ! moi !
– Oui, momie d’Égypte encore.
– Sacripant ! coureur ! infâme !
– Ouh ! ouh ! rage-t-elle ! Mais rage-t-elle, c’te momie empaillée !
La querelle arrivait à son paroxysme. Heureusement Suzanne entra, venant de sa chambre avec Mme Fiammati.
Suzanne riait aux éclats et disait :
– Es-tu bête, madame Fiammati, quand tu t’y mets !
Elle s’interrompit en voyant Saturnin et Plock se faire des gestes de menace :
– Allons, dit-elle, vous voilà encore en querelle, vous autres ! Je suis sûre que le sujet de votre dispute est encore, comme toujours, la question de ma vertu.
Elle se reprit à rire. Puis, s’arrêtant tout à coup en voyant que le concierge et la lingère continuaient à se jeter des regards furibonds, elle leur dit du ton le plus sérieux qu’il lui fut possible de prendre :
– Saturnin, vous êtes un mauvais sujet, et vous, Plock, vous êtes une prude.
Flatté de l’épithète, le portier présenta d’un air gracieux la lettre, cause première de la querelle.
– Une lettre ! le timbre d’Auxerre ! s’écria Suzanne saisie de surprise et de joie. Laissez-moi.
Plock et Saturnin sortirent, et on les entendit pendant quelques minutes prolonger dans l’antichambre leur altercation.
La lettre était de Mariette, la sœur de Suzanne. Elle faisait honneur à l’instituteur de leur village natal, car elle était fort gentiment écrite. Suzanne constata que la petite écrivait mieux qu’elle.
Si la filleule de M. Hardestaime avait le plus vif désir d’être seule pour jouir à son aise de la lecture de la chère missive, la curiosité aiguillonnant Mme Fiammati n’était pas moins forte. Craignant de se voir congédiée aussi, elle s’empressa de déclarer que l’heure de la dictée était venue.
Suzanne se récria :
– Non, madame Fiammati. Assez. Au diable l’orthographe ! J’en sais bien autant qu’il m’en faut pour vivre.
– Cependant, répliqua la maîtresse de français vexée, madame a encore écrit hier haricots, c, o, t, s.
– Eh bien ? fit Suzanne stupéfiée.
– C’est une faute, dit gravement la docte Fiammati. Les pluriels en aux s’écrivent a, u, x, comme caporaux, chevaux, arsenaux.
– Et dire que je la paye pour m’apprendre la langue ! Voilà où en est sa science quand elle n’a plus la grammaire sous les yeux, pensa Suzanne en étouffant un éclat de rire dans son mouchoir.





























