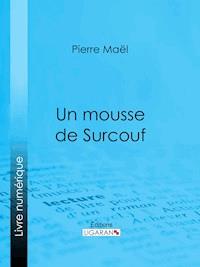Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La mer partout, au levant, au couchant, au midi, au septentrion, la mer grise et morne, pleine de trouble et de tristesse, sous un firmament sans soleil. Et sur cette mer, un navire long et étroit, couronné d'un panache de fumée que les vents, singulièrement bas, déroulent en épais flocons lents à se fondre dans l'air ambiant."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MA PETITE AMIE
GERMAINE DE VERCY
P.M.
La mer partout, au levant, au couchant, au midi, au septentrion, la mer grise et morne, pleine de trouble et de tristesse, sous un firmament sans soleil. Et sur cette mer, un navire long et étroit, couronne d’un panache de fumée que les vents, singulièrement bas, déroulent en épais flocons lents à se fondre dans l’air ambiant.
Il y a douze jours que ce navire a quitté Cherbourg. Ce n’est point un vaisseau de guerre, bien que deux canons d’acier s’allongent sur le pont, à l’avant et à l’arrière. Les couleurs de la France battent à sa corne, et l’allure dont il va est celle d’un rapide coureur des mers. Et cependant, malgré sa vitesse ordinaire, il n’est encore qu’à la hauteur du 70e parallèle. Des causes d’ordre rationnel et logique ont pu seules retarder ainsi sa marche.
On louche au printemps. Afin de gagner du temps, les navigateurs ont devancé le mois d’avril. On ne marche qu’avec la plus extrême prudence, car la débâcle est déjà commencée. La vitesse, qui pourrait être de quatorze nœuds, n’est que de huit milles à l’heure Le navire a rencontré quelques blocs errants dès la pointe d’Ekersünd, où il a fallu relâcher. Puis, la mer se faisant libre, on a longé les hautes falaises de la Norvège, la région des fiords.
Maintenant, le cap Nord n’est plus qu’à quelques minutes à l’est. Demain, après-demain, selon que les courants chauds le permettront, on se rapprochera de la côte, et, le 15 mai, l’océan Boréal sera entièrement ouvert.
Sur le gaillard d’arrière du navire, deux hommes s’entretiennent, confortablement assis en de vastes fauteuils de canne et tournant le dos à la direction du steamer.
L’un de ces hommes est jeune. Il paraît avoir vingt-huit ans. Il est grand, large d’épaules, bien pris dans toute sa personne. Il porte la petite tenue des officiers de la marine militaire. Son interlocuteur, à la barbe et aux cheveux blancs, ne semble pourtant pas dépasser la cinquantaine. Ils s’entretiennent avec un intérêt soutenu du but et des conditions du voyage.
« Depuis le départ, notre Étoile n’a pas bronché. Elle se comporte comme un vieux routier de l’océan. Laissez-moi vous féliciter. C’est le modèle des navires, et vous avez toutes les raisons d’en être fier, puisque vous en êtes le père. »
C’est le jeune homme qui vient de parler.
Son compagnon a souri au compliment. Modestement il répond :
« Sans doute, sans doute, j’en suis le père… adoptif. Mais c’est Lacrosse qui l’a découvert dans ses langes. Combien ne lui dois-je pas, et aussi à vous, mon cher Hubert ! Voici trois ans que je vous pille sans que vous le soupçonniez, que je mets à contribution votre savoir et vos expériences combinées.
– Oh ! mon expérience, cher oncle, est de très minime importance. Je laisse toute la haute valeur de ce mot à l’acquis du commandant Lacrosse. Pour moi…
– Pour vous, interrompit M. de Kéralio, n’êtes-vous pas le créateur de ce sous-marin dont nous attendons des merveilles ? »
Hubert sourit :
« Allons, j’avoue que j’y suis pour quelque chose. Mais ce quelque chose n’est pas encore expérimenté, et d’ailleurs la découverte ne m’en appartient pas en propre. Mon frère Marc est de moitié dans l’invention, et si l’épreuve justifie nos espérances, c’est à lui surtout qu’en reviendra la gloire. »
M. de Kéralio se mit à rire.
« Ah oui ! dit-il, le fameux secret que vous ne devez révéler qu’à son heure !
– Précisément, mon cher oncle, ce secret dont la divulgation demande à être précédée d’une expérimentation concluante.
– En ce cas, le moment est venu d’y recourir », prononça derrière les deux hommes une voix claire et fraîche de jeune fille.
Ils se retournèrent en même temps.
« Ma cousine, dit Hubert en s’inclinant respectueusement.
– Ma petite Belle, fit M. de Kéralio, viens-tu donc nous rappeler l’heure du déjeuner ? Je ne sais si le vent qui nous rafraîchit en ce moment nous creuse plus qu’à l’ordinaire, mais j’avoue que mon estomac me paraît en avance sur ses habitudes. »
La nouvelle venue lendit sa main au jeune homme, son front au baiser paternel.
« Non, père, répliqua-t-elle, et votre estomac est dans son tort. Il est à peine dix heures du malin, et je suis venue pour assister à la féerie qui se prépare. Le commandant Lacrosse, en effet, m’a prévenue que, dans un instant, nous assisterions à une véritable illumination de glaces. »
Et, sans façon, elle attira un siège pareil à ceux des deux hommes, et s’y assit.
Celle qui venait de parler était une grande et belle jeune fille de vingt ans. Elle était brune avec des yeux bleus, le type des races d’origine kymrique et ibère, telles que les Irlandais, les Gaëls d’Écosse et ceux des côtes de Bretagne. Toute sa personne, bien prise et svelte, annonçait une vigueur rare chez une femme, en même temps que le reflet métallique de ses pupilles dénotait, sous certains froncements des sourcils, une grande énergie. On devinait en elle l’âme et l’organisme d’une héroïne véritable, sans forfanterie comme sans timidité gauche ou empruntée.
Belle – ou très exactement Isabelle de Kéralio – était la fille unique d’un propriétaire et industriel, possesseur de terres et d’usines au Canada, où sa famille s’était établie depuis deux siècles. M. Pierre de Kéralio, Breton d’origine, avait fini par revenir à la terre de ses pères et s’était installé dans une magnifique propriété aux environs de Roscoff. Isabelle n’avait que dix ans au moment de ce retour au sol natal. Elle avait grandi dans la compagnie des gens de la côte, mais sous la haute et attentive direction de son père, demeuré veuf très peu de temps après la naissance de sa fille. Il avait conservé à celle-ci les soins assidus et quasi maternels de Tina Le Floc’h qui l’avait nourrie, et rien n’était plus touchant que l’affection de la paysanne léonaise pour son enfant d’adoption. En même temps, ne se connaissant pas d’autre famille, le richissime M. de Kéralio avait appelé près de lui deux jeunes orphelins de dix-huit et vingt ans, ses neveux Hubert et Marc d’Ermont, fils d’une sœur, morte également en même temps que son mari, le capitaine de vaisseau Robert d’Ermont. Hubert avait terminé ses études préparatoires à l’École Navale. Son oncle ne le retint donc pas ; il l’encouragea même à suivre sa voie et ses goûts dans la glorieuse carrière où il s’engageait. Deux ans plus tard, le jeune homme commençait sa vie de marin en qualité d’aspirant de deuxième classe.
À l’heure présente, il était lieutenant de vaisseau. Un congé illimité, accordé par le ministre pour encourager la généreuse et patriotique tentative de M. de Kéralio, avait permis à l’officier de prendre sa part des hasards, mais aussi de la gloire à venir de cette expédition dans ces régions mortelles d’où si peu d’explorateurs sont revenus.
Le frère aîné d’Hubert, Marc d’Ermont, d’une complexion délicate et maladive, d’une rare intelligence, s’était voué à l’étude des sciences physiques. C’était, à trente ans, l’un des savants les plus distingués de la capitale ; son nom, à maintes reprises, avait brillé en regard d’utiles découvertes. Il n’avait pu accompagner son frère et son oncle dans leur expédition. Mais, depuis deux années, en compagnie d’Hubert, il s’était livré à de mystérieuses et difficiles recherches pour ajouter aux chances du voyage la garantie de moyens nouveaux dus à l’invincible pouvoir de la science.
Isabelle de Kéralio était une assez singulière personne, dont le caractère et l’éducation ne ressemblaient guère à ceux de nos jeunes filles françaises. Du long séjour de sa famille en Amérique elle tenait, peut-être par voie d’habitude lentement acquise, cette énergie virile qui contraste si fort avec la douceur, la langueur même et les grâces timides des femmes de la vieille Europe. Rompue à tous les exercices du corps, pourvue d’une haute culture intellectuelle, elle eût sans doute effrayé un autre épouseur que son cousin Hubert.
Mais Hubert d’Ermont connaissait bien sa cousine Isabelle. Il savait que ces allures, peu habituelles chez les jeunes Françaises, ne nuisaient aucunement aux qualités exquises de Mlle de Kéralio, qu’elles ne faisaient que dissimuler aux regards peu clairvoyants les trésors de tendresse et de charité que contenait cette âme d’élite. D’ailleurs Isabelle dépouillait dans l’intimité ces dehors étranges. Elle recouvrait tous les charmes de son sexe, et les manifestait même avec une rare puissance de séduction. Musicienne accomplie, soit qu’elle laissât courir ses doigts sur le clavier, soit qu’elle donnât l’essor à l’ampleur vibrante d’une voix admirable, elle incarnait alors toute l’harmonie intime dont sa beauté n’était que la parure extérieure.
Ils s’étaient fiancés spontanément, avec l’agrément de M. de Kéralio, et il avait été convenu que le mariage se célébrerait le jour où Hubert aurait conquis les épaulettes de lieutenant de vaisseau.
Il les avait conquises de bonne heure, à vingt-sept ans. Mais, alors, un nouveau délai avait été apporté à l’union désirée de part et d’autre.
Pierre de Kéralio n’était point marin, mais il avait suffisamment navigué pour ne rien redouter de la mer. Bien plus, il en avait contracté l’amour, et, à l’âge où la plupart des hommes se retirent du travail et des fatigues, il avait, lui, conçu la pensée de mettre au service de la science une partie de son immense fortune. Le patriotisme avait donné à cette noble idée un caractère de grandeur touchante, et, un jour, il avait dit, à haute voix, devant tout un auditoire d’amis invités aux fiançailles d’Hubert d’Ermont et d’Isabelle de Kéralio :
« Dès que ma fille sera mariée, je mettrai à exécution un grand projet qui me lient au cœur depuis de longues années. J’organiserai une expédition et j’irai au Pôle. Il ne sera pas dit que Nares, Stephenson, Aldrich et Markham, c’est-à-dire des Saxons, en 1876 ; que Greely, Lockwood et Brainard, des Américains, c’est-à-dire d’autres Saxons, en 1882, seront allés au-delà du 83e parallèle, sans que des Français les aient dépassés. »
Isabelle avait jeté un cri.
« Quand je serai mariée ! Eh bien, dussent tous nos amis me blâmer à l’unisson, il ne sera pas dit non plus qu’Isabelle de Kéralio n’aura pas pris sa part d’une telle gloire. Je connais assez le cœur d’Hubert pour savoir qu’il m’accordera la permission de suivre mon père jusqu’au sommet du monde. »
Quelques-uns des amis applaudirent ; le plus grand nombre se récria.
« Ma fille ! » essaya d’interrompre M. de Kéralio.
Isabelle ne le laissa pas achever. Elle lui entoura le cou de ses deux bras, et, avec une tendresse envahissante et dominatrice, répliqua :
« Chut, père ! Pas un mot de plus. C’est entendu. Tu m’as élevée de telle façon que je ne suis qu’un garçon manqué, au dire de beaucoup de gens. J’irai au Pôle Nord. Et puis, vous savez, papa, ajouta-t-elle en riant, je ne vous désobéis pas, puisque vous venez de me fiancer à Hubert, et que son autorité sur moi égale désormais la vôtre. Sur ce, parlons de l’expédition. »
M. de Kéralio s’adressa alors à Hubert.
« C’est donc à vous, mon futur gendre, qu’il me faut recourir. Voulez-vous être assez bon pour faire entendre raison à cette jeune personne déraisonnable ? »
Hubert, mis au pied du mur, se leva.
« Mon cher père, répondit-il, car je puis vous donner ce titre, j’essayerai de dissuader Mlle de Kéralio d’un projet plein de périls. Je m’attacherai à lui montrer combien une telle résolution est d’un accomplissement difficile pour une femme. Mais, si elle refuse de se rendre à vos avis et aux miens, si elle persiste dans une volonté qui, bien que vaillante, devrait céder le pas à de plus prudentes considérations, je me permettrai de conclure en vous demandant une part des périls. Où ira Isabelle de Kéralio, moi, Hubert d’Ermont, son fiancé et prochainement son mari, j’irai. »
M. de Kéralio n’avait rien à répondre.
Quant à l’assistance, si extravagante que parût l’hypothèse, elle savait ceux qui venaient de parler tout à fait capables de la réaliser.
On se borna donc à remplir les coupes de champagne, et un toast spécial fut porté au succès de la future expédition.
C’était ainsi qu’avait pris naissance l’idée de cette campagne au Pôle Nord.
Mais, une fois l’accord établi à ce sujet, il avait fallu en dresser le plan.
Tout d’abord, M. de Kéralio avait obtenu pour Hubert d’Ermont le congé nécessaire. Puis il avait appelé à lui un vieil ami, Bernard Lacrosse, ancien officier de la marine française, que son peu de fortune avait contraint d’abandonner le service de l’État pour accepter le commandement d’un transatlantique. Après cinq années de cette nouvelle existence, le commandant Lacrosse avait fait partie, en qualité d’officier volontaire, d’une expédition russe au Pôle Nord par la Nouvelle-Zemble. À quarante-deux ans, il était reparti pour les terres antarctiques, cette fois officier en second d’un navire français. Il en était à peine de retour, qu’une lettre de M. de Kéralio le réclamait au nom de l’amitié et de la science. Il s’était empressé d’accourir.
D’accord avec M. de Kéralio et Hubert d’Ermont, Lacrosse avait choisi et rassemblé l’équipage de l’Étoile Polaire. Tel était en effet le nom prédestiné du navire.
Ce furent tous de joyeux compagnons, ces navigateurs du Pôle, car on sait combien la gaieté et l’entrain sont des qualités indispensables chez ceux qui vont courir de pareilles aventures. Les trois initiateurs de la campagne avaient fait avec un discernement scrupuleux le choix du personnel, en commençant par les officiers et les médecins. Aussi ne voyait-on guère que figures joviales parmi les inscrits du rôle de l’équipage.
L’état-major était composé de la manière suivante :
Commandant de l’expédition : Pierre de Kéralio, 50 ans.
Commandant de l’« Étoile Polaire » : Bernard Lacrosse, lieutenant de vaisseau, 48 ans.
Lieutenants : Paul Hardy, 28 ans ; Louis Pol, 27 ans, enseignes de vaisseau démissionnaires ; Jean Rémois, capitaine au long cours, ancien enseigne de vaisseau auxiliaire, 54 ans.
Médecin : André Servan, 40 ans ; chirurgien : Félix Le Sieur, 58 ans.
Officier mécanicien : Albert Mohizan, 30 ans.
Chimiste-naturaliste : Hermann Schnecker, 36 ans.
À la liste des officiers il fallait ajouter le lieutenant de vaisseau Hubert d’Ermont, fiancé de Mlle de Kéralio, embarqué à la faveur d’un congé illimité.
Tous les officiers avaient appartenu à la marine militaire. Chacun d’eux représentait donc une somme de savoir, de pratique et d’énergie considérable.
La même entente des caractères et des capacités avait présidé au choix des matelots. Par une sorte d’égoïsme national, M. de Kéralio avait voulu que tous fussent Bretons ou Canadiens, c’est-à-dire des compatriotes de sa double patrie.
Puis on avait procédé à l’armement du navire.
L’Étoile Polaire n’avait pas encore navigué. Elle était sur chantier à Cherbourg, commencée par une maison d’armements que la faillite avait empêchée d’en prendre livraison. C’était un steamer de 800 tonneaux, gréé en trois-mâts barque et construit en vue du long-cours. Bernard Lacrosse, qui avait visité tous les ports de France pendant une période de deux mois, avait eu la chance de découvrir littéralement cette « étoile » sur son ber. Il l’avait immédiatement achetée pour le compte de M. Kéralio, et avait fait reprendre les travaux avec des dispositions particulières et des aménagements spéciaux pour la course à travers les glaces.
Le navire était muni de deux machines compound à triple expansion de la force de 500 chevaux. Il était formé d’une carène dont les varangues en demi-cintre concave renfermaient trois ponts et portaient un revêtement de bois de tek, laissant entre lui et la coque un vide de 22 centimètres rempli d’étoupe et de bourre de palmier. La quille, la carlingue, l’étrave et l’étambot étaient en acier enveloppé d’une sorte de gaine en cuivre.
Le cuivre avait été employé avec intention, pour donner plus d’élasticité à la coque. Il figurait dans les arcs-boutants et les joints du bâti, ce qui permettait au navire de subir de très fortes pressions sans se rompre. Un maître-bau longitudinal reliait les diverses parties du bâtiment et en faisait un tout presque homogène. Les épaisseurs du matelas de teck variaient entre 225 millimètres au centre du navire, 120 à l’avant et 100 à l’arrière. Toute la coque était distribuée en compartiments étanches. Outre la doublure de bourre entre les deux épidermes de bois, on avait garni les murailles et les lambris de minces feuilles de feutre comprimé, qui empêchait la perte du calorique et la pénétration de l’humidité. Pour éviter au gouvernail le choc des glaces, on avait lié à ses côtés de longues poutres revêtues de cuivre, formant daviers, avec le secours desquelles il serait possible de le démonter et de le coucher sur le pont.
L’étrave se profilait selon une courbe évidée se terminant en un éperon de 3 mètres de longueur, également en acier. Enfin on avait adapté à l’avant, en même temps que des treuils à vapeur, l’appareil Pinkey et Collins dont se servent les baleiniers pour dispenser, par les grands froids, les hommes de la manœuvre des ris. Des coudes de tôle disposés au-dessus des robinets d’échappement permettaient de projeter la vapeur sur les glaces les plus rapprochées, dans un rayon de 5 mètres, sur les flancs de la carène.
Le détail de l’armement n’avait pas été moins soigné que le gros œuvre. L’Étoile Polaire possédait, outre les deux canons de 10 centimètres placés sur le pont, deux canons-revolvers Hotchkiss, quatre fusils-harpons, deux obusiers lance-bouées. Puis on avait emporté trois baleinières, cinq canots à glace entièrement revêtus de lames de cuivre, et dont les quilles recevaient au besoin des patins ou des essieux pour le traînage. Enfin, à l’arrière, sous des taux le protégeant contre l’influence du dehors, s’abritait le mystérieux bateau sous-marin au sujet duquel M. de Kéralio venait de féliciter Hubert d’Ermont.
La conversation, un moment interrompue par l’arrivée d’Isabelle, reprit plus vive entre les trois personnages.
« Mon cher cousin, dit la jeune fille, revenant à la commune pensée, je vous disais tout à l’heure que l’occasion me semblait propice pour mettre à l’épreuve votre découverte et celle de Marc. »
Le lieutenant de vaisseau demanda gaiement :
« Est-ce la seule curiosité qui vous fait parler ainsi, Isabelle, ou bien dois-je traduire vos paroles dans le sens d’un sentiment d’intérêt en faveur des efforts accomplis par mon frère et par moi ? »
Les sourcils de la jeune fille eurent un rapide froncement.
Mais cette irritation passagère fit place à l’enjouement ordinaire de la fantasque créature, car elle répondit avec son plus doux sourire :
« En douteriez-vous un seul instant, mon cher Hubert ? Me jugez-vous donc si étrangère aux choses de la science ? Sans doute, mon affection pour l’auteur ou les auteurs d’une invention que, sur la foi que j’ai en eux, je tiens pour admirable, n’est point exempte d’un peu de crainte. Mais, pour vous rendre toute ma pensée, je suis contente d’avouer qu’en tout ceci je suis surtout attentive aux résultats pratiques de notre campagne, et que je m’attache à vous avec d’autant plus de sollicitude depuis que je vous sais porteur d’une invention qu’on pourrait nommer la panacée des mécomptes en matière de découvertes. »
Un sourire vaguement sceptique courut sur les lèvres de la jeune fille.
Hubert d’Ermont n’était point encore à l’âge où l’on maîtrise d’un seul coup toutes ses impatiences. Ce persiflage souriant de Mlle de Kéralio faillit l’emporter au-delà des limites qu’il s’était imposées en matière de confidences.
Mais, quelque violente tentation qu’il eût de jeter à la jeune fille la preuve irréfutable de son mérite, il se souvint juste à propos qu’il n’avait pas le droit de s’expliquer avant un jour et une heure fixés d’avance.
Toutefois, s’il n’avait point ce droit, la faculté lui était laissée de se défendre au moyen d’apparences favorables. Il se leva donc de sa chaise longue, non sans une certaine vivacité, et, tendant la main à sa cousine :
« S’il vous plaît, mademoiselle la douteuse, de descendre, en compagnie de mon oncle, jusque dans ma chambre, je pourrai vous montrer, sinon la découverte en application, tout au moins les instruments sur lesquels elle se fonde. »
Isabelle se redressa très gaie :
« Ho ! ho ! Hubert, vous me paraissez prendre la chose plus à cœur qu’il ne convient. Faut-il vous dire que mon doute est tout de surface et que j’ai, au contraire, la plus grande confiance en votre savoir uni à celui de votre cher Marc ? »
M. de Kéralio la plaisanta :
« Sans doute, ma fille ; mais tu me parais appartenir quelque peu à l’école de saint Thomas Didyme, qui ne croyait qu’après avoir vu. Aussi bien, puisque Hubert nous le propose, allons voir. »
Tous trois se dirigèrent vers l’écoutille.
Au moment où ils mettaient le pied sur la première marche de l’escalier en fer forgé, ils furent croisés par le commandant Lacrosse.
« Parbleu ! Bernard, s’écria M. de Kéralio, vous ne serez pas fâché de voir avec nous les trésors de science emmagasinés dans la chambre de mon futur gendre. »
Et passant son bras sous celui de Lacrosse, M. de Kéralio l’entraîna à la suite des deux jeunes gens.
L’intérieur de l’Étoile Polaire avait été aménagé à l’instar d’un yacht de plaisance. La coursive, le salon, la salle à manger, le fumoir étaient décorés d’une boiserie d’acajou au long de laquelle régnait un capiton soigneusement rembourré. Les chambres des officiers s’ouvraient sur la coursive. À l’entour du salon rayonnaient celles de M. de Kéralio et de sa fille, du commandant Lacrosse et d’Hubert d’Ermont.
Ce fut dans cette dernière qu’entrèrent les quatre visiteurs.
Elle était meublée avec une extrême simplicité, avec une parfaite entente de l’art d’utiliser les moindres coins. La couchette, installée dans un angle, reposait sur quatre tiroirs tenant lieu d’armoire. La toilette et la table de nuit tenaient en un meuble arrondi, pivotant dans une façon de niche, et il suffisait de faire tourner ce meuble, pour obtenir un élégant pupitre pourvu d’un tabouret à dossier.
Dans l’angle opposé se dressait un coffre-fort d’acier dont l’épaisseur défiait toute tentative d’effraction. Une savante combinaison de chiffres en garantissait l’impénétrabilité.
Hubert désigna des sièges à ses compagnons.
« Mon oncle, commença-t-il, bien que je sois votre hôte, je suis ici chez moi, avec votre consentement, bien entendu. C’est donc à moi à faire les honneurs de mes appartements, et c’est à ma chère cousine que j’en ferai le premier hommage. »
Il prit un trousseau de clefs dans son pupitre et, le tendant à la jeune fille :
« Voulez-vous introduire cette clef dans la serrure de ce coffre-fort ? » demanda-t-il.
En même temps, de la main droite, avec une prestesse singulière, il combinait les chiffres latents sous les boulons d’acier de la porte.
Isabelle n’eut qu’à tourner la main. Le cliquetis net de six verrous sortant à la fois, accompagné du bruit d’un ressort qui se détend, précéda l’ouverture de la porte, et l’intérieur du coffre apparut, distribué en casiers symétriques.
« Voilà le trésor ! fit Hubert avec un geste de comique déclamation.
– Voyons le contenu », réclama M. de Kéralio.
Hubert se pencha, et retira de l’un des casiers divers objets d’une forme assez simple et dont le premier aspect ne révélait rien au regard.
C’étaient des cylindres d’acier, d’un poids relativement considérable. Ils mesuraient environ 30 centimètres de diamètre, et ils se terminaient uniformément en canules étranglées par un double collier auquel s’adaptait une double vis de fermeture, assez analogue à celles des robinets de gaz.
Bernard Lacrosse prit la parole :
« Il ne faut pas être bien malin pour deviner que ces cylindres contiennent quelque chose. Est-il permis de demander quoi ? »
Hubert d’Ermont mit un doigt sur sa bouche.
« Pas avant le moment venu. Oui, vous l’avez compris, ces cylindres contiennent “quelque chose”, je ne puis vous le faire connaître que lorsque nous serons en telle situation que nulle mauvaise volonté n’en puisse tirer parti contre nous. Sachez seulement que ces cylindres renferment le secret de notre victoire prochaine : la chaleur et la force, la lumière et le mouvement. Avec eux, grâce à eux, nous ne connaîtrons plus d’obstacles. Ce sont eux qui nous mèneront au Pôle. »
Les auditeurs de ce petit discours demeurèrent un instant bouche bée devant celui qui le prononçait.
« Parbleu ! s’il en est comme vous le dites, mon cher d’Ermont, reprit Lacrosse, il est certain que c’est là un secret qu’il faut garder avec soin. »
La figure d’Isabelle était devenue pensive.
« À quelles “mauvaises volontés” faisiez-vous allusion, Hubert ? »
Le jeune homme allait répondre sans doute, lorsque la porte de la cabine s’ouvrit brusquement du dehors, livrant passage à un magnifique chien de Terre-Neuve, qui vint poser sur les genoux d’Isabelle sa large tête pleine d’intelligence.
« Bonjour, Salvator ! » fit gaiement la jeune fille en caressant le superbe animal.
Hubert parut contrarié.
« Nous avions donc laissé la porte ouverte ? » fit-il avec un peu de vivacité.
Il replaça le cylindre d’acier dans le coffre et referma celui-ci avec précipitation.
Par l’entrebâillement de la porte, un nuage de fumée de tabac venait de pénétrer dans la cabine.
Hubert, qui s’était élancé dans le salon, vit une haute silhouette à cheveux roux s’enfoncer dans la coursive.
« Monsieur Schnecker était là ! prononça-t-il, le sourcil froncé, en rentrant dans la cabine.
– Notre chimiste ? demanda gaiement Isabelle.
– Oui, notre chimiste, un monsieur qui ne me revient guère, ajouta d’Ermont. Depuis quelques jours son attitude me semble étrange. Je crois que nous ferons bien de le surveiller.
– Oh ! Hubert, que dites-vous là ! s’écria la jeune fille, de plus en plus surprise.
– Je dis ce que je pense, conclut le jeune officier. Au reste, ma chère cousine, voulez-vous interroger un témoin impartial ? »
Avant qu’elle eût répondu, et tandis qu’elle le considérait avec étonnement, le lieutenant de vaisseau leva de la main la tête du chien, qu’il regarda bien dans les yeux.
« C’est ton ami, pas vrai, Salvator, monsieur Schnecker ? »
Salvator montra toutes ses dents, et un sourd grondement de colère roula dans les profondeurs de sa large poitrine.
Le 15 mai, l’Étoile Polaire avait dépassé le cap Nord. Jusqu’à cette heure, le plan qui avait prévalu avait été de prendre la route au nord-est. On voulait en effet revenir sur les pas de l’expédition du Tegetthoff, dirigée, de 1872 à 1874, par Payer et Weyprecht, qui, de la Nouvelle-Zemble, située par 76° de latitude nord, avaient gagné une terre inconnue, qu’ils dénommèrent Terre de François-Joseph et supposèrent étendue du 80e au 83e parallèle.
Ce plan, outre qu’il fournissait à des voyageurs européens la faculté d’être plus voisins du vieux continent, avait également, le mérite de flatter l’amour-propre de gens désireux de s’ouvrir une voie toute nouvelle. « On serait bien malheureux, avait pensé M. de Kéralio, si l’on ne parvenait pas à se frayer un passage en deçà du 30e degré de longitude orientale, entre le Spitzberg et les terres fragmentaires de la Nouvelle-Zemble. »
Le commandant Bernard Lacrosse avait combattu ce projet, et les raisons qu’il avait invoquées pour le combattre étaient fort concluantes. Outre qu’on allait ainsi à l’aventure, on négligeait bénévolement, et par une sorte de fanfaronnade, de mettre à profit l’expérience des devanciers, notamment les découvertes précises faites sur la Terre de Grinnell, en 1875 et 1876, par Nares, Markham et Stephenson, plus récemment, de 1881 à 1884, par Greely, Lockwood et leurs vaillants et infortunés compagnons.
Bernard Lacrosse raisonnait avec un bon sens souverain. « Au moins, disait-il, en suivant cette voie, aurons-nous un chemin tout ouvert jusqu’au 83e parallèle. Le canal et le détroit de Smith, la baie de Lady Franklin, sont aujourd’hui des points de repère suffisants pour des gens de savoir et d’énergie. »
Il ajoutait, non sans apparence de vérité :
« Il est à craindre, d’autre part, que la débâcle ne nous rende le chemin très difficile dans une région où les terres sont rares, et ne nous entraîne malgré nous vers l’ouest. Ce serait du temps perdu, puisqu’il faudrait hiverner au voisinage de l’Islande, et ce avec le grave inconvénient d’épuiser nos ressources au tiers seulement du parcours. »
Son avis ne devait que trop tôt être confirmé par les faits.
Dès le 16 mai on s’aperçut que le champ de glace, imparfaitement rompu, ne donnait aucun passage à l’Étoile Polaire. Les multiples tâtonnements auxquels on se livra n’aboutirent qu’à une perte de temps, et, malgré tous les efforts, le 25 mai, on était rejeté de quatre degrés dans l’ouest. La voie, obstruée à l’orient, semblait, par une singulière ironie, s’aplanir d’elle-même au couchant.
L’entêtement de M. de Kéralio céda devant cette démonstration des faits eux-mêmes, et, se rendant aux sages conseils du capitaine, il fut le premier à conclure en faveur d’un changement de direction.
À la satisfaction générale, on abandonna donc la route fermée au nord-est pour se diriger vers l’horizon contraire, et l’Étoile Polaire mit résolument le cap sur la pointe méridionale du Spitzberg.
La mer se faisant de plus en plus libre, on y parvint vers le 15 juin. Il y eut, ce jour-là, quatre-vingts jours d’écoulés depuis le départ de Cherbourg. On était au 78° degré de latitude boréale. Il n’en restait que cinq à franchir pour atteindre le point extrême des investigations humaines. Mais chacun savait que l’on louchait à la limite, et que désormais allait commencer la véritable campagne, pleine de luttes et d’efforts. Pour franchir trois de ces degrés en traîneaux, Nares, Markham, Stephenson, puis Greely, Lockwood et Brainard, avaient mis deux mortelles années.
Il fallait se hâter. L’été des pôles est fort court, et, juillet passé, le refroidissement commence. Depuis que l’on avait dépassé le Cercle polaire, on ne faisait plus aucune consommation de luminaire, le soleil de minuit fournissant tout l’éclairage. Depuis près d’un mois, les glaces disjointes et fuyantes ne se montraient plus qu’à l’état de fragments peu considérables. Mais le commandant avait hoché la tête et répondu en souriant aux exclamations étonnées de Mlle de Kéralio :
« Patience ! Tout, cela va changer. N’oubliez pas que nous sommes dans la partie la moins encombrée des mers polaires. Nous ne devrons compter qu’à partir du Grœnland. »
Il disait vrai. Ce fut en vain que de l’extrémité méridionale du Spitzberg on essaya de s’élever directement vers le nord. Le pack, ou champ de glace, arrêta l’Étoile Polaire dès le second jour de la navigation. Il lut même impossible de maintenir la route vers l’ouest sur le 78e parallèle, les avancées des isbrèdes drossant le navire vers le sud.
On dériva, ainsi de trois degrés. Puis le champ de glace s’ouvrit de nouveau sous l’action d’un courant chaud. Le commandant Lacrosse se dirigea obliquement vers le nord-ouest. Le 25 juin, on avait regagné le 77e degré, et la côte du Grœnland apparut bordée d’une frange glacière d’environ 35 milles de développement. Le cap Bismarck accusa sa noire silhouette dans le nord.
Obligée de surveiller ses abords, l’Étoile Polaire marchait sous une allure très modérée, à peine huit nœuds. À mesure que le navire s’avançait dans le nord, les glaces se faisaient plus nombreuses. Maintenant elles se suivaient sans interruption, en chapelet d’îlots d’inégale grandeur. Il n’y avait jusqu’à présent que des blocs à surface plane, des fragments d’ice-fields. Mais il en venait de moins plais, bossues de boursouflures, hérissés de fines aiguilles, zébrés de fentes longitudinales, avec des cassures nettes et brillantes comme des arêtes de verre brisé. Derrière ceux-là, d’autres apparaissaient, plus hauts, plus larges, qui de loin affectaient des formes bizarres. Quelques-uns donnaient à l’œil la sensation de voiles lointaines aperçues à l’horizon ; et l’on voyait grossir et s’accroître la flottille à mesure que l’on se rapprochait du grand fiord de François-Joseph, découvert par Payer au cours du voyage de la Germania et de la Hansa.
Enfin, le 50 juin, l’Étoile Polaire, s’engageant dans le chenal du fiord, jetait l’ancre sous ce même 76e parallèle que l’on avait déjà louché sur les côtes du Spitzberg. Le moment était venu de mettre à exécution la seconde partie du plan de M. de Kéralio. Elle consistait à déposer à terre une partie des navigateurs, afin de permettre à l’Étoile Polaire de redescendre aussi vite que possible dans le sud pour s’y procurer les chiens et le personnel esquimaux indispensables aux traînages prochains.
À la vérité, ce plan avait subi de telles modifications qu’on pouvait le dire entièrement renouvelé. On avait perdu un temps précieux à tenter la route de l’est. Au lieu de remonter vers la Terre de François-Joseph, on se trouvait sur la côte orientale du Grœnland, au-dessous du mont Petermann. On se proposait désormais de suivre une route oblique du 24e au 55e parallèle de longitude occidentale, afin de croiser, s’il était possible, la route de Lockwood, en 1882, par 82°44′ de latitude nord. C’était un projet grandiose et hérissé de difficultés ; mais, ainsi que le disait M. de Kéralio, est-il donc un obstacle capable d’arrêter les Français ?
Il restait au capitaine Lacrosse quarante-six jours, du 1er juillet au 15 août, pour gagner le sud du Grœnland, doubler au besoin le cap Farewell, et ramener au fiord François-Joseph les équipes de chiens nécessaires à l’expédition des traîneaux.
Par bonheur, ce moment de l’année était celui des plus fortes chaleurs. L’Étoile Polaire, pendant ses trois mois de course, n’avait subi aucune avarie. Elle était encore abondamment pourvue de charbon, et, même après son retour, en posséderait suffisamment pour une future campagne de navigation, si la mer s’ouvrait de nouveau devant son aventureuse hardiesse.
Grâce aux mesures prises longtemps à l’avance et minutieusement calculées, le débarquement des principaux explorateurs fut terminé en vingt-quatre heures. La bordure cristalline du fiord n’était pas de plus de 6 milles en largeur, et telles étaient encore l’épaisseur et la solidité de la glace, qu’on y pouvait défier toute influence de la débâcle extérieure. Ces croûtes du littoral sont fixées là depuis des siècles, et leurs assises reposent, selon toute apparence, sur le roc même, où elles forment une console dominant de deux ou trois mètres le niveau des eaux libres. Pour plus de sécurité, Bernard Lacrosse fit procéder, dès l’abord, à un sondage, qui accusa le fond à vingt-cinq brasses sur une corniche de syénite et de roches schisteuses. Il était manifeste que la côte se relevait en pente très douce jusqu’à l’affleurement du sol.
En même temps que les voyageurs, on débarqua les diverses pièces de bois numérotées qui allaient permettre la rapide construction du baraquement destiné à abriter les explorateurs restant à terre. Là encore, l’exercice, précédemment répété, du montage et du démontage des poutres, arcs-boutants, voliges, murailles et cloisons de la maison de bois, procura une économie de temps vraiment merveilleuse. La douceur exceptionnelle de la température, accusant, de midi à trois heures, 9 degrés centigrades, et 5 entre minuit et trois heures du matin, favorisa les travaux. En six heures, le Fort Espérance – ainsi l’avait-on dénommé d’avance – fut paré pour recevoir les douze personnes qui descendaient à terre, à savoir : M. de Kéralio, sa fille Isabelle, son neveu Hubert d’Ermont, la bonne Tina Le Floc’h, nourrice et suivante d’Isabelle, le docteur Servan, le naturaliste Schnecker, et les six matelots bretons Guerbraz, Hélouin, Kermaïdic, Cariou, Le Maout et Riez.
Ce fut à ces douze débarqués que le reste de l’équipage confia le soin d’ajouter à la maison improvisée les deux ailes nécessaires au logement ultérieur des trente-trois officiers et matelots demeurés à bord du navire, et qui ne rentreraient de leur course au cap Farewell que pour s’enfermer avec leurs compagnons dans la longue nuit de l’hivernage.
Le bon chien Salvator suivit à terre Isabelle et sa nourrice. Il n’aurait pu vivre éloigné de sa jeune et vaillante maîtresse.
Enfin, le 1er juillet au matin, le commandant Lacrosse, à la suite d’un banquet de « revoir » donné à bord de l’Étoile Polaire, après avoir serré-toutes les mains de ceux qui, les premiers, mettaient le pied sur la Terre Verte du nord, donna le signal du départ, promettant d’être de retour avant la fin du mois d’août.
Il y eut un moment d’indicible tristesse lorsque le steamer s’ébranla sous la première impulsion de son hélice. Quelle que pût être l’ardeur de ces explorateurs intrépides, ils ne purent envisager sans appréhension cette première séparation. Ceux qui restaient allaient faire la première expérience du séjour sur une terre désolée ; ceux qui s’éloignaient, au contraire, pourraient, une fois encore, toucher à des bords moins déserts et rentrer en communication avec la société, quelque rudimentaires qu’en fussent les misérables agglomérations.
Mais on avait la certitude d’un prochain revoir. On étouffa donc le malaise de cette scission préalable, et les débarqués s’occupèrent tout de suite à remplir le mieux possible le temps qu’ils avaient à passer avant la venue de l’hiver.
La première besogne fut celle de l’aménagement de la maison.
Celle-ci était un véritable chef-d’œuvre de mécanique industrielle et d’ordonnance hygiénique. Elle mesurait, dans son état actuel, et dépourvue des deux, ailes qui devaient la flanquer ou plutôt l’envelopper, un diamètre de 12 mètres, formant la corde du demi-cercle selon lequel elle était construite. Le diamètre de ses ailes devait gagner 3 mètres de plus à chaque extrémité de celui-ci. L’ensemble de la demeure représentait donc ainsi un cercle dont la seconde moitié devait déborder la première, tandis que la cour intérieure mesurait une aire de 6 m. 50 recouverte d’une toiture mobile.
La distribution de cet étrange édifice, assez semblable à nos panoramas, donnait naissance à un certain nombre de salles ou, plus exactement, de compartiments, habités par plusieurs locataires à la fois. Une de ces chambres, la mieux aménagée, était réservée à Mlle de Kéralio et à sa nourrice. Indépendamment de deux salles à manger inégales, l’une pour les officiers, l’autre pour l’équipage, la maison comprenait encore la cuisine commune, trois chambres à bains, un laboratoire de physique et chimie, un réduit d’observations astronomiques et météorologiques, une infirmerie, une pharmacie, soit ensemble dix pièces de service public et huit chambres.
Elle avait été ainsi conçue par M. de Kéralio et exécutée sur les plans qu’il avait mis une année à parfaire et à améliorer, avec le concours entendu et sagace du docteur Servan.
Ce fut donc avec un légitime orgueil que M. de Kéralio fit à ses compagnons, devenus en même temps ses hôtes, les honneurs de cette demeure provisoire qui, en bien des régions heureuses, aurait pu être définitive. Il s’étendit même avec complaisance sur les explications qu’il en donna.
« Veuillez considérer que notre logis est fait de morceaux scrupuleusement étiquetés et, par conséquent, aussi aisément démontables et transportables qu’ils ont été ajustés ici. Nous avons un double mur de planches, et le long de la paroi interne est plaqué un revêtement de toile goudronnée qui dissimule nos conduits d’air chaud destinés à combattre le refroidissement intérieur. Les deux murailles sont séparées par un vide de 25 centimètres en guise de chambre à air. Leurs surfaces intérieure et extérieure sont tapissées de couches de papier posées les unes sur les autres, et, pour plus de sécurité, nous allons revêtir nos cloisons de tentures de laine. »
Et, n’oubliant aucun détail, il montrait aux visiteurs émerveillés les colonnes de cuivre et d’acier soutenant la légère armature des charpentes, le jeu délicat des fermes laissant carrière à l’action des vents les plus violents par le glissement des angles sur leurs boulons, le grenier dominant toute la demeure, les plafonds percés de patins-glace pour utiliser la lumière du jour tout en supprimant les courants d’air inévitables des portes et des fenêtres, le plancher feutré soutenu par des traverses de fer revêtues de bois.
Un corridor circulaire, ou, mieux, une galerie mettait toutes les pièces en communication et permettait d’y accéder sans passer de l’une à l’autre par les portes intérieures.
Tandis que l’on visitait l’édifice dressé et aménagé en moins de quarante-huit heures, le chimiste Schnecker, qui observait toutes choses avec la plus curieuse attention, jeta tout à coup un cri de surprise.