
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'étaient deux beaux enfants, l'un brun et nerveux, grand et fort pour ses dix ans, l'autre blonde, fluette et menue, flexible et grêle. Ils jouaient de tout leur cœur, avec une exubérance de vie ardente, dans le beau parc verdoyant qui entourait la superbe villa. L'air pur et sain dans hautes vallées avait préservé leurs premières années de cette espèce de dépérissement, de flétrissure qu'inflige presque toujours le climat des pays chauds fils des blancs… "
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MON AMI
M. ALFRED BESNIER
CONSEILLER GÉNÉRAL DES CÔTES-DU-NORD
Affectueux souvenir.
P.M.
C’étaient deux beaux enfants, l’un brun et nerveux, grand et fort pour ses dix ans, l’autre blonde, fluette et menue, flexible et grêle. Ils jouaient de tout leur cœur, avec une exubérance de vie ardente, dans le beau parc verdoyant qui entourait la superbe villa.
L’air pur et sain des hautes vallées avait préservé leurs premières années de cette espèce de dépérissement, de flétrissure qu’inflige presque toujours le climat des pays chauds aux fils des blancs établis dans les colonies.
L’aîné était un robuste garçon répondant au nom de Michel, dont les traits fins et délicats n’en accentuaient que mieux l’énergie d’une physionomie étrangement virile chez un enfant de cet âge. De deux ans plus jeune, la petite Sonia, Russe comme l’indiquait son prénom, était une adorable fillette à la taille souple comme un jonc, aux yeux pétillants de malice ingénue.
Deux autres compagnons de jeux, plus remarquables encore, se mêlaient à leurs bruyants ébats.
L’un était un de ces chiens de montagnes que les Anglais ont acclimatés dans les chaînes des Highlands et qui doivent descendre de nos Pyrénées, gigantesque animal au poil fauve, soyeux et doux au toucher, à la tête énorme éclairée de deux larges prunelles intelligentes ; l’autre, un singe de petite taille, au pelage gris, rond et dodu comme une pelote de velours. Le chien se nommait Duc ; le singe obéissait à l’appellation de Bull, ou Boule, qu’on lui appliquait indifféremment. Celaient les jeunes, ou plutôt les vieux amis de Michel Merrien et de Sonia Rezowska.
Le petit Michel, en effet, était le fils adoptif et le neveu du célèbre voyageur français Jean Merrien et de sa femme Cecily Weldon, une Américaine vaillante et dévouée. Cinq ans plus tôt, Mer rien et sa compagne, liés seulement par une amitié qu’avaient resserrée et fortifiée les périls bravés et les fatigues endurées en commun, avaient accompli un véritable prodige de courage et de persévérance en escaladant le Gaurisankar. Divers rivaux, devenus, eux aussi, des amis les avaient suivis en cette périlleuse aventure. Hélas ! de ceux-ci plusieurs avaient succombé, et parmi eux on comptait le plus vaillant des hommes, le major Plumptre, un officier d’avenir dont l’Angleterre pleurait encore la perte.
Au retour de cette expédition, Jean Merrien avait épousé la jeune et charmante Américaine. Déjà riche de sa personne, l’explorateur s’était trouvé à la tête d’une fortune de nabab, et il avait formé le projet, approuvé ci partage par sa femme, d’en consacrer les énormes revenus à quelque généreuse entreprise qui servit à la gloire des races civilisées et au bonheur de l’humanité.
Mais, avant de fixer un but à ses efforts, Merrien avait emmené sa jeune femme en France. C’était là qu’il avait adopté le fils d’un frère aîné, orphelin de précoce intelligence, qu’il voulait élever dans les principes de sa généreuse philosophie. Après un an de séjour sur la terre natale, suivi d’un passage assez court au pays de sa femme, le voyageur avait repris le chemin de l’Inde, toujours escorté de son fidèle Euzen Graec’h, l’hercule armoricain dont il avait fait son ami.
Après quelques hésitations ; les deux époux, mettant d’accord leurs conceptions, d’ailleurs peu dissemblables, du rôle qu’ils se proposaient de jouer, s’étaient arrêtés au plan suivant : ils fonderaient, au nord de l’Inde, dans le voisinage de Dardjiling, sur les hauts plateaux dont la salubrité permet aux Européens de vivre dans des conditions hygiéniques analogues à celles de leur propre continent, un établissement à la fois sanitaire et commercial où, sans distinction de nationalités, les hommes d’énergie pussent unir leurs efforts pour propager les idées bienfaisantes et les progrès matériels qui font l’honneur des peuples de race blanche.
Ce que se proposaient, en outre, Jean Merrien et sa femme – mais de cela ils n’ouvraient point la bouche, – c’était d’entreprendre, aussitôt que l’occasion leur semblerait propice, un nouveau voyage de pénétration au travers de la barrière himalayenne jusqu’en ces régions à peu près inconnues, en cet « antre du mystère » qui se nomme le Tibet.
Et s’ils ne parlaient de ce projet à personne, c’était parce qu’ils tenaient compte des leçons d’une cruelle expérience.
Ils avaient présentes à l’esprit les terribles péripéties de leur précédente expédition ; de se rappelaient l’opposition aussi violente qu’acharnée des sectes religieuses de l’Inde, opposition dont ils avaient constaté l’opiniâtreté implacable et qui leur avait été funeste, même après sa défaite, dans la sanglante catastrophe où le major Plumptre avait trouvé la mort les obstacles parfois insurmontables dressés devant leurs pas par le mauvais vouloir des moindres chefs de village, des plus infimes gouverneurs de frontières. Et, instruits par ces épreuves personnelles, ils n’avaient pas voulu fournir aux malveillances du fanatisme le prétexte et l’occasion de préparer d’avance les machinations qui devraient faire avorter leur courageux, dessein.
Mais sans le divulguer inutilement, les deux époux jugèrent mile et pratique d’en préparer de longue main la réalisation, en se fixant eux-mêmes sur les lieux où ils allaient fonder la colonie, centre de leur rayonnement civilisateur, point de départ de la pacifique conquête qu’ils allaient entreprendre.
Ce fut dans ce but qu’accompagnés du Breton Euzen Graec’h et de l’Indien Salem-Boun, un serviteur du major Plumptre, que celui-ci leur avait recommandé, presque légué, sur son lit de mort, M. et Mme Merrien et le petit Michel se transportèrent à Dardjiling, d’abord, bientôt après à soixante kilomètres à l’est de la charmante ville, au pied du massif du Guariam et sur l’extrême frontière du Sikkim, en un territoire contesté sur lequel l’Inde anglaise exerçait déjà une autorité réelle, bien qu’elle ne fût pas encore nominale.
Merrien s’y fit délivrer une vaste concession de territoire, qu’il affecta sur-le-champ à diverses cultures rémunératrices, notamment à celle du thé. Il y exploita les bois d’essence précieuse, les pins des constructions maritimes, le teck, l’eucalyptus même importé d’Australie. En peu de mois, il eut rassemblé autour de lui un nombreux groupement de travailleurs et ouvert des débouchés à la vente de leurs produits. Rien plus : il fit de ce lieu d’élection le centre d’une sorte de colonie de bienfaisance, vers laquelle affluèrent les bonnes volontés laborieuses que le sort n’avait point favorisées. Il appela ses colons de tous les points de la vieille Europe et même de la jeune Amérique ; il les assujettit à une règle de fraternelle solidarité, et, en deux ans, il put voir le noyau primitif de onze ou douze fondateurs grossir jusqu’au chiffre encourageant de deux cent cinquante membres réunis en une sorte de phalanstère où la mutuelle estime fournit une base inébranlable à l’affection la plus solide, principe d’échange de services réciproques.
Alors, à la tête de cette force morale, il reprit les grands et nobles projets qu’il avait formés.
Parmi ces compagnons de la nouvelle cité des montagnes se trouvaient quelques-uns de ceux qui avaient partagé avec lui des périls et la gloire de sa première expédition dans l’Himalaya c’était ainsi que le docteur Mac-Gregor avait voulu s’établir, à son tour, dans ce qu’il appelait gaiement « Le royaume de Merrien » Il s’était fait construire une fort élégante villa et y avait ajouté, en guise d’annexes, une infirmerie agencée avec une parfaite entente du confortable. Un jeune chirurgien français, Paul Lormont, s’y occupait, à ses côtés, à tout organiser en prévision de maladies ou d’accidents qui, grâce à Dieu, leur laissaient, jusqu’ici, de nombreux loisirs. Si bien que le praticien anglais avait coutume de dire à son auxiliaire, en riant : « À ce régime, mon cher camarade, nous n’avons qu’à nous droguer et nous amputer réciproquement. »
Une autre personnalité se retrouvait dans le phalanstère du Tchoumbi, car c’était sur le territoire de cette vallée que Merrien avait fondé son établissement, dans une ravissante vallée arrosée par un affluent de la Tista.
Le Kchatryia Goulab, le chasseur expérimenté, homme de courage et de conseil, avait consenti, non à se fixer dans cette colonie de l’Himalaya oriental, mais à partager son temps entre le Kachmir, sa patrie toujours chère, et les régions qui avoisinent l’Assam et le Bhoutan.
Ainsi Jean Merrien et Cecily Weldon se retrouvaient en « pays de connaissance », selon l’expression consacrée. À ces amis éprouvés ils avaient vu se joindre des collaborateurs nouveaux, au premier rang desquels se plaçait le consul de Russie à Constantinople, M. Yvan Rezowski, père de la gentille compagne de jeux de Michel, Sonia Rezowska, qu’il idolâtrait d’une affection d’autant plus vive qu’il pleurait la perte de sa mère, morte quelques années auparavant.
Le site, d’ailleurs, était merveilleusement choisi parmi ces hautes vallées dont les Anglais ont fait le principal centre des sanatoires du Bengale, Placée an nord et à l’est de Dardjiling et de Tamlong, résidence du radjah du Sikkim, l’établissement fondé par Merrien se ressentait de cette latitude supérieure. La température y était aussi douce que dans les colonies anglaises de l’ouest, mais une forte chaîne transversale, s’appuyant d’une part sur les contreforts du Tchoumbi, de l’autre sur les assises du Guariam, arrêtait les moussons du sud dans la saison chaude et préservait les nouveaux planteurs des souffles brûlants et de l’excessive humidité dont souffraient leurs voisins.
À la faveur de cette clémence appréciable du ciel, les plantations réussissaient à merveille, et les quinquinas, si difficilement acclimatés aux environs de Dardjiling, prospéraient sans obstacle, mêlés aux arbres à thé et aux bois résineux des versants septentrionaux.
Et cependant, là encore, Jean Merrien avait pu constater la continuité des hostilités sourdes qu’il avait rencontrées déjà, au cours du son voyage à la découverte du Gaurisankar.
Les influences religieuses, venues du Nord comme du Sud, l’enveloppaient d’une trame de suspicions et de malveillances. Il se sentait surveillé, épié ; tous ses mouvements étaient connus, toutes ses intentions contrôlées. Les bouddhistes de la région, plus ou moins affiliés aux secrètes congrégations des ritualistes tibétains, observaient avec méfiante ses moindres actions. Bien que la nouvelle colonie eût enrichi la contrée par ses travaux et son commerce, ni les grands, c’est-à-dire l’entourage immédiat du radjah, ni le peuple, formé d’un mélange à peu près égal de Leptchas et de Bhoutias, ou Boutanais, ne voyaient d’un œil favorable la propagande des idées tentée par les blancs et la réelle amélioration apportée dans la vie matérielle des populations par leur progressive initiation à une bienfaisante activité.
Plusieurs fois, Mac-Gregor, et surtout le chikari Goulab, avaient informé Merrien de l’hostilité sourde qui croissait dans l’ombre à rencontre de ses projets et de ses généreux efforts. À diverses reprises, des avis menaçants, venus d’origines inconnues, avaient prévenu le Français qu’il aurait à se repentir de son audace civilisatrice. L’Inde du Nord ne voulait pas des bienfaits de cette civilisation qu’il prétendait lui imposer malgré elle et elle saurait bien s’affranchir de l’esprit d’émancipation que les blancs s’appliquaient à souffler aux races abâtardies de la frontière tibétaine.
Merrien avait longtemps espéré que les autorités anglaises seraient ses auxiliaires et soutiendraient sa tentative.
Force lui avait été de reconnaître ce qu’une telle espérance avait d’illusoire.
L’œuvre qu’il avait entreprise ne pouvait être encouragée et, à plus forte raison, soutenue par l’Angleterre. Deux motifs y mettaient obstacle : il était Français et il était catholique. La présence même du docteur Mac-Gregor ne suffisait pas à lui assurer le concours des agents de la Grande-Bretagne. Mais, du moins, de ce côté, Merrien savait-il qu’il pouvait compter sur une impartialité plutôt bienveillante.
Telle était la situation du phalanstère de Tchoumbi au moment où s’ouvre ce récit. Quatre années d’efforts persévérants, de mutuelle confiance, secondés par toutes les ressources de l’industrie européenne que la fortune du jeune ménage avait permis à celui-ci d’utiliser dans l’intérêt même de la colonie, avaient amené le nouveau groupement à prendre l’extension vraiment considérable qui en faisait, actuellement, l’un des centres les plus importants du nord de l’Inde. Et, chaque jour, le noyau européen voyait grossir à ses côtés la population indigène qu’attirait l’espoir promptement réalisé de trouver à ce foyer une chaleur de vie rayonnante, capable de l’arracher aux misères de sa condition sous le joug oppresseur et spoliateur des tyrannies locales.
C’était dans ce milieu qu’avaient grandi côte à côte Michel Merrien et Sonia Rezowska. Les deux enfants s’étaient liés d’une tendresse fraternelle. Études et jeux leur étaient communs et chacun d’eux trouvait dans l’autre une sorte d’aide et d’appui qui les faisait s’unir plus étroitement, avec une conception des devoirs et des joies de l’existence bien supérieure à l’ordinaire notion qu’en peuvent acquérir des enfants de cet âge.
Ce jour-la, tout au début de l’hiver, au sortir des grandes pluies d’octobre, ils prenaient leurs ébats sur une verte pelouse établie en tapis sur les pentes doucement inclinées des mamelons qui s’élèvent progressivement sur les flancs du gigantesque Guariam. Le ciel, très clair, leur permettait de voir étinceler au-dessus de leurs têtes les glaciers et les aigrettes de neige de l’énorme glacier hérissé de pics éblouissants. L’horizon, étroit et borné de la vallée au niveau du sol, s’échancrait et se développait au-dessus des premiers contreforts, et l’uni pouvait s’y perdre dans la variété des fonds étagés en ferrasses, grandissant au-dessus des masses vert sombre des forêts, se creusant en gorges profondes, en cluses resserrées, s’estompant dans les teintes brumeuses et bleuâtres des crêtes superposées. Et, de la sorte, le regard s’élevait comme sur les degrés d’un amphithéâtre, pour aller, de proche en proche, par-delà les cimes neigeuses, se perdre dans l’azur immaculé du firmament.
C’était dans ce cadre d’un féerique décor que les deux enfants s’abandonnaient joyeusement aux plaisirs de leur fige, partages par Boule et par Duc avec un entrain qui ne le cédait en rien à celui de leurs jeunes maîtres.
Du haut de la véranda qui dominait le toit de la villa, Mme Merrien pouvait surveiller de l’œil, à distance, les folles courses et les soudaines éclipses du petit couple plein de vie fougueuse. Car, sur ce terrain montueux et accidenté, les plis et les ravins étaient fréquents, expliquant les promptes disparitions des quatre joyeux camarades.
Un moment, lassés, sans doute, mais prêts à recommencer leurs ébats, les deux enfants interrompirent leurs steeple-chases fantaisistes pour se reposer sur un banc de gazon, à l’ombre d’un bouquet de cèdres dont les troncs robustes étaient ceints d’un véritable buisson d’orchidées et de fougères arborescentes.
Et, tout de suite, une conversation animée fournit la digression et le délassement à ces jeux fatigants :
« Sonia, demanda Michel à sa compagne, est-ce que tu n’as pas remarqué quelque chose ? »
Et, comme elle ouvrait de grands yeux surpris, il poursuivit :
« Oui. Ne trouves-tu pas qu’il y a longtemps que Miles Turner n’est pas venu nous voir ? »
La petite fille tressaillit.
« C’est vrai, ce que la dis là, Michel. Ce bon Miles ! Voilà près d’un mois que nous ne l’avons vu. »
Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ajouta, avec une véritable tristesse dans la voix :
« Pauvre Miles ! Chaque fois qu’il vient, il nous apporte un cadeau à sa manière. Il est peut-être malade !
Le garçonnet appuya, avec un sérieux plein d’observation :
« Ce ne serait pas étonnant, Sonia, car il mène une singulière existence, ce pauvre homme. Mon oncle racontait l’autre jour, à table, que Miles Turner est obligé de se cacher parce que les agents anglais te prendraient pour le mettre en prison. Il paraît qu’il a été condamné autrefois, qu’il s’est échappé, et que depuis lors il court les bois, vivant uniquement du produit de sa chasse.
– Oh ! mon Dieu ! prononça la fillette en joignant les mains, notre ami Miles a été condamné ?
– Oui, Sonia. Du moins, c’est ce que j’ai entendu raconter à mon oncle. »
Ils n’avaient pas achevé ce dialogue, qu’un sifflement très doux se fit entendre à la lisière des bois qui entouraient le parc. Un même cri de joie jaillit de la poitrine des deux enfants, et ils s’élancèrent vers le versant du coteau.
« Il y a un proverbe français qui dit : Quand on parle du loup, on en voit la queue », fit gaiement Michel Merrien.
Et il entraîna en courant sa campagne vers la bordure des grands arbres.
Sans crainte aucune, les enfants franchirent la clôture du parc et pénétrèrent sous le couvert des ramures épaisses.
Ils y marchèrent pendant quelques minutes et s’arrêtèrent en une clairière assez vaste dont le tapis de gazon dur et serré, n’eût été l’humidité du sol, n’aurait pu offrir une couche meilleure aux vagabonds de ces régions paisibles.
Soudain une forme humaine se détacha du tronc d’un ébénier et s’avança vers eux.
C’était un homme de haute taille et dont le misérable accoutrement ne cachait point les formes herculéennes. Vêtu de lambeaux de cotonnade, chaussé de fortes bottes, le nouveau venu abritait sous un chapeau de paille en pitoyable état une chevelure inculte et une barbe hirsute. Seules une carabine jetée en bandoulière et si bien entretenue qu’elle en paraissait neuve, une cartouchière de cuir fauve et une ceinture de peau de daim formaient un contraste stupéfiant avec cette défroque lamentable.
« Miles, mon bon Miles ! » s’écria Sonia, en courant, les mains tendues, vers le nouvel arrivait.
Michel, qui la suivait, semblait plus réservé en sa confiance et gardait un peu de froideur.
La figure rébarbative de l’outlaw s’était éclairée d’un bon sourire. Il prit les mains que lui tendait la fillette et les baisa respectueusement. Puis il s’assît sur l’herbe et se mit à considérer les enfants avec une sorte d’attendrissement.
« Savez-vous, petite Sonia, murmura-t-il, que vous avez failli ne plus revoir votre vieux Miles ?
– Oh ! se récrièrent les deux enfants, avec un geste d’incrédulité.
– Oui, reprit le vagabond. Un tigre a manqué me manger. Il m’a mis pour quinze jours sur le flanc. Mais, n’importe ! le bon Dieu m’a protégé. J’ai eu sa peau, et je l’apporte pour payer les cartouches dont j’ai le plus grand besoin. Est-ce que votre père voudra encore m’en donner, monsieur Michel ? »
Il demandait cela doucement, presque humblement, en une langue mêlée d’anglais et de mauvais français. Il était manifeste qu’il n’employait ce dernier que pour faire plaisir ; à ses jeunes interlocuteurs, par précaution oratoire.
Michel répondit, non sans quelque hésitation :
« Je ne sais pas, monsieur Miles, si mon oncle voudra vous donner des cartouches. Parce que vous savez que c’est mon oncle, et non pas mon père, comme vous dites.
– Oh ! vous le lui demanderez bien, mon petit Michel, supplia le malheureux. La peau que j’apporte est fort belle. Elle vaut au moins douze cents roupies sur le marché de Calcutta. Tenez, je vais vous la montrer. »
Et le pauvre diable, suivi par les enfouis, revînt vers l’arbre qu’il avait quitté l’instant précédent, et ramassa sur le sol un paquet volumineux enveloppé d’une mauvaise toile. Quand il eut dénoué celle-ci, il étala aux regards émerveillés de ses petits compagnons une admirable peau de tigre mesurant 2 m. 80 du museau à l’extrémité de la queue, selon la manière d’évaluer des chasseurs et des pelletiers.
« Voilà ce que j’apporte, mon petit Michel. Vous voyez qu’il y a là de quoi payer plus de dix mille cartouches et je n’en demande que trois cents de chaque espèce : menu plomb et balles.
– Je ne sais pas, monsieur Miles, je ne sais pas, répéta l’enfant en proie à une évidente perplexité.
– Et pourquoi votre oncle, qui a été si bon jusqu’à présent, ne voudrait-il plus, monsieur Michel ?
– Parce que j’ai entendu dire à mon oncle qu’on n’avait pas le droit de vous en donner, que vous étiez un échappé de prison. »
C’était une douloureuse parole et qui prenait une sévérité plus grande, ainsi prononcée par cette bouche d’enfant. L’outlaw baissa la tête et de grosses larmes se mirent à couler sur ses joues bronzées par le hâle du grand air et de l’implacable soleil.
« My God ! pleurait-il, my God ! Qu’est-ce que je vais devenir si l’on ne me donne pas de munitions. C’est me condamner à mort, à mourir de faim ! Car voilà quatre ans que je vis dans la montagne et jamais je n’ai fait de mal à personne. C’est vrai ! j’ai été condamné, mais, enfin, j’ai payé ma dette et ce n’est pas juste que je retourne en prison quand je ne demande qu’à vivre en honnête homme, quand je ne réclame que ma liberté ! »
Sa douleur faisait mal à voir. Spontanément Sonia saisit les mains de misérable.
« Il ne faut pas pleurer, monsieur Miles, il ne faut pas pleurer, Michel ne vous a pas dit qu’on ne vous donnerait pas de cartouches. Il les demandera pour vous et je les demanderai aussi, et monsieur Merrien vous en donnera. N’est-ce pas, Michel, que tu demanderas ?
– Oui, Sonia, oui, monsieur Miles, nous demanderons, répondit Michel, dont les paupières humides trahissaient l’émotion.
– Il faut aller les demander tout de suite, Michel fit encore la petite Russe. Attendez-nous là, mon bon Miles. »
Et, soulevant dans ses bras Boule, qui s’était tenu perché sur son épaule, elle reprit en courant le chemin de la villa.
Pour y rentrer, il était plus avantageux de faire un léger détour par une sorte de chemin creux qui menait tout droit à la maison. Sous un rideau de verdure, une véritable voûte de feuillage, la route s’encaissait profondément entre deux larges pans de rochers qu’on eût dits coupés à la scie, tant leurs rigides parois étaient lisses et nettement tranchées.
Ce chemin avait été interdit aux deux enfants, soit, qu’on en redoutât l’ombre toujours humide et trop fraîche, soit parce qu’il dirait un abri facile aux reptiles et aux insectes venimeux, assez Communs en cette région où la Jaune et la flore des tropiques se mêlent à celles des climats tempérés. Très obéissants, Michel et Sonia n’avaient jamais enfreint cette prohibition.
Mais, en ce moment, sous l’impulsion de leurs cœurs pleins d’émoi, troublés par le chagrin du malheureux Turner et pressés d’y porter la consolation, ils estimèrent que la voie la plus courte était la meilleure, et que leurs parents ne leur tiendraient pas rigueur d’avoir fait fléchir la loi devant l’exception de la charité.
Ils coururent donc tout d’une traite jusqu’au chemin creux et s’y engagèrent sans autre réflexion.
Sonia, qui avait pris les devants, était stimulée par le désir généreux d’arriver la première, afin d’être la première à solliciter la pitié de M. Merrien. Mais Michel, honteux de son hésitation, la serrait de près, ayant cru remarquer que l’exhortation de sa compagne contenait une nuance de reproche.
Brusquement, le pied de la jeune fille heurta contre un obstacle imprévu, et la fit trébucher.
Mais elle n’eut pas même le temps de s’en apercevoir. Un manteau sombre, une couverture de laine s’abattit sur sa tête. Elle en fut enveloppée si promptement qu’elle ne put même abandonner le petit singe qu’elle portait dans ses bras, et se sentit enlever d’un effort vigoureux sans même se rendre compte de ce qui lui arrivait.
Michel, lui, avait vu toute la scène.
Au moment où la fillette avait trébuché, une ombre avait surgi des côtés du ravin. Un homme entièrement nu s’était élancé sur elle, déployant l’ample étoffe qui avait servi à envelopper l’enfant.
Mais le petit garçon n’avait pas eu le temps d’en voir davantage.
Lui-même venait d’être saisi par derrière, tandis qu’une main lui fermait la bouche pour l’empêcher de crier.
Alors, en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, les deux enfants avaient été emportés par deux hommes trapus et robustes et ramenés dans les bois. Là, les ravisseurs avaient rejoint toute une bande et, avec elle, s’étaient rapidement éloignés dans la direction de l’est, vers la vallée du Tchoumbi.
Peut-être l’audacieux enlèvement serait-il resté longtemps ignoré, si Mme Merrien, qui, du haut de la terrasse, surveillait les jeux des enfants et les avait vus revenir par le chemin creux, ne s’était alarmée du temps qu’ils mettaient à en sortir. Elle avait appelé un behra indou auquel elle avait donné l’ordre d’aller voir à l’entrée du ravin couvert si les enfants ne s’attardaient point dans ces parages réputés dangereux.
Le domestique était revenu disant qu’il n’avait point aperçu les deux baba (enfants).
La jeune femme avait pris peur. S’arrachant elle-même à sa quiétude, elle avait couru jusqu’aux abords du passage interdit. En un instant, tout le personnel de la maison avait été sur pied. Au milieu de l’universelle désolation, les premières recherches n’avaient été que confusion et désordre. Mais, bientôt, Jean Merrien, accompagné de M. Rezowski, de Graec’h et du docteur Mac-Gregor, était accouru. Toute la colonie européenne s’était assemblée en armes et d’intelligentes battues avaient été organisées sur-le-champ.
Hélas ! elles avaient été vaines. Tous les efforts étaient demeurés infructueux, et la soirée s’était achevée sans résultat.
Sans résultat n’est point le mot exact. Les battues avaient donné lieu un incident pénible : l’arrestation un peu brutale du malheureux Miles Turner.
Car l’infortuné vagabond n’avait point quitté la clairière où avait eu lieu son entrevue avec les enfants. Il attendait leur retour, en proie à une poignante incertitude, partagé entre la crainte et l’espérance. Accorderait-on à son dénuement le misérable secours qu’il sollicitait et duquel dépendait sa vie ?
Au lieu des aimables messagers, porteurs attendus de la bonne nouvelle, l’outlaw n’avait vu revenir que des hommes au visage décomposé par l’inquiétude et la colère. Ils sciaient jetés sur lui sans même prendre la peine de te questionner, tous les soupçons étant excusables on pareille circonstance, surtout à l’encontre d’un fugitif hors la loi et, par là même, trop sujet à caution. Sa redoutable vigueur avait écarté les premiers assaillants. Mais il avait trouvé en Euzen Graec’h un adversaire digne de lui. Le colossal Breton l’avait terrassé, et, garrotté étroitement, Turner avait été ramené à la villa pour y être interrogé par les juges improvisés de la nouvelle colonie.
« Je te reconnais, lui avait dit durement Merrien. Tu es ce Miles Turner auquel nos pauvres enfants accordaient si imprudemment leur sympathie. C’est ainsi que tu reconnais les services qu’on t’a rendus ?
– Avant de m’accuser, répondit le prisonnier sur le même ton, vous feriez mieux de me dire ce que vous me reprochez »
Il avait fait cette réponse d’un accent calme qui dénotait au premier abord l’innocence. Les assistants en furent frappés.
Merrien expliqua alors au pauvre diable la disparition des enfants. Il insista sur l’entrevue qu’ils avaient dû avoir avec le vagabond. Turner ne nia point. À son tour, il raconta les détails de cette entrevue et le motif généreux qui avait déterminé les enfants à lui conseiller d’attendre leur retour dans la clairière où on l’avait arrêté.
Brusquement, ses yeux se mouillèrent et il s’écria, les larmes dans la voix :
« Et vous avez pu croire que j’étais assez vil, assez lâche pour nuire à ces deux chères créatures les seules que j’aie aimées et qui m’aient accordé leur pitié depuis que je mène l’effroyable existence à laquelle je suis réduit ? »
Sa voix émut les juges. Merrien prit à part ceux qui assistaient à l’interrogatoire.
« Cet homme dit certainement ta vérité, messieurs », prononça-t-il d’un accent de conviction.
En ce moment, d’ailleurs, l’attestation de Turner fut confirmée par l’intervention d’un témoin digne de foi.
C’était le babourchi Salem-Boun qui accourait essoufflé, annonçant que des traces de pas venaient d’être relevées sur les versants orientaux de la montagne. Mais, plus que tout autre témoignage, un évènement significatif venait de se produire.
Le domestique de M. Rezowski, un Leptcha d’une fidélité à toute épreuve, entrait, tenant à la main un rouleau de bambou entouré d’une bandelette de parchemin sur laquelle étaient tracés péniblement, en langue anglaise, ces mots trop pleins de sens :
« Vous ne reverrez pas les enfants tant que vous n’aurez pas quitté le pays. »
Il y eut d’abord une profonde stupeur dans l’assistance à la lecture du message par lequel les ravisseurs, se dénonçant eux-mêmes en quelque sorte, signifiaient leur ultimatum à Merrien et à ses compagnons.
« Vous ne reverrez pas les enfants tant que vous n’aurez pas quitté le pays. »
Ces deux phrases, très claires dans leur signification littérale, étaient pleines d’obscurité à la réflexion.
Et d’abord fallait-il en restreindre le sens ? À qui s’adressait cette mise en demeure ?
Au premier coup d’œil, il semblait qu’elles ne visassent que Jean Merrien et l’ancien consul de Russie.
Car Michel était le neveu de l’explorateur français, et Sonia la propre fille de M. Rezowski.
« C’est nous seuls que vise la menace », prononça douloureusement le malheureux père, en s’adressant à son ami.
Jean ne répondit pas sur-le-champ. Il hocha la tête néanmoins. Puis, après quelques minutes de silence, il dit :
« Messieurs, je crois qu’il y a là matière à discussion. Je vous demande donc de vous unir à moi pour essayer de sonder ce mystère. Avant toute résolution, il me paraît indispensable de concentrer nos efforts et de mettre en commun toutes nos lumières. Tenons donc conseil sur l’heure, afin de pouvoir agir au plus tôt. »
Il entraîna ses compagnons dans le vaste et confortable cabinet de travail où il avait coutume d’élaborer les projets qui concernaient l’agrandissement et la prospérité de la colonie. On laissa Miles Turner sous la garde de deux robustes Leptchas, en attendant qu’on eût statué sur son sort, et, tout aussitôt, les avis furent ouverts.
Autour de la grande table qui servait de pupitre à Merrien, prirent place M. Rezowski, le docteur Mac-Gregor, son aide et ami, le chirurgien français Lormont, Euzen Graec’h, Goulab, arrivé de Srinagar depuis la veille, l’Américain Morley, autre survivant de l’expédition du Gaurisankar, et le babourchi Salem-Boun.
Malgré l’immense chagrin qui l’accablait, Mme Merrien avait tenu à prendre part au conseil ainsi réuni. C’était une femme forte, et elle comprenait que l’heure n’était pas aux inutiles lamentations.
On ouvrit donc les discussions les plus diverses sur l’évènement. L’essentiel était d’agir au plus tôt.
La première question qui se posa fut relative aux mystérieux avis qu’on venait de recevoir.
L’épître, écrite en fort médiocre anglais, avait été tracée par une main manifestement inexperte.
En l’examinant de très près, M. Rezowski, qui avait étudié la graphologie, conclut que les caractères avaient été péniblement assemblés par la plume maladroite d’un Indien.
Les raisons qu’il donna d’un tel jugement étaient absolument probantes.
« Voyez, fil-il en suivant du doigt les jambages hésitants des lettres, il est évident que la main qui a tenu la plume est habituée à écrire de gauche à droite, ce qui apparaît dans la raideur des signes en écriture droite, dans l’absente des liaisons et la rupture des mots. Obligé de renverser la marche, le scribe a mis sur sa copie, à défaut de sa signature individuelle, celle de sa race et le sceau de sa propre éducation. »
Le chikari Goulab appuya cette sagace induction, et tout le monde se rangea à l’opinion des deux hommes.
« Oui, insista le Kachmiri, il est certain que ce n’a été là qu’un, grossier subterfuge pour nous entraîner sur une fausse piste. Les ravisseurs ne sont pas des Anglais, ainsi qu’ils ont essayé de nous le faire accroire, mais bien des natifs qui, aujourd’hui comme il y a cinq uns, poursuivent soit une œuvre de vengeance personnelle, soit une action d’hostilité religieuse. C’est donc de ce côté que doivent se tourner nos recherches. »
Mac-Gregor hocha la tête et demanda au Kchatryia avec un peu d’incrédulité :
« Mon cher Goulab, je fais le plus grand cas de votre jugement. Mais autant je trouverais votre hypothèse admissible, si nous habitions l’occident de l’Inde, ou même les frontières du Népal, autant je la crois erronée en ce pays, à cette bordure extrême du Sikkim et du Bhoutan.
– Et pourquoi vous paraît-elle erronée, docteur ? questionna à son tour le chikari.
– Parce que, mon excellent ami, c’est bon aux fidèles du brahmanisme – je parle des séries violentes et fanatiques – de poursuivre par de tels moyens la destruction de leurs adversaires. Mais vous ne devez pas oublier qu’ici nous n’avons autour de nous que des bouddhistes et, même, des sectateurs d’un bouddhisme fort atténué, si je puis m’exprimer ainsi. Ni les Leptchas, ni les Bhoutias ne sont hommes à faire une guerre religieuse. À défaut de tout autre précepte, ne trouvent-ils pas la tolérance et la résignation enseignées par leur propre religion ? »
Goulab ne parut nullement ébranlé par cette objection pourtant sérieuse du docteur.
« Vous auriez absolument raison, répondit-il, si le fanatisme était redouté par nous dans le peuple. Or ce n’est pas la population que j’accuse. Il n’y a pas meilleurs hommes au monde que les Leptchas, ni plus indifférents que les Bouthias. Ces derniers, d’ailleurs, sont, par intérêt même, les amis des étrangers. Ne vouez-vous pas d’ouvrir un véritable asile à tous les fugitifs qui se dérobent à la tyrannie du radjah ?
– Mais qui donc accusez-vous, alors, Goulab ? » interrogea Mme Merrien.
Le Kachmiri répondit gravement, selon son habitude, en pesant tous ses mots :
« Si je n’accuse pas le peuple, je puis au moins soupçonner les chefs de ce peuple.
– Mais, interrompit Merrien, les chefs, ici, ce sont les représentants du radjah, sous la surveillance anglaise. »
Goulab eut un fin sourire.
« Oui, sous la surveillance anglaise, comme vous dites. Mais tout le monde sait que cette surveillance est uniquement politique et que le gouvernement a trop à faire de tenir en bride les velléités de révolte des petits princes tributaires pour leur donner des motifs de querelles et des prétextes à rébellion en soutenant tous ses sujets européens dans leurs revendications, même les plus légitimes. »
Il y avait dans les paroles une pointe d’ironie si visible, que le docteur Mac-Gregor crut devoir protester.
« Mon cher Goulab, dit-il avec quelque sévérité, je ne m’attendais pas à une telle insinuation de votre part.
– Docteur, répliqua le chikari en liant, on peut être bon sujet de Sa Majesté Britannique et critiquer son gouvernement. »
Ce n’était pas le moment d’une discussion. M. Rezowski le fit remarquer avec un peu de vivacité.
« Messieurs, dit-il, les circonstances nous pressent. Ne perdons point notre temps en discussions acerbes. Je prie Goulab de nous expliquer clairement sa pensée en nous faisant connaître la nature et l’objet de ses soupçons. »
Ainsi mis en demeure, le Kchatryia s’expliqua sans ambages comme sans réticences.
La raison de ses craintes était Fort judicieusement déduite d’un ensemble d’observations concluantes.
C’est, en effet, un objet de remarque qui n’échappe point aux Européens de sens droit que, depuis ces dernières années surtout, la surveillance des frontières de l’empire britannique aux Indes se fait de plus en plus étroite et tracassière.
Les Lamas du Tibet, jadis tolérants, accueillants même pour les voyageurs blancs, se montrent, de nos jours, jaloux de leurs prérogatives et semblent redouter une sorte d’invasion morale de la part des religions de l’occident.
Depuis les frères Schlagintweit, les jésuites Huc et Gabet, le Russe Prjevalski, aucun voyageur de marque n’a pu franchir les bornes du mystérieux État qui s’enferme entra les monts du Karakoroum, l’Himalaya et le Kouen-Lun sur trois de ses côtés et les sources à peu près inconnues des grands fleuves orientaux, l’Irraouaddi, la Salouen, le Mékong, le Ménam, le Hoang-Ho, le Ta-Kiang et le Yang-Tsé-Kiang. À l’intérieur de ce long trapèze aux angles arrondis, c’est le domaine de l’hypothèse, le champ ouvert à toutes les suppositions, huître du mystère en ce qu’il peut avoir de plus stupéfiant, de plus effrayant même, et le courage moral est aussi nécessaire que l’endurance physique aux hardis investigateurs qui y veulent pénétrer.
Or, à juger froidement la situation, on se rend aisément compte de l’hostilité des Lamas.
Le bouddhisme, en effet, pour les races diverses qui habitent les plus âpres vallées et les plus hauts plateaux du Tibet, n’est pas seulement une religion, c’est une constitution politique. La théocratie s’est fait une citadelle de ces régions presque inaccessibles, qu’elle est résolue à défendre avec une ténacité d’autant plus acharnée, qu’elle doit à ses concessions du passé d’avoir perdu un hou tiers de son premier territoire. Car, au point de vue de la logique naturelle, les hautes vallées de l’Indus et du Gange, avec leurs affluents principaux, le Djhilam, le Satledj, la Gogra, les Koçi, soit, la moitié du Kachmir, les États, aujourd’hui tributaires de l’Angleterre, tels que le Népal, le Sikkim et le Bhoutan, font partie du Tibet primitif, dénommé Bod-Youl par ses habitants, nom que l’un retrouve aisément dans les mots Bhot-tan et Bhou-tân, terre des Bod.
On s’explique donc sans effort l’animadversion de la Caste sacerdotale pour l’introduction de tout élément étranger.
Il est évident, en effet, que le bouddhisme des Lamas serait en mauvaise posture en face du christianisme.
Et parmi toutes les confessions chrétiennes, c’est dans le catholicisme qu’il rencontre son plus redoutable adversaire.
Comme le catholicisme, la religion des disciples plus ou moins stricts observateurs des préceptes de Çakya-Mouni a un pape, le Dalaï-Lama, dont lassa est la résidence officielle ; elle a des prêtres réputés tous saints et savants, des monastères et des couvents pour les fidèles des deux sexes, des cérémonies pleines de pompe et d’éclat, des livres sacrés, des pratiques pieuses, des jeunes et des abstinences, des pénitences rigoureuses, de longues prières et tout un enseignement à la fois symbolique et pratique, dont la similitude avec celui du catholicisme a longtemps fourni à certains esprits cette opinion que le catholicisme n’était et ne pouvait être qu’un frère puîné du bouddhisme. On comprend que ces nombreux points de contact fournissent matière à réflexions graves aux Lamas du Tibet.
Ceux-ci sentent, assurément, combien le voisinage d’une religion plus rationnelle peut nuire à la leur, surtout si le peuple, qui ne s’attache qu’aux pratiques rituelles et superstitieuses, accepte une croyance qui ne changerait rien à ses habitudes. Dès lors, la prudence étant, comme l’assure le proverbe, la « mère de la sûreté », il est normal que les ministres des Lamas de Lassa et de Chigatsé appliquent tous leurs efforts à éloigner d’eux une concurrence fatalement désastreuse.
Telles furent les considérations pleines de sens invoquées par le Kchatryia Goulab.
Il n’eut pas de peine à réunir tous les avis en un commun assentiment. Sa parole avait éclairé les esprits.
« Tout ça, c’est très bien, opina Euzen Graec’h. Mais nous ne devons pas nous attarder.
– D’autant, appuya Salem-Boun, que si l’avis de Goulab est fondé c’est à l’ensemble de la colonie que s’adresse le défi.
– Il faut donc savoir au plus tôt quelle route ont pu prendre les ravisseurs », ajouta le jeune chirurgien Lormont.
Ces mots mettaient le problème au point. Il ne s’agissait pas tant de connaître les intentions que l’itinéraire des bandits.
Là les avis furent partagés.
Le plus grand nombre estimèrent que les voleurs d’enfants avaient dû prendre la route du nord-est, celle de Chigatsé, en ce moment de l’année surtout, étant l’objet d’une surveillance trop active.
« Le Tachi-Lama, fit observer Mac-Gregor, n’a aucune raison d’être désagréable au gouvernement anglais devenu son trop proche voisin, surtout depuis que la présidence du Bengale construit la route de Dardjiling au Tibet.
– Cela me paraît évident, dit Merrien. D’ailleurs, ce chemin est par lui-même trop difficile.
– C’est donc au nord-est que nous devons courir, appuya Goulab, à travers Tchoumbi, pour regagner l’avance que ces coquins ont sur nous et leur fermer les voies de fuite vers la Chine. »
Il ajouta avec toute la force du bon sens :
« Mais avant tout, il me semble urgent de prévenir les autorités du Dardjiling, afin qu’elles prennent des mesures immédiates. »
Une fois encore, le sentiment du chikari prévalut, et l’on décida sur l’heure renvoi d’un messager spécial à Dardjiling.
En attendant son retour, qui ne pouvait avoir lieu que le surlendemain au plus tôt, il fut décidé qu’une première colonne, courant au plus pressé, partirait vers l’est, à travers la vallée de Tchoumbi. Un courrier spécial porterait à cette colonne l’autorisation écrite du radjah de Tamloung, indispensable pour aplanir les difficultés des frontières.
Mais quels seraient les hardis chasseurs qui composeraient cette première expédition ?
Il va sans dire que tous, parmi les assistants, voulaient en faire partie.
Mais Euzen Graec’h, appuyé par le prudent Goulab, objecta qu’une telle mission ne pouvait être confiée qu’à des hommes aussi résolus qu’habiles à se dissimuler pour mieux surprendre les secrets de leurs adversaires. Trop nombreux, ils seraient promptement signalés et, par conséquent, dépistés. L’essentiel, dans cette chasse à l’homme, n’était-il pas, tout d’abord, de retrouver la trace des enfants et des ravisseurs ?
Ce sentiment fort sage fut néanmoins l’objet d’une discussion. Merrien, résumant les débats et forçant, même la conclusion, décida que, sur-le-champ, la colonne se formerait de trois petits groupes marchant à une demi-journée de distance l’un de l’autre, afin de maintenir entre eux les communications nécessaires à leur réussite.
Le premier groupe ainsi formé se composa de Jean Merrien lui-même, d’Euzen Graec’h et de Goulab.
Le second comprit le docteur Mac-Gregor, M. Rezowski et un domestique leptcha, du nom de Saï-Bog, attaché à sa personne depuis une dizaine d’années et dont la fidélité lui paraissait être à toute épreuve.
Le troisième, destiné à ne se mouvoir que plus lentement, comprenait Morley, l’ancien serviteur de miss Cecily Weldon, du babourchi Salem-Boun et de l’héroïque jeune femme elle-même, qu’aucune objection ne put détourner du projet formé par elle de prendre sa part des fatigues et des dangers à courir.

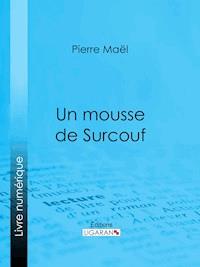














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












