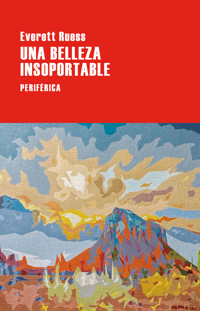Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
En 1930, âgé d’à peine quinze ans, un jeune Californien du nom d’ Everett Ruess entreprend seul une série de voyages au cœur des déserts de l’Ouest américain, encore peu connus à l’époque. Au cours des mois qui suivent, il entretient une correspondance nourrie avec sa famille et quelques amis, relatant ses pérégrinations et ses rencontres, partageant ses réflexions sur la vie et la nature. Puis soudain, en 1934, il disparaît sans laisser de traces. Une disparition mystérieuse dans les canyons rouges de l’Utah, qui reste inexpliquée à ce jour. Seules nous sont parvenues ses lettres et notes de journal écrites au cours de ces cinq années de voyages. Ici compilés, ces écrits révèlent un jeune homme étonnant, nimbé de mystère et d’une surprenante maturité, un écrivain sensible en parfaite communion avec la nature sauvage dans laquelle il s’est plongé. La vie et la disparition d’Everett Ruess sont une des mystérieuses légendes de l’Ouest américain. Ce livre offre la première édition française d’une sélection de ses textes, dont jaillit l’idéalisme romantique de la jeunesse et l’émerveillement de la nature. PREFACE DE JON KRAKAUER
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préface
Au printemps 1992, un garçon de vingt-quatre ans originaire de la banlieue de Washington, soucieux de mieux se connaître en s’imposant un défi, se rendit en stop vers l’Alaska et s’enfonça dans la nature sauvage pour y vivre en autarcie. Il s’appelait Chris McCandless. Avant de s’enfoncer seul dans les fourrés, il envoya une carte postale à un ami, avec ces mots enjoués :
« Salut de Fairbanks ! C’est la dernière fois que tu as de mes nouvelles, Wayne. Merci de renvoyer tout mon courrier à l’expéditeur. Beaucoup de temps risque de passer avant que je ne regagne le Sud. Si cette aventure s’avérait fatale et que tu n’avais plus de mes nouvelles, sache que tu es un type merveilleux. À présent, je m’enfonce dans la nature. »
Quatre mois plus tard, des chasseurs d’élan découvrirent les restes faméliques de McCandless près de la frontière septentrionale du Parc national du Denali. Le magazine Outside me demanda d’écrire un article sur cette tragédie, propos plus tard amplifié jusqu’à devenir un livre, publié en 1996 sous le titre Into the Wild.
À l’été 1993, alors que je menais mes recherches pour ce livre et que j’en parlais au téléphone avec le fameux alpiniste et auteur David Roberts, il remarqua : « Tu sais, l’histoire de McCandless me fait beaucoup penser à celle d’Everett Ruess… » Je dus confesser que j’en ignorais tout.
Stupéfait de l’entendre, il m’exhorta à me procurer Vagabond de la beauté, choix de lettres et de notes de journal intime édité par W. L. Rusho, publié une dizaine d’années plus tôt. Aussitôt après avoir raccroché, je me ruai à la librairie et achetai ce livre qui me tint éveillé toute la nuit. Au lever du soleil, je compris la justesse du propos de Roberts : à bien des égards, la ressemblance entre les vies des deux jeunes gens était extraordinaire.
Ruess a disparu en 1934, à l’âge de vingt ans, alors qu’il faisait une expédition solitaire dans le pays des canyons rouges du Sud de l’Utah – à l’époque, c’était une étendue sauvage saturée d’une mystique analogue à celle de l’Alaska aujourd’hui. Comme McCandless, c’était un idéaliste et un romantique. Tous deux ressentaient une attirance passionnée pour les entreprises audacieuses dans des paysages vierges. Voici par exemple deux phrases d’une carte postale de McCandless écrite alors qu’il pagayait seul sur le fleuve Colorado, seize mois avant d’aborder son aventure fatale en Alaska :
« J’ai décidé de mener cette vie pour un certain temps. J’y trouve tant de liberté et de simple beauté qu’il est impossible d’y renoncer. »
Et voici deux lignes d’une lettre de Ruess en novembre 1934, peu avant qu’il disparaisse sans laisser de traces :
« Quant à savoir quand je visiterai la civilisation, ce n’est pas pour bientôt, je pense. Je ne me suis pas lassé des solitudes ; au contraire, j’apprécie leur beauté et la vie errante que je mène, avec toujours plus d’acuité. »
L’étrange résonance entre ces extraits et d’autres des deux jeunes aventuriers était si prononcée qu’une semaine après avoir découvert Ruess grâce à Roberts, je parcourus les 2000 kilomètres séparant ma maison à Seattle de l’obscur ravin appelé Davis Gulch, site du dernier campement connu d’Everett Ruess.
Sur presque toute sa longueur de 6 kilomètres, ainsi que je l’ai décrit plus tard dans Into the Wild, c’est une entaille sinueuse et profonde dans la roche lisse, assez étroite parfois pour qu’on puisse cracher d’un côté à l’autre, longée par des surplombs en grès qui empêchent d’accéder au plancher du canyon… Le pays environnant Davis Gulch est une étendue desséchée de roche nue et de sable couleur brique. La végétation est chétive. Il est quasi impossible de trouver de l’ombre pour s’abriter d’un soleil qui flétrit tout. Mais descendre à l’intérieur du canyon, c’est découvrir un autre monde. Des peupliers s’inclinent avec grâce sur des nuages de figuiers de Barbarie. Les hautes herbes dansent sous la brise. La floraison fugace d’un lys sego pointe sous l’orteil d’une arche de pierre haute de trente mètres et des troglodytes des canyons se hèlent sur une note plaintive depuis le chaume d’un chêne du Maryland. Très haut au-dessus du ruisseau, une source suinte sur la paroi pour abreuver une excroissance moussue et des adiantes cheveux-de-Vénus suspendus à la roche, tels des coussins verts et opulents.
Debout au fond du canyon, à me demander où, au juste, Ruess avait fait cuire ses haricots et paître ses ânes, où il avait dormi sous les étoiles, j’espérais deviner quelque chose à partir des détails de ce cadre – quelque indice révélant son essence – qui m’éclairerait par extension, fût-ce indirectement, sur McCandless. Je ne devais pas être déçu. Ma visite de Davis Gulch m’incita à en savoir le plus possible sur Everett Ruess et finalement à inclure dans Into the Wild un chapitre décrivant sa vie écourtée et son étrange disparition.
Vagabond de la beauté est une lecture irrésistible qui rehausse encore le mystère de cette existence évanescente. Celui que l’histoire de Chris McCandless aura intrigué sera sans doute fasciné par celle d’Everett Ruess.
Jon Krakauer
Avant-propos
L’histoire d’Everett Ruess est ancienne et le temps l’a presque effacée. Elle figure d’ordinaire parmi les légendes contées autour d’un feu de camp ou entre autres détails du pays des canyons. Qui la raconte est quasi certain que ses auditeurs n’auront jamais entendu parler d’Everett. Un livre d’abord paru en 1940, On Desert Trails with Everett Ruess1, renfermait certaines de ses lettres et quelques poèmes. Mais il est depuis longtemps épuisé et fort rare.
Après une petite enquête de détective, mon éditeur Buckley Jeppson a retrouvé le frère d’Everett, Waldo, à Santa Barbara en Californie. Ce dernier, seul survivant de la famille Ruess, outre qu’il conservait la plupart des lettres, photographies et peintures d’Everett connues, accepta de les voir publier. Suivirent deux années de travail intense et de découverte. Il fallait lire chacune des pièces écrites ou commentées par notre sujet. Il fallut classer et ordonner tous les documents par dates, importance et intérêt. C’est à ce moment que j’intervins dans le projet. Il m’intéressa aussitôt car j’avais passé beaucoup de temps à écrire sur le Nord de l’Arizona et le Sud de l’Utah, arpentés par Ruess au début des années 1930, comme à les photographier.
Mais je savais encore peu de choses sur Everett quand nous partîmes tous trois pour Escalante, dans l’Utah, en septembre 1982, pour mener l’enquête. Chose étrange, beaucoup de gens du village se rappelaient encore la quinzaine où Everett avait séjourné là, en novembre 1934. Puis nous poursuivîmes notre route vers le sud dans un paysage spectaculaire de canyons et de falaises près de Hole-in-the-Rock. Ayant passé la nuit dans une cabane de garde coincée entre des dômes vertigineux de grès rouge, nous nous enfonçâmes à cheval dans Davis Gulch où avaient été trouvés le dernier camp et les ultimes inscriptions d’Everett.
Il y eut d’autres voyages dans d’autres villes de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique pour interroger des témoins comme Clayborn Lockett, Tad Nichols, Randolph « Pat » Jenks, qui tous avaient connu Everett. Je l’évoquai longtemps avec Ken Sleight, excellent guide de rivière et du pays des canyons, qui lui avait consacré des années d’enquête. Je pris des notes, enregistrai les conversations, fis des photos, m’informai du folklore du pays des canyons.
Ainsi le livre s’est-il développé en perspective, profondeur et signification. Je ne saurais affirmer que nous n’avons plus rien à découvrir sur notre vagabond. Certains de ses amis, contemporains de ses premières années à Los Angeles, sont assurément encore vivants, de même que des gens qu’il connut à San Francisco en 1933-1934. Peut-être la parution de ce livre en incitera-t-elle certains à livrer de nouvelles informations éclairantes. Peut-être ses écrits manquants – dont son journal de 1934 – referont-ils surface grâce à lui. L’éditeur comme la famille seraient reconnaissants de ce qui permettra d’approfondir l’étude.
Everett Ruess était un jeune homme très complexe, parcouru de motivations aussi nombreuses que dévorantes dont nous n’avons qu’une vague idée. Sa correspondance nous permet d’entrevoir qu’il fut relativement incompris, même de son vivant. Qu’il ait pu dissimuler une partie de sa nature, même à des amis et parents proches, est une possibilité. Par bonheur, ses lettres et autres écrits sont si riches de détails descriptifs et introspectifs qu’ils suffisent à nous révéler le fond de sa personnalité et de son caractère. Avoir pu colorer et rehausser l’image d’un jeune auteur si doué fut en soi une fascinante mission.
W. L. RushoSalt Lake City, avril 1983
1 Sur les pistes du désert avec Everett Ruess.
LA BEAUTÉ ET LA TRAGÉDIED’EVERETT RUESS
En 1934, en pleine dépression économique, Everett Ruess disparut. Son dernier camp connu se trouvait dans la région de la rivière Escalante, dans le Sud de l’Utah, lieu de roches nues, de falaises à-pic, de canyons vertigineux et de hautes mesas2. Si le paysage a été sculpté par de violents orages épisodiques, l’eau y est rare. C’est un paysage où les teintes de la terre sont chaque jour enflammées par le soleil levant, où elles changent sans cesse à mesure que les ombres s’allongent et diminuent avec les heures dans un contraste permanent avec la lumière colorée. C’est la quintessence du pays des canyons. En tant que jeune artiste, Everett Ruess était irrésistiblement attiré par l’Escalante, non pas tant pour dessiner et peindre, que pour emmagasiner des expériences et en tirer de quoi écrire, organiser ses impressions et réactions comme il l’avait si souvent fait dans le Nord de l’Arizona et en Californie. Il disparut avant qu’aucune de ses descriptions écrites, sous forme de lettres, pût être envoyée de la rivière. On n’a jamais retrouvé son journal de 1934.
Grâce aux nombreuses lettres écrites dans d’autres lieux au cours des mois et des années précédentes, nous pouvons toutefois en apprendre beaucoup sur lui comme sur les régions qu’il traversa. À bien des égards, ce n’était qu’un jeune homme ordinaire des États-Unis, passionné par l’errance dans les contrées reculées de l’Ouest. Il était glabre, de taille et corpulence moyennes, avenant, prompt à sourire, sans rien d’inhabituel. Il était jeune, âgé de vingt ans seulement quand il disparut, et tenait à la fois de l’adulte et de l’adolescent. Comme l’écrivit un jour un ami de la famille, « c’était tantôt un vieil ami, tantôt un jeune ami ». Il pouvait être logique, puis illogique. Il pouvait rire et chanter, jouer la comédie, ou ruminer sa tristesse, dans le silence et la solitude.
Mais surtout, il pouvait voir, d’une manière qui dépassait de loin la simple réalité organique. Ses réactions aux merveilles de la Nature allaient au-delà de ce que nous considérons comme l’expérience normale, jusqu’à une quasi-résonance avec les ondes lumineuses d’un paysage qui le frappaient de toutes parts. Ce don étrange le distinguait de ses connaissances, amis et parents. La plupart d’entre nous sont touchés par la contemplation des vues les plus sublimes – vallée, désert ou montagne. Mais bien rare celui qui ressent si vivement la beauté qu’il en souffre comme lui. Et il était en mesure de décrire avec un talent extraordinaire les réactions suscitées par les panoramas découverts en route.
Il est heureux pour nous qu’Everett ait si bien écrit. À lire ce qu’il voyait et ressentait, le lecteur d’aujourd’hui a un aperçu de ce qu’est une liberté passionnée. Comme lui, à tel ou tel moment de notre vie, nous aspirons tous à nous arracher aux conforts et sécurités d’une existence monotone. Nous aussi, nous éprouvons le besoin d’entrer dans notre petit désert pour satisfaire la quête si ardue d’un destin unique. L’histoire d’Everett est l’histoire universelle de la découverte du moi.
Ses lettres contiennent des affirmations de ce genre : « J’ai vu presque plus de beauté que je n’en peux supporter », ou « une beauté si absolue et accablante qu’elle manque tuer un être sensible par sa gloire perçante ». Il poursuivit ses voyages, attiré comme par un aimant loin des villes de Californie, à travers montagne, désert et canyon, jusqu’à la fin de sa destinée. Voyageant pour ainsi dire sans argent, il survivait avec peu de nourriture, sans presque aucun confort et peu d’encouragement extérieur car rarissimes étaient, parmi ses rencontres, celles à même de comprendre ses motivations ou d’apprécier sa sensibilité.
Nous qui vivons des décennies après sa disparition ne le comprenons pas pleinement non plus. Seules subsistent de vagues traces, qui sont toutefois intrigantes. Nous avons ses journaux des voyages de 1932 et 1933, ainsi que quelques poèmes et essais, quelques clichés et des lettres écrites sur lui par des gens qui l’avaient croisé. Surtout, nous avons les lettres qu’il écrivit à ses parents, son frère et quelques-uns de ses amis. Ces documents sont précieux en ce qu’ils nous disent beaucoup de son caractère et de sa personnalité, sans tout nous révéler. Aucun jeune homme n’écrit à sa mère avec la plus grande franchise sur tous les sujets. Même vis-à-vis d’un père, d’un frère et d’amis, chacun joue un rôle destiné à cacher nombre de ses pensées les plus intimes. Everett réussissait sans doute mieux que la plupart des jeunes à exprimer ses véritables sentiments, mais nul ne saura jamais ce qu’en cachent d’essentiel ses écrits. Il en résulte qu’un élément hypothétique vient se greffer sur tout ce qu’en ont dit les autres.
Pour commencer à comprendre notre jeune homme, il est indispensable de parler de sa mère, Stella. Passionnée d’art, artiste elle-même, Stella Knight Ruess, fille du fameux pionnier de Californie William Henry Knight, avait suivi une formation artistique à l’University of Southern California et enseignait le dessin dans une école d’Alhambra. Elle avait étudié l’impression sur blocs de bois ou plaques de linoléum à Columbia University. Elle aimait composer des poèmes, dont beaucoup furent publiés. Elle s’investissait activement dans des clubs d’art et d’écriture, dont la National League of American Pen-women, le Ruskin Art Club et le Poetry and Music Club de Los Angeles.
Everett, né le 28 mars 1914, benjamin de deux garçons, reçut sans doute toute l’attention de sa mère, d’abord ses soins maternels puis ses leçons d’écriture, de dessin et de peinture qui finirent par le convaincre qu’il devait mener carrière d’artiste. Ce n’est pas par hasard que les domaines où il était le plus doué – prose lyrique, poésie, impression au bloc et esquisses – aient été ceux de Stella. Ils collaborèrent même sur tel ou tel projet artistique – il fournissait des esquisses qu’elle transférait sur plaque pour impression. S’il fit plus tard montre, du moins dans ses écrits, d’un haut degré d’intelligence et de talent naturel, ce fut la formation de Stella qui établit aussi solidement chez lui l’art de voir et d’apprécier.
Bien que nous n’ayons aucune des lettres de la mère à son fils, il semble qu’elle ait eu sur lui une profonde influence. Comme Everett, c’était une vraie romantique qui se souciait peu des conséquences des décisions prises. Elle suivait la philosophie affichée par la grande danseuse Isadora Duncan : les femmes devaient pouvoir exprimer librement leurs inclinations idéalistes et romantiques, et surtout décider de leur propre destin. En tant que militante de l’art, elle croyait vivement aux vertus de la participation : si elle ne créait pas elle-même, elle devait travailler dans des ateliers où étudier l’art d’autrui. À ses yeux, seuls ceux qui participaient à l’art étaient vraiment vivants.
Stella considérait sa famille comme une institution artistique : elle fit graver « The House of Ruess » en-tête de son papier à lettres. Estimant qu’il fallait un exutoire aux écrits de la famille, elle imprima le Ruess Quartette, livret de petit format contenant des poèmes et des articles des quatre membres de la famille, Christopher, Stella, Everett et Waldo. Le sceau familial figurant sur le livret arbore un cadran solaire et la devise « Glorifiez l’heure ».
Son sens de l’urgence artistique dut sans doute jouer un rôle fondamental dans le désir ardent de son cadet d’échapper à l’école pour s’enfoncer, encore adolescent, au désert.
Le père des garçons avait accompli son cursus d’Harvard en trois ans seulement pour en sortir diplômé summa cum laude. Il fut d’abord chef du service de probation du comté d’Alameda en Californie puis directeur de l’éducation et de la recherche au département de probation du comté de Los Angeles. Diplômé en théologie à Harvard, il avait été pasteur unitarien et gestionnaire des ventes. Actif même après sa retraite en 1949, il consacra le dernier lustre de sa vie à l’American Institute of Family Relations, pour y aider des personnes plus âgées à trouver des objectifs valables et constructifs.
Christopher Ruess écrivait aussi de la poésie, mais il s’intéressait surtout aux grandes questions philosophiques et morales : il échangea avec son fils sur ces sujets dans les dernières années avant qu’Everett disparaisse. (On lira notamment sa lettre à son fils du 10 décembre 1933.) Il incarnait aussi le côté pratique de la famille : dans la mesure du possible, il s’efforça d’aiguiller ses fils dans leurs études pour qu’ils embrassent des carrières intéressantes. Qu’Everett ait quitté l’université au bout d’un seul semestre fut un durable sujet d’affliction pour son père.
Son frère Waldo était aussi un soutien à la maison. Plus âgé de quatre ans et demi, il était déjà dans la vie active au début des années trente, d’abord en tant qu’attaché diplomate puis comme homme d’affaires international. Au total, il travaillerait et vivrait dans dix pays étrangers, dont la Chine, le Japon, l’Algérie, l’URSS, l’Islande, le Salvador, le Mexique et l’Espagne, et voyagerait dans cent autres. Everett écrivait fréquemment à son frère aîné et ses lettres dévoilent clairement la grande estime qu’il avait pour lui.
Il faut noter que toute la famille Ruess était très soudée, ce qui donnait beaucoup de force à chacun de ses membres. Si Everett fut en mesure de s’aventurer à plusieurs reprises dans un désert impitoyable, sans fonds suffisants ni équipement moderne, il le dut notamment au soutien moral et financier de ses parents et de son frère. Il trouvait aussi en eux un public réceptif à ses peintures, esquisses, poésie et lettres. Ces dernières, par exemple, dont il connaissait les lecteurs, sont beaucoup plus intéressantes et travaillées que les entrées de son journal, qui tendent à être plus factuelles que lyriques.
Le plus grand talent d’Everett fut son aptitude à voir, puis exprimer la magnitude, la couleur et l’atmosphère changeante de la nature. S’il décrit bien les hautes sierras, il excelle à peindre les déserts de roche rouge du Nord de l’Arizona et du Sud de l’Utah. Cette stupéfiante aptitude à faire naître chez le lecteur les sentiments qu’on a en présence du paysage, associée au mystère de sa disparition, a pu le faire qualifier de mystique par tel ou tel. Il va de soi que ce n’était pas un mystique religieux puisqu’il se qualifiait lui-même d’agnostique, mais il jouissait assurément d’une aptitude inhabituelle : voir au-delà de la réalité concrète de sa formation et de son expérience. Randolph « Pat » Jenks, qui connut notre jeune homme en 1931, déclare : « Ruess était l’être le plus sensible, le plus intuitif que j’ai connu. Il n’était pas toujours capable de l’exprimer. Mais je ne saurais dire s’il était ou non un mystique. »3 Répondre à cette question dépend évidemment du sens donné au mot, mais que la question soit si souvent posée nous confirme la force de sa personnalité et le caractère de sa prose.
Il faut tout de même préciser que ses écrits souffrent d’une limite importante : il était apparemment incapable d’apprécier ou de décrire les actions et interactions humaines avec le paysage qu’il comprenait si bien. On y trouve fort peu d’informations sur ceux qui le modelèrent ou furent modelés par lui. Il tenait les Indiens pour des êtres nobles ayant appris à vivre du pays. Pour lui, les non-Indiens n’étaient que des intrus. Bien qu’on puisse supposer que le zèle et l’esprit de pionnier qui l’animaient aient été partagés par les premiers colons, il considérait que la plupart des philosophies « allogènes » semblaient prôner la confiscation de la terre, et non la communion avec elle. Il en résulte que seule l’histoire indienne avait un rapport avec son sujet, sa propre réaction à la beauté naturelle.
La vraie quête d’Everett était celle de son identité et de son accomplissement. Assurément, il fit l’expérience du besoin de but et de direction dès qu’il commença ses errances en 1930. Les nombreux mois passés dans les montagnes et désert au cours des quatre années suivantes, riches d’expériences merveilleuses, lui dispensèrent aussi la douleur de l’isolement, jusqu’à frôler parfois la lisière séparant la réalité du délire, la santé morale de l’incohérence. L’hiver passé à San Francisco, tout en lui dispensant l’amitié d’autres artistes, aiguisa sa conscience et la conviction d’avoir un regard très particulier. Il demeurait pourtant peu sûr de lui en tant que peintre et écrivain, et tentait désespérément, ardemment, de trouver sa place artistique.
Le jeune Ruess avait encore grand besoin de se former dans les arts visuels. Les peintures, esquisses et aquarelles qui subsistent dans la collection familiale révèlent une mauvaise compréhension des transitions chromatiques et une main hésitante dans le dessin. Ses impressions sur plaques de linoléum, en revanche, révèlent une bonne perception de l’équilibre de la composition, comme de l’impact dramatique.
Le paradoxe le plus étonnant de sa personnalité fut sans doute que s’y associaient un visionnaire introverti, hypersensible, à un aventurier extraverti et courageux.
Son cran – cette aptitude absolument intrépide, candide, puérile à affronter n’importe quelle situation comme si elle n’avait rien que d’ordinaire – le rendait unique. Il fit de l’autostop jusqu’à Monument Valley, où on l’abandonna sans presque aucun argent. Mais il poursuivit sa route et fit savoir qu’il était heureux. On a dit qu’il pénétrait souvent et simplement dans les hogans4 navajos, sans y être prié, pour s’y installer comme chez lui. Ses lettres révèlent un manque de réticence stupéfiant chez les personnes célèbres. S’il voulait rencontrer quelqu’un, il allait frapper à sa porte et se présentait. Quand ceux qui l’avaient croisé remarquèrent plus tard qu’il était étrange, ils faisaient allusion à ses manières intrépides, pas à ses expériences visionnaires. Certains les appréciaient, d’autres le jugeaient fou. Certains Navajos le prirent pour un sorcier. En tout cas, tous le tenaient pour tout à fait extraordinaire.
Sa confiance en lui était énorme, du moins jusqu’à la fin 1933 quand, influencé par de nombreux amis intelligents et talentueux, il se mit à douter de certaines de ses lignes de conduite. Même alors, il cessa de s’interroger quand les questions devinrent trop dérangeantes. Puis il regagna le désert où il pouvait penser et écrire sur la beauté de la nature ; où il pouvait écarter les doutes qui l’assaillaient et retrouver son assurance de naguère.
Cette confiance en soi extrême, implantée et solidement nourrie par sa mère, fut à la base de tout ce qu’il fit depuis son diplôme de fins d’études secondaires jusqu’à sa disparition. Les seules exceptions furent son inscription durant cinq mois à l’UCLA en 1932-1933, sur l’insistance de son père, et son séjour volontaire à San Francisco en 1933-1934. Il était mal à l’aise à l’UCLA et se fatigua du rythme frénétique et des encombrements de San Francisco.
Si sa mère l’informa de telle ou telle des dures réalités de ce monde avant qu’il quitte le foyer, cela n’apparaît ni dans ses actes ni dans ses écrits. Il semble que non seulement elle ne fit rien pour le dissuader de quitter le toit familial encore adolescent, mais qu’elle approuva – voire encouragea – ce qu’elle tenait pour son indépendance artistique.
Il faut dire quelques mots des expériences d’Everett à San Francisco à la fin de 1933 et au début de 1934. Après avoir passé les trois années précédentes, par bribes, à voyager dans les montagnes et les déserts, il s’y jeta à corps perdu dans une expérience intense de découverte artistique auprès de peintres, photographes, musiciens, écrivains et agitateurs politiques dans une atmosphère bohème. Bon nombre des artistes qu’il rencontra étaient établis, connus et très compétents dans leur domaine. Mais l’assurance d’Everett, son intelligence candide, son désir d’apprendre et son évidente sensibilité lui ouvrirent bien des portes. Les lettres à ses parents subsistantes ne nous parlent que de quelques grands contacts avec des artistes de la ville à cette période. Il y en eut sans doute davantage. Dans la mesure où le jeune homme avait encore beaucoup à apprendre pour devenir un artiste visuel mature, on peut deviner quel fut le résultat de ces contacts. La plupart furent sans doute francs, sinon brutaux, s’agissant de la nécessité de parfaire formation et expérience. Il découvrit probablement qu’il était loin d’être aussi bon qu’il le croyait, ce qui peut avoir gravement entamé son estime de lui. Au surplus, il semble avoir pris alors une décision lourde de conséquence : quel que fût son besoin de parfaire sa formation et son expérience artistiques, il refusa de s’attarder davantage dans les grandes villes, coupé de ses solitudes chéries. Les lettres expédiées d’Arizona et de l’Utah en 1934, si elles sont souvent les plus admirables stylistiquement, trahissent un sentiment de futilité, la prise de conscience qu’il était désormais piégé par son amour du désert, son aversion des villes et son besoin de formation supplémentaire. La découverte était aussi glaçante que frustrante.
On peut penser qu’avec du temps et du travail Everett aurait pu devenir un artiste compétent, un excellent interprète du paysage qu’il aimait, comme son ami Maynard Dixon. Heureusement, il fut à même d’acquérir une discipline et un savoir-faire remarquables s’agissant d’écriture descriptive. De fait, cette concentration d’énergie rend ses lettres uniques dans la littérature nord-américaine. L’auteur Wallace Stegner, dans son livre Le Pays mormon, rend ainsi hommage à Ruess :
« Ce qu’Everett recherchait, c’était la beauté et il la concevait en termes plutôt romantiques. Semblable vénération de la beauté, si extravagante, pourrait prêter à rire s’il n’y avait quelque chose de magnifique dans un service aussi absolu. Les propos d’esthétique au salon sont grotesques, voire un peu obscènes ; devenus un art de vivre, ils peuvent parfois vous valoir la dignité. Si nous rions d’Everett Ruess, nous devrons rire de John Muir parce qu’il n’y a guère que l’âge qui les différencie. »
Dans sa dernière lettre connue, adressée à son frère, il souligne : « Je ne crois pas que je pourrais jamais m’installer. J’ai déjà trop connu les profondeurs de la vie et préférerais n’importe quoi à une retombée brutale. »
La difficulté fondamentale de notre jeune homme semble avoir été celle-ci : avec le développement extrême de sa sensibilité, il se sentait poussé plus vite au-dehors qu’il ne mûrissait ou ne pouvait s’instruire.
Tel un poulain pur-sang, aussi beau qu’indompté, il se précipita dans la course, sans la mise au pas ni le dressage appropriés. Sa mère, si soucieuse de voir son fils devenir un bon artiste, ne vit pas la nécessité de le retenir ; elle ne fit pas que le laisser partir, elle l’y exhorta apparemment.
En conclusion, la vie d’Everett fut en partie tragique parce qu’il aspirait à l’inaccessible en art, probablement sans saisir à quel point ses écrits étaient devenus perspicaces. Nulle part ailleurs, dans la littérature du pays des canyons, on ne trouvera l’imagerie sensible, réfléchie, sincère, émouvante de ses lettres. Nous devons aussi apprécier, et même nous émerveiller, de son art de voir – vision qui lui permit de réagir à la beauté naturelle si intensément que les mots étaient souvent inaptes à la traduire et qu’elle semblait brûler son être même.
2 Colline ou montagne arasée comme une mesa (« table » en espagnol). (NdT)
3 Conversation avec Randolph Jenks à Alamos, au Mexique, le 1er décembre 1982.
4 Case faite de bois et de boue.
LES LETTRES
Quand Everett Ruess se dirigea dans les montagnes ou vers le désert, il avait deux grands objectifs. Il voulait d’abord recueillir des impressions, faire l’expérience, jusqu’à l’extase, de scènes naturelles. Ensuite, il voulait enregistrer les scènes, soit visuellement par esquisses ou aquarelles, soit par écrit. Mais son talent s’avéra plus fort via ce dernier médium, dont il fit son expression favorite. Il aurait pu écrire un livre, ou des essais, ou des articles de magazine, mais il choisit les lettres, sans doute parce qu’elles maintenaient le contact avec les siens et lui offraient un auditoire assuré et compréhensif.
En traversant lentement les solitudes, il avait du loisir en abondance et pouvait composer ses descriptions presque sur le motif, devant le paysage. Il lui arrive d’utiliser les mêmes formules dans des lettres adressées à différents destinataires, à plusieurs jours de distance, comme s’il les avait mémorisées ou se servait d’un brouillon. Et ses lettres révèlent une composition soigneuse et châtiée, où rien n’est laissé au hasard.
Voici la plupart des lettres subsistantes écrites entre juin 1930 et sa disparition en novembre 1934. Elles avaient pour destinataires ses parents, son frère ou un petit cercle d’amis. Parmi ces derniers certains restent mystérieux, connus par leur seul prénom. Il arrive qu’une lettre soit même dépourvue de salutations. L’essentiel de la collection, cependant, a été soigneusement conservé par la famille Ruess durant un demi-siècle et elle est en très bon état.
Nous avons limité le commentaire au minimum de manière à garder au récit son parfum et sa continuité.
Aucune des réponses envoyées à Everett ne figure ici pour la simple raison qu’aucune n’existe, à une exception près : une réponse de son père à quelques questions philosophiques, datée du 10 décembre 1933. Il semble qu’il ait détruit les autres plutôt que de devoir les ajouter à son bagage. Dans ses propres écrits, toutefois, le jeune homme fait rarement allusion aux réflexions d’autrui ; son thème reste la nature et la réaction qu’elle lui inspire. Ses lettres n’en sont que plus intéressantes pour nous car elles ne s’adressent pas qu’à une personne, mais à nous tous, aujourd’hui comme hier.
Pourquoi s’être tant investi dans ses lettres ? Il souhaitait bien sûr impressionner ses correspondants. Il souhaitait surtout saisir par écrit l’intensité subjective des impressions créées par le paysage. Il s’est parfois plaint de ses pauvres mots mais il a beaucoup mieux réussi avec ses « simples mots » qu’il l’aurait imaginé.
1930
À l’âge précoce de seize ans, à l’été 1930, Everett Ruess quitta le foyer familial de Los Angeles pour effectuer son premier grand voyage en solitaire. Muni d’un sac de couchage et d’un énorme sac à dos, il remonta en stop la côte jusqu’à Carmel et campa au bord de l’océan Pacifique.
Serment au vent
Venu de vastes espaces inconnus,
Enjambant les abysses et le temps,
En nous tous se dresse et court
La puissance du vent sans mesure.
Déferlant des plaines ouvertes,
Pur et ardent, des sommets,
Renouvelé par les pluies,
Il s’insère dans nos âmes.
Dans l’air silencieux, net et bleu,
Juché sur une falaise solitaire,
Où l’air est aussi clair que rare,
Je fais au vent… mon serment :
« Par la force de mon bras, le regard de mes yeux,
Par l’adresse de mes doigts, je jure,
Tant que m’habitera la vie, que jamais ne
Suivrai-je d’autre voie que celle, profonde, du vent.
Je sentirai la gaieté du vent jusqu’à ma mort ;
Je travaillerai avec l’exaltation du vent ;
Je chercherai sa pureté ; et jamais ne suivrai-je
D’autre voie que celle, profonde, du vent. »
Ici dans la complète quiétude,
Juché sur une falaise solitaire,
Où l’air tremble d’éclairs,
J’ai fait au vent mon serment.
Le 28 juin
Chers parents,
Bien arrivé à Morro Bay hier soir après avoir voyagé avec neuf personnes, dont la femme d’un marin, un garçon épicier, un vendeur et un laveur de vaisselle. J’ai dormi au milieu d’un creux entre les dunes, après avoir construit mon feu juste à la brune. Je me suis rendu compte que nous avions éliminé tant de choses qu’il n’y avait pas beaucoup à manger. Au matin, mes couvertures étaient à tordre avec la brume et la rosée. J’ai regagné San Luis Obispo avec le patron de l’épicier et j’écris ceci dans l’une de ses boutiques. Je suis sur le point de partir pour Carmel.
Affectueusement,
Everett
Moins de deux jours après son arrivée, il écrivait dans sa lettre suivante : « Je me suis rendu à l’atelier d’Edward Weston pour lier connaissance avec lui. » Edward Weston était l’un des photographes les plus célèbres et appréciés du pays5. On peut déduire de cette approche audacieuse, comme d’événements analogues par la suite, que notre jeune homme n’était guère intimidé par les photographes, peintres, musiciens, auteurs, commerçants en produits indiens, cow-boys ou Navajos. On a dit que cette hardiesse était une caractéristique familiale des Ruess, mais c’était plus probablement une composante de caractère, s’agissant de tout ce qui touchait à l’art, qu’il devait à sa mère Stella.
Le 30 juin
Carmel
Chère Mère,
J’ai passé une belle journée hier, à arpenter la plage. Puis je me suis installé sur un rocher à l’allure de trône, isolé en pleine mer. Je n’en suis parti que lorsqu’une énorme lame est venue m’asperger et m’en déloger.
Dans l’après-midi, je me suis baladé dans la ville jusqu’à la connaître assez bien. J’ai marché un peu moins de deux kilomètres jusqu’à la Mission San Carlos et le fleuve Carmel.
Revenu en ville, je me suis rendu à l’atelier d’Edward Weston pour faire connaissance. C’est l’un des conducteurs qui m’avaient pris en stop près de Morro Bay qui m’avait parlé de lui. J’ai vu un très grand nombre de ses photos. C’est un homme très large d’esprit.
Affectueusement,
Everett
J’ai passé la nuit dernière sous les pins. Écris en poste restante, à Carmel.
Le 1er juillet
Cher Père,
Hier je suis parti en promenade et j’ai découvert que j’étais sur le Seventeen-Mile Drive. J’ai donc continué sur environ 24 kilomètres, en m’arrêtant pour faire une esquisse d’un endroit pittoresque. Vers deux heures, il faisait si sombre et brumeux que je pensais qu’il était cinq heures. J’ai franchi les dunes pour apercevoir six chevreuils – deux biches et quatre faons, qui avançaient en curieuse procession. Ils n’étaient pas du tout farouches.
J’ai vu aussi deux énormes écureuils gris. Sans suivre d’itinéraire précis, je prenais une route puis une autre, ce qui m’a révélé une partie intéressante du pays.
M. Weston m’a invité à dîner et j’ai rencontré ses deux fils, des garçons très sympathiques. J’ai dormi dans son garage, qui est vide. Ce matin, je l’ai balayé et remis en ordre.
Affectueusement,
Everett
Le 2 juillet
Cher Waldo,
Hier, je me suis beaucoup amusé avec les deux fils de M. Weston, Neil et Cole. Tous deux sont plus jeunes que moi. Il y a deux autres fils, déjà mariés. M. Weston a une maison à Los Angeles, une autre dans Topanga Canyon et il loue trois maisons ici. Celles-ci sont sur le même terrain. L’une lui sert d’atelier, l’autre sert de chambre aux fils et dans la troisième on fait la cuisine et M. Weston y dort. Il y a aussi une bonne, Sonia, qui tient la maison. Hier soir, Cole et moi sommes descendus sur son vélo jusqu’au fleuve, le Carmel, où nous avons retrouvé Neil et un gros garçon du nom de Sam, qui avait pris le maximum autorisé de truites. J’ai fait des crêpes pour tout le monde ; puis nous avons tous dîné de bacon et de truite. Un peu plus tard, nous avons tous nagé dans le fleuve, très large à son embouchure lorsqu’elle se jette dans l’océan.
Affectueusement,
Everett
Le 4 juillet
Chère Mère,
Hier, j’ai téléphoné à Harry6 et nous nous sommes retrouvés à Point Lobos pour peindre un peu. Nous avons fait une marine à l’aquarelle chacun. Puis nous avons rangé nos affaires et arpenté les rochers. Nous avons trouvé trois étoiles de mer et une immense anémone. Puis nous avons regardé tous les lions de mer sur les rochers et nous les avons écoutés aboyer. Nous avons envoyé des cailloux sur les rochers en contrebas.
Par la suite, nous avons refait une autre esquisse chacun. Nous avons vu un bébé couleuvre de 15 centimètres à l’étincelante queue bleue. Puis nous sommes repartis vers la maison. J’ai été pris en stop par une dame dont la famille possède Point Lobos.
Ce soir, j’ai soupé avec les Weston et nous nous sommes regroupés autour du feu tandis que M. Weston nous lisait Moby Dick. Quand Cole s’est endormi, nous sommes tous allés nous coucher.
Je vais peindre avec Harry demain.
Affectueusement,
Everett
L’impact des lames et le roulement des galets
Je me suis éveillé sur un frisson, les nerfs aux aguets. Ça s’est renouvelé, ce qui m’avait réveillé – le cri violent, étrange, d’une mouette grise s’abattant bas au-dessus de moi dans l’obscurité. Une brume lourde, poisseuse, s’était installée, qui rendait l’endroit absolument désolé. Rien n’était visible. J’étais seul, au bout d’un promontoire en lame de couteau que, par quelque étrange caprice, j’avais choisi pour m’accueillir cette nuit-là. Mon sac de couchage était coincé dans une crevasse peu profonde. D’un côté, le granit nu tombait à pic dans la mer écumeuse. De l’autre, le rocher était relié au promontoire principal, mais en dessous, un étroit tunnel à la haute voûte avait été rongé par l’océan. À un endroit, une mince crevasse en perçait le toit jusqu’au ciel. Chaque vague déferlante s’écrasait très loin dans l’embouchure étroite de la caverne en refoulant une rapide bouffée d’air froid et d’écume par l’ouverture du sommet, comme par un soufflet.
Derrière moi, j’entendais le mugissement bas et l’impact lugubre des lames et le ressac des galets quand les vagues quittaient la grève. Une fois encore, j’entendis le cri de la mouette, plus bas, étrangement éloigné. Puis un fort vent hurlant se leva, qui fendit la brume comme un couteau invisible. En un instant, tout fut d’une transparence de cristal. La pleine lune illumina de lointaines cimes blanches et les crêtes tonitruantes qui se volatilisaient en écume dans le tunnel, en m’envoyant un air sifflant au visage.
(Extrait d’un essai)
Sous la mer
Fusant entre des plantes marines incurvées dans le sable
Voici une compagnie de poissons brillants.
Ils vont tourbillonnant dans les vertes profondeurs de la mer,
Étincellent, tels les rides d’argent sur une mare
Qui dansent et scintillent dans la lumière froide de la lune.
Puis les voilà partis, aussi vite qu’ils étaient venus,
Et les algues follement agitées bougent
Plus lentement et sont enfin tranquilles.
À présent, dans les forêts muettes de la mer,
Dérive peu à peu, rayonnante, ondoyante,
Une méduse lustrée. Soudain,
D’une opalescence rose et changeante,
Elle se fait translucide et disparaît presque,
Mais pour briller encore, au loin, contre
Des roches noires où les formes ombreuses sont une gaze.
C’est là qu’elle se fond enfin dans la distance
Fantôme glissant lentement loin de nous.
Le 14 juillet
Cher Père,
Je viens de recevoir ta lettre du 16, avec le chèque, dont je te remercie. J’ai reçu un dollar pour mes linogravures jusqu’ici. L’une d’elles sera publiée la semaine prochaine. J’ai gagné 2 dollars à faire le caddie et cinquante cents en jardinant. Je compte scier un peu de bois ce soir.
Je viens de finir ma lessive ce matin. À présent, je vais me rendre à Monterey pour économiser un peu sur le cuir de mes chaussures. J’ai tenté de joindre Mlle Graham, mais le téléphone ne répondait pas. Je la verrai dès mon retour de Big Sur la semaine prochaine.
Quant à la nourriture, j’ai consommé quatre miches de pain, trois pots de beurre de cacahuète et environ six litres de lait depuis que je suis ici. J’ai aussi mangé plusieurs boîtes de maïs et de petits-pois, et environ cinq de nourriture pour le petit-déjeuner.
C’est une bonne nouvelle pour les linogravures de Mère et la couverture du magazine de poésie. L’art peut rapporter si l’on sait s’y prendre.
Hier, Leon Wilson7 et moi sommes allés dessiner sur les rochers près de Point Lobos. Nous avons nagé dans les eaux glacées du Pacifique puis exploré plusieurs grottes, en longeant toute la péninsule à la nage. Certaines de ces grottes étaient très grandes, pourvues de voûtes hautes et arquées. D’autres étaient si basses qu’il fallait bien choisir le moment d’y pénétrer. Tantôt une vague se dressait face à moi et je restais stationnaire tout en nageant. Puis une lame déferlait derrière moi et m’emportait sur une vingtaine de mètres. Nous étions presque engourdis quand nous sommes sortis. Quand nous avons regagné la petite plage sablonneuse d’où nous étions partis, j’ai allumé un feu pour nous sécher.
En te souhaitant de la chance financière,
Affectueusement,
Everett
Le 24 juillet
Chers Père, Mère et Waldo,
Dimanche dernier, je suis allé chez Harry et nous sommes partis pêcher. Mais nous n’avons rien attrapé que deux oursins. J’ai lu quelques pages d’un livre, La Légende des aventures glorieuses de Till l’Espiègle.
Samedi soir, Mme Greene m’a invité à voir une pièce au Forest Theatre, Over the Fairy Line. C’était une pièce pour enfants, plutôt bonne. Mme Greene avait plusieurs billets, mais sa famille n’avait pas eu envie d’y aller.
Lundi matin, je suis parti pour Big Sur, avec un sac lourd d’environ 25 kg avec les couvertures. J’ai été pris en stop à partir du pont sur le fleuve Carmel jusqu’à Highlands Inn, à 6,5 kilomètres. Puis j’ai marché sur 3 kilomètres et j’ai été recueilli par un chauffeur de fardier sur 16 kilomètres, jusqu’à Glen Deven. Il faisait très froid et c’était très venteux. La route est extrêmement montagneuse. La plupart du temps, elle est trop étroite pour que deux voitures s’y croisent.
Après le trajet en camion, j’ai marché 3 kilomètres jusqu’à arriver à un endroit où la route faisait une longue boucle vers l’intérieur, pour éviter un canyon. En face, je pouvais voir où la montagne était excavée et j’ai pensé que c’était par la route. En contrebas, au bord de l’océan, il y avait une petite plage. J’ai décidé d’y manger mon déjeuner.
J’ai donc glissé, dérapé et dévalé le flanc de la montagne jusqu’à arriver au fond de la vallée où serpentait un petit ruisseau. Sur la plage se trouvaient des monceaux de bois flotté, provenant sans doute d’une épave. J’ai déjeuné perché sur l’arche d’une petite grotte où déferlait la mer écumante. En dessous se trouvaient nombre d’algues brunes, agitant leurs frondes avec chaque mouvement de la mer, ondulant comme des pieuvres.
J’ai commencé à gravir le flanc de la montagne. Il était incliné d’environ 110 degrés. Si je m’étais tenu droit, j’aurais basculé en arrière sous l’effet de mon sac. Ce fut une ascension très compliquée mais j’y suis finalement arrivé, pour me rendre compte que ce que j’avais pris pour une route n’était qu’un sentier. En le parcourant, j’ai remarqué un très gros morosphynx, au corps gris rayé d’orange.
Une fois revenu sur la route, j’ai continué un certain temps, jusqu’à atteindre une vallée, au pied de la pente de Little Sur. Après une halte, j’ai commencé à monter en pénétrant dans une forêt de séquoias. J’ai dépassé un derrick et plusieurs hommes travaillant sur la route. Quelques-uns d’entre eux étaient des forçats.
Vers quatre heures, je pénétrais juste dans la partie la plus dense de la forêt de séquoias. J’ai été pris en stop par un habitant de Monterey qui rendait visite à ses petits-enfants à Big Sur. Il savait tout de l’histoire du lieu, c’était donc intéressant de le rencontrer. Les premiers habitants ici ont été les Espagnols il y a un siècle. Un immense territoire a été concédé à un seul homme. D’autres ont vite suivi, mais aujourd’hui presque tous leurs descendants abandonnent ranchs et fermes, ou bien ils y meurent.
La route a été très difficile à réaliser. Les premiers colons ont dû tout faire à la pioche et à la pelle, et la tracer sans instruments de géométrie. La région est quasi inaccessible par la mer car le rivage est trop rocheux. En pleine mer, j’ai pu apercevoir l’épave d’un bateau japonais qui gisait là depuis trois mois.
En atteignant enfin Big Sur (c’est-à-dire la poste), j’ai installé mon campement près du fleuve (qui s’appelle aussi Big Sur) pour préparer mon dîner. J’ai ramassé une pierre pour l’âtre, sous laquelle était caché un gros serpent. J’ai fait cuire une conserve de petits-pois, mais en l’ôtant du feu je me suis brûlé les doigts et j’ai presque tout renversé. Bien vite, je me suis glissé sous les couvertures pour m’y emmitoufler. À ce moment précis, un homme est survenu, accompagné de quatre petits garçons et filles.
Il s’est avéré que je campais du mauvais côté de la rivière, car l’un est semi-public alors que l’autre est tout à fait privé. Mais comme je m’étais installé, l’homme m’a dit que je pouvais passer la nuit là. Peu après, je m’endormais sous les sycomores et les sureaux.
Mardi matin, j’ai caché mon sac sous un chêne et suis parti en direction de l’océan. Sur une longue distance, le long de la plage, il y avait des chambres à air éparpillées ici et là, en provenance de l’épave. Toutes étaient déchirées ou percées par l’eau de mer, mais le caoutchouc était intact.
J’ai fait une aquarelle dans des conditions plus difficiles que jamais : le vent n’a cessé de projeter du sable sur ma peinture et ma feuille tout au long. Le sable y reste collé, non sans produire un effet intéressant, mais je ne crois pas qu’il restera beaucoup de couleur quand le sable tombera.
Plus tard dans la journée, j’ai gravi les montagnes en suivant de petits canyons abondant en chênes très pittoresques. J’en ai esquissé quelques-uns. Il y avait aussi des bouquets de séquoias et de sycomores. En de nombreux endroits, le sol était couvert de chardons.
Une fois, alors que j’étais arrêté pour admirer quelques chênes, un petit colibri curieux est passé à deux doigts de mon visage pour se percher sur un rameau à trente centimètres de moi. La nuit, j’ai campé en surplomb de la grand-route dans un petit creux.
J’étais rentré à Carmel à midi. Puis je me suis rendu chez les Weston et Neil, Cole et moi sommes descendus sur la plage à la rencontre de M. Weston qui photographiait du varech. Puis nous avons remonté le rivage. Nous avons placé soixante étoiles de mer dans une petite mare. Elles étaient de toutes tailles et colorées de rouge, brun, mauve, bleu, jaune et vermillon.
Affectueusement,
Everett
Le 1er août
Chers Père, Mère et Waldo,
Je pars pour le Yosemite ce dimanche, d’où je gagnerai le lac Mono. J’ai gagné 14 dollars cette semaine, dont 12 en trois jours. Je ne compte pas perdre davantage de temps à gagner de l’argent cet été dont je consacrerai le reste à peindre et voyager.
Le magazine Carmelite a utilisé une autre de mes gravures et je vais leur en découper une nouvelle aujourd’hui.
Chez les Criley se trouvaient de grandes couvées de bébés cailles. Toutes les deux ou trois minutes, je voyais une ombre passer sur le sol en contrebas (j’étais monté travailler dans les pins) et la mère caille poussait un cri d’avertissement. Elle disait à ses poussins de rester immobiles pendant le survol du faucon. Il est certain qu’il en a attrapé plusieurs.
Affectueusement,
Everett
Le 5 août
Chère famille,
Hier soir, au crépuscule, je suis arrivé au Yosemite. Au début, la vallée semblait presque irréelle.
J’ai oublié de vous dire qu’un vagabond avait déniché mon sac à Carmel et qu’il a dévoré un pot d’une livre de beurre de cacahuètes sur place, ainsi qu’une demi-boîte de Pep. Il n’a pas fait d’autre dégât.
J’ai trouvé une place de camping au camp 7, ai fait mon lit et mon dîner. Puis je me suis rendu dans un autre camp où les gardes et certains des campeurs organisaient un divertissement. Il y avait foule. Nous avons chanté quelques chansons amusantes puis écouté un choix de mélodies d’harmonica. Ensuite un Écossais a joué de la cornemuse pour faire danser une fille. Il annonçait les différents airs, mais ils me semblaient tous pareils. Je ne connais rien d’aussi mortellement monotone que la cornemuse. On avait l’impression qu’il ne s’arrêterait jamais.
Après la cascade de feu8 j’ai regagné mon camp, mais j’ai eu beaucoup de mal à le retrouver dans la nuit.
Ce matin, j’ai seulement acheté quelques articles chez l’épicier, d’ailleurs payés fort cher. Je ne prévois pas de beaucoup marcher aujourd’hui, mais je ferai un tour dans la vallée, sans me presser. Quel soulagement c’est d’être ici, enfin ! Bien que les chutes d’eau soient asséchées pour la plupart, tout est frais et vert. Les daims sont presque aussi apprivoisés que des chiens. Je vais devoir faire attention pour que les ours ne trouvent pas mon bacon.
Affectueusement,
Everett
Le bruit de l’eau déferlante
Alors il n’y aura d’autre musique que le bruit de l’eau déferlante qui se brise sur les rochers pointus loin en contrebas, et le soupir du vent dans les pins – un vent chaud qui me caresse doucement les joues, m’ébouriffe tendrement et se perd vers le bas. Seul je suivrai la sente obscure, gouffre noir d’un côté et de l’autre altitudes inaccessibles, obscurité devant et derrière moi, obscurité qui palpite, s’écoule et se ressent. Puis d’un coup, un souffle irréel de vent venu des profondeurs infinies m’apportera de nouveau à l’oreille le bruit étrange, à peine reconnu de l’eau déferlante. Quand ce bruit meurt, tout meurt.
(Extrait d’un essai)
Le 22 août
Chers Père, Mère et Waldo,
Après un petit-déjeuner de crêpes lundi matin, j’ai quitté Glen Aulin et pris le sentier du lac McGee vers le lac Tenaya. Les rocs et dalles de granit étaient polis comme des miroirs à côté du glacier.
Tout au long des sentiers du Yosemite se trouvent des arbres morts, souvent couchés en travers du chemin. On ne les enlève jamais et l’on modifie le sentier pour les contourner. On m’a dit qu’au Parc national Rainier, dès qu’un arbre tombe, les gardes se précipitent en groupe pour le tronçonner et déblayer le chemin.