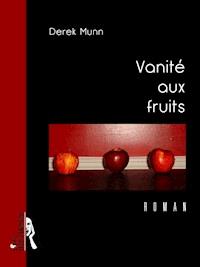
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions L'Ire des marges
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une méditation sur l'ordinaire d'une existence sans relief, d'où surgira le choix d'une vie...
Au moment de faire le choix de sa vie, un homme questionne son appétit pour celle-ci, découvre l'œuvre d'un peintre méconnu et en tire l'idée d'un tableau dans lequel il se mettra en scène lui-même. Une écriture narrative, précise et poétique. Une méditation sensible sur la vacuité d’une existence ordinaire qui conduira le protagoniste à lui donner pleinement son sens.
Un roman intimiste, autoportrait sensible et fragmenté d’un homme à la manière d’Arcimboldo.
EXTRAIT
Je rentre pour la dernière fois.
Je suis au temps des dernières fois.
Je bouillonne de l’excitation infantile des veilles de vacances, cette anticipation qui contient déjà tous les souvenirs.
Je suis comme une toile apprêtée.
J’allais faire quelque chose. J’ai oublié quoi.
Autant commencer là. Tout de suite.
Debout, dans la pièce en bas.
Des raisins donc. J’avais fait une liste, mais...
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
S’enroule et se déroule ainsi, autour de son quotidien, de sa famille et de la mise en place de ce choix, une liste de fruits qu’il a établie et qui lui permet de revisiter les souvenirs ou émotions qui leur sont attachés. Mais ce n’est pas si simple, car Vanité aux fruits est également une poupée russe. Et Derek Munn a réussi le tour de force d’emboîter les pièces dans le désordre, sans que cela interpelle. Si bien que le lecteur découvre à la fin du livre, avec stupeur, que quasiment toutes les clefs de ce fameux choix lui étaient données dès le début... -
Nathalie André, Éclairs
Transformant le moindre geste familier, la moindre trace quotidienne réputée connue en un surprenant abîme poétique, comme sait le pratiquer si intensément un Pierre Michon, par exemple, ou le Gabriel Josipovici de
Tout passe, Derek Munn nous offre un cadeau rare et précieux dont la douce teinte surréaliste n’enveloppe que mieux les cinglantes aspérités. -
Charybde 27
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en Angleterre en 1956,
Derek Munn habite en France depuis 1988 et écrit en français.
Il a également publié :
Mon cri de Tarzan en 2012 (Laureli/Léo Scheer) et
Un paysage ordinaire en 2014 (Éditions Christophe Lucquin Éditeur), qui a obtenu le prix Place aux Nouvelles 2015 de Lauzerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Martine
Do I dare to eat a peach ?
T.S. Eliot - The love song of J. Alfred Prufrock
Ces têtes composées sont des têtes qui se décomposent.
Roland Barthes – Arcimboldo
Cette nuit
Je rentre pour la dernière fois.
Je suis au temps des dernières fois.
Je bouillonne de l’excitation infantile des veilles de vacances, cette anticipation qui contient déjà tous les souvenirs.
Je suis comme une toile apprêtée.
J’allais faire quelque chose. J’ai oublié quoi.
Autant commencer là. Tout de suite.
Debout, dans la pièce en bas.
Des raisins donc. J’avais fait une liste, mais…
L’intérieur commence à s’assombrir, dehors il y a une lumière apaisée, poussiéreuse de fin de journée.
Je me rapproche de la fenêtre, hume vers le haut comme une plante cherchant le soleil. Puis je me mets à côté. Je ne veux pas que mon corps empêche d’entrer des lueurs qui radoucissent la transition vers l’obscurité.
Les grappes de raisin sont sur la table.
Posées dans la grande assiette blanche.
L’assiette est ébréchée, elle l’était déjà quand je l’ai achetée dans un vide grenier, peu après mon arrivée. Elle ne valait rien, je l’ai aimée tout de suite. Sa blancheur soutient le rayonnement délicat des fruits derrière le voile de la pruine. J’observe les grappes avec précision, attentif à la possibilité d’un mouvement. Sous la concentration de mes yeux les fruits semblent respirer. Les uns sur les autres, ils se touchent sans insistance, sans poids. Un contact respectueux.
Je les écoute.
Le crépuscule cède à la nuit. Je place la main gauche devant mon visage, j’encadre les raisins dans le vide formé par l’index et le pouce.
Je ne bouge pas.
Pendant plusieurs minutes.
La lumière n’est plus de la lumière.
Je tiens toujours les raisins dans les yeux. L’air, le silence font bloc, crépitent comme une banquise chaude. L’atmosphère est granuleuse. De la rue des bruits s’infiltrent en éclats. Taches rouges, jaunes pour la plupart, parfois vertes. Pour mieux les saisir, je ferme les yeux. Rouge jaune rouge. Ponctuées de noir. Des voix, des véhicules. Le jaune vire au gris. La lumière se fossilise. Les sons, les silences vont, viennent, se tressent, ondulent. Je m’appuie contre le mur. Je voudrais me fossiliser aussi, me solidariser avec ce moment, ces sensations. Les raisins se distinguent de moins en moins, mais leur poids pèse toujours dans mes yeux.
Je les ai achetés hier.
Je suis allé voir la mer.
Plus que toute autre chose, je voulais faire une dernière visite à la mer. Comme regret. Comme conversation. La mer oracle. La mer silence. La mer sommeil.
Je suis parti très tôt, le jour n’avait pas encore de couleur. Je voulais être tranquille sur la route. Ça faisait des semaines que je n’avais pas conduit. Je me gère, je suis obligé d’être présent dans chacun de mes gestes, mais je ne peux pas tout contrôler. Parfois j’ai des absences, la douleur me coupe les jambes. Par chance ça ne m’est jamais arrivé au musée sans que je puisse le cacher, ou à un moment critique, au volant.
J’ai vu le lever du soleil. Un œuf à l’horizon. Le jaune émergeait de l’eau, le blanc s’étalait sur les vagues.
C’était parfait.
Je regardais, regardais, regardais. Ça ne cessait pas. Les couleurs changeaient avec la lumière, la lumière changeait avec le temps. Le temps s’effaçait lui-même. Je m’absentais. C’était bon. Il y avait là une fin possible. Je sentais mon absence, j’y étais. C’était moi. Je peignais la mer avec mes yeux. La mer, le ciel. C’était moi. Mais je ne pouvais que rester inachevé. J’imaginais des tableaux que je n’aurais jamais pu peindre.
Il aurait été facile de ne pas repartir, de laisser tomber mon entêtement.
Mais si la mer te berce, elle te réveille en même temps.
J’ai pensé au pique-nique. Je me suis dit qu’il fallait un œuf dur. Cette pensée prolongeait le bonheur des vagues. Elle me rassurait. Elle justifiait cette excursion. L’œuf était dans ma main, dans ma bouche, entier. De l’albâtre mou.
Puis j’ai eu peur.
Le monde commençait à grouiller autour de moi. La route du retour devenait plus intimidante. Plus j’attendais, plus je m’angoissais. J’allais tout rater. Ça me faisait attendre encore.
Regarder la mer, c’est fermer les yeux. Je m’embarquais, je partais.
Ma faiblesse m’impose des mouvements furtifs, sans fluidité. Je manipulais la voiture de la même façon. Les déformations de la chaussée sous les pneus étaient des cailloux dans mes chaussures. Ma vitesse congestionnait certains, je le sentais. Mais le soleil montait dans mon dos, faisait étinceler la mer sur moi.
Les raisins étaient exposés au bord de la route à l’entrée d’un village. Une annonce gribouillée sur l’envers d’un morceau de carton indiquait le prix. Les premiers de la saison pour moi. C’était inespéré. Une sorte de victoire.
Il faut fermer les volets. Sinon la petite communauté de la rue viendra frapper à la porte me rappeler que j’ai oublié. Car il vaut mieux quand même, on ne sait jamais. Et à part ça, tout va bien ? Des gens sympas qui veillent gentiment. Voisins pas compliqués, accueillants dès mon arrivée. Leur bonté me fait peur maintenant, me fait raser les murs. Je dois rester vigilant. Il ne faut pas qu’on me détourne ni m’empêche.
Les couleurs, bruits, odeurs s’unifient au moment où je me détache du mur. L’air grésille, brunit, s’épaissit, graillonne. Quelqu’un fait griller du poisson. Oubliant l’impossibilité de ce plaisir, je mords l’envie. Le jaune implose, rouge, fond dans le noir. Cela m’entraîne dans un tourbillon boueux de douleur. Le poisson se bat dans mon estomac, un hameçon s’en prend à mes viscères. C’est moi qui me dispute aux deux bouts du fil. Ma main cherche le mur que je viens de quitter et qui semble s’être déplacé. Je me plie, me laisse tomber. À genoux je fouille au cœur de la douleur ma présence, mon absence.
Rattraper un instant d’inattention nécessite énormément de concentration, de patience.
La chaleur intense du mal devient une froideur moite, une vision moirée. Le monde s’effrite devant mes yeux. Dans mes yeux. Des atomes gris jubilent sur mes rétines.
J’arrive à trouver ça beau.
Chaque seconde est une prise d’escalade. Je m’agrippe, m’appuie, me déplie entre les strates des élancements. Respirant. Me levant. L’espace n’a pas de sens. Le temps reste aux aguets. Le calme est immense. J’écoute. L’odeur de friture s’épanche dans l’air du soir qui refuse de se rafraîchir. J’attends. La douleur, hurlant en silence, patiente avec moi.
Un reste. Un rebut.
La blancheur de l’assiette recueillie dans le noir.
Je ferme les yeux. Regarde.
Dans le creux de ma main.
Tiède, humide.
Devenue froide.
Si la saison c’est maintenant, dans les supermarchés on en trouve toute l’année. On en achète sans y faire attention. D’où ils viennent, le goût même. Comme ça, on perd le goût. C’est plus facile, une vie qu’on ne vit pas.
C’est ce que j’ai fait pour la dernière visite à ma mère. J’ai acheté des raisins sans pépins. C’est moi qui avais créé cette nécessité. Sorte d’ultime contradiction. Je ne sais pas si c’était réellement pour elle.
J’avais déjà pris ma décision, mais je ne l’avais pas encore vécue. Elle fermentait dans mon corps. Cette visite était une étape importante, je pensais la craindre. La crainte était dans la pensée. J’en avais peut-être besoin. Je pensais ce que je devais penser. C’était une étape importante. Les raisins n’y étaient pour rien.
J’avais l’habitude de lui apporter une petite chose à manger. Des chocolats, moins périssables, auraient été bien pour l’occasion, mais je m’écœurais d’avance à l’idée de la voir malaxer la pâte brune dans sa bouche. Des raisins, c’était assez classique aussi. Je me suis dit, sans pépins, ça sera plus simple. Cette idée s’est fixée dans ma tête. Je n’ai jamais aimé les raisins sans pépins. Vaguement par principe, puis quelque chose dans la pulpe me dérange. Une fantaisie, une illusion sans doute, mais cette absence me semble augmenter la densité de la chair, lui donner un air cadavérique. Je lui offrais quelque chose que je n’aimais pas alors qu’elle aurait mangé n’importe quoi. Il suffisait de le lui donner, de lui dire de manger. Si je n’avais rien apporté cela aurait été pareil. C’était un échange vidé de tout sens de partage. Deux personnes invisibles qui se regardaient. Non. Elle souriait quand je souriais, elle faisait écho à mes mots, imitait mes gestes. Mais elle ne me reconnaissait pas. Elle n’était pas ma mère, je n’étais pas son fils. Ses minutes étaient des heures, des semaines. Entre chaque bouchée elle s’éteignait. Puis de nouveau elle était là, comme si de rien n’était, prête à ouvrir la bouche comme un oisillon pour la becquée. J’étais heureux de ne pas avoir besoin de lui montrer l’exemple, seulement imaginer avaler quelque chose dans cette atmosphère surchauffée me donnait la nausée, l’air était croquant d’odeurs, de particules macérées.
Je lui tendais les raisins, elle les mangeait. Elle n’était responsable de rien, ne pouvait être coupable ni avoir du mérite. Mais de savoir que je la voyais pour la dernière fois, même si c’était mon choix, était douloureux. Un exercice de culpabilité. Elle suçait, elle mastiquait, elle extrayait le jus. Puis, très doucement, elle crachait les peaux dans le creux de ma main.
On m’a dit d’aller là.
Me voilà.
Un déplacement. Un soi-disant stage. Beaucoup de route, deux nuits d’hôtel, un jour et demi d’abstractions. C’est la première fois qu’on m’impose ce genre de truc. Une façon de faire des économies. Investir dans la communication, mais surtout ne rien dire.
Libéré, je me sens confiné. Je sors et c’est comme si je tombais. Mon corps est mou, l’air dense, moelleux. Une chaleur exceptionnelle pour le mois. Depuis le matin j’ai entendu au moins quatre personnes dire qu’il n’y a plus de saisons, le beau temps les rend mornes. Je traverse le parking comme un ivrogne. Après les résonances de ma claustration une impression de silence. Un vacarme blanc réverbère dans ma tête.
Perplexe, je m’arrête, regarde le bâtiment que je viens de quitter. Un bloc rectangulaire revêtu de tôles métalliques toutes neuves, toutes propres. Sans ouvertures apparentes. Il ne ressemble pas à une construction permanente, ni à un lieu où on imaginerait abriter régulièrement, durant de longues périodes des êtres humains. Sauf que si, on l’a imaginé. Dans la zone, il y a plusieurs boîtes similaires de taille, de couleur différentes, d’autres sont en chantier. C’est un nulle part froidement sûr de lui, ni ville ni campagne, indifférent à tout ce qui l’entoure.
Je n’arrive pas à me décider à monter dans la voiture. Quelque chose n’enclenche pas. Un défaut dans l’enchaînement des instants. Des gens sortent, passent, partent. Il y en a qui disent bonsoir, mais dans ce lieu je me sens anonyme. Je suis sans doute fatigué, j’ai peut-être faim.
Depuis la veille, je trimbale une banane dans mon sac. Ma femme l’y a mise, je ne la voulais pas, elle a insisté, Tu fais ce que tu veux. J’étais crispé, tendu, tracassé par cette histoire de stage alors qu’elle semblait la prendre à la légère. Elle disait, Ça te fera du bien, tu devrais en profiter, saisir l’opportunité. Je lui ai répondu que ce n’était pas le moment, qu’elle ne comprenait pas. Je savais bien qu’elle comprenait, mais nous pensions différemment. Son sourire, sa bienveillance m’étouffaient, je me sentais comme un môme sur le départ pour mon premier voyage en dehors de la famille.
La banane a souffert dans le sac. La peau, son jaune devenu un peu grisâtre, est encore lisse, mais à l’intérieur, la pulpe a commencé à se ramollir. Si je ne la mange pas tout de suite je ne la mangerai jamais. C’est un fruit qui m’a toujours inspiré de l’ambivalence. Trop mûres elles m’écœurent, alors que Nathalie les mange même noircies, mais je n’ai pas l’intention de la ramener à la maison. C’est par un réflexe d’obéissance économe que je l’épluche. En mastiquant je m’éloigne de la voiture. J’ai envie de bouger. Mais pour une raison qui m’échappe, je n’ose pas aller très loin. Ce n’est pas une sensation de menace, plutôt l’impression d’être à la limite de quelque chose. Je regarde le noir au-delà du parking. C’est comme si je faisais une sortie dans l’espace. Si j’allais plus loin rien ne me retiendrait. Je fais de petits allers-retours comme si j’étais impatient. Je ne le suis pas. Je ne suis rien. C’est à peine si je suis convaincu de ma présence. La scène me semble fausse, un collage, un montage. Même les couleurs, la lumière manquent de naturel. Tout est aplati, projeté sur une toile de fond devant laquelle une doublure, un doppelgänger se déplace à ma place.
Sauf que ce soir-là, doppelgänger est un mot que je ne connais pas encore.
Manger une banane dans le noir, sur ce parking, avec les premières gouttes qui tombent, c’est ridicule, incongru. Toutefois c’est bien moi qui mâche la chair de ce fruit que je ne me résous pas à gaspiller. Si le goût n’est pas déplaisant, je cale rapidement. C’est du béton végétal dans ma bouche, il faut l’avaler vite, avant qu’il ne prenne, me bloque la gorge.
À l’hôtel, je remplis les tableaux d’information censés permettre l’analyse statistique de ma journée. Découpée, compressée dans les cases du formulaire, mon activité s’effrite. Chaque réponse met en doute la précédente, je ne cesse de revenir en arrière, ne trouve pas de place pour mon expérience dans les questions, ni dans les possibles réponses proposées. Je mets dix fois le temps prévu pour l’accomplissement de cette tâche.
Avec l’envoi du fichier je m’éteins. Je n’ai pas l’habitude des hôtels, ne suis pas à l’aise. Je sens bien que la chambre n’a que faire de ma présence.
Je m’étends sur le lit, j’attends.
Ça me rappelle les occasions de mon enfance où on m’enfermait ou je m’enfermais dans ma chambre.
Je ne boude pas, mais c’est cette sensation qui revient, une humeur sans borne et en même temps claustrophobe. Enfant, il y avait toujours quelqu’un, quelque chose, une injonction, une tentation, comme un hypnotiseur claquant des doigts, pour mettre un terme à la transe. Ici, il me semble qu’il n’y a rien à espérer. Je ne boude pas, mais c’est tout comme.
Du coin de l’œil, je perçois un mouvement. Quelque chose serait passé à l’extérieur de la fenêtre. Je tourne la tête, il n’y a rien, la nuit, le reflet de la chambre, moi sur le lit regardant d’un air ahuri. Ça aurait pu être un oiseau, ce n’en était pas un, j’en suis tout de suite certain. Cette certitude m’énerve, née de l’incertitude, elle est aussi fausse que vraie. Frisson d’une autre époque, elle ne me vaut rien. Je me sens incomplet, môme encore, non, ado. Je me dis que je devrais fermer les rideaux. Puis je me dis que non. Mais je devrais bouger. Je ne devais pas être là. C’est une journée qui ne m’appartient pas, elle se délaie dans un temps imprécis.
Cette histoire de stage me trouble. Apprendre, réapprendre, recommencer. Ou juste commencer. Après tant d’années être happé par un souvenir que j’ignorais avoir conservé, me trouver le souvenir de mes souvenirs. La fin du lycée. Toute la vie était une hallucination où je ne me positionnais pas. Le monde venait se moquer de moi avec des regards difformes, impitoyables, hilares, narquois. Cous de girafes, monstres, têtes pleines de menace, de mésestime m’espionnaient par la fenêtre de ma chambre bien que l’appartement soit au cinquième étage. Il n’y avait rien, non, mais cela ne m’empêchait pas d’appréhender, de craindre ma crainte. Mes doutes m’obligeaient à prendre ça au sérieux. Je me bousculais seul dans une solitude encombrée.
Et après ? La suite ?
Il n’y en a pas eu.
Juste la vie qui continue. Ma vie apparemment. Qui m’a amené ici, sans que je comprenne pourquoi.
Je regarde la fenêtre, ne peux m’empêcher de regarder la fenêtre, de voir ce que je ne vois pas, d’être fasciné par cette absence.
Ma femme me remue. La sonnerie du téléphone. Une secousse, un secours, une violence contre mon inertie. Devoir de réalité. Stimulus pénible. Répondre ou ne pas répondre. Le choix est hypothétique, l’hésitation existe seulement comme la trace laissée par quelque chose déjà effacé. Des paroles brusquement cajoleuses grincent dans mon oreille. Ça va ? Ça c’est bien passé ? Tu es où ? Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu as mangé ? Je suis en conflit avec mes réactions. Cette sincérité provoque un haut-le-cœur comme la dernière bouchée de la banane. Je n’arrive pas à absorber ce qu’elle me dit, n’entre pas dans la conversation, profère simplement les réponses qu’elle me tend avec ses questions. Je ne quitte pas des yeux la fenêtre. Mais il faut que tu manges. Sors, bouge-toi, ça te changera les idées, te donnera de l’appétit. Allez, je te laisse, sinon il va être trop tard.
Je glisse le téléphone dans ma poche et ma femme avec. Ce nouveau silence embrasse celui de la maison où elle vient de reposer le combiné. Je me dis, elle est seule ce soir, elle a pensé à moi, alors que





























