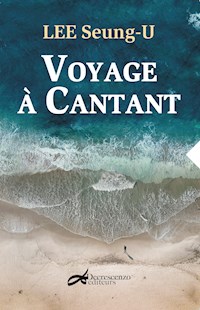
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Decrescenzo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a Pip le vieil homme bourru, épris de Moby Dick, qui a succombé au chant des Sirènes, il y a Tanaël, missionnaire qui n’a jamais converti personne, soupçonné du meurtre de sa compagne, et Jungsu qui ne parvient pas à éliminer la sirène d’alarme qui se déclenche dans sa tête. Tous trois se retrouvent à Cantant, un village perdu dans lequel une fois l’an, un étrange rite est le clou de la fête.
Après Le Chant de la terre, LEE Seung-U et son huitième titre en français nous plongent dans un drame dont l’auteur a le secret. Avec ce huis-clos où chaque personnage se heurte à son passé « cette bête féroce », LEE Seung-U montre une fois encore son habileté à traquer les lacis de la conscience humaine.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Lee Seung-U est l'un des auteurs coréens les plus connus en France. Avec Voyage à Cantant, il nous offre un roman intimiste, presque onirique, traversé par les questions du pêché et de la transcendance par l'écriture
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LEE Seung-u
VOYAGE
À
CANTANT
Roman
Traduit du coréen par
KIM Hye-gyeong et Jean-Claude de CRESCENZO
Ouvrage publié sous la direction de
Julien PAOLUCCI
Ouvrage traduit et publié avec le concours dela Fondation Daesan
Titre original : 캉탕 [cantang]
© LEE Seung-u, 2019Tous droits réservésÉdition originale publiée en Coréepar Hyundae Munhak Publishing Co., Ltd.
© Édition française publiée avec l’accord de Hyundae Munhak Publishing Co., Ltd.© Decrescenzo éditeurs, 2022pour la traduction française.ISBN 978-2-36727-091-3
Nos livres et nos auteurs sur :www.decrescenzo-editeurs.com
La couverture deVoyage à Cantanta été réalisée par Thomas GILLANT
Du même auteur chez le même éditeur
Le Regard de midi, 2009
Le Chant de la terre, 2017
0
Cantant est une minuscule ville portuaire de l’Atlantique. Elle ne figure pas sur la plupart des cartes ordinaires. Les gens d’ici disent vivre au bout du monde. Faiblement peuplée, peu fréquentée, Cantant est calme toute l’année, sauf à la mi-mai, où elle grouille de monde autour du port. À cette période a lieu une fête pendant une semaine. La fête de Cantant offre un programme qui ne laisse aucun doute quant à la présence de la mer dans la vie de ses habitants depuis des temps immémoriaux. L’affiche est spectaculaire : un long défilé de pêcheurs munis d’équipements variés, cordes, filets, harpons, etc., un concours de chants marins, un rite sacrificiel auprès du dieu de la mer, enfin, un défilé de bateaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Le dernier jour de la fête, des volontaires sautent dans la mer depuis une tour en forme de mât installée pour la circonstance sur la digue et dont la hauteur donne le vertige. Ce rituel est inspiré d’un ancien culte de la région : l’offrande de corps humains au dieu de la mer. Au siècle dernier encore, cette coutume devait apaiser le courroux du dieu marin en lui offrant un sacrifice. Les ancêtres de Cantant choisissaient la victime de l’année par tirage au sort et l’emmenaient en pleine mer, au bord d’un tourbillon qu’ils appelaient « le Palais ». Bateaux et villageois s’y regroupaient, les enfants n’étaient pas exclus. Les bateaux encerclaient le Palais, et depuis le sommet du mât du bateau de tête, la victime, les yeux bandés, sautait dans la mer sous le regard des curieux. On croyait alors que la victime s’en irait vivre dans le palais sous-marin. Ce rite a été aboli. Mais dans le cœur des habitants, notamment ceux qui tirent bénéfice de la mer, la nécessité d’apaiser la divinité n’a pas disparu. Ils ont conservé la coutume en la modernisant. La fête, malgré son aspect ludique, est conçue, organisée et animée dans la seule perspective d’apaiser le divin courroux. Dans la version contemporaine de la cérémonie, le tirage au sort de la victime n’existe plus. D’ailleurs, le terme de victime n’est plus employé. On ne va plus au bord du tourbillon. N’importe qui peut se jeter dans la mer depuis le faîte de la tour installée sur la digue. Les touristes venus de loin ne sont pas les derniers à participer. Ce rituel est devenu un jeu. Nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à s’élancer depuis le sommet de la tour, espérant que leurs vœux, d’après une légende populaire, se réaliseront, à condition de crier bien fort pendant le saut. Il est impossible de connaître l’origine de cette croyance proche de la superstition. On n’aurait pas tort de supposer un dessein secret par lequel la future victime se porte volontaire. Faut-il penser que tous ces gens ont autant de vœux à voir se réaliser ? On ne les appelle plus « victimes », et ils n’ont d’ailleurs pas conscience d’en être. Le terme « pada », employé pour désigner celui qui saute depuis le sommet de la tour, signifie « élu » en dialecte de la région. Il grimpe sur la tour en volontaire, et se jette dans la mer en élu.
1
Marcher, voir, écrire. Han Jungsu n’avait pas de projets prévus. Il n’avait d’ailleurs ni le temps ni la tête à élaborer des projets. Il est vrai que marcher, voir, écrire est déjà un projet en soi. Au demeurant, l’idée ne venait pas de Jungsu lui-même. J, un ami psychiatre qu’il avait consulté durant cinq séances de deux heures chacune, lui avait conseillé de prendre un long repos. « Arrête tout et pars. Quitte ton bureau sans même le ranger. Fais ce que tu n’as jamais fait et va là où tu n’es jamais allé. » J avait parlé en prophète. C’est du moins l’impression qu’en avait eue Jungsu. J était presque le seul ami à qui il pouvait se confier sans crainte. Il pensait parfois que J le connaissait mieux qu’il se connaissait. Cette idée n’était pas fausse. Il se demandait de temps à autre qui il était, mais J semblait en savoir plus long sur lui qu’il n’en savait lui-même. Jungsu ne se considérait pas comme un individu complexe, mais J utilisait souvent des expressions suggérant que son ami l’était beaucoup plus qu’il ne le croyait. Certainement, J voulait-il dire que tout le monde, sans exception, est complexe, laissant entendre que son ami n’avait rien de spécial de ce point de vue ; pourtant, Jungsu avait l’impression que son ami psychiatre semblait dire qu’il était quelqu’un d’un peu particulier. Cette confiance exemplaire à l’égard de J nous permet de comprendre sans trop de difficulté le motif de son départ vers une destination inconnue, sans autre projet que de marcher, voir, écrire, ainsi que l’avait conseillé J. Effectivement, du jour au lendemain, il quitta sa maison, sans même ranger son bureau, délaissant la tasse de café qu’il était en train de prendre. Il est capital de comprendre qu’il était si mal en point qu’il n’avait pas repoussé le conseil du spécialiste. J lui avait dit : « Nietzsche marchait six heures par jour, parfois huit heures, pour oublier ses atroces migraines. Il marchait jusqu’à ne plus ressentir le mal chronique dont il souffrait depuis sa jeunesse. Dans une lettre à un ami, il avait confessé que presque tous ses livres étaient nés en marchant. À quelques exceptions près, les idées lui venaient chemin faisant. Si c’est vrai, c’est extraordinaire, non ? Il n’y a pas de raison d’en douter. Tant d’idées dans une tête aussi minuscule, on comprend que la migraine n’ait jamais pu le quitter bien longtemps. Chacun de ses pas stimulait une pensée, qu’il transformait en écrit, et, la pensée évacuée, la migraine disparaissait. N’est-ce pas ? Voilà pourquoi il devait marcher six à huit heures par jour. » Jungsu se doutait bien que son ami J ne le comparait pas à Nietzsche, mais il accepta la marche comme une prescription efficace dans son cas. Nietzsche et Jungsu ne pouvaient être comparés, mais leurs symptômes, eux, le pouvaient. Si on accepte la similitude des symptômes, il n’y a aucune raison de refuser la similitude des prescriptions. « En marchant tu verras, puis tu écriras ce que tu as vu. Le reste, ce qui te préoccupe habituellement, laisse tomber. Tu n’es pas Nietzsche, et tout ce que tu auras vu ne se transformera pas automatiquement en livre. » Pour renforcer l’efficacité de sa prescription, J n’oublia pas d’insister sur les recommandations suivantes : Ne pas marcher pour voir. Ne pas écrire s’il n’y a rien à écrire. Se contenter de marcher. Marcher sans être conscient de marcher. En préparant sa valise, Jungsu pensa que l’idée d’un voyage avait probablement germé en lui avant de recevoir le conseil de J. Il n’en avait pas eu conscience, mais J l’avait perçu aussitôt. J s’était borné à dévoiler l’idée à la place de son patient et ami. Il lui avait permis de réaliser ce qu’il n’avait jamais osé faire jusqu’ici, pour une raison ou pour une autre. C’est à ce moment-là qu’il se rendit vraiment compte que J le connaissait mieux qu’il ne se connaissait lui-même. Ne rien prévoir, ne se préoccuper de rien, ce n’est pas si facile. Il n’avait jamais vécu ainsi. Son mode de vie ne le tolérait pas. Jungsu eut l’impression d’avoir attendu l’annonce du gardien de prison l’autorisant à sortir après avoir purgé sa peine. Après un moment de flottement, une fois que cette idée eut fait son chemin, il finit par croire qu’il avait été emprisonné tout ce temps. Il s’empressa de quitter sa maison sans même débarrasser son bureau de la tasse de café.
2
Je n’avais aucune destination en tête, si bien que je ne pouvais aller nulle part. Celui qui peut aller n’importe où ne va en réalité nulle part. Celui qui peut aller n’importe où n’est pas un homme libre, mais un homme incompétent. Il ne s’autorise pas à choisir, il se laisse aller. Le mot « liberté » désigne la possibilité de choisir entre ceci et cela. Quand il n’y a ni ceci ni cela, quand il n’y a pas de différence entre ceci et cela, la possibilité de choisir est éliminée. La liberté disparaît. L’existence d’un mur garantit la liberté de le franchir. Impossible de franchir un mur si le mur n’existe pas. Sans mur, on ne peut parler ni de liberté ni de compétence à le franchir. Si le mur ne marque pas la différence avec le sol, il est impossible de le franchir. Ne jamais confondre liberté et laisser-aller.
3
Lors de la sixième séance, J remit à Jungsu une adresse inconnue. Il lut aussitôt l’inquiétude sur le visage de son ami qui, revenu le consulter deux fois en moins d’un mois, bafouillait à propos de liberté, d’incompétence et de laisser-aller. Son ami et patient se tourmentait à l’idée de devoir modifier ses habitudes. J ne lui demandait pas la lune, mais Jungsu réagissait comme si elle lui était demandée. J remarqua que son ami était transi de peur, bien qu’il ne l’exprimât pas, soit parce qu’il n’en avait pas conscience, soit parce qu’il en avait honte. D’après l’appréciation du psychiatre, bien qu’il y eût peu de différence entre ces deux raisons possibles, il valait mieux traiter l’ignorance plutôt que la honte. Il y avait fort à parier que la peur réelle d’être séparé de son milieu habituel l’emportât sur une vague peur de l’inconnu. Certains sont en proie au désir de se frotter à un monde inconnu, mais ce n’est pas le cas de tous. Vénérer un autre monde, merveilleux, hypothèque le retour au monde familier. Le vagabondage, avec retour assuré au monde familier, n’est qu’un voyage, bien qu’il puisse durer longtemps. La liberté, la disponibilité du voyageur découlent plus de la certitude que son retour aura bien lieu que des nouvelles expériences qu’il aura menées dans ce monde merveilleux. Sans garantie de retour, le monde inconnu se transforme en crainte plutôt qu’en rêve. Celui qui souffre de son univers familier craint aussi de s’en séparer. Chacun y est plus ou moins attaché. J, convaincu qu’il serait inutile de ranimer la crainte de Jungsu d’être privé de son confortable univers, et plutôt qu’en faire la remarque à son ami, préféra présenter un projet concret, en lui glissant une adresse dans la main. J, considéré par Jungsu comme le plus à même de le connaître, jugea que l’état de son patient était sérieux, en tout point comparable à celui de Nietzsche. Autrement dit, il n’était pas dans le cas du patient qui requiert une médication ou une intervention chirurgicale. Il avait besoin de s’évader de son propre monde. D’après le jugement de J, il devait se rendre en un lieu où l’attraction du monde familier serait sans effet. « Je pourrais te recommander un endroit lointain, si tu veux. Un endroit dépaysant. Un endroit où ton moi passé n’interviendra pas dans ton moi futur. J’espère que tu en as le désir. » Se rendre à une adresse qu’on lui a indiquée rassure celui qui s’effraie des mondes inconnus (celui qui n’est pas conscient que cette peur naît de la séparation avec le monde connu) ; bien que cette adresse ne soit pas une forme vivante, elle donne l’illusion d’en être une. Connaissant combien est efficace la sensation physique de tenir quelque chose à la main, J écrivit à dessein une adresse en gros caractères sur une feuille blanche pliée en deux ; il la glissa à Jungsu en pressant légèrement la main de son ami, et de son autre main, il lui prit le bras. La scène ressemblait à une cérémonie de transmission d’un secret. À cet instant, Jungsu sentit sa poitrine se contracter ; un vague sentiment de confiance en soi, voire de satisfaction, l’étreignit. Il ne quittait pas sur un coup de tête un monde familier pour un monde inconnu, non, il partait vers un ailleurs à découvrir. Cela lui suffisait. « Il était dingue de Moby Dick, le roman de Melville. » En décidant d’expédier Jungsu le plus loin possible, là où l’attraction du monde connu n’exercerait pas son influence, un homme lui vint à l’esprit. J en fit à son ami le portrait suivant : « Il croyait que les personnages de ce roman étaient réels. Tu te rends compte ? Il est vrai que l’écrivain avait écumé les mers sur un baleinier pendant sa jeunesse ; mais cette drôle d’idée déprécie l’imagination de l’auteur, non ? En tous cas, il avait embarqué avec la ferme intention de chasser la baleine. Et probablement, il devait en chasser. Il devait prendre un plaisir manifeste à lutter avec elle dans l’immensité marine. Mais à mon avis, il s’était embarqué pour satisfaire son goût du vagabondage. J’imagine combien il devait être étouffant pour un jeune homme féru de littérature, dégustant le vaste monde à travers ses lectures, de vivre en valet de ferme répandant du fumier dans les champs et cueillant des algues marines. Il avait réellement mené cette vie-là. Matelot engagé pour une longue période sur un baleinier, il était tombé amoureux d’une femme rencontrée dans un port où son bateau avait jeté l’ancre, puis il s’était installé avec elle. Depuis, il n’a plus jamais repris la mer. Faut-il dire qu’il a vagabondé à la recherche d’une terre où s’enraciner ? Ou bien faut-il dire qu’il a vagabondé parce qu’il ne trouvait pas de terre où s’enraciner ? Il ne serait pas farfelu de tirer de sa vie la leçon suivante : il faut vagabonder jusqu’à trouver une terre où s’enraciner. “Je ne descendrai pas de la mer avant d’avoir jeté l’ancre.” Voilà ce qu’il m’avait dit. Je ne l’ai vu qu’une seule fois, vers la fin de mes études universitaires. Au gré de mes voyages, sac sur le dos, je suis allé le voir là où il vivait. Un endroit pas facile où se rendre. J’étais curieux de savoir comment il en était arrivé à s’installer dans un pareil lieu. C’est à cette époque qu’il m’a dit : “Je ne descendrai pas de la mer avant d’avoir jeté l’ancre.” Il n’avait pas tenu que ce propos, mais la confidence avait résonné dans ma tête. Descendre de la mer ? Il devait prendre la mer pour un moyen de transport. Il s’agit du petit frère de ma mère, mon oncle maternel, donc. » Jungsu lui demanda s’il avait réellement un oncle maternel, sans véritable envie de le savoir, si bien qu’il n’attendît pas la réponse. En revanche, il fixa avec une grande intensité l’adresse inscrite sur la feuille que son ami avait glissée dans sa main, et finit par dire en scandant chaque mot : « C’est… bien… loin… d’ici. » J approuva d’un signe de tête en répétant : « Oui, c’est bien loin d’ici. Je t’avais prévenu, c’est le bout du monde. »
4
« Je ne descendrai pas de la mer avant d’avoir jeté l’ancre. » Pour celui qui parle ainsi, la mer est un grand bateau. Chargé de marchandises ou d’êtres humains, un bateau se déplace d’un point à un autre, vers un endroit proche ou éloigné. Même si le voyage est long, les marchandises ou les êtres humains débarqueront tôt ou tard, lorsque le bateau sera arrivé à destination. Et même si les passagers restent longtemps à bord, ils se déplacent, ils n’y passent pas leur vie. Un bateau est un moyen de transport, pas un lieu d’habitation. Que le bateau soit bien équipé ou non, que les passagers restent longtemps à bord ou non, cela ne change rien à l’affaire. Pour untel, la mer est un grand bateau ; pour untel, le monde peut être un bus ou un train. Celui qui prend un bus ou un train, comme celui qui prend un bateau, ne fait que se déplacer ; il n’y passe pas sa vie. Que le bus ou le train soient bien équipés, qu’il y reste longtemps ou non, cela ne change rien à l’affaire. Il n’en descendra pas avant l’arrêt. Il ne pourra pas. Mais au fait, où se dirigent la mer et le monde ?
5
Voici l’histoire de Pip, jadis Choi Kinam, telle que J la raconta à Jungsu. Un baleinier avait jeté l’ancre dans un port peu connu de l’Atlantique. Sans qu’il eût eu le projet de faire escale. Si le moteur n’avait pas subi une avarie, après avoir frôlé la catastrophe et le risque d’être retourné par un typhon au beau milieu de l’océan, ce navire n’aurait jamais jeté l’ancre à Cantant. Le capitaine s’était mis à la recherche du port le plus proche, où réparer le bateau, mais aussi pour offrir un repos à ses marins découragés par la puissance de Poséidon. Mais la forte amplitude de la marée avait rendu l’accostage impossible. L’ancre jetée en pleine mer, les marins avaient atteint la terre ferme en chaloupes. Près du bord de mer, dans une auberge médiocre, dépourvue d’enseigne, mais où on pouvait trouver à dormir, boire et manger, Pip avait rencontré Naya. La fille de l’aubergiste aidait ses parents au service lorsqu’une dizaine de marins avaient envahi soudain l’auberge. Le coup de foudre n’avait pas eu lieu. Cela ne voulait pas dire que Naya n’était pas d’une beauté extraordinaire. Elle avait l’air bien trop jeune pour qu’un marin de vingt-cinq ans, voguant sur les mers depuis presque deux ans, y prêtât attention. À l’opposé de sa plantureuse maman, Naya paraissait chétive. Les marins à peine débarqués ne s’étaient pas intéressés à la jeune fille, mais plutôt à la mère, aussi affable avec les voyageurs inconnus qu’avec ses clients habituels. Certains marins lui avaient fait sans détour des avances. Pip aussi avait jeté des regards furtifs sur la patronne, mais jamais sur sa fille. Après le dîner, il s’était éclipsé du tapage classique d’une soirée bien arrosée et, débordant de sentimentalisme, s’en était allé flâner sur le bord de mer, le regard perdu sous une pluie d’étoiles. L’alcool avait provoqué la nausée typique du « mal de terre ». Il avait marché en se laissant guider par les odeurs d’humus et d’herbes. Dans le calme qui régnait, hormis le murmure de la mer, il avait entendu soudain un chant. Un écho si faible qu’il donnait l’illusion de surgir du clapotement des vagues. Au fur et à mesure que Pip marchait, le son était devenu plus distinct ; à son insu, il s’était dirigé dans la direction du chant. Malgré le timbre doux et limpide, le chant diffusait un sentiment mélancolique. Devant une maison bornée par un mur de pierre, sur une étendue de sable, il avait tendu l’oreille. Il entendait la berceuse chère à son enfance, bien que la mélodie fût tout à fait différente. Il était possible que sa mère eût chanté une berceuse pour l’endormir, mais il n’avait aucun souvenir de s’être endormi de la sorte. C’était vraiment un phénomène étrange qu’une berceuse de son enfance revînt à son esprit. Mais il ne s’était arrêté pas à l’étrangeté du phénomène. Il avait soudain éprouvé une envie immédiate de s’endormir, comme il le faisait au temps de son enfance, dans les bras de la personne qui chantait. Le chant était infiniment tendre, comme la première étreinte qui chavire le corps épuisé et l’âme esseulée. Il connaissait l’histoire du chant des Sirènes auquel avaient succombé les marins. Il savait qu’il fallait se boucher les oreilles à la cire et s’attacher au mât comme l’avait fait Ulysse dans l’Odyssée, pour ne pas se jeter à l’eau dans un état d’enchantement. Il n’avait pas imaginé que le chant des Sirènes fût lié à la profonde nostalgie des marins emprisonnés entre mer et ciel. Le chant des Sirènes n’a rien d’une berceuse. Mais les marins ensorcelés, le corps épuisé et l’âme esseulée, avaient probablement substitué ce chant à la berceuse qu’ils avaient entendue ou crue entendre dans leur enfance. Ce chant incarnait la nostalgie du sein maternel, du pays natal et de la femme. Comment expliquer autrement l’autodestruction volontaire de ceux qui viennent d’être ensorcelés ? Cette histoire n’a pas été conçue pour célébrer le talent exceptionnel des Sirènes, mais pour mettre en garde contre la nostalgie dont souffrent les âmes épuisées et esseulées. Pip n’avait ni cire pour se boucher les oreilles ni mât pour s’y attacher. Attiré par une force mystérieuse, il entra dans le chant ; et dans la maison d’où venait le chant. La maison appartenait à la patronne de l’auberge, et le chant était l’œuvre de la petite fille qui l’aidait durant le service du soir. Non, ce n’était plus une petite fille. Elle l’était quand elle débarrassait les tables d’un geste calme parmi les mouvements grossiers des marins excités par l’air de la terre, après un long voyage ; celle qui chantait cette mélodie mélancolique, assise face à la mer sombre, n’était pas une petite fille. Pour lui, elle était une sirène. Depuis la nuit des temps, on dit des sirènes qu’elles sont des fées avec une tête, un buste de femme et un corps d’oiseau aquatique1





























