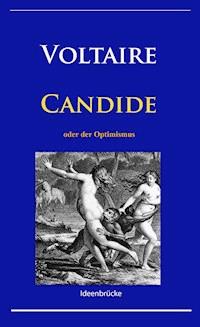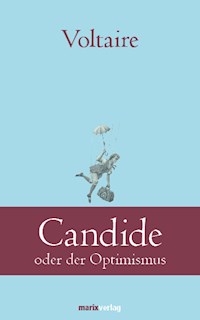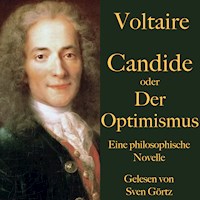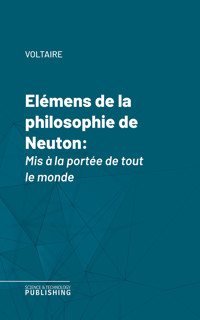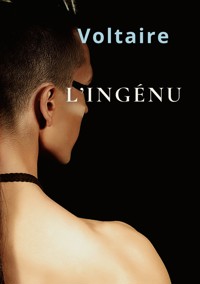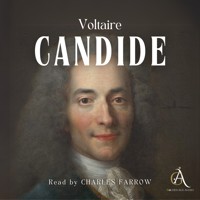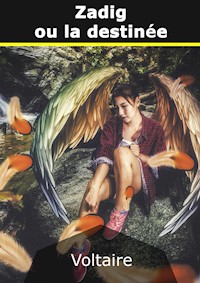
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sur le point d'épouser la plus belle fille de Babylone, jouissant de tous les privilèges de la jeunesse et de la fortune, vertueux de surcroît, Zadig se demande s'il est possible de vivre heureux ici-bas. Sa fiancée ne tarde pas à la trahir, des fanatiques le traînent en justice, on le menace du bûcher, on le vend comme esclave en Egypte et c'est par miracle qu'il retrouve sa patrie et triomphe de la laideur et de la bassesse du monde. Zadig sent le soufre et fait peur aux puissants, mais Voltaire éblouit par sa gaieté perpétuelle, sa sagesse, sa malice, son style enchanteur de " Français suprême " comme disait un de ses contemporains.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zadig ou la destinée
Pages de titrePage de copyrightVoltaire
Zadig ou la destinée
Histoire orientale
Épître dédicatoire de Zadig à la sultane Sheraa par Sadi.
Le 10 du mois de schewal,
l’an 837 de l’hégire.
Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l’esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d’Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d’un livre d’un ancien sage qui, ayant le bonheur de n’avoir rien à faire, eut celui de s’amuser à écrire l’histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu’il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d’en juger ; car, quoique vous soyez dans le printemps de votre vie, quoique tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle, et que vos talents ajoutent à votre beauté ; quoiqu’on vous loue du soir au matin, et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n’avoir pas le sens commun, cependant vous avez l’esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendue raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu. Vous êtes discrète et vous n’êtes point défiante ; vous êtes douce sans être faible ; vous êtes bienfaisante avec discernement ; vous aimez vos amis, et vous ne vous faites point d’ennemis. Votre esprit n’emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance ; vous ne dites de mal ni n’en faites, malgré la prodigieuse facilité que vous y auriez. Enfin votre âme m’a toujours paru pure comme votre beauté. Vous avez même un petit fonds de philosophie qui m’a fait croire que vous prendriez plus de goût qu’une autre à cet ouvrage d’un sage.
Il fut écrit d’abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n’entendons. On le traduisit en arabe, pour amuser le célèbre sultan Ouloug-beb. C’était du temps où les Arabes et les Persans commençaient à écrire des Mille et une Nuits, des Mille et un Jours, etc. Ouloug aimait mieux la lecture de Zadig ; mais les sultanes aimaient mieux les Mille et un. « Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Ouloug, des contes qui sont sans raison, et qui ne signifient rien ? – C’est précisément pour cela que nous les aimons, répondaient les sultanes. »
Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas, et que vous serez un vrai Ouloug. J’espère même que, quand vous serez lasse des conversations générales, qui ressemblent assez aux Mille et un, à cela près qu’elles sont moins amusantes, je pourrai trouver une minute pour avoir l’honneur de vous parler raison. Si vous aviez été Thalestris du temps de Scander, fils de Philippe ; si vous aviez été la reine de Sabée du temps de Soleiman, c’eussent été ces rois qui auraient fait le voyage.
Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable, et votre bonheur sans fin.
Sadi.
Le borgne
Du temps du roi Moabdar il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l’éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions ; il n’affectait rien ; il ne voulait point toujours avoir raison, et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu’avec beaucoup d’esprit il n’insultât jamais par des railleries à ces propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ces médisances téméraires, à ces décisions ignorantes, à ces turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles, qu’on appelait conversation dans Babylone. Il avait appris, dans le premier livre de Zoroastre, que l’amour-propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux ; il ne craignait point d’obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre : Quand tu manges, donne à manger aux chiens, dussent-ils te mordre. Il était aussi sage qu’on peut l’être ; car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens Chaldéens, il n’ignorait pas les principes physiques de la nature, tels qu’on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu’on en a su dans tous les âges, c’est-à-dire fort peu de chose. Il était fermement persuadé que l’année était de trois cent soixante et cinq jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde ; et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu’il avait de mauvais sentiments, et que c’était être ennemi de l’État que de croire que le soleil tournait sur lui-même, et que l’année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain.
Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu’il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémire, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémire l’aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l’Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C’étaient les satellites du jeune Orcan, neveu d’un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était permis. Il n’avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig ; mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n’être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu’il aimait éperdument Sémire. Il voulait l’enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence ils la blessèrent, et firent couler le sang d’une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s’écriait : « Mon cher époux ! on m’arrache à ce que j’adore. » Elle n’était point occupée de son danger ; elle ne pensait qu’à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l’amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémire évanouie et sanglante, qui en ouvrant les yeux vit son libérateur. Elle lui dit : « Ô Zadig ! je vous aimais comme mon époux ; je vous aime comme celui à qui je dois l’honneur et la vie. » Jamais il n’y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémire ; jamais bouche plus ravissante n’exprima des sentiments plus touchants par ces paroles de feu qu’inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa blessure était légère ; elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement ; un coup de flèche reçu près de l’œil lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait aux dieux que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes : elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards ; mais un abcès survenu à l’œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu’à Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade, et déclara qu’il perdrait l’œil ; il prédit même le jour et l’heure où ce funeste accident devait arriver. « Si c’eût été l’œil droit, dit-il, je l’aurais guéri ; mais les plaies de l’œil gauche sont incurables. » Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d’Hermès. Deux jours après l’abcès perça de lui-même ; Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu’il n’avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point ; mais, dès qu’il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l’espérance du bonheur de sa vie, et pour qui seule il voulait avoir des yeux. Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu’elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orcan la nuit même. À cette nouvelle il tomba sans connaissance ; sa douleur le mit au bord du tombeau ; il fut longtemps malade, mais enfin la raison l’emporta sur son affliction ; et l’atrocité de ce qu’il éprouvait servit même à le consoler.
« Puisque j’ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d’une fille élevée à la cour, il faut que j’épouse une citoyenne. » Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville ; il l’épousa, et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l’union la plus tendre. Seulement il remarquait en elle un peu de légèreté, et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d’esprit et de vertu.
Le nez
Un jour, Azora revint d’une promenade, tout en colère, et faisant de grandes exclamations. « Qu’avez-vous, lui dit-il, ma chère épouse ? qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même ? – Hélas ! dit-elle, vous seriez indigné comme moi, si vous aviez vu le spectacle dont je viens d’être témoin. J’ai été consoler la jeune veuve Cosrou, qui vient d’élever, depuis deux jours, un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l’eau de ce ruisseau coulerait auprès. – Eh bien ! dit Zadig, voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari ! – Ah ! reprit Azora, si vous saviez à quoi elle s’occupait quand je lui ai rendu visite ! – À quoi donc, belle Azora ? – Elle faisait détourner le ruisseau. » Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproches si violents contre la jeune veuve, que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig.
Il avait un ami, nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu’aux autres : il le mit dans sa confidence, et s’assura, autant qu’il le pouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azora ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement, la nuit même, qu’on n’avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle, et qu’on venait d’ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères, au bout du jardin. Elle pleura, s’arracha les cheveux, et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu’il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s’adoucit ; le souper fut plus long que le dîner ; on se parla avec plus de confiance. Azora fit l’éloge du défunt ; mais elle avoua qu’il avait des défauts dont Cador était exempt.
Au milieu du souper, Cador se plaignit d’un mal de rate violent ; la dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait pour essayer s’il n’y en avait pas quelqu’une qui fût bonne pour le mal de rate ; elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone ; elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie ? lui dit-elle avec compassion. – Elle me met quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador, et il n’y a qu’un seul remède qui puisse me soulager : c’est de m’appliquer sur le côté le nez d’un homme qui soit mort la veille. – Voilà un étrange remède, dit Azora. – Pas plus étrange, répondit-il, que les sachets du sieur Arnoua1 contre l’apoplexie. » Cette raison, jointe à l’extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. « Après tout, dit-elle, quand mon mari passera du monde d’hier dans le monde du lendemain sur le pont Tchinavar, l’ange Asraël lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première ? » Elle prit donc un rasoir ; elle alla au tombeau de son époux, l’arrosa de ses larmes, et s’approcha pour couper le nez à Zadig, qu’elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d’une main, et arrêtant le rasoir de l’autre. « Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Cosrou ; le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. »
Le chien et le cheval
Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il est écrit dans le livre du Zend, est la lune du miel, et que le second est la lune de l’absinthe. Il fut quelque temps après obligé de répudier Azora, qui était devenue trop difficile à vivre, et il chercha son bonheur dans l’étude de la nature. « Rien n’est plus heureux, disait-il, qu’un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu’il découvre sont à lui : il nourrit et il élève son âme, il vit tranquille ; il ne craint rien des hommes, et sa tendre épouse ne vient point lui couper le nez. »
Plein de ces idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l’Euphrate. Là il ne s’occupait pas à calculer combien de pouces d’eau coulaient en une seconde sous les arches d’un pont, ou s’il tombait une ligne cube de pluie dans le mois de la souris plus que dans le mois du mouton. Il n’imaginait point de faire de la soie avec des toiles d’araignée, ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées, mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes, et il acquit bientôt une sagacité qui lui découvrait mille différences où les autres hommes ne voient rien que d’uniforme.
Un jour, se promenant auprès d’un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là comme des hommes égarés qui cherchent ce qu’ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme, lui dit le premier eunuque, n’avez-vous point vu le chien de la reine ? » Zadig répondit modestement : « C’est une chienne, et non pas un chien. – Vous avez raison, reprit le premier eunuque. – C’est une épagneule très petite, ajouta Zadig ; elle a fait depuis peu des chiens ; elle boite du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très longues. – Vous l’avez donc vue ? dit le premier eunuque tout essoufflé. – Non, répondit Zadig, je ne l’ai jamais vue, et je n’ai jamais su si la reine avait une chienne. »
Précisément dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l’écurie du roi s’était échappé des mains d’un palefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d’inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s’adressa à Zadig, et lui demanda s’il n’avait point vu passer le cheval du roi. « C’est, répondit Zadig, le cheval qui galope le mieux ; il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit ; il porte une queue de trois pieds et demi de long ; les bossettes de son mors sont d’or à vingt-trois carats ; ses fers sont d’argent à onze deniers. – Quel chemin a-t-il pris ? Où est-il ? demanda le grand veneur. – Je ne l’ai point vu, répondit Zadig, et je n’en ai jamais entendu parler. »
Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n’eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine ; ils le firent conduire devant l’assemblée du grand Desterham, qui le condamna au knout, et à passer le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu qu’on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt ; mais ils condamnèrent Zadig à payer quatre cents onces d’or, pour avoir dit qu’il n’avait point vu ce qu’il avait vu. Il fallut d’abord payer cette amende ; après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desterham ; il parla en ces termes :