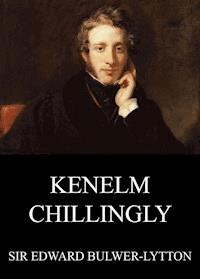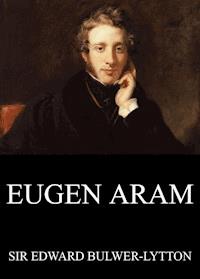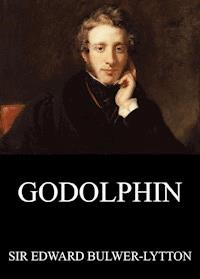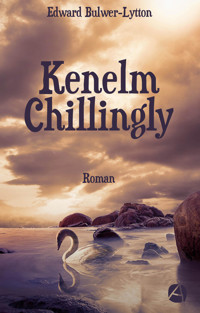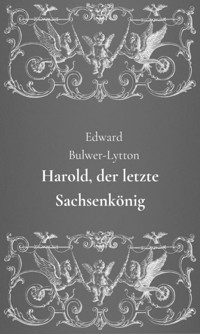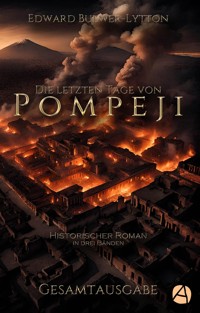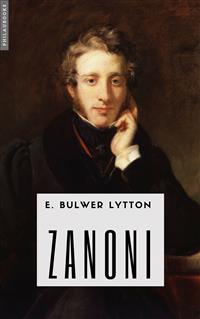
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Zanoni décrit la vie de deux êtres humains devenus immortels. L’un, Mejnour, est sans passion, tandis que Zanoni, son disciple, a atteint un équilibre entre raison et passion. Zanoni possède la jeunesse éternelle, le pouvoir et la connaissance absolue. Sa rencontre avec Viola Pisani bouleversera sa vie, jusque-là idéale et parfaite. Zanoni s’interrogera sur l’intérêt de sacrifier l’amour pour l’Initiation. Tandis que Mejnour reste insensible aux événements qui agitent le monde, il n’en est pas de même pour Zanoni qui est tenté de s’impliquer dans la révolution. Zanoni finira par perdre son immortalité et se sacrifier pour sa bien-aimée. Le nom Zanoni est dérivé de la racine chaldéenne zan, qui signifie «soleil», et le personnage principal est doté d’attributs solaires. Cette édition reprend celle de 1882, traduite avec l’autorisation de l’auteur. Wikipédia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zanoni
Edward Bulwer Lytton
Traduction parPierre Lorain
Table des matières
I. LE MUSICIEN
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
II. ART, AMOUR ET MYSTÈRE
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
III. THÉURGIE
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
IV. LE GARDIEN DU SEUIL
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
V. LES EFFETS DE L’ÉLIXIR
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
VI. LA SUPERSTITION ABANDONNE LA FOI
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
VII. LE RÈGNE DE LA TERREUR
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Livre I
LE MUSICIEN
1
C’était une vierge d’une rare beauté, mais de sa beauté elle ne prenait point souci... Chez les favoris de la nature, de l’amour et des cieux, la négligence même est pleine encore d’art.
Gerusal. lib., canto II, 14-18
Dans la seconde moitié du dernier siècle vivait et florissait à Naples un digne artiste nommé Gaetano Pisani. C’était un compositeur de grand génie, mais sans renommée populaire ; il y avait dans toutes ses œuvres quelque chose de capricieux et de fantastique que n’approuvait pas le goût des dilettanti napolitains. Il aimait les sujets étranges, et les airs et les symphonies qu’ils lui inspiraient éveillaient dans l’auditoire une sorte de terreur. Les titres de ses opéras suffiront sans doute pour en faire comprendre le caractère. Je trouve, par exemple, parmi ses manuscrits : le Festin des Harpies, les Sorcières de Bénévent, la Descente d’Orphée aux Enfers, le Mauvais œil, les Euménides, et beaucoup d’autres qui accusent une imagination puissante, se complaisant dans le terrible et le surnaturel, quoique souvent aussi, au milieu de ces sombres créations, une fantaisie légère et délicate vienne jeter des passages d’une grâce et d’une beauté exquises. Il est vrai qu’en empruntant ses sujets à la mythologie antique, Gaetano Pisani se montrait plus fidèle que ses contemporains à l’origine primitive et au génie naissant de l’opéra italien. Descendant dégénéré sans doute, mais pourtant légitime, de l’antique union entre la poésie lyrique et le drame, l’opéra avait, après une longue et obscure proscription, retrouvé sur les bords de l’Arno et au milieu des lagunes de Venise un sceptre plus débile, mais une pourpre plus éclatante ; et c’est aux sources classiques de la fable païenne qu’il puisa ses premières inspirations. La Descente d’Orphée de Pisani n’était qu’une répétition plus hardie, plus sombre et plus scientifique de l’Eurydice que Jacopi Peri mit en musique lors de l’auguste mariage de Henri de Navarre et de Marie de Médici 1. Cependant, ainsi que je l’ai dit, le style du compositeur napolitain ne plaisait pas en somme à des oreilles rendues difficiles et méticuleuses en fait de mélodie par la délicatesse recherchée des œuvres de l’époque ; des fautes et des extravagances faciles à découvrir et souvent, en apparence, volontaires, fournissaient aux critiques des motifs plausibles de défaveur. Si le pauvre Pisani n’eût été que compositeur, il fût sans doute mort de faim ; mais fort heureusement pour lui il possédait un excellent talent d’exécutant, surtout sur le violon, et il dut à cet instrument de pouvoir décemment subsister comme membre de l’orchestre du grand théâtre de San-Carlo. Là, des tâches précises et rigoureusement assignées maintenaient, sous un frein passablement efficace, les écarts de sa fantaisie, quoique, s’il en faut croire l’histoire, il ait été cinq fois exilé de son pupitre pour avoir scandalisé les conoscenti et jeté le désarroi dans l’orchestre tout entier par des variations improvisées, d’une nature si bizarre et si saisissante, qu’on eût pu soupçonner les harpies et les sorcières, ses inspiratrices, d’étreindre de leurs griffes les cordes de son instrument.
Mais, dans ses moments lucides et calmes, il était impossible de trouver un artiste qui l’égalât ; force avait donc été de le réinstaller, et il avait fini par se résigner, à peu près régulièrement, au cercle étroit des adagio et des allegro de rigueur. L’auditoire aussi, qui connaissait son faible, surveillait d’une oreille jalouse le moindre écart, et si, pour un moment, il s’oubliait, ce qui se trahissait à l’œil aussi bien qu’à l’oreille par quelque étrange contorsion du visage ou quelque mouvement convulsif de l’archet, aussitôt un murmure discret venait avertir le pauvre musicien, et le rappeler de son Élysée ou de son Tartare aux sobres régions de son pupitre. On le voyait alors tressaillir comme au sortir d’un songe, jeter autour de lui, en guise d’excuse, un regard rapide et effaré ; puis, l’air déchu et humilié, ramener au sentier battu et régulier de la monotonie son instrument rebelle. Mais, de retour chez lui, il se dédommageait de la fastidieuse corvée. Là, saisissant son malheureux violon avec des doigts féroces, il en faisait jaillir, souvent jusqu’au matin, des accords étranges et fantastiques, et mainte fois le pêcheur matinal, surpris et effrayé sur la plage par cette sauvage harmonie, s’est senti envahir d’une terreur superstitieuse et s’est signé comme si quelque sirène ou quelque esprit des eaux eût fait entendre à son oreille les échos plaintifs d’un autre monde.
L’apparence de Pisani était conforme à la nature de son talent. Ses traits étaient nobles et frappants, mais usés et hagards ; sa chevelure noire et négligée se roulait en boucles inextricables, et ses grands yeux, profondément creusés, lançaient un regard fixe, rêveur et spéculatif. Chacun de ses gestes était bizarre, saccadé et brusque comme la pensée qui l’agitait ; et, quand il glissait à travers les rues ou sur la plage, on l’entendait rire tout seul et se parler à lui-même. Du reste, c’était une nature douce, innocente et sans malice ; volontiers il partageait son obole avec le premier lazzarone qu’il trouvait sur son passage et qu’il aimait à voir se chauffer paresseusement au soleil. Il était cependant éminemment insociable. Il n’avait point d’amis, ne flattait aucun protecteur, et ne fréquentait aucune de ces joyeuses réunions si chères aux enfants de la musique et du Midi. Lui et son talent semblaient seuls se convenir : tous deux originaux, primitifs, farouches, irréguliers. Séparer l’homme de la musique était impossible ; elle était lui. Sans elle, il n’était rien... une simple machine. Avec elle, il était roi d’un monde, sa création. Pauvre Gaetano ! c’était bien le moins ; il était assez déshérité dans le monde des autres ! On voit, je ne sais quelle ville manufacturière d’Angleterre, une pierre tumulaire avec cette inscription :
CLAUDE PHILIPS
Son mépris souverain des richesses et son inimitable talent sur le violon le firent admirer de tous ceux qui le connurent.
Coïncidence logique d’éloges bien divers ! Il y aura, ô génie ! un rapport constant entre ton mépris pour les richesses et ton talent sur le violon !
Le mérite de Gaetano comme compositeur s’était principalement révélé dans la musique écrite pour son instrument de prédilection, le plus noble de tous, à coup sûr, le plus varié dans ses ressources, et le plus riche en puissance pathétique. Ce que Shakespeare est aux poètes, l’instrument de Crémone l’est à tous les autres instruments. Pisani avait cependant composé d’autres œuvres d’une portée plus large et d’un ordre plus élevé, et notamment son précieux opéra qui ne fut ni acheté ni publié, qu’on ne peut publier et qui pourtant ne peut périr : sa Sirène. Ce grand ouvrage avait été le rêve de son enfance, la bien-aimée maîtresse de sa jeunesse, et, maintenant que la vieillesse approchait, la Sirène « était là, debout auprès de lui, comme l’image de sa jeunesse. » Vainement avait-il lutté pour la donner au monde. Paisiello lui-même, si bonhomme, si dénué de jalousie, secoua sa tête bienveillante lorsque l’auteur soumit au maestro di capella une de ses scènes les plus palpitantes. Et pourtant, Paisiello, cette musique, si différente de tous les modèles que te proposait Durante, peut bien... Mais patience, Gaetano ; attends ton heure et tiens ton instrument d’accord.
Si étrange que cela puisse sembler à l’aimable lectrice, ce grotesque personnage avait pourtant formé ces liens que les mortels ordinaires considèrent volontiers comme leur monopole exclusif : il était marié ; il avait un enfant. Chose plus étrange encore, sa femme était une fille de la tranquille, régulière et peu fantastique Angleterre ; elle était beaucoup plus jeune que lui, belle et bonne avec un doux visage anglais : elle l’avait épousé par choix, et (le croiriez-vous, madame ?) elle l’aimait encore. Comment pour l’épouser ? comment cet être timide, insociable, fantasque, osa-t-il jamais lui demander sa main ? Questions auxquelles je ne puis répondre qu’en vous priant de jeter les yeux autour de vous, et de commencer par m’expliquer comment la moitié des maris et la moitié des femmes que vous voyez ont trouvé à se marier. En y réfléchissant, pourtant, cette union n’avait rien, après tout, de si extraordinaire. La jeune fille était enfant naturelle de parents trop nobles pour la réclamer jamais et la reconnaître. Elle avait été amenée en Italie pour apprendre l’art qui devait la faire vivre, car elle avait du goût et de la voix ; elle était dans une position subalterne et soumise à de mauvais traitements : le pauvre Pisani était son maître, et, de toutes les voix qu’elle avait entendues depuis son berceau, celle de Pisani était la seule qui lui sembla dépourvue de la corde qui reproche et qui gronde. Si bien que... eh bien ? le reste ne va-t-il pas de soi ? la conséquence n’est-elle pas naturelle ? Naturelle ou non, ils se marièrent. Cette jeune femme aimait son mari, et toute jeune, et toute douce qu’elle était, on eût pu dire que, des deux, c’était elle qui protégeait l’autre. Combien de fois avait-il échappé au déplaisir des despotes de San-Carlo et du conservatoire, grâce à la médiation secrète et officieuse de sa femme ! À travers quelles souffrances, car il était d’une santé frêle et chétive, lui avait-elle prodigué ses veilles et ses soins ! Souvent, dans ses sombres nuits, elle allait l’attendre au théâtre, avec sa lanterne pour l’éclairer, et son bras ferme pour le soutenir ; sans quoi, dans ses distraites rêveries, le musicien aurait bien pu poursuivre sa Sirène jusque dans la mer ! Et puis, elle savait avec tant de patience, et peut-être (l’amour véritable n’est pas toujours le plus éclairé des critiques) avec tant d’enthousiasme, écouter ces tempêtes de mélodie excentrique et fiévreuse, et l’arracher, en le comblant d’éloges en chemin, à ses longues veillées nocturnes, pour le contraindre à prendre du repos et du sommeil ! J’ai dit que sa musique faisait partie de l’homme lui-même, et cette douce créature semblait faire partie de sa musique. C’était quand elle était assise auprès de lui, que tout ce qui était tendre et féerique dans ses incohérentes créations venait se glisser comme à la dérobée dans son jeu. Sa présence sans doute réagissait sur la musique, la modifiait, radoucissait ; mais lui, qui ne cherchait jamais le comment ni le pourquoi de son inspiration, il ne le soupçonnait pas. Il ne savait qu’une chose : qu’il l’aimait et la bénissait. Il était convaincu qu’il le lui disait vingt fois par jour ; il ne le lui disait jamais : c’était un homme peu expansif, même avec sa femme. Son langage à lui, c’était sa musique ; celui de sa compagne, c’étaient ses mille soins affectueux ! Il était plus communicatif avec le barbiton, comme le docte Mersennus veut que nous appelions toutes les variétés de la grande famille des instruments à cordes. Barbiton sonne assurément mieux que fiddle en anglais ; va donc pour barbiton. C’est à cela qu’il parlait pendant une grande heure ; il le louait, le grondait, le caressait, que dis-je ? (tel est l’homme et l’homme le plus innocent !) il le maudissait ; on avait entendu parfois un juron entre deux notes ; mais cet excès avait toujours été suivi du plus édifiant repentir. Le Barbiton avait aussi sa langue à lui ; il savait se défendre au besoin, et, quand il s’avisait de gronder à son tour, la victoire lui restait. C’était un noble personnage que ce violon ; un tyrolien, le chef-d’œuvre de l’illustre Steiner. Son grand âge avait quelque chose de mystérieux. Combien de mains, aujourd’hui réduites en poussière, avaient fait vibrer ses cordes avant qu’il devint le Robin Goodfellow, l’inséparable de Gaetano Pisani ! Sa boîte même était vénérable ; un étui merveilleusement peint, par Carache, dit-on. Pour cet étui, un collectionneur anglais avait offert plus que Pisani n’avait jamais réalisé avec son violon. Mais Pisani, parfaitement content d’une cabane pour lui-même, était fier de donner un palais à son Barbiton. Son Barbiton ! c’était l’aîné de ses enfants. Il faut maintenant nous occuper de la cadette.
Comment te dépeindrai-je, Viola ? La musique, assurément, est en partie responsable de la venue de cette jeune étrangère. Dans son aspect et dans son caractère on eût pu reconnaître une ressemblance de famille avec cette vie singulière et pour ainsi dire incorporelle de la musique, qui, nuit après nuit, s’épanchait en élans aériens et fantastiques sur les flots étoilés... Belle, elle l’était ; mais d’une beauté toute singulière ; c’était une combinaison, une harmonie d’éléments opposés. Sa chevelure était d’un or plus riche et plus pur que celles qu’on voit même dans le Nord ; mais ses yeux brillaient de tout le sombre, doux et irrésistible éclat d’une splendeur plus qu’italienne, et presque orientale. Un teint d’une pureté exquise, mais sans cesse changeant, animé à un moment, pâle le moment suivant. Et avec ce teint, l’expression variait également : tout à l’heure rien de si triste ; rien maintenant de si radieux.
J’ai le regret de dire que ce que nous appelons proprement éducation avait été fort négligé chez leur fille par ce couple singulier. Sans doute, ni l’un ni l’autre n’avait beaucoup de connaissances à communiquer ; la science d’ailleurs n’était pas à la mode comme aujourd’hui : mais le hasard ou la nature avait favorisé la jeune Viola. Elle apprit du moins la langue de sa mère et celle de son père. Elle trouva aussi bientôt le moyen de savoir lire et écrire ; et sa mère, catholique romaine, lui enseigna de bonne heure à prier. Seulement, pour réagir contre toute cette instruction, les habitudes étranges de Pisani, les soins qu’il réclamait de sa femme, laissaient souvent l’enfant seule avec une vieille ouvrière qui l’aimait sans doute chèrement, mais qui n’était nullement en état de l’élever. Dame Gionetta était, des pieds à la tête, Italienne, et Napolitaine, qui plus est. Toute sa jeunesse avait été amour, tout ce qui lui restait de vie était superstition. Elle était bavarde, à moitié folle, une vraie commère. Tantôt elle parlait à l’enfant des princes et des chevaliers qu’elle avait vus à ses pieds ; tantôt elle glaçait tout son sang avec des contes et des légendes aussi vieilles peut-être que les fables de la Grèce et de l’Étrurie, de démons, de vampires, de danses nocturnes autour du grand noyer de Bénévent, et du charme implacable du Mauvais Œil. Tous ces récrits contribuaient à jeter sur l’imagination de Viola un voile mystérieux tissé graduellement et silencieusement, et qu’une pensée plus mûre, à un âge plus avancé, pourrait en vain chercher à écarter. Mais surtout cette tournure d’éducation romanesque la disposait merveilleusement à suspendre, avec une joie pleine de terreur, son oreille et son âme à la musique de son père. Ces accords extatiques, cherchant toujours à traduire en notes brisées et étranges le langage d’êtres d’un monde inconnu, la berçaient depuis sa naissance. On eût pu dire que son âme s’était nourrie de musique : associations d’idées et de souvenirs, sensations de peine et de plaisir, tout se mêlait d’une façon inexplicable avec ces accords qui tantôt la ravissaient, et tantôt l’effrayaient. C’était là ce qui l’accueillait quand ses yeux s’ouvraient aux rayons du soleil ; c’était là ce qui l’éveillait tremblante sur sa couche solitaire, au milieu des ténèbres de la nuit. Les légendes et les contes de Gionetta ne servaient qu’à mieux faire comprendre à l’enfant le sens de cette harmonie mystérieuse ; ils fournissaient des poèmes à la musique paternelle.
La fille d’un tel père ne pouvait guère manquer de montrer quelque goût pour son art. Ces dispositions se développaient surtout par l’oreille et par la voix. Encore enfant, elle chantait divinement. Un grand cardinal, grand à la fois dans l’État et au Conservatoire, entendit parler de son talent, et se la fit amener. Dès ce moment son sort fut décidé ; elle devait être la gloire future de Naples, la prima donna de San Carlo. Pour éveiller son émulation, Son Éminence l’emmena un soir dans sa loge ce serait quelque chose pour elle de voir la représentation, quelque chose de plus encore d’entendre les applaudissements prodigués aux brillantes signoras qu’elle était destinée à éclipser ! Avec quel éclat glorieux s’ouvrit pour elle dès l’aurore cette vie de la scène, ce monde idéal de la Musique et de la Poésie, le seul monde qui sembla correspondre aux rêves étranges de son enfance !... Il lui sembla que, rejetée jusque-là sur une rive étrangère, elle venait d’être tout à coup ramenée enfin dans sa patrie ; elle reconnaissait les formes et le langage de sa terre natale. Enthousiasme profond et vrai, riche de toutes les promesses du génie ! enfant, ou homme, tu ne seras jamais poète, si tu n’as senti tout l’idéal, tout l’enchantement romanesque de cette île de Calypso, qui s’est révélée à toi le jour où, pour la première fois, le voile magique s’est écarté pour laisser le monde de la Poésie éblouir le monde de la prose !
L’initiation était maintenant commencée. Il lui fallait lire, étudier, rendre par un geste, un regard, les passions qu’elle devait exprimer sur la scène ; leçons dangereuses sans doute pour beaucoup d’autres, mais non pas pour le pur enthousiasme qui naît de l’art : car l’âme qui conçoit l’art dans sa vérité n’est qu’un miroir ; pour refléter fidèlement l’image projetée sur sa surface, ce miroir doit rester sans souillure. Elle suivit la nature et le vrai par un instinct d’intuition. Ses rôles acquirent dans sa bouche une puissance dont elle n’avait pas conscience ; sa voix attendrissait le cœur jusqu’aux larmes, ou l’embrasait d’une généreuse indignation. Mais tous ces résultats n’étaient que la conséquence de cette sympathie que le génie, même dans son innocence première, éprouve pour tout ce qui sent, qui désire ou qui souffre. Viola n’était pas une de ces natures féminines trop précoces, qui comprennent l’amour ou la jalousie exprimés dans les vers ; son talent était un de ces secrets étranges, dont je laisse aux psychologues le soin de trouver le mot. Ils sauront peut-être nous apprendre pourquoi des enfants à l’esprit naïf et simple, au cœur pur, savent distinguer avec une sagacité si pénétrante, dans l’histoire que vous leur contez, dans la chanson que vous leur chantez, la différence entre l’art vrai et l’art faux, entre la passion et le jargon emphatique, entre Homère et Racine 2.
Ils nous diront aussi comment ces mêmes cœurs qui n’ont encore ni senti ni battu peuvent renvoyer fidèlement les mélodieux accents de l’émotion naturelle. En dehors de ses études, Viola était une simple et affectueuse enfant, quelque peu capricieuse, non pas de caractère (elle était douce et docile), mais par accès ; comme je l’ai déjà donné à entendre, sa disposition passait de la tristesse à l’enjouement, de la joie à l’abattement, sans aucun motif apparent. S’il existait une cause à ces brusques revirements, il la faut chercher dans ces premières et mystérieuses influences que j’ai signalées en essayant d’expliquer l’effet produit sur son imagination par les flots mobiles et intarissables d’harmonie qui on coulaient et tremblaient sans cesse autour d’elle : car il est à remarquer que, chez les personnes les plus sensibles aux effets de la musique, des airs, des motifs reviennent souvent, au milieu des occupations les plus triviales de la vie, les tourmenter, et en quelque sorte les poursuivre avec acharnement. Une fois admise dans l’âme, la musique participe à sa nature spirituelle et ne meurt jamais. Elle erre confusément à travers les détours et les dédales de la mémoire, et souvent on l’entend encore distincte et vivante, comme au jour où pour la première fois elle fit vibrer les ondes aériennes. Il en était ainsi de Viola : parfois sa fantaisie évoquait malgré elle ces visions d’harmonie évanouie ; elles apparaissaient devant elle, tantôt gaies, et alors elles faisaient rayonner un sourire sur ses traits ; tantôt tristes, et alors elles faisaient planer une ombre sur son front, interrompaient sa joie enfantine, et la forçaient à s’asseoir pensive et solitaire.
C’est donc avec raison que nous pouvons dire, dans un sens figuré, que cette belle créature, si aérienne dans son apparence, si harmonieuse dans sa beauté, si elle-même dans ses allures et dans ses pensées, pouvait s’appeler la fille non du musicien, mais de la musique. À la voir, on s’imaginait volontiers que la destinée qui l’attendait appartenait moins à la vie réelle qu’à cet élément romanesque qui, pour des yeux qui savent voir et des cœurs qui savent sentir, coule pour ainsi dire parallèlement à la vie réelle, flot à flot, jusqu’à ce que tous deux se perdent dans le sombre Océan.
Aussi n’y avait-il rien d’étrange à ce que Viola elle-même, dès son enfance, et plus encore à mesure qu’elle atteignait en s’épanouissant la sérieuse et virginale fraîcheur de la jeunesse, se crût destinée à un avenir de bonheur ou de misère, mais qui dans l’un ou l’autre cas devait être à l’unisson avec l’atmosphère romanesque et idéale qu’elle respirait. Souvent elle se glissait à travers les buissons qui tapissaient la grotte voisine de Pausilippe, ouvrage gigantesque des vieux Cimmériens, et là, assise auprès du tombeau sacré de Virgile, elle s’abandonnait à ces visions dont nulle poésie ne saurait définir et fixer le vague insaisissable : car le poète qui éclipse tous ceux qui aient jamais chanté, c’est un jeune cœur qui rêve. Souvent aussi, à cette place, près du seuil ombragé par un feston de pampre, en face de cette mer d’un bleu si profond et si immobile, elle venait s’asseoir au milieu d’un jour d’automne, ou par une belle soirée d’été, et là elle bâtissait ses châteaux aériens. Qui de nous n’en fait autant, non pas seulement dans la jeunesse, mais avec l’espérance à demi effacée et obscurcie de l’âge avancé ? Rêver, c’est le privilège de l’homme, la royauté commune au roi et au paysan. Mais ces rêves de Viola en plein jour étaient plus habituels, plus nets, plus solennels que ceux auxquels la plupart de nous s’abandonnent. Ils ressemblaient aux orama des Grecs : prophéties et visions tout ensemble.
1Orphée était le héros favori de l’opéra naissant. L’Orfeo d’Ange Politien fut exécuté en 1475. L’Orfeo de Monteverde fat joué à Venise en 1667.
2Nous désirons laisser à l’auteur seul tout le mérite et toute la responsabilité de ses appréciations littéraires. (Note du traducteur.)
2
C’était de l’étonnement, c’était du désir, c’était du bonheur.
Gerus. lib., canto II, 21
Enfin l’éducation est achevée. Viola a bientôt seize ans. Le cardinal déclare arrivé le temps où le nom nouveau doit être inscrit dans le Libro d’Oro, sur ces pages brillantes réservées aux enfants de l’art et de l’harmonie. Oui, mais dans quel rôle ? quel est le maestro dont le génie doit recevoir d’elle une forme vivante, une incarnation sensible ? C’est là le secret. Le bruit court que l’inépuisable Paisiello, ravi de la manière dont elle a rendu son Nel cor più non me sento et son Io son Lindoro, va écrire quelque nouveau chef-d’œuvre pour les débuts de Viola. D’autres prétendent que c’est dans le comique qu’elle excelle, et que Cimarosa travaille sans relâche à un second Matrimonio segreto. En attendant, il y a quelque part dans les négociations un temps d’arrêt. On remarque que le cardinal est d’assez mauvaise humeur. Il a dit publiquement, et ces paroles ne font augurer rien de bon : Cette petite sotte est aussi folle que son père ; ce qu’elle demande est insensé. » Les conférences se succèdent rapidement. Le cardinal a, dans son cabinet, des entretiens forts solennels avec la pauvre enfant. Tout est Inutile. Naples, surexcitée par la curiosité, se perd en conjectures. Les remontrances aboutissent à une querelle, et Viola retourne au logis maussade et boudeuses elle ne veut pas jouer, elle a résilié son engagement.
Pisani, trop inexpérimenté pour connaître tous les périls de la vie de théâtre, avait accueilli avec plaisir l’espérance que quelqu’un au moins de son nom ajouterait de la gloire à son art. L’obstination de sa fille lui déplut. Il ne dit rien cependant (il ne grondait jamais en paroles), mais il saisit le fidèle Barbiton. O fidèle Barbiton, tu grondas, toi, et effroyablement ! Il grinça, il gloussa, il gémit, il grogna. Et les yeux de Viola se remplirent de larmes, car elle comprenait ce langage. Elle s’approcha furtivement de sa mère et lui parla bas ; et, quand Pisani suspendit son occupation, il les vit toutes deux, la mère et la fille, en larmes. Il les regarda ébahi ; puis, comme il sentait qu’il avait été bourru, il courut retrouver son Inséparable. Et maintenant, vous eussiez cru entendre le chant d’une fée qui cherche à bercer et à apaiser l’humeur capricieuse de quelque enfant d’adoption. Limpides, voilées, argentines, les notes ruisselaient avec un doux murmure sous l’archet magique. La douleur la plus obstinée se fût arrêtée pour écouter ; et par intervalles, à travers la douce et plaintive mélodie, s’échappait tout à coup une note bizarre, enjouée, sonore, comme un éclat de rire ; mais non pas un rire humain. C’était un des motifs les mieux réussis de son opéra bien-aimé : la Sirène endormant par ses chants les vents et les flots. Nul ne sait ce qui aurait suivi, mais son bras fut arrêté. Viola s’était jetée sur son cœur, et l’avait embrassé avec des yeux qui lançaient à travers ses cheveux dorés un regard tout souriant de bonheur. Au même moment la porte s’ouvrit : un message du cardinal. Il mandait Viola sur-le-champ. Sa mère l’accompagna au palais de Son Éminence. La réconciliation fut complète : tout s’aplanit. Viola eut carte blanche, et choisit son opéra. Froides et barbares nations du Nord, avec vos discussions et vos débats, vos existences tumultueuses du Pnyx et de l’Agora ! ne cherchez pas à concevoir l’agitation occasionnée dans Naples la musicale, en apprenant qu’elle allait jouir d’un nouvel opéra et d’une cantatrice nouvelle. Mais de qui cet opéra ? Jamais intrigue de cabinet ne fut aussi secrète. Pisani revint un soir du théâtre dans un état évident de trouble et d’irritation. Malheur aux oreilles qui, ce soir-là, auraient entendu le Barbiton ! On l’avait suspendu de ses fonctions, on avait craint que le nouvel opéra et le premier début de sa fille comme prima donna ne fussent une trop grande épreuve pour ses nerfs. Et ses variations improvisées, toute sa diablerie de sirènes et de harpies au milieu d’une telle solennité, c’était là une perspective trop effrayante pour qu’on en courût les chances. Se voir écarté, et cela, le soir même où devait chanter sa fille, dont la mélodie n’était qu’une émanation de la sienne ; écarté pour quelque rival nouveau : c’en était trop pour la chair et le sang d’un musicien. Pour la première fois il discuta la question avec des paroles, et demanda gravement (le Barbiton avec toute son éloquence n’aurait pu traduire distinctement la demande) quel devait être l’opéra, quel était le rôle. Et Viola tout aussi gravement répondit qu’elle avait promis le secret au cardinal. Pisani n’insista pas ; il disparut avec le violon, et bientôt, des combles de la maison (où dans ses grandes colères l’artiste se réfugiait parfois), on entendit l’Inséparable gémissant et soupirant comme si son cœur était brisé.
L’affection de Pisani se trahissait peu à la surface. Il n’était pas de ces pères tendres et caressants qui aiment à avoir sans cesse leurs enfants jouant autour de leurs genoux : son esprit et son âme étaient si complètement absorbés dans son art, que la vie domestique coulait auprès de lui comme si elle eût été un rêve, et comme si le cœur seul eût été la forme substantielle et la réalité matérielle de l’existence. Il en est souvent ainsi chez les personnes qui poursuivent quelque étude abstraite. Cette disposition est proverbiale chez les mathématiciens.
« Monsieur ! la maison brûle ! s’écria tout effarée la servante au savant français.
– Allez le dire à ma femme, sotte que vous êtes ; est-ce que je me mêle jamais du ménage ? »
Et il continua son problème.
Mais qu’est-ce qu’un problème ? que sont les mathématiques auprès de la musique ? de la musique qui compose des opéras, et de plus joue du barbiton ? Savez-vous ce que répondit l’illustre Giardini au novice qui lui demandait combien il lui faudrait de temps pour apprendre à jouer du violon ? Écoutez et désespérez, vous tous qui voudriez tendre cet arc auprès duquel celui d’Ulysse n’est qu’un jouet d’enfant. « Douze heures par jour pendant vingt années consécutives. » Comment voulez-vous qu’un homme qui joue du barbiton soit toujours à batifoler avec ses enfants ? Non, Pisani ! plus d’une fois, avec toute la vive susceptibilité de l’enfance, la pauvre Viola s’est échappée de la chambre pour pleurer en pensant que tu ne l’aimais pas. Et pourtant, sous cette abstraction extérieure de l’artiste n’en coulait pas moins la tendresse naturelle du père ; et, en grandissant, la rêveuse avait compris le rêveur. Et maintenant, exclu lui-même de toute renommée, se voir privé de saluer la renommée de sa fille ! voir cette fille elle-même conjurée contre lui ! Une telle ingratitude était plus aiguë que la dent du serpent, et plus aigus que la dent du serpent fut la plainte déchirante du sympathique barbiton.
L’heure solennelle est venue. Viola est partie pour le théâtre sa mère avec elle. Le musicien, indigné, s’est enfermé chez lui. Gionetta se précipite dans sa chambre. Le carrosse de Son Éminence est à la porte ; il fait demander le padrone. Il faut qu’il quitte son violon, qu’il mette son habit de brocart et ses manchettes de dentelle. Les voici ! vite, vite ! Et rapidement roule le carrosse doré, et majestueusement trône le cocher, et pompeusement caracole le noble attelage. Le pauvre Pisani, mal à l’aise, se perd dans un tourbillon d’étonnements. Il arrive au théâtre, il descend à la grande entrée, il tourne sur lui-même, il regarde derrière lui, autour de lui : partout quelque chose lui manque. Le violon ! où est-il ? Hélas ! son âme, sa voix, son moi, le Pisani de Pisani est resté à la maison. Ce n’est qu’un automate que les laquais entraînent par les escaliers, par les couloirs, dans la loge du cardinal. Mais alors, quels sons le viennent frapper ? Est-ce un rêve. Le premier acte est terminé (on ne l’a envoyé chercher que lorsque le succès ne paraissait plus douteux) ; le premier acte a tout décidé. Il le sent bien, en vertu de cette sympathie électrique qui s’établit tout d’abord entre chaque âme individuelle et tout un vaste auditoire. Il le sent à l’immobilité de la foule en suspens ; il le sent même au doigt levé du cardinal. Il voit sa Viola sur la scène, rayonnante de pierreries et d’étoffes brillantes ; il entend sa voix vibrant à travers mille cœurs émus qui ne font qu’un cœur. Mais la scène, le rôle, la musique, c’est son autre enfant, son enfant immortelle, la fille incorporelle de son âme, celle qu’il a créée, élevée, chérie pendant tant d’années d’obscurité patiente et de génie douloureusement méconnu, son chef-d’œuvre, sa Sirène. C’était donc là ce mystère qui l’avait tant irrité ; c’était là la cause de la querelle avec le cardinal, le secret à révéler seulement quand le succès serait assuré ; et la fille avait uni son triomphe le triomphe de son père.
Et la voilà debout, devant toutes ces âmes inclinées qu’elle domine, plus belle que la sirène même qu’il avait évoquée du fond des abîmes de l’harmonie. Longue et douce récompense du travail ! Où donc trouver sur la terre une extase égale à celle que connaît le génie, lorsque, de ses profondeurs obscures, il s’élance à la fin en pleine lumière, en pleine gloire !
Pas une parole, pas un geste ne lui échappa. Rivé sur place, hors d’haleine, il était là immobile, le visage baigné de larmes seulement, par instants, sa main errait çà et là ; elle cherchait machinalement le fidèle instrument. Pourquoi n’était-il pas là pour participer à son triomphe ?
Enfin le rideau tomba, et sa chute déchaîna une tempête d’applaudissements. Debout, comme un seul homme, se leva l’auditoire ; d’une seule voix il acclama ce nom bien-aimé. Elle s’avança tremblante, pâle, et dans toute la foule ne vit que le visage de son père. L’assemblée suivit ce regard plein de larmes, et, dans un frisson d’émotion, saisit et ressentit l’élan de l’enfant. Le bon cardinal le fit doucement avancer. Artiste aux accords fantastiques ! ta fille t’a rendu plus que la vie que tu lui donnas ! « Mon pauvre violon, dit-il en essuyant ses yeux, ils ne te siffleront plus désormais ! »
3
De ces mélangea contraires de glace et de feu, de rires et de pleurs, d’espérances et de crainte, l’enchanteresse...
Gerus. lib., canto IV, 94
Or, malgré le triomphe et de la cantatrice et de l’opéra, il y avait eu dans le premier acte, et par conséquent avant l’arrivée de Pisani, un moment où les chances de succès avaient paru plus que douteuses. C’était dans ce chœur tout rempli des excentricités particulières à l’auteur. Lorsque ce tourbillon de la fantaisie tournoya et écuma, froissant et meurtrissant l’oreille et le goût par les sons les plus incohérents, l’auditoire tout à coup reconnut la main de Pisani. On avait donné à l’opéra un titre qui jusqu’alors avait écarté tout soupçon sur la paternité de l’ouvrage. L’ouverture et l’introduction, d’un style correct et harmonieux, avaient égaré le public au point de lui faire croire qu’il reconnaissait le génie de son cher Paisiello. Habitué depuis longtemps à ridiculiser et presque à mépriser les prétentions de Pisani comme compositeur, il s’apercevait qu’on lui avait subrepticement dérobé les applaudissements dont il avait salué l’ouverture et les premières scènes. Un murmure de mauvais présage circulait dans la salle. Les acteurs, l’orchestre, si prompts à ressentir l’impression électrique de l’auditoire, devinrent agités, intimidés, et n’eurent pas, au moment critique, cette énergie et cette précision qui seules pouvaient sauver la bizarrerie de la musique.
Dans tout théâtre, les rivaux ne manquent jamais à l’auteur et à l’acteur nouveaux ; ennemis impuissants tant que tout va bien, mais embuscade dangereuse du moment que le moindre accident vient entraver la marche du succès. Un sifflet se fit entendre, isolé il est vrai ; mais l’absence significative de toute manifestation contraire sembla annoncer que l’instant approchait où la censure allait devenir contagieuse. C’était comme le souffle qui ébranle l’avalanche indécise. À cet instant critique, Viola, la reine des sirènes, sortit pour la première fois de sa grotte marine. Au moment où elle aborda la rampe, la nouveauté de sa situation, l’indifférence glaciale du public, que ne dissipa même pas d’abord l’apparition d’une beauté si singulière ; les murmures peu charitables des autres acteurs, l’éclat éblouissant des lumières, et, mille fois plus que tout le reste, ce sifilet récent qui avait pénétré jusqu’à sa retraite, tout cela paralysa ses moyens et étouffa sa voix ; et, au lieu de la grande invocation où elle devait subitement se révéler par une entrée saisissante, la royale sirène, redevenue une enfant tremblante, demeura pâle et muette devant ces milliers d’yeux dont le regard froid et sévère était braqué sur elle.
À ce moment même, quand déjà la conscience de ses facultés semblait sur le point de lui faire défaut, et que d’un regard timide elle implorait la multitude immobile, elle aperçut, dans une loge près de la scène, un visage qui, du même coup et comme par enchantement, produisit sur son âme un effet impossible également à analyser et à oublier. Ce visage éveillait une vague réminiscence qui la poursuivait sans cesse, comme si elle l’eût déjà aperçu dans un de ces rêves éveillés dont, depuis son enfance, elle avait aimé à se laisser bercer. Elle ne pouvait détacher les yeux de ces traits, et, à mesure qu’elle les contemplait, la crainte glaciale qui l’avait d’abord saisie se dissipa comme un brouillard devant le soleil.
Dans le profond éclat de ces yeux qui rencontraient les siens, il y avait en effet tant de bienveillants encouragements, tant d’admiration douce et compatissante, tant de choses qui conseillaient, qui animaient, qui fortifiaient ; que tout homme, acteur ou orateur, qui a jamais ressenti, en présence d’une foule assemblée, l’effet d’un seul regard attentif et sympathique, comprendra aisément l’influence soudaine et inspiratrice qu’exercèrent sur la débutante l’œil et le sourire de l’étranger.
Elle regardait encore, et son cœur déjà se réchauffait, quand l’étranger se leva à demi, comme pour rappeler le public au sentiment de la courtoisie qu’il devait à une artiste si belle et si jeune ; et, sitôt que sa voix eut donné le signal, la salle entière y répondit par une explosion généreuse de bravos : car l’étranger lui-même était un personnage fort remarqué, et sa récente arrivée à Naples occupait, de moitié avec l’opéra nouveau, toutes les langues de la ville ; puis, quand les applaudissements eurent cessé, claire, pleine et dégagée de toute entrave, comme un esprit affranchi de son argile mortelle, la voix de la sirène déborda en torrents de ravissante harmonie, Dès cet instant la foule, les hasards du succès, le monde entier, Viola oublia tout, tout, excepté ce monde fantastique dont elle était la reine. La présence de l’étranger semblait compléter cette illusion qui dérobe à l’artiste toute réalité en dehors du cercle de son art. Elle sentit comme si ce front calme et grave, ces yeux brillants, lui inspiraient une puissance jusqu’alors inconnue ; et, tout en cherchant un langage pour traduire l’étrange impression produite par sa présence, elle emprunta à cette présence même le secret de ses chants les plus mélodieux.
Ce n’est que lorsque tout fut fini, quand elle aperçut son père et qu’elle comprit sa joie, que l’étrange enchantement fit place au charme plus doux du foyer et de l’amour filial. Et comme, avant de quitter la scène, son regard se reporta involontairement vers la loge, le sourire de l’étranger, calme et presque mélancolique, pénétra profondément dans son cœur pour y vivre, pour y être évoqué avec des souvenirs confus, mélangés à la fois de joie et de douleur.
Passons sur les félicitations du cardinal-virtuose, fort ébahi de découvrir que lui, et tout Naples avec lui, s’étaient jusqu’alors trompés dans une question de goût ; plus étonné encore de s’entendre, et tout Naples avec lui, avouer leur erreur. Passons sur les témoignages hyperboliques d’enthousiasme qui vinrent assiéger les oreilles de la cantatrice, lorsque, reprenant son voile modeste et sa robe de jeune fille, elle échappa à la foule des admirateurs qui obstruaient toutes les issues. Passons sur le doux embrassement du père et de l’enfant traversant de nouveau les rues étoilées et la Chiaja déserte dans le carrosse du cardinal. Ne nous arrêtons pas à rappeler les larmes et les exclamations de la bonne et simple mère... Les voici revenus ; voici la chambre bien connue, venimum ad larem nostrum1. Voyez la vieille Gionetta se trémoussant pour préparer le souper, et écoutez Pisani qui éveille le Barbiton assoupi dans son étui, pour communiquer le grand événement à l’Inséparable intelligent.
Écoutez ce rire de la mère, rire anglais, voilé et plein d’enjouement, Eh bien ! Viola, bizarre enfant, pourquoi demeurer ainsi à l’écart, le front appuyé sur tes belles mains, les yeux perdus dans l’espace ? Allons, éveille-toi ! Il faut qu’un radieux sourire éclaire cette nuit la maison tout entière 2.
Quelle heureuse réunion autour de cette humble table ! C’était un festin à faire envie à Lucullus dans sa salle d’Apollon, que ces raisins secs, ces appétissantes sardines, et cette riche polenta, et ce vieux flacon de lacrima-Christi, présent du bon cardinal. Le Barbiton, installé sur un fauteuil à dossier droit et élevé, auprès du musicien, semblait participer au joyeux banquet. Son honnête figure bien vernie reluisait à la clarté de la lampe ; et il y avait jusque dans son silence une gravité modeste de farfadet mystérieux, chaque fois que son maître, entre deux bouchées, se tournait vers lui pour compléter son compte rendu de la soirée par quelque détail oublié. La femme de Pisani contemplait affectueusement cette scène ; le bonheur lui avait ôté tout appétit ; tout à coup elle se leva, et plaça sur le front de l’artiste une guirlande de lauriers qu’elle avait tressée d’avance dans l’anticipation toute maternelle du succès, et Viola, placée de l’autre côté de son frère le Barbiton, ajusta doucement la couronne sur les cheveux de son père, en lui disant d’un ton caressant : « N’est-ce pas, caro padre, que vous ne le laisserez plus me gronder ? »
Alors le pauvre Pisani, le cœur doucement tiraillé par sa double tendresse, animé à la fois par le lacrima et par le succès, se tourna vers le plus jeune de ses enfants (ce n’était pas le Barbiton) avec un orgueil naïf et grotesque : « Je ne sais lequel des deux je dois le plus remercier ; tant vous me donnez de joie. Ma fille, je suis si fier de toi et de moi-même ! Mais lui et moi, pauvre ami ! nous avons été si souvent malheureux ensemble ! »
Le sommeil de Viola fut troublé, c’était naturel. L’ivresse de la vanité et du triomphe, le bonheur du bonheur qu’elle avait causé, tout cela valait mieux que le sommeil. Et pourtant sa pensée bien des fois s’arrachait à toutes ces impressions pour voler vers ce regard, vers ce sourire toujours présents, et aux quels devait à jamais s’associer le souvenir de ce triomphe et de ce bonheur. Ses impressions, comme son caractère, étaient étranges et toutes particulières. Ce n’était pas ce qu’éprouve une jeune fille dont le cœur, percé pour la première fois par un regard, soupire le langage naturel et inné du premier amour. Ce n’était pas précisément de l’admiration, quoique le visage qui se reflétait dans chaque flot de son inépuisable et mobile fantaisie fût d’une beauté rare et majestueuse. Ce n’était pas non plus un simple souvenir plein de charme et de tendresse laissé par la vue de l’inconnu ; c’était un sentiment humain de reconnaissance et de bonheur, mêlé à je ne sais quel élément mystérieux de crainte et de vénération. Certainement elle avait déjà vu ces traits ; mais quand et comment ? Alors seulement que sa pensée avait cherché à esquisser sa destinée future, et que, malgré tous ses efforts pour inonder cette vision de fleurs et de rayons, un pressentiment sombre et glacial l’avait fait reculer malgré elle dans les plus intimes replis de son âme. Elle avait enfin trouvé ce quelque chose si longtemps recherché par mille aspirations inquiètes, mille vagues désirs moins du cœur que de la pensée ; non pas comme la jeunesse qui découvre l’être qu’elle doit aimer, mais plutôt comme le savant qui, après de longues et infructueuses tentatives pour saisir le mot de quelque secret de la science, voit enfin la vérité briller de loin à ses yeux d’une lueur obscure et vacillante encore, et tour à tour l’attirer, disparaître, l’inviter de nouveau, et de nouveau s’évanouir. Elle tomba enfin dans un pénible sommeil peuplé d’images incohérentes, indécises, informes. Elle s’éveilla au moment où le soleil, derrière une nuée brumeuse, laissait tomber à travers la fenêtre un rayon pâle et maladif ; déjà son père avait repris son unique occupation, et elle l’entendit tirer de son Inséparable un accord grave et étouffé, comme un chant lugubre de mort.
« Et pourquoi, demanda-t-elle, quand elle l’eut rejoint dans sa chambre, pourquoi, père, votre inspiration était-elle si triste après la joie d’hier ?
– Je ne sais enfant : je voulais être joyeux, et composer un air en ton honneur ; mais le drôle que voilà est si obstiné, qu’il m’en a fallu passer par où il a voulu. »
1Nous rentrons au foyer.
2Ridete quidquid est domi cachinnorum. Catull., ad Sirm. Penin.
4
Excitait ainsi ses désirs lents et timides.
Gerus. lib., canto IV, 88
Pisani avait l’habitude, excepté lorsque les devoirs de sa profession réclamaient son temps d’une manière spéciale, de consacrer au sommeil une partie de la journée, habitude moins de luxe que de nécessité pour un homme qui dormait peu pendant la nuit. À dire vrai, qu’il se fût agi de composer ou d’étudier, les heures du milieu de la journée étaient précisément celles pendant lesquelles Pisani n’aurait pu travailler, même s’il l’eût voulu. Son génie ressemblait à ces fontaines toujours pleines au lever et au déclin du jour, qui débordent la nuit, et sont à midi parfaitement taries. Pendant ces heures consacrées par son mari au sommeil, la signora s’échappait ordinairement pour aller faire les emplettes nécessaires au petit ménage, ou pour jouir (quelle est la femme qui n’aime cette distraction ?) de la causerie de quelque voisine. Et que de félicitations n’avait-elle pas à recueillir le lendemain de ce brillant triomphe ?
C’était l’heure où Viola allait volontiers s’asseoir au dehors, sous une tenture qui ombrageait le seuil de la porte sans obstruer la rue, et c’est là que vous pouvez la voir maintenant, soutenant sur ses genoux une partition que son regard distrait parcourt de temps à autre ; derrière elle, et au-dessus de sa tête, une vigne suspend les festons capricieux de son riche feuillage, et devant elle, à l’horizon, se déroule la mer, avec quelque blanche voile immobile qui semble assoupie sur les flots.
Pendant qu’elle était assise ainsi, plongée dans sa rêverie plutôt que dans ses pensées, un homme venant du côté de Pausilippe, à pas lents et le regard baissé, passa tout près de la maison. Viola leva subitement les yeux, et tressaillit d’une sorte de terreur en reconnaissant l’étranger. Elle laissa échapper une exclamation involontaire ; le cavalier se retourna, l’aperçut et s’arrêta.
Pendant quelques instants il demeura debout entre elle et la nappe éblouissante des eaux du golfe, contemplant le front timide et l’aspect frêle et délicat de la jeune fille qu’il avait devant lui, dans un silence plein de sérieuse réserve qui n’avait rien de la hardiesse outrecuidante d’un admirateur présomptueux. Enfin, il parla.
« Êtes-vous heureuse, mon enfant, dit-il d’une voix presque paternelle, de la carrière qui s’ouvre devant vous ? Entre seize ans et trente, il y a dans les applaudissements une musique plus douce que toute celle que peut faire entendre votre voix.
— Je ne sais, balbutia d’abord timidement Viola. » Mais il y avait tant de douceur et de limpidité dans la voix qui lui parlait qu’elle reprit avec plus de courage : « Je ne sais si je suis heureuse à présent : je l’étais hier. Et je sens aussi, Excellence, que je vous dois des remerciements, dont vous ignorez sans doute le motif.
— Vous vous trompez, dit le cavalier en souriant. Je sais que j’ai contribué à votre succès bien mérité, mais c’est vous qui savez à peine comment. Le pourquoi, le voici : parce que j’ai vu dans votre cœur une ambition plus noble que celle de la vanité féminine ; c’est à la fille que je me suis intéressé. Vous eussiez peut-être mieux aimé que j’eusse tout simplement admiré l’artiste.
— Non, oh ! non.
— C’est bien, je vous crois. Et maintenant, puisque nous nous rencontrons, je vais m’arrêter pour vous donner un conseil. À votre première apparition au théâtre, vous aurez à vos pieds toute la folle jeunesse de Naples. Pauvre enfant ! la flamme qui éblouit l’œil peut aussi brûler les ailes. Souviens-toi que le seul hommage qui ne souille pas, c’est celui que ne peut offrir la foule banale des adorateurs. Quels que soient les rêves de l’avenir, et, tout en te parlant, j’en mesure le vague et capricieux essor, puissent ceux-là seuls se réaliser qui ont pour centre et pour but le foyer de la famille ! »
Il s’arrêta ; le cœur de Viola battit avec force. Puis, comprenant à peine, tout Italienne qu’elle était, la grave portée de ses conseils, elle s’écria avec une explosion d’émotions naturelles et innocentes :
« Ah ! Excellence, vous ne pouvez savoir combien m’est déjà cher ce foyer domestique. Et mon père !... Sans lui, signor, ce foyer n’existerait plus. »
Un sombre nuage se répandit sur le visage du cavalier. Il contempla la paisible maison presque ensevelie sous le feuillage de la vigne, puis ramena son regard sur les traits vifs et animés de l’artiste.
« C’est bien, dit-il. Un cœur simple est souvent à lui-même son meilleur guide. Courage donc, et soyez heureuse. Adieu, belle cantatrice.
— Adieu, Excellence... Mais... « Quelque chose d’irrésistible, une sensation inquiète et accablante de crainte et d’espérance lui arracha cette question : « Je vous reverrai à San-Carlo, n’est-ce pas ?
— Pas du moins d’ici à quelque temps. Je quitte Naples aujourd’hui.
— En vérité !...»
Et Viola sentit son cœur s’affaisser en elle ; la poésie du théâtre s’était évanouie.
— Et, dit le cavalier en se retournant et en posant doucement sa main sur celle de Viola, peut-être, avant que nous nous retrouvions, aurez-vous eu à souffrir, à connaître les premières et poignantes douleurs de la vie, à apprendre combien ce que donne la gloire est impuissant à compenser ce que perd le cœur. Mais soyez ferme et ne cédez point, pas même à ce qui peut sembler la piété de la douleur. Regardez dans le jardin du voisin, cet arbre... Voyez comme il a grandi, tordu et contrefait. Quelque vent égara le germe dont il naquit dans les fentes du rocher ; étouffée, murée par les pierres et les bâtiments, par la nature et par l’homme, sa vie n’a été qu’une lutte perpétuelle pour voir la lumière ; la lumière, principe essentiel de cette vie. Voyez comme il s’est tortillé et crispé ; comment, rencontrant l’obstacle sur un point, il a travaillé et combattu, tronc et branches, pour arriver enfin à la clarté des cieux... Comment s’est-il conservé à travers tous ces hasards défavorables de sa naissance et des circonstances ? Pourquoi son feuillage est-il vert et frais comme celui de cette vigne qui peut ouvrir largement tous ses bras au soleil ? Mon enfant, c’est grâce à l’instinct même qui le poussa à lutter ; grâce à ce combat pour la lumière, achevé par la conquête de la lumière. Ainsi, d’un cœur ferme et intrépide, à travers tous les coups de la douleur et du destin, se tourner vers le soleil, tendre au ciel par mille efforts, voilà ce qui donne la science aux forts, aux faibles le bonheur. Avant que nous nous rencontrions encore, plus d’une fois votre regard triste et accablé se portera vers ces paisibles rameaux ; et, lorsque vous en entendrez jaillir les chants des oiseaux, quand vous verrez le rayon, repoussé du toit et du rocher, venir jouer avec le feuillage, apprenez alors la leçon que vous enseigne la nature, et à travers les ténèbres frayez-vous un chemin à la lumière. »
Tout en parlant, il s’était lentement éloigné, et Viola était demeurée seule, étonnée, muette, attristée de cette obscure prédiction du malheur à venir ; et pourtant, malgré sa tristesse, charmée. Involontairement elle le suivit des yeux ; volontairement elle étendit les bras comme pour le rappeler. Elle eût donné des mondes pour le voir se retourner, pour entendre une fois encore cette voix calme, voilée, argentine, pour sentir encore cette main effleurer la sienne. Un rayon de lune adoucit et embellit tous les angles obscurs sur lesquels il tombe telle avait été la présence de l’étranger. Le rayon s’évanouit, et tout reprend son aspect vulgaire et ténébreux : ainsi il avait disparu, et le tableau du monde extérieur était redevenu banal. L’inconnu poursuivit son chemin par cette longue et délicieuse route qui aboutit au palais en face des jardins publics, et conduit aux quartiers les plus fréquentés de la ville.
Un groupe de jeunes étourdis stationnait à l’entrée d’une maison ouverte au passe-temps favori de l’époque, et fréquentée par les joueurs les plus riches et les mieux nés. Tous lui firent place quand il passa devant eux en s’inclinant.
Per fide ! dit l’un, n’est-ce pas là le riche Zanoni dont on parle tant ?
— Oui. On dit que sa fortune est incalculable.
— On ! qui on ? sur quels fondements ? Il n’est à Naples que depuis peu de jours, et jusqu’à présent je n’ai pu trouver personne qui puisse me renseigner sur son pays, sa famille, ou, ce qui est plus important, sa fortune.
— C’est vrai ; mais il est arrivé sur un bon navire qui est à lui. Voyez ; mais vous ne pouvez l’apercevoir à cette heure ; il est mouillé là-bas dans le golfe. Ses banquiers parlent avec vénération des sommes qu’il place entre leurs mains.
— D’où vient-il ?
— De je ne sais quel port de l’Orient. Mon valet a su par les matelots du môle qu’il avait longtemps habité l’intérieur de l’Inde
— Et je me suis laissé dire que dans l’Inde on ramasse l’or comme des cailloux, et qu’il y a des vallées où les oiseaux bâtissent leurs nids avec des émeraudes pour attirer les papillons. Voici venir le prince des joueurs Cetoxa. Parions qu’il a déjà fait la connaissance d’un si riche cavalier. Il a pour l’or l’affinité de l’aimant pour le fer. Eh bien ! Cetoxa, quelles sont les plus récentes nouvelles des ducats du signor Zanoni ?
— Oh ! dit négligemment Cetoxa, mon ami...
— Ah ! ah ! vous l’entendez ; son ami.
— Oui, mon ami Zanoni va passer quelque temps à Rome ; il m’a promis à son retour de prendre jour pour souper avec moi, et alors je le présenterai à vous et à la meilleure société de Naples. Diavolo ! savez-vous que c’est un seigneur des plus spirituels et des plus agréables ?
— Contez-nous donc, comment vous vous êtes si vite lié avec lui.
— Mon cher Belgioso, rien de plus simple. Il voulait une loge à San-Carlo. Inutile de vous dire que l’attente d’un opéra nouveau (quelle œuvre splendide ! ce pauvre diable de Pisani, qui l’aurait jamais pensé ?) et d’une actrice nouvelle (quelle beauté ! quelle voix ! ah !) avait fait retenir tous les coins de la salle. Je sus le désir qu’avait Zanoni de faire honneur au talent napolitain, et, avec cette courtoisie envers les étrangers de distinction qui me caractérise, je mis ma loge à sa disposition. Il l’accepte, je me présente à lui entre deux actes : il est charmant, m’invite à souper. Cospetto ! quel train de maison ! Nous veillons plus tard, je lui dis toutes les nouvelles de Naples, nous devenons deux amis de cœur, il me force avant de partir d’accepter ce diamant, une misère, dit-il ; les joailliers l’estiment cinq mille pistoles ! La plus délicieuse soirée que j’aie passée depuis dix ans. »
Les cavaliers firent cercle pour admirer le diamant.
« Seigneur comte Cetoxa, dit un personnage grave et sombre, qui s’était signé à plusieurs reprises pendant le récit du Napolitain, ne connaissez-vous pas les mystérieuses rumeurs qui circulent sur cet étranger, et pouvez-vous sans crainte recevoir de lui un présent qui peut entraîner les conséquences les plus fatales ? Ne savez-vous pas, qu’on dit qu’il est magicien, qu’il a le mauvais œil, que...
— De grâce, épargnez-nous vos superstitions surannées, répondit dédaigneusement Cetoxa. Elles sont passées de mode : on ne veut entendre parler aujourd’hui que de scepticisme et de philosophie. Et après tout, ces rumeurs, bien considérées, à quoi se réduisent-elles ! En voici toute l’origine. Un vieil imbécile de quatre-vingt-six ans, un pur radoteur, affirme solennellement avoir vu ce même Zanoni, il y a soixante-dix ans, alors que lui-même, le vénérable témoin, n’était encore qu’un enfant, à Milan. Et ce Zanoni, comme vous voyez, est au moins aussi jeune que vous ou moi, Belgioso.
— Mais, reprit le gentilhomme grave, c’est là qu’est le mystère. Le vieil Avelli déclare que Zanoni ne paraît pas d’un jour plus âgé que lorsqu’il le vit à Milan. Il ajoute que même à Milan, notez bien ceci, où, sous un autre nom, Zanoni apparut avec la même splendeur, le même mystère l’entourait déjà, et que là un vieillard se rappela l’avoir vu, soixante ans auparavant, en Suède.
— Bah ! répliqua Cetoxa ; on en a dit autant du charlatan Cagliostro ; de pures fables. J’y croirai quand je verrai ce diamant changé en une botte de foin. Au reste, ajouta-t-il gravement, je considère cet illustre seigneur comme mon ami, et le moindre mot murmuré contre son honneur ou sa réputation, je le regarderai à l’avenir comme une injure personnelle. »
Cetoxa était une lame redoutée, et possédait une feinte des plus dangereuses, qu’il avait lui-même ajoutée aux variations de la stoccata. Le gentilhomme grave, malgré tout l’intérêt qu’il portait au bien-être spirituel du comte, avait pour son propre salut corporel une sollicitude non moins profonde ; il se contenta de lui jeter un regard de commisération, traversa la porte, et monta à la salle de jeu.
« Ha ! ha ! dit Cetoxa en riant, ce bon Loredano est jaloux de mon diamant. Messieurs vous soupez avec moi ce soir. Je vous jure que jamais je n’ai rencontré compagnon plus charmant, plus sociable, ni plus amusant, que mon cher ami le signor Zanoni. »
5
L’hippogriffe, oiseau étrange et gigantesque, l’emporte au loin.
Orl. Fur., canto. VI, 18.
Et maintenant, en compagnie de ce mystérieux Zanoni je dis adieu à Naples pour quelque temps. Montez derrière moi, lecteur, montez mon hippogriffe, installez-vous à votre aise. J’ai acheté la selle, l’autre jour, d’un poète qui aime le confort, et l’ai fait rembourrer à neuf à votre intention. Voyez, voyez, nous montons. Regardez au-dessous de vous, pendant que nous poursuivons notre essor ; ne craignez rien, les hippogriffes ne buttent jamais ; tous les hippogriffes de l’Italie sont garantis comme des montures faites pour les personnes d’un âge respectable. Laissez tomber vos regards sur les paysages qui fuient au-dessous de nous !
Là, près des ruines de l’antique Atella des Osques, s’élève Aversa, jadis forteresse normande ; ici rayonnent les colonnes de Capoue, au-dessus des eaux du Vulturne. Salut, fertiles campagnes, et vous, fameux vignobles du vieux Falerne ! Salut, bosquets dorés d’orangers de Mola di Gaeta ! Salut, arbustes parfumés, fleurs sauvages, omnis copia narium